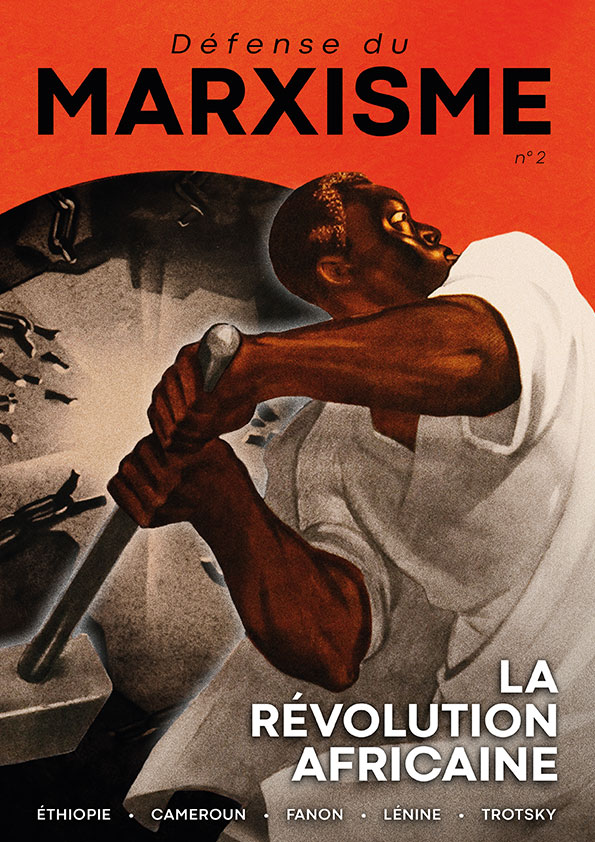Lors de l’élection présidentielle d’avril 2017, les militants de Révolution – section française de la Tendance Marxiste Internationale – ont soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Cinq ans plus tard, nous renouvelons ce soutien.
Le candidat de la France insoumise (FI) représente la seule possibilité concrète de battre la droite (y compris Macron) et l’extrême droite. Par ailleurs, le programme officiel de la FI, L’Avenir en commun, est plus radical – plus à gauche – que les programmes des Verts et du PS (Taubira comprise). Ces derniers promettent le « changement », mais sans lever l’ombre d’un petit doigt contre les intérêts, le pouvoir et les richesses de la grande bourgeoisie française. Or, on sait bien ce que valent de tels programmes à l’épreuve du pouvoir, surtout dans le contexte d’une profonde crise du capitalisme : la politique réactionnaire de François Hollande en a donné une illustration limpide, entre 2012 et 2017.
Ceci étant dit, même si le programme de la FI est plus radical que celui des Verts et du PS, cela reste un programme réformiste : il se propose d’améliorer nettement les conditions de vie de l’écrasante majorité de la population, mais sans rompre avec le système capitaliste. C’est sa faiblesse centrale, que nous analyserons ici dans le détail, tout en développant les grandes lignes de notre programme, celui du marxisme révolutionnaire.
« Corriger » le capitalisme ?
Dans son introduction à L’Avenir en commun, Mélenchon écrit : « Le capitalisme financiarisé de notre temps provoque une violence sociale et un saccage de la nature sans précédent dans l’histoire de la civilisation humaine. Tout, même les pandémies, lui permet de se gaver. […] Puisqu’il se nourrit de ses propres désastres, ce système est incapable de se corriger lui-même ».
Effectivement, la crise sanitaire a infligé d’énormes souffrances aux peuples du monde entier, mais elle a aussi permis aux milliardaires d’accumuler de nouveaux milliards. En France, par exemple, leur fortune a augmenté de 86 % entre mars 2020 et octobre 2021 (1). Mais dès lors, la question se pose : si le capitalisme est incapable « de se corriger lui-même », que faut-il faire ? Les jeunes et les travailleurs doivent-ils se charger eux-mêmes de corriger ce système ? Autrement dit, doivent-ils tenter de sauver le capitalisme contre la volonté des capitalistes ? Ou doivent-ils, au contraire, renverser ce système et le remplacer par un autre ?
Les marxistes répondent : tout en luttant au quotidien pour défendre et améliorer les conditions de vie des masses, dans le cadre du capitalisme, le mouvement ouvrier doit se donner pour objectif central de renverser ce système, de porter les travailleurs au pouvoir et d’engager la transformation socialiste de la société. Tant que le capitalisme n’aura pas été renversé, en France et à l’échelle mondiale, il condamnera l’humanité aux crises économiques, à la régression sociale, aux guerres impérialistes et aux catastrophes environnementales.
A l’inverse, L’Avenir en commun propose de « corriger » – autrement dit, de réformer – le système capitaliste. C’est notable dès la citation de Mélenchon, ci-dessus : il y cible non le capitalisme en général, mais le capitalisme « financiarisé ». Ce n’est pas anodin. Si le problème, c’est le capitalisme « financiarisé », alors il suffit de purger le capitalisme de sa « financiarisation ». De fait, une section du chapitre 8 de L’Avenir en commun s’intitule : « Définanciariser l’économie réelle ». Elle cible « les actionnaires » et affirme : « Il faut protéger l’économie réelle des agissements de ces spéculateurs en reprenant le pouvoir sur la finance ».
Problème : les lois fondamentales de « l’économie réelle », sous le capitalisme, engendrent fatalement le développement et la domination croissante du capital financier. Marx l’a anticipé dans Le Capital – et Lénine, plus tard, a souligné le rôle central de ce phénomène dans le développement de l’impérialisme (2). Toute l’histoire du capitalisme, depuis, a confirmé les analyses de Marx et de Lénine. En conséquence, la perspective d’un capitalisme « définanciarisé », au XXIe siècle, est une contradiction dans les termes. Pour en finir avec le chaos économique et social, il faudra purger la société du capitalisme, et non le capitalisme de « la finance » (ce qui est impossible). Il faudra exproprier tous les grands leviers de l’économie – y compris le secteur financier – et les placer sous le contrôle démocratique des travailleurs. Ce sont les salariés qui doivent diriger l’« économie réelle », de façon à organiser une planification démocratique de la production, dans l’intérêt du plus grand nombre et de la sauvegarde de l’environnement.
Mélenchon rejette cette perspective. Et pour tenter de donner une consistance théorique au projet de « définanciarisation » du capitalisme, il présente la domination du capital financier comme un phénomène relativement récent : « Depuis les années 1980, nous vivons dans un type particulier de capitalisme où le capital financier commande au reste », affirme-t-il (3). Comprenez : dans les années 1980, le capitalisme a dérapé dans la gabegie financière ; il faut donc le remettre sur le droit chemin pour que les choses commencent à s’arranger. Mais non : la domination du capital financier ne date pas des années 1980. En 1916, Lénine écrit L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme, où il démontre, faits et chiffres à l’appui, que le capital financier a pris le dessus dès le seuil du XXe siècle.
Mélenchon ignore-t-il ce texte célèbre de Lénine ? Probablement pas. A la différence de la plupart des dirigeants réformistes, il connaît ses classiques du marxisme. Mais il a besoin d’une autre théorie du capital financier pour justifier son programme réformiste.
Réformes et réformisme
Contrairement à une idée reçue, les marxistes sont favorables à la lutte pour des réformes. Sans la lutte quotidienne pour de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, des services publics de qualité, etc., la révolution socialiste serait impossible. C’est à travers la lutte pour des réformes, à travers l’expérience de cette lutte (et de ses limites), que la masse des travailleurs s’organise, mûrit, élève son niveau de conscience – et, finalement, tire la conclusion que la lutte pour des réformes ne suffit pas, qu’il faut un changement radical : une révolution.
Ce à quoi les marxistes s’opposent, c’est au réformisme, qui, comme l’expliquait Lénine, « limite aux réformes les aspirations et les activités de la classe ouvrière », alors que les travailleurs « resteront toujours des esclaves salariés, malgré des améliorations isolées, aussi longtemps que durera la domination du capital » (4). Autrement dit, au lieu de lier étroitement la lutte pour des réformes à la nécessité d’une révolution socialiste, les dirigeants réformistes expliquent aux travailleurs qu’ils doivent se contenter de réformes et que le renversement du capitalisme n’est ni nécessaire, ni souhaitable.
Au sein du camp réformiste, on doit distinguer deux ailes : une aile droite et une aile gauche. L’aile droite du réformisme est incarnée par le PS et les Verts. Ils proclament haut et fort leur attachement au système capitaliste. Mais comme ce système est en crise profonde et que la bourgeoisie exige des contre-réformes drastiques, ils n’osent pas proposer des réformes progressistes dignes de ce nom. D’où l’extrême modération de leur programme, qui confine au néant. Ils font penser à des laquais qui, de la table bien garnie de la bourgeoisie, cherchent à faire discrètement tomber quelques miettes en direction du peuple, tout en gratifiant leurs maîtres de mille sourires et courbettes.
L’aile gauche du réformisme est dominée par la FI (5). Mélenchon ne proclame pas son attachement au capitalisme. Au contraire : il le critique sévèrement et, au moyen de nombreuses réformes progressistes, projette d’en éliminer les effets négatifs, mais sans pour autant le renverser et le remplacer par un autre système économique et social. Les 160 pages de L’Avenir en commun proposent d’éliminer les désastreuses conséquences sociales et environnementales du capitalisme – tout en laissant ce système en place.
La résistance de la bourgeoisie
Ici, on nous répondra peut-être : « Mais au moins, les réformes progressistes de L’Avenir en commun permettront d’améliorer le sort de dizaines de millions de personnes, dans le pays. Augmentation très nette des salaires, des retraites et des minimas sociaux, développement des services publics, embauche massive de fonctionnaires, baisse du temps de travail (jusqu’à 32 heures), sixième semaine de congés payés, gratuité de l’éducation et de la santé publiques, construction d’un million de logements sociaux : toutes ces mesures – et bien d’autres – marqueraient un énorme progrès ! ».
En effet, si elles étaient appliquées, les nombreuses mesures progressistes du programme de la FI se traduiraient par une très nette amélioration du niveau de vie et des conditions de travail (ou d’étude) de l’écrasante majorité de la population. Seule une toute petite minorité de la population serait « lésée », au sens où son indécente accumulation de richesses serait entravée. Mais justement, c’est cette infime minorité de la population – la classe dirigeante – qui, aujourd’hui, contrôle l’économie, l’appareil d’Etat et les grands médias. Se laissera-t-elle imposer, sans résister, le programme de la FI ? Cela contredirait toute l’expérience passée, à commencer par le dénouement de la crise grecque de 2015, qui a vu le réformiste Tsipras renoncer à son programme de réformes sociales sous la pression des bourgeoisies grecque et internationale. Au lieu d’appliquer son programme électoral, Tsipras a poursuivi la politique de coupes budgétaires et de contre-réformes qui martyrise le peuple grec.
Si Mélenchon et son mouvement remportent les prochaines élections, la classe dirigeante française opposera au programme de la FI une résistance d’autant plus acharnée que la crise du capitalisme est très profonde – et que le capitalisme français ne cesse de décliner, ces dernières décennies, face à ses principaux concurrents sur le marché mondial. Du fait des problèmes de compétitivité du capitalisme français, la bourgeoisie ne peut même plus tolérer nos conquêtes sociales passées ; elle a un besoin vital de contre-réformes drastiques. Elle le rappellerait immédiatement et très concrètement à un gouvernement de la FI, sous la forme d’une fuite des capitaux, d’une grève des investissements, d’un vaste chantage à l’emploi et d’une campagne médiatique implacable. L’Union Européenne et les marchés financiers internationaux ajouteraient leurs propres pressions à celles de la classe dirigeante française.
Dans de telles circonstances, un gouvernement de la FI n’aurait que deux possibilités : soit céder aux pressions et, donc, renoncer à son programme progressiste ; soit passer à l’offensive, c’est-à-dire nationaliser les grands leviers de l’économie, de façon à priver la bourgeoisie des moyens de saboter l’action gouvernementale.
En résumé : oui, si les mesures progressistes de L’Avenir en commun sont mises en œuvre, le niveau de vie des masses s’élèvera très nettement ; mais pour appliquer ces mesures, un gouvernement de la FI devra briser la résistance de la bourgeoisie en allant beaucoup plus loin que L’Avenir en commun. Il devra mettre à l’ordre du jour l’expropriation de l’ensemble des grands moyens de production et d’échange : industrie, banques, grande distribution, transports, secteur pharmaceutique, etc. Or Mélenchon exclut explicitement – et régulièrement – cette perspective. C’est la carence centrale de toute sa politique.
« La France n’est pas la Grèce »
Lorsqu’on évoque la crise grecque de 2015, un argument revient fréquemment : « La France n’est pas la Grèce. La France est une grande puissance qui saura se faire respecter. Nous enverrons au diable les capitalistes allemands et tous les gouvernements de l’UE qui s’opposeraient à la politique progressiste d’un gouvernement de la FI ».
Il y a un élément de vérité – et un seul – dans ce raisonnement. Il est vrai qu’à l’égard d’un gouvernement de la FI, le gouvernement allemand et ceux des autres pays de l’UE ne pourraient pas se comporter exactement comme ils se sont comportés à l’égard d’Alexis Tsipras, en 2015. La situation économique de la France et son poids, au sein de l’UE, détermineraient sans doute des méthodes de pression et un rythme de l’offensive sensiblement différents. Mais cela ne changerait rien à l’hostilité radicale des classes dirigeantes européennes à l’égard d’un gouvernement de la FI. Elles seraient fermement déterminées à le faire plier, parce qu’elles ne pourraient pas tolérer l’exemple fâcheux – de leur point de vue de classe – d’un gouvernement de gauche qui, au cœur de l’UE, mène une vaste politique de réformes sociales progressistes.
Aussi, lorsque les auteurs de L’Avenir en commun tablent sur la bienveillance de la Banque Centrale Européenne (BCE), moyennant une « modification de son statut » (contre la volonté des capitalistes allemands ?), ils nagent en pleine féérie. La réalité, c’est que la BCE, dont l’« indépendance » est totalement fictive, serait un instrument de choix dans l’offensive des bourgeoisies européennes contre un gouvernement de la FI, lequel serait rapidement – sinon immédiatement – confronté à une flambée des taux d’intérêts de la dette française.
Frédéric Lordon annonce une « tempête spéculative » si la FI arrive au pouvoir. On peut discuter l’exactitude de cette formule, mais l’essentiel est ailleurs : elle indique la bonne perspective générale. Et il faut relever l’extrême légèreté de la réponse de Mélenchon à Lordon, dans la revue Ballast : « Si nous ne payons pas, la vie continuera. Nous continuerons à nous lever le matin, à emmener les enfants à l’école et à accomplir toutes les sorties et les activités de la vie sociale, quelle que soit la monnaie qui circule. En face, par contre, ils prennent un risque. Car eux n’auront plus rien si nous refusons de payer. Donc s’ils sont raisonnables, je le serai. Mais je ne cèderai pas. » (6)
C’est à peine croyable, même de la part d’un dirigeant réformiste. Revenons sur terre deux minutes. Si les travailleurs sont indifférents au nom et à la forme extérieure de « la monnaie qui circule », ils sont en revanche très attentifs à sa valeur, c’est-à-dire à son pouvoir d’achat. Mais surtout, il ne suffira pas à Mélenchon de menacer les bourgeoisies d’un défaut de l’Etat français sur sa dette pour que celles-ci deviennent « raisonnables ». Bien sûr, elles vont manœuvrer, temporiser, agiter la carotte et le bâton, alterner sourires diplomatiques et coups de poignard. Mais elles ne céderont pas. Elles ne deviendront pas « raisonnables ». C’est précisément pour cela qu’il faudra les renverser.
Au fond, ces quelques lignes de Mélenchon sont caractéristiques de l’impasse du réformisme. S’il développe cette perspective, qui confine au rêve éveillé, c’est parce qu’il n’envisage pas la seule voie réaliste : l’expropriation de tous les grands leviers de l’économie française (banques comprises), l’organisation effective d’un nouveau pouvoir, celui de la classe ouvrière, et un appel aux classes ouvrières d’Europe et d’ailleurs pour qu’elles suivent l’exemple des travailleurs français. Nous ne disons pas qu’un tel bouleversement révolutionnaire serait une entreprise facile et totalement paisible. Mais elle reste infiniment plus réaliste que le conte de fées de Mélenchon.
La bourgeoisie française
A lire et écouter le dirigeant de la FI, on a parfois l’impression que ses seuls adversaires sont à Bruxelles et Berlin. Il est particulièrement remonté contre la classe dirigeante allemande. C’est à elle, en priorité, qu’il adresse son « je ne cèderai pas ». Nul doute que la classe dirigeante allemande accueillerait très froidement – et même agressivement – une victoire électorale de Mélenchon, en avril prochain. Mais en concentrant ainsi son feu sur l’UE et le gouvernement allemand, il néglige un autre adversaire de taille et farouchement hostile au programme de la FI : la classe dirigeante française. Cette négligence est d’autant plus remarquable que le grand patronat français manifeste très clairement son hostilité au programme de la FI. Pas un jour ne passe sans que Mélenchon et son mouvement ne soient vilipendés, dans les médias bourgeois.
La classe dirigeante française est très hostile au programme de la FI. Pour comprendre les raisons de cette hostilité, il suffit de citer quelques mesures de ce programme. L’Avenir en commun prévoit de « porter immédiatement le SMIC mensuel à 1400 euros net », de « porter a minima au niveau du SMIC – revalorisé – toutes les pensions pour une carrière complète », et de porter l’ensemble des minimas sociaux (RSA, minimum vieillesse, etc.) « au niveau du seuil de pauvreté » (soit 1063 euros par mois). Les « jeunes détachés du foyer fiscal parental » bénéficieront d’une « garantie d’autonomie » du même montant : 1063 euros. A elles seules, ces mesures – qui permettraient d’arracher des millions de personnes à la misère – coûteraient au grand patronat et à son Etat plusieurs milliards d’euros par an, au bas mot.
Poursuivons : « tout chômeur de longue durée se verra proposer [par l’Etat] un emploi utile à la transition écologique ou à l’action sociale (les secteurs d’urgence), en lien avec ses qualifications et sur la base du volontariat ». Ces emplois – plus d’un million, potentiellement – seront payés « au moins au SMIC revalorisé », soit 1400 euros net. Par ailleurs, L’Avenir en commun prévoit d’embaucher massivement des fonctionnaires, et ce dans tous les services et administrations. Le programme ne donne pas de chiffre global, mais une chose est claire, à sa lecture : il prévoit de créer beaucoup plus de postes de fonctionnaires que tous les candidats de droite ne rêvent d’en supprimer.
Toutes ces mesures vont évidemment dans la bonne direction. Mais comment le gouvernement les financera-t-il ? L’Avenir en commun répond : par la dette (grâce à la généreuse bienveillance de la BCE) et en taxant le Capital (foyers et profits). Nous avons écarté, plus haut, l’hypothèse d’une généreuse bienveillance de la BCE : loin d’être un levier du gouvernement de la FI, la dette sera surtout un moyen, pour la bourgeoisie, de l’attaquer. En ce qui concerne la taxation du Capital, nous y sommes évidemment favorables. Mais il est clair que cette perspective suscite une profonde hostilité dans les couches les plus fortunées de la population.
Nous pourrions donner bien d’autres exemples à partir des centaines de mesures que contient L’Avenir en commun. Pris dans son ensemble, ce programme prévoit le transfert d’au moins plusieurs dizaines de milliards d’euros, chaque année, des poches du grand patronat vers celles des salariés, des chômeurs, des étudiants et des retraités. C’est précisément ce qui fait le caractère progressiste de ce programme – et sa différence avec les programmes homéopathiques du PS et des Verts.
Mais encore une fois, il est bien évident que la bourgeoisie française ne laissera pas s’opérer une telle ponction du Capital sans résister de toutes ses forces. C’est d’autant plus évident qu’à la ponction directe du Capital, via les augmentations de salaires et diverses taxes (entre autres), s’ajouteront les effets économiques d’une telle ponction, à commencer par la baisse de la rentabilité et de la compétitivité des grandes entreprises du secteur privé. Dans la vaste course aux profits et aux parts de marché à laquelle se livrent les grandes entreprises et les grandes puissances capitalistes, sur l’arène mondiale, la mise en œuvre du programme de Mélenchon constituerait un frein de taille. Voilà ce que la bourgeoisie française ne tolérera pas, en particulier dans un contexte de profonde crise du capitalisme et, ce qui n’arrange rien, de déclin relatif du capitalisme français. La bourgeoisie française n’acceptera aucun compromis durable. Seule son expropriation – c’est-à-dire son renversement, comme classe dirigeante – l’empêchera de se livrer au sabotage permanent des mesures sociales contenues dans L’Avenir en commun.
Un « programme de transition » ?
Dans l’interview à Ballast que nous avons déjà citée, Mélenchon s’efforce de donner une justification théorique à son refus de pousser jusqu’au bout – jusqu’à la révolution socialiste – la lutte contre la bourgeoisie, ses privilèges et son pouvoir. Il mentionne le célèbre Programme de transition de Léon Trotsky, et affirme à ce propos : « on pourrait dire que L’Avenir en commun est un programme de transition : il rompt avec la société actuelle sans dire quelle société il compte instaurer, en faisant confiance à l’Histoire pour répondre à la question. » Plus loin, il précise : « L’Avenir en commun est un programme de transition. Il ne propose pas l’abolition de la propriété privée, mais il rompt nettement avec la société du néolibéralisme. La suite n’est pas écrite. Mais, clairement, il ouvre la possibilité d’une société économique qui repose davantage sur la propriété collective que sur la propriété privée, sur la planification que sur le marché ».
Nous encourageons tous nos lecteurs à lire l’excellent Programme de transition de Léon Trotsky, rédigé en vue de la Conférence fondatrice de la IVe Internationale, en 1938. Ils y constateront très vite que l’analogie entre ce programme et L’Avenir en commun est pour le moins audacieuse. Il ne serait jamais venu à l’idée de Trotsky de rédiger un programme qui « rompt avec la société actuelle sans dire quelle société il compte instaurer », comme l’écrit Mélenchon. Le Programme de transition se présente lui-même, dès ses premières pages, comme « un système de revendications transitoires dont le sens est de se diriger de plus en plus ouvertement et résolument contre les bases mêmes du régime bourgeois. (…) [Sa] tâche consiste en une mobilisation systématique des masses pour la révolution prolétarienne. » Non seulement ce programme défend l’abolition de la propriété privée des grands moyens de production, mais l’ensemble de ses revendications transitoires orientent la lutte des masses dans cette direction, c’est-à-dire vers la conquête du pouvoir par la classe ouvrière et la transformation socialiste de la société.
Le Programme de transition de Trotsky était un programme d’action révolutionnaire. L’Avenir en commun est un programme électoral réformiste. Dès lors, il serait un peu vain et abstrait de reprocher à Mélenchon de ne pas reprendre à son compte l’ensemble du programme élaboré par Trotsky en 1938. Ici, nous voulons surtout analyser les principales contradictions internes de L’Avenir en commun – et souligner les obstacles auxquels sa modération exposerait fatalement un gouvernement de la FI, compte tenu de la situation économique et sociale actuelle, en France et dans le monde. Et comme Mélenchon affirme que son programme « ouvre la possibilité d’une société économique qui repose davantage sur la propriété collective que sur la propriété privée, sur la planification que sur le marché », nous voulons entrer dans le détail de cette idée et avancer quelques mesures concrètes qui vont dans ce sens – mais qui, dans L’Avenir en commun, brillent par leur absence.
La crise sanitaire
Le sixième chapitre de L’Avenir en commun s’intitule La vie en état de pandémie permanente. Il avance une série de mesures qui tranchent nettement avec la gestion catastrophique de la crise sanitaire par le gouvernement Macron, dont le souci principal était – et demeure – de sauvegarder les profits du grand patronat.
Par exemple, L’Avenir en commun prévoit de « revenir sur les suppressions de lits » dans les hôpitaux et d’« engager un plan pluriannuel de recrutement des professionnels du soin et du médico-social (médecins, infirmiers, aide-soignants et personnels administratifs) ». Par ailleurs, la gratuité totale des soins serait garantie par le « remboursement à 100 % des soins de santé prescrits ».
Cependant, si les soins sont remboursés à 100 %, nous ne voyons pas pourquoi l’ensemble du secteur de la santé – établissements de soins, industries du médicament, etc. – ne serait pas public à 100 %. A défaut, l’Assurance maladie continuerait d’être une énorme source de profits pour les grands actionnaires du secteur, sans le moindre bénéfice pour la santé de la population. Ce que la pandémie a parfaitement démontré, c’est la contradiction frontale entre la course aux profits et la santé publique. Cette contradiction, qui a fauché de nombreuses vies depuis mars 2020, ne peut être levée qu’en nationalisant – sous le contrôle démocratique des salariés – l’ensemble des établissements de soins privés (cliniques, hôpitaux, EHPAD, etc.), ainsi que l’ensemble du secteur pharmaceutique et des industries liées à la santé publique.
En 2020, le chiffre d’affaires du secteur pharmaceutique, en France, s’est élevé à plus de 62 milliards d’euros, en progression de 2,4 % par rapport à 2019. La même année, Sanofi a réalisé 36 milliards d’euros de chiffres d’affaires, dont 20,4 % de « marge nette » (taux de profits). Impressionné, le magazine Challenges commente : c’est « une profitabilité que n’atteignent que quelques majors du tabac, du luxe ou de la finance, loin devant le taux de profit moyen de 7 % des autres secteurs. » (7)
A eux seuls, ces chiffres suffisent à justifier l’expropriation de Big Pharma. Or, cette mesure ne figure pas dans L’Avenir en commun. Le programme de la FI prévoit seulement de « réquisitionner les entreprises indispensables à la production de matériel sanitaire (masques, tests, purificateurs) ». Mais d’une part, la réquisition est une mesure temporaire, alors qu’il faut des mesures définitives : des expropriations, c’est-à-dire des nationalisations sans indemnisation des gros actionnaires. D’autre part, ces expropriations ne doivent pas seulement concerner la production de masques, de tests et de purificateurs ; elles doivent s’étendre à l’ensemble du secteur de la santé. Il faut l’arracher des griffes des actionnaires, qui se préoccupent uniquement de leurs profits, et non de la santé du plus grand nombre. Ce faisant, on pourra enfin satisfaire les revendications des salariés des hôpitaux, des EHPAD et d’autres établissements de soins, qui dénoncent depuis des années leurs conditions de travail épuisantes, sous la pression des politiques d’austérité.
Non seulement L’Avenir en commun ne propose rien de tel, mais il prévoit de « mettre en place une conditionnalité des aides perçues par les entreprises privées pour la recherche de vaccins et de médicaments ». Ainsi, non content de laisser ces entreprises entre les mains de capitalistes, un gouvernement de la FI leur accorderait des aides publiques. « Conditionnalité » ou pas, c’est un cas particulier de la formule chère aux actionnaires : « nationaliser les pertes, privatiser les profits ». Ceci n’a pas sa place dans un programme qui prétend « changer de système ». Il faut arrêter de jeter de l’argent public dans les caisses des grands groupes capitalistes. On a besoin de cet argent pour construire des écoles, des hôpitaux, des logements publics et bien d’autres choses qui manquent cruellement !
Dernière remarque : nous ne proposons pas de fonctionnariser, d’un seul coup, l’ensemble des médecins libéraux. Leur statut est loin d’être le problème central du système de santé actuel. La médecine libérale se résorbera graduellement dans une médecine publique au fur et à mesure que le système de santé publique lui-même se développera, offrira de meilleures conditions de travail à son personnel et couvrira correctement l’ensemble du territoire national. Alors, de plus en plus de médecins choisiront d’eux-mêmes le secteur public, parce qu’il leur offrira de bonnes conditions d’exercice et les avantages d’un travail collectif, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui dans un système hospitalier rongé par l’austérité, les fermetures de lits et la course à la rentabilité.
La planification écologique
L’Avenir en commun consacre pas moins de 20 pages à la politique environnementale. Face au « capitalisme financiarisé qui épuise les humains et la planète », le programme défend « la planification, puisque le marché et la concurrence ont montré leur incapacité à relever [les] défis » environnementaux.
Ainsi formulée, cette ambition tranche nettement avec le « capitalisme vert » que défendent obstinément les dirigeants du PS et des Verts, car ils sont incapables de penser le monde sans la domination du « libre marché ».
Dans le détail, L’Avenir en commun propose des mesures (taxes, interdictions, etc.) visant à contraindre les capitalistes à moins polluer et moins gaspiller. Mais il propose aussi « un plan massif de 200 milliards d’euros d’investissements écologiquement et socialement utiles ».
Ceci pose deux problèmes. D’une part, est-il possible de contraindre les capitalistes à limiter ou arrêter des activités qui leur sont extrêmement profitables ? L’expérience nous permet de répondre : non, c’est impossible. Tant qu’ils contrôlent les grands moyens de production, ils trouvent mille et un moyens de contourner des mesures punitives et de résister aux contraintes légales qu’un gouvernement voudrait leur imposer.
D’autre part, qui va réaliser les investissements colossaux nécessaires au développement des énergies renouvelables, au développement massif des transports publics et à la transition écologique en général ? Le secteur privé ? C’est impossible. Seule la « puissance publique » peut réaliser de tels investissements, à condition qu’elle soit dotée de moyens financiers et industriels à la hauteur de cet objectif.
Ces deux problèmes ont une seule et même solution : la nationalisation des principaux moyens de production et la mise en place d’une planification démocratique de l’économie, sous le contrôle des salariés et des consommateurs. La planification écologique ne sera possible que sur la base d’une planification économique. Sans cela, elle restera suspendue dans les airs. On ne peut planifier ce qu’on ne contrôle pas – et on ne peut contrôler ce qu’on ne possède pas. Or, le nombre de nationalisations prévues par L’Avenir en commun est très limité. Soyons précis et exhaustifs : le texte mentionne les autoroutes, la SNCF, Ariane Espace, la Française des Jeux, la branche « énergies marines » d’Alstom, les aéroports récemment privatisés, EDF, Engie et « des banques généralistes ». C’est tout – et c’est bien peu. Par ailleurs : quelles banques faut-il nationaliser ? Et pourquoi pas toutes les banques ? Pourquoi laisser aux capitalistes une seule de ces grosses banques « généralistes », c’est-à-dire spécialisées dans la spéculation et le pillage des ressources de la planète ? Une planification digne de ce nom devra s’appuyer sur un secteur bancaire entièrement public, centralisé et doté d’une capacité d’investissements optimale.
La nationalisation des grandes entreprises du secteur de l’énergie, comme EDF et Engie, est indispensable. Mais bien d’autres secteurs économiques sont impliqués dans le saccage de l’environnement – et devront être réorganisés pour y mettre un terme. Par exemple, le secteur des transports devra fonctionner d’une façon radicalement différente de ce que nous connaissons dans le système actuel, où une poignée de grands capitalistes font produire des millions de véhicules individuels polluants (mais très profitables) et où les transports publics sont à la fois négligés et soumis aux diktats de la rentabilité. Il faudra, au contraire, investir massivement dans les transports publics, au détriment des véhicules individuels polluants. Mais pour cela, il nous faudra contrôler ce secteur, et donc d’abord exproprier l’ensemble des parasites qui le contrôlent aujourd’hui.
Poursuivons. L’isolation des logements est un enjeu important de la transition écologique. Il faudra non seulement isoler les logements existants, mais aussi intégrer ce paramètre aux nouveaux logements à construire – et il faudra en construire beaucoup, car il en manque beaucoup. On le peut ! Avec plus de cinq millions de chômeurs, en France, ce n’est pas la main-d’œuvre qui fait défaut, ni les compétences. Mais il n’est pas question qu’un plan de construction de logements publics serve à enrichir les grosses entreprises du BTP. Celles-ci devront être nationalisées et regroupées dans un secteur public centralisé permettant de bien planifier les vastes travaux de construction et de rénovation nécessaires.
Enfin, l’industrie agroalimentaire (qui nous empoisonne allègrement) et la grande distribution (qui vole tout le monde, des petits producteurs aux consommateurs) devront également passer dans le secteur public. Comment, sinon, pourrions-nous réorganiser et développer une agriculture capable de satisfaire les besoins de tous – en cessant, enfin, de ruiner la nature, notre santé et nos portefeuilles ?
L’expropriation des grands capitalistes est une nécessité à la fois d’un point de vue écologique et d’un point de vue social. Une planification démocratique de l’économie permettra la plus grande rationalisation des rapports de l’homme à la nature, mais aussi des rapports sociaux eux-mêmes. Elle ouvrira la possibilité d’éliminer toutes les formes d’exploitation et d’oppression. Les marxistes soulignent souvent qu’une telle perspective ne pourra se réaliser pleinement qu’à l’échelle internationale. C’est évident en ce qui concerne la situation écologique : la pollution et le dérèglement climatique ne connaissent pas de frontières. C’est un problème mondial, que seul le socialisme mondial, en définitive, pourra résoudre.
La VIe République
L’Avenir en commun s’ouvre sur l’objectif de fonder une nouvelle République – la VIe – à l’issue d’un processus démocratique bien précis : une Assemblée constituante serait convoquée, qui aurait deux ans pour rédiger une nouvelle Constitution, laquelle serait alors soumise à référendum.
Les marxistes abordent cette question – comme toutes les autres – d’un point de vue de classe. La bourgeoisie française est consciente du discrédit croissant dont sont frappées les institutions de la Ve République. En lui-même, ce discrédit représente un danger pour son pouvoir, comme l’a montré le rôle joué par la revendication du RIC (8) dans le mouvement des Gilets jaunes. Cependant, si la classe dirigeante ne tente pas, à ce stade, de redorer son blason au moyen d’une nouvelle République, c’est notamment parce qu’elle redoute qu’un tel changement suscite trop d’attentes, dans les masses, et déclenche un mouvement de revendications démocratiques et sociales échappant à son contrôle. C’est le dilemme classique des classes dirigeantes embourbées dans un régime en crise : si elles ne réforment pas ce régime, elles s’exposent aux convulsions sociales ; mais si elles le réforment, elles s’y exposent aussi. Ceci finit par provoquer une division au sommet, dans l’Etat bourgeois lui-même. Cette division est d’ailleurs l’une des prémisses d’une crise révolutionnaire.
De notre point de vue de classe, le rejet de la Ve République est une évidence. Cette République est pourrie jusqu’à la moelle. Ses institutions sont gangrenées par les passe-droits et la corruption en tous genres. En dernière analyse, cependant, la crise des institutions n’est que l’expression de la crise du système économique et social sur lequel elles reposent – le capitalisme – et qu’elles ont pour fonction de défendre. C’est la racine du mal.
Dans la Ve République française comme dans tous les autres types de régimes en Europe, le véritable pouvoir ne réside ni dans les Assemblées élues au suffrage universel, ni dans les conseils des ministres, ni même dans les palais présidentiels ou royaux. Le véritable pouvoir réside dans les conseils d’administration des banques et des multinationales. En France, une centaine de grandes familles capitalistes a une influence décisive sur la politique menée par les gouvernements successifs.
Mélenchon souligne souvent les traits monarchiques de la fonction présidentielle, en France. Mais comme ses prédécesseurs, l’actuel « monarque présidentiel », Emmanuel Macron, est lui-même à genoux devant le grand Capital, véritable roi du monde contemporain. Par conséquent, si une VIe République ne détrône pas ce monarque moderne, elle ne sera qu’une république bourgeoise de plus. Or telle est précisément la faiblesse centrale du programme de la FI : il ne contient pas les mesures indispensables pour en finir avec la dictature du Capital. Cela réduit énormément la portée du projet de VIe République. Pour doter ce projet d’un contenu conforme aux intérêts fondamentaux de notre classe, il faut le reformuler ainsi : « A bas la Ve République ! Pour une République socialiste ! ».
Cela ne signifie pas que les marxistes sont indifférents à toute réforme démocratique dans le cadre du système capitaliste et de ses institutions. Au contraire : il faut organiser des luttes conséquentes pour défendre ou conquérir même les plus « petits » droits démocratiques, précisément parce que ces droits favorisent la lutte de notre classe contre la bourgeoisie. Par exemple, nous devons revendiquer le droit de vote des étrangers à toutes les élections – et pas seulement aux « élections locales », comme le prévoit L’Avenir en commun, sans même prendre la peine de justifier cette restriction.
L’appareil d’Etat
Les marxistes distinguent la forme de l’Etat (République, monarchie constitutionnelle, dictature militaire, etc.) et son caractère de classe (Etat bourgeois, Etat ouvrier, etc.). Cette distinction est fondamentale. L’Etat bourgeois le plus démocratique au monde, doté du plus démocratique des Parlements, demeure l’instrument de domination d’une poignée de grands capitalistes sur la masse des travailleurs.
Encore une fois, les marxistes ne sont pas du tout indifférents à la forme de l’Etat. Du point de vue de la lutte des travailleurs contre la bourgeoisie, la République parlementaire est la meilleure forme d’Etat possible. Mais ceci n’entraîne aucune idéalisation de la République bourgeoise ; cela signifie simplement qu’une telle République offre les meilleures conditions politiques à la lutte pour la renverser et la remplacer par une République socialiste.
Les réformistes rejettent ce point de vue marxiste. Ils ne distinguent pas la forme de l’Etat et son caractère de classe. Ils idéalisent « la République », la République « universelle », abstraite, sans contenu de classe – bref, une République qui n’existe pas, n’a jamais existé et n’existera jamais nulle part.
L’Avenir en commun exprime bien ce point de vue réformiste. Ses auteurs défendent « la République » en général – et s’indignent : en France, « une caste de privilégiés, vouée aux plus riches, gangrène l’Etat ». C’est vrai, mais on peut en dire autant de tous les Etats bourgeois, c’est-à-dire de tous les Etats qui reposent sur des rapports de production capitalistes. L’Etat bourgeois est, par nature, « voué aux plus riches » : c’est sa fonction même. Au lieu d’en tirer la conclusion qu’il faut un autre type d’Etat, un Etat ouvrier, reposant sur des rapports de production socialistes, les auteurs de L’Avenir en commun nous proposent, en 11 mesures, « un plan de séparation de l’argent et de l’Etat ». Malheureusement, les mesures de ce « plan » visent uniquement quelques formes flagrantes de corruption, de clientélisme et de népotisme. On ne voit pas du tout comment elles pourraient suffire à « séparer l’argent de l’Etat ». Un tel objectif est contradictoire, sous le capitalisme, car l’Etat y est, par nature, au service de « l’argent », c’est-à-dire du grand Capital.
L’Etat bourgeois, même sous sa forme républicaine, est l’Etat de la bourgeoisie, l’Etat qui défend son pouvoir, ses privilèges et son « argent ». Face à ce lien organique, essentiel, entre la bourgeoisie et son Etat, les 11 mesures du « plan » de la FI font penser à l’entreprise notoirement vaine consistant à vider un océan à l’aide d’une petite cuillère (ou même 11 petites cuillères).
Cette position réformiste à l’égard de l’Etat se reflète aussi dans le deuxième chapitre du programme, qui est consacré à la justice et la police. Certaines des mesures qu’il contient vont dans la bonne direction, par exemple « la gratuité des procédures [judiciaires] les plus courantes » (dont le divorce). Mais pour le reste, ce chapitre fait totalement l’impasse sur le caractère de classe de la justice et de la police, ces deux piliers de l’Etat bourgeois. On y lit : « En République, la justice est rendue au nom du peuple ». Sur le papier, sans doute : l’encre ne coûte pas cher. Mais factuellement, dans tous les régimes capitalistes, le système judiciaire illustre bien la formule du philosophe grec Anacharsis : « La Justice est comme une toile d’araignée : les petits s’y font prendre et les grands la déchirent ». En France, plus de 400 Gilets jaunes ont été incarcérés, mais parmi leurs codétenus ne figuraient aucun de ces voyous en col blanc qui se livrent chaque année, dans une impunité totale, à des fraudes fiscales de grande envergure.
Par ailleurs, L’Avenir en commun propose de « refonder une police républicaine », c’est-à-dire une police « qui soit attachée aux principes de l’état de droit », car « la police doit agir pour la protection des libertés individuelles et collectives ». Cette conception de la police bourgeoise relève de la pure rêverie « républicaine ». Comme l’expliquait Marx, la police bourgeoise fait partie de ces « hommes en armes qui défendent les rapports de production capitalistes », ce qui est précisément l’essence de l’Etat bourgeois. La police bourgeoise ne peut pas être réformée ; elle ne peut qu’être désintégrée par une révolution socialiste, qui lui substituera « le peuple en armes », selon la formule de Marx commentant l’expérience de la Commune de Paris (1871).
Les communards ont formulé deux autres principes qui seront au fondement de l’Etat ouvrier : 1) l’éligibilité et la révocabilité permanente de tous les hauts fonctionnaires ; 2) la rémunération de ces derniers à hauteur du salaire d’un travailleur qualifié. A elles seules, ces deux mesures seront infiniment plus efficaces, pour « séparer l’Etat de l’argent », que ne le seront les 11 mesures du « plan » de L’Avenir en commun. Mais l’application de ces deux mesures suppose une révolution socialiste, c’est-à-dire le renversement de la bourgeoisie et le transfert du pouvoir entre les mains de la classe ouvrière.
L’Union Européenne
Nous avons souligné, plus haut, que les dirigeants de l’UE seraient très hostiles à un gouvernement de la FI. En particulier, la classe dirigeante allemande – qui domine l’UE, économiquement – exercerait des pressions colossales sur le gouvernement français pour qu’il renonce à son programme de réformes progressistes.
La façon dont Mélenchon anticipe cette situation – et prévoit d’y répondre – a un peu évolué, ces dernières années. Ses fameux « plans A et B » n’ont plus tout à fait le même contenu et la même articulation. Dans la version de 2017 de L’Avenir en commun, on pouvait lire : « le plan A, c’est la sortie concertée des traités européens par l’abandon des règles existantes pour tous les pays qui le souhaitent et la négociation d’autres règles. Le plan B, c’est la sortie des traités européens unilatérale par la France pour proposer d’autres coopérations. L’UE, on la change ou on la quitte. » Le plan B (la « sortie unilatérale des traités ») était présenté comme une sortie de l’UE.
Dans la version actuelle du programme de la FI, le plan A reste le même, mais le plan B est formulé ainsi : « nous appliquerons dans tous les cas immédiatement notre programme au niveau national en assumant la confrontation avec les institutions européennes (plan B). Nous utiliserons pour cela tous les leviers pour faire valoir notre position au Conseil européen et désobéirons aux règles bloquantes chaque fois que c’est nécessaire. » Autrement dit, le plan B n’est plus vraiment un plan alternatif au plan A. Il consiste simplement à affirmer que, « dans tous les cas », un gouvernement de la FI appliquera son programme. Au lieu d’une « sortie de l’UE », on a la perspective d’une désobéissance de la France aux injonctions des dirigeants de l’UE – mais sans rupture formelle avec l’UE.
Cette évolution du programme de la FI a suscité les vives protestations d’une (toute petite) partie de la « gauche radicale », celle qui répète à longueur de journée que la « sortie de l’UE », en elle-même, marquerait un grand pas en avant pour la jeunesse et la classe ouvrière de notre pays (9). Nous n’avons jamais partagé ce point de vue. Tant que les Bouygues, Dassault, Bolloré, Lagardère et compagnie contrôleront les grands leviers de l’économie française, il n’y aura pas d’issue pour les jeunes et les salariés, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE. Et ce qui vaut pour la France vaut pour tous les pays d’Europe. Par exemple, est-ce que le Brexit a marqué un progrès pour les masses exploitées et opprimées de Grande-Bretagne ? D’évidence, non. Le capitalisme britannique est toujours debout et produit toujours les mêmes ravages sociaux.
Ceci étant dit, l’évolution de L’Avenir en commun, sur l’UE, ne marque pas un progrès par rapport à la version de 2017. Le « plan A », qui prévoit par exemple de négocier une « modification du statut de la BCE », est un conte de fées qui laissera de marbre la classe dirigeante allemande (entre autres). Quant au nouveau « plan B », il anticipe l’inévitable « confrontation » entre un gouvernement de la FI et les dirigeants de l’UE, mais sans se donner les moyens programmatiques d’en sortir victorieux. Les « leviers d’action » qu’il envisage – le recours au « droit de véto » de la France, le conditionnement de la « contribution française au budget de l’UE », etc. – ne feraient pas reculer les dirigeants de l’UE. Au contraire, ils répliqueraient vigoureusement, sous la forme de sanctions et de chantages divers. Il est vrai que les dirigeants de l’UE ne voudront pas en expulser la France, car ceci marquerait le début de la fin de l’UE elle-même. Mais ils auront, eux aussi, leur « plan B », sous la forme d’énormes pressions financières et commerciales.
La seule issue, encore une fois, ce sera la rupture avec le capitalisme et l’appel aux autres classes ouvrières d’Europe pour qu’elles suivent cet exemple, dans la perspective de remplacer l’UE – cette vaste machinerie au service des multinationales européennes – par une Fédération des Etats socialistes d’Europe. Cela peut sembler lointain et abstrait, mais c’est la seule voie, la seule perspective à la fois réaliste et conforme aux intérêts des masses.
Guerres et paix
Il faudrait toute une brochure pour analyser correctement la politique internationale de la France insoumise. Ici, nous nous limiterons à la façon dont la question de la guerre est abordée dans le chapitre de L’Avenir en commun intitulé : « Une diplomatie altermondialiste pour la paix ».
On y lit : « Pour promouvoir la paix et la coopération, retrouver une voix indépendante est une nécessité ». A cette fin, le programme de la FI prévoit de « retirer immédiatement [la France] du commandement intégré de l’OTAN puis, par étapes, de l’organisation elle-même », car « les alliances militaires permanentes, comme l’OTAN construite par et pour les Etats-Unis, sont contraires aux intérêts et aux principes de notre pays. » Dès l’Introduction du programme, Mélenchon affirme : « Nous pouvons donc animer une diplomatie altermondialiste entendue et respectée. Ce sera la meilleure contribution de la France à la paix et au co-développement. Elle ne sera pas isolée, au contraire. Et elle ne sera plus embarquée dans des conflits menés au profit des seuls Etats-Unis en déclin. »
Il est vrai que l’impérialisme français est à la remorque de l’impérialisme américain. De fait, la France n’est désormais qu’une puissance de second rang. C’est la conséquence du déclin de son poids économique relatif au cours des dernières décennies, qui ont été marquées par l’hyper-domination des Etats-Unis et l’ascension de la Chine (entre autres). Dans ce contexte, le gouvernement de Macron – comme d’autres avant lui – a joué le rôle de bruyant caniche de l’impérialisme américain, lequel observait avec mépris le petit animal et, de temps à autre, lui flanquait un coup de botte.
Telle est la position réelle de l’impérialisme français. Mais dès lors, comment « l’indépendance » de la France à l’égard des Etats-Unis pourrait-elle « contribuer à la paix » mondiale, selon la formule de L’Avenir en commun ? Posons la question autrement. Nous ne sommes pas pour le maintien de la France au sein de l’OTAN, bien sûr ; mais par quel miracle sa sortie de l’OTAN ferait perdre son caractère impérialiste au capitalisme français ? En outre, par quel autre miracle cela empêcherait les autres puissances de l’OTAN – Etats-Unis en tête – de poursuivre leurs guerres impérialistes ?
L’Avenir en commun répond à cette dernière question en proposant que l’Organisation des Nations Unies (ONU) joue un rôle central, décisif, dans les affaires du monde. Il faut « renforcer l’ONU pour faire vivre un monde ordonné », affirme le programme, qui poursuit : « en dépit de ses insuffisances, l’ONU reste le seul organe légitime, car universel, pour assurer la sécurité collective. » Il faut donc « refuser toute intervention militaire sans mandat de l’ONU » – ce qui revient à accepter les interventions qui bénéficient d’un tel mandat.
Tout ceci est en complète contradiction avec ce qu’est l’ONU et son rôle réel dans les rapports internationaux. Le rôle de l’ONU n’est pas d’empêcher les guerres. Cette institution n’a jamais joué un rôle progressiste. Elle n’est qu’un forum dans lequel les grandes puissances impérialistes débattent surtout des questions secondaires. Lorsqu’une question importante est à l’ordre du jour, l’ONU n’a pas le dernier mot : ce sont les grandes puissances qui décident, suivant leurs intérêts. On l’a vu, par exemple, dans le cas de l’invasion de l’Irak en 2003. Pour des raisons liées aux intérêts de l’impérialisme français, la France avait pris position, à l’ONU, contre l’intervention militaire. Qu’ont fait les impérialistes américains ? Ils ont tout de même envahi l’Irak, sans mandat de l’ONU. Et ce n’est là qu’un exemple parmi bien d’autres.
Il est vrai que, parfois, les cinq puissances du Conseil de Sécurité de l’ONU s’accordent sur certaines interventions militaires. Mais celles-ci n’en conservent pas moins leur caractère impérialiste et donc réactionnaire. La première guerre du Golfe (1990) était appuyée par l’ONU, tout comme l’embargo imposé à l’Irak entre 1991 et 2003, lequel a fait, selon les sources, entre 500 000 et 1,5 million de victimes, dont une majorité d’enfants. Plus récemment, il y a eu l’intervention en Libye (2011), qui a plongé ce pays dans un chaos dont il n’est toujours pas sorti. Et que dire d’Haïti, ce pays martyr qui, entre 2004 et 2017, a vécu sous une dictature de facto des Casques bleus de l’ONU ?
En bref, le « mandat de l’ONU » n’est absolument pas le bon critère. S’accrocher à ce critère, c’est tomber dans le piège des impérialistes, car l’une des fonctions de l’ONU est précisément de couvrir les guerres d’un voile de « légalité internationale », quand c’est possible. Il s’agit d’un élément de propagande non négligeable. Notre rôle est de dénoncer cette propagande et d’expliquer les véritables motivations des belligérants, dans chaque guerre.
Souvent, l’horreur de la guerre pousse des militants de gauche à déclarer : « il faut faire quelque chose, et tout de suite ! » Et trop souvent, cela se termine par le soutien à une intervention impérialiste, en particulier lorsqu’elle bénéficie d’un mandat de l’ONU. On voit ce que cela donne aujourd’hui en Libye. Il faut en tirer les leçons – et regarder les choses en face : la guerre est une caractéristique fondamentale, inévitable, du capitalisme moderne. On ne peut avoir l’un sans avoir l’autre. Si nous voulons sérieusement lutter contre les guerres impérialistes, notre premier devoir est d’expliquer, à chaque occasion, quelle est la véritable nature de classe de la guerre et quels objectifs réels poursuivent les différentes forces engagées. C’est de ce point de vue de classe que doivent être organisées des mobilisations de masse contre les guerres impérialistes.
En France, il faut en priorité dénoncer les crimes de l’impérialisme français – notamment en Afrique – et mobiliser le mouvement ouvrier contre ces crimes. Et il faut inlassablement expliquer qu’une paix authentique, durable, universelle, ne sera possible que lorsque nous aurons débarrassé le monde du système capitaliste – et donc de l’impérialisme. Ce n’est certes pas pour « tout de suite », mais c’est la seule solution au fléau de la guerre.
Socialisme, collectivisme et coopérativisme
Une conclusion se dégage de tout ce qui précède : L’Avenir en commun ne se donne pas les moyens de sa propre réalisation, car il s’arrête devant l’obstacle central au progrès social : la propriété privée des grands moyens de production. Le programme de la FI ne propose pas de balayer cet obstacle, c’est-à-dire d’exproprier les parasites géants qui contrôlent les principaux leviers de l’économie. Nous avons tenté de montrer à quelles difficultés ceci exposerait un gouvernement de la FI. Une célèbre formule de Lénine résume bien cette idée : « on ne saurait aller de l’avant sans marcher au socialisme » (10). Précisément, L’Avenir en commun ne marche pas au socialisme.
Dans son interview à Ballast, Mélenchon explique préférer le mot « collectivisme » à celui de « socialisme » : « Je trouve que le mot “socialisme” introduit une confusion. Il faut passer des heures à dire ce qu’il est et ce qu’il n’est pas » (à cause du PS). Et donc, « aujourd’hui, je préfère me décrire comme “collectiviste” ».
Nous ne sommes pas du tout convaincus de la nécessité de renoncer au mot « socialisme ». La résonance des mots, dans la conscience des masses, change radicalement sous les coups de boutoir des événements. Aux Etats-Unis, pendant plus d’un demi-siècle, les mots « socialisme » et « communisme » sentaient le soufre satanique ; aujourd’hui, sous l’impact de la crise du capitalisme, des dizaines de millions d’Américains se réclament avec enthousiasme du socialisme et du communisme.
Ceci dit, le fond du débat ne porte pas sur le choix des mots, mais sur le contenu des concepts. Le socialisme – au sens marxiste du terme – est un « collectivisme », puisqu’il vise la collectivisation de toutes les grandes entreprises du pays. Or c’est précisément ce que ne vise pas L’Avenir en commun. Mais dès lors, en quoi peut bien consister le « collectivisme » des dirigeants de la FI ?
Une réponse est apportée dans le chapitre intitulé Partage des richesses. Il y est proposé de « généraliser l’économie sociale, solidaire et coopérative », en « favorisant le développement des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) et les sociétés coopératives et participatives (SCOP) de façon à développer des services communs dont la responsabilité est partagée entre citoyens et usagers, salariés, partenaires publics et privés. » Telle serait « l’alternative à l’économie libérale ».
Notez bien : l’alternative à l’économie « libérale » – et non à l’économie capitaliste. Et pour cause : le coopérativisme n’est pas vraiment une alternative au capitalisme, car une coopérative est une entreprise en situation de concurrence, sur un marché, avec d’autres entreprises, fussent-elles d’autres coopératives. Or, pour faire face à la concurrence, il faut recourir aux bonnes vieilles méthodes capitalistes : accroissement de la productivité et de l’intensité du travail, blocage ou baisse des salaires, réduction de la masse salariale au minimum nécessaire, etc. Autrement dit, les travailleurs « possèdent » l’entreprise, mais ils finissent par s’exploiter eux-mêmes suivant des méthodes qui sont à l’œuvre dans les entreprises capitalistes les plus classiques. Cela finit souvent par introduire une différenciation croissante, au sein de l’entreprise, entre des travailleurs qui dirigent et des travailleurs qui sont dirigés.
Par ailleurs, dans la mesure où il n’élimine pas le chaos du marché, le coopérativisme est incompatible avec la planification. Celle-ci requiert la socialisation et la centralisation des principales ressources économiques du pays, en même temps que leur gestion démocratique. Pour qu’elles puissent faire l’objet d’une planification rationnelle et démocratique, ces ressources doivent être la propriété collective de l’ensemble des travailleurs. Bien sûr, dans le cadre d’une économie socialiste, les travailleurs de telle entreprise collectivisée seront directement impliqués dans les décisions relatives à son activité et, en particulier, aux conditions de travail qui y prévalent. Mais comme entreprise publique, elle fera partie intégrante d’un plan d’ensemble, dont l’élaboration et le contrôle impliqueront des couches bien plus larges de travailleurs.
Mélenchon dit à Ballast : « je me ressource souvent auprès d’auteurs anarchistes ». De fait, il y a dans le coopérativisme ce résidu de mentalité de petit propriétaire qu’on retrouve dans l’anarchisme. C’est un drôle de collectivisme, car il est mitigé par le marché, la concurrence et toutes les merveilles qui en découlent. Le collectivisme conséquent, socialiste, est incompatible avec un coopérativisme généralisé. D’ailleurs, historiquement, l’influence du socialisme moderne s’est forgée à travers une lutte contre les tendances coopérativistes et anarchisantes qui, au milieu du XIXe siècle, puisaient leurs forces dans cette masse d’artisans et de petits paysans que le capitalisme n’avait pas encore liquidée.
De nos jours, en France et comme dans toutes les grandes puissances capitalistes, la classe ouvrière constitue l’écrasante majorité de la population active. Pas une roue ne tourne, pas une lumière ne brille et pas un téléphone ne sonne sans l’aimable permission des travailleurs. Leur mission historique, c’est de prendre le pouvoir et de réorganiser la société sur la base d’une planification socialiste et démocratique de l’économie. Propriétaires collectifs de l’ensemble des moyens de production socialisés, ils sauront les coordonner, les développer et les administrer de façon à satisfaire les besoins et réduire le temps de travail de tous. Depuis que Marx et Engels, les premiers, l’ont formulée de façon scientifique, cette perspective n’a rien perdu de son actualité. Elle reste la seule façon d’en finir avec la barbarie dans laquelle le capitalisme mondial entraîne l’humanité.
1) Dernier rapport Oxfam sur les inégalités économiques.
2) En particulier dans L’impérialisme, stade suprême du capitalisme.
3) Interview de Mélenchon dans la revue Ballast, le 14 janvier 2022.
4) Marxisme et réformisme. Tome 19 des œuvres complètes de Lénine, p.399.
5) Le PCF est l’autre force du réformisme de gauche. Mais la FI bénéficie d’une base électorale plus large que le parti de Fabien Roussel.
6) Interview de Mélenchon dans la revue Ballast.
7) Sources : leem.org et Challenges
8) RIC : Référendum d’Initiative Citoyenne.
9) C’est le cas, par exemple, du Pôle de Renaissance Communiste en France (PRCF), une organisation qui, après avoir soutenu Mélenchon en 2017, a annoncé qu’elle ne le soutiendrait pas, cette fois-ci, et qu’elle allait présenter une candidature de l’« Alternative Rouge et Tricolore ». Par bonheur, cette défection n’aura pas d’impact visible sur le plan électoral (ni sur tout autre plan).
10) La catastrophe imminente et les moyens de la conjurer (septembre 1917).