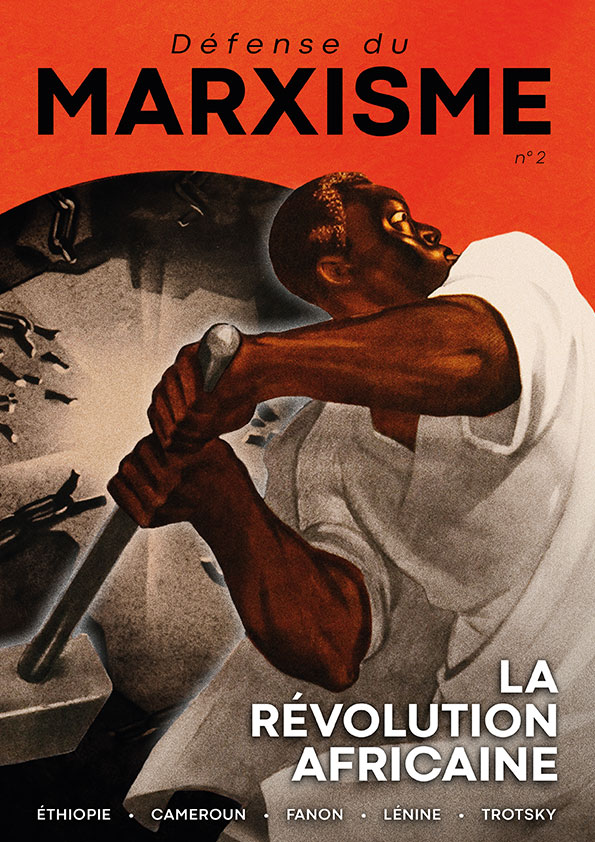Article écrit en septembre 2017
Moins de deux ans après sa création, la France insoumise (FI) est devenue la force dominante à gauche. Non pas, bien sûr, qu'elle soit la mieux organisée ou qu'elle ait le plus grand nombre d'élus. Mais elle domine indiscutablement dans la conscience politique des masses. Tous les sondages le soulignent : la FI est perçue comme la principale opposition de gauche au gouvernement Macron. Elle suscite beaucoup d'espoirs et d'attentes dans les couches les plus exploitées et les plus opprimées de la population. C'est fondamental. Aucun puissant appareil, aucun vaste « réseau d'élus » ne peut remplacer un tel soutien populaire.
Nos adversaires – la classe dirigeante, ses politiciens et ses relais médiatiques – ne s'y sont pas trompés : ils attaquent sans cesse Mélenchon et son mouvement. Dans cette agressivité, il entre une certaine dose de peur. Or celle-ci, comme on le sait, est mauvaise conseillère : en concentrant le feu sur la FI, ils contribuent à accroître son autorité et la désignent implicitement comme une possible alternative au gouvernement actuel (ce qu'elle est). Les politiciens bourgeois font toujours cette erreur, lorsqu'ils sentent le sol se dérober sous leurs pieds. En Espagne, la droite a déversé des tonnes de calomnies sur Podemos, pendant des années, en l'accusant notamment de soutenir – ô surprise – la « dictature » de Nicolas Maduro, au Venezuela. En Grande-Bretagne, Jeremy Corbyn subit le même sort, sur d'autres thèmes. Mais chaque fois, les calomnies finissent par éclabousser les calomniateurs.
Un phénomène international
Le succès de la FI ne tombe pas du ciel. Il est important d'en comprendre les raisons fondamentales. En premier lieu, il faut souligner le caractère international de ce phénomène. Partout, la crise mondiale du capitalisme provoque une polarisation – sur la droite et sur la gauche – qui déstabilise en profondeur les échiquiers politiques. En particulier, l'aile droite de la social-démocratie, qui a dominé la gauche pendant des décennies, est dans une crise profonde. Elle est de plus en plus concurrencée par des forces qui émergent sur sa gauche. C'est le cas notamment en Espagne (Podemos) et en Belgique (PTB). Avant cela, l'ascension rapide de Syriza, en Grèce, s'était réalisée au détriment du PS grec, le PASOK. En Grande-Bretagne, l'aile droite du Labour est confrontée à l'énorme popularité de Jeremy Corbyn, qui vient de la gauche du parti. Aux Etats-Unis, il n'y a pas de social-démocratie à proprement parler : le Parti Démocrate est un parti purement bourgeois. Mais il n'empêche que la campagne de Bernie Sanders aux primaires démocrates, en 2016, fut un séisme politique majeur : il se présentait comme un « socialiste », proposait une « révolution politique contre la classe des milliardaires » – et suscitait l'enthousiasme de millions d'Américains.
L'émergence de la FI est l'expression, en France, du même processus, qui s'enracine donc dans la situation objective : dans la crise du système capitaliste, dans ses conséquences sociales désastreuses et dans les politiques d'austérité qui se succèdent depuis la récession mondiale de 2008. Dans ce contexte, tous les partis – de droite comme « de gauche » – qui participent à la mise en œuvre de politiques d'austérité en sortent profondément discrédités. Un espace s'ouvre alors sur la gauche. Encore faut-il l'occuper, ce dont furent incapables les « frondeurs » du PS (qui se plaignaient de la politique de Hollande, mais votaient pour) et la direction du PCF (qui est embourbée dans des alliances avec le PS). Mélenchon, lui, a su occuper cet espace ; il a su rompre clairement avec le PS et incarner le refus des contre-réformes et des coupes budgétaires. Sans surprise, la radicalité de son discours a rencontré un puissant écho chez des millions de jeunes et de travailleurs.
Il est inutile d'aller chercher beaucoup plus loin les raisons du succès de la FI. Par exemple, on lit parfois que Mélenchon aurait trouvé le « bon dosage » entre « nationalisme » et « socialisme ». C'est faux. D'une part, il n'y a pas de bon dosage en la matière : nationalisme et socialisme s'excluent mutuellement ; le socialisme est par essence internationaliste. D'autre part, les tendances nationalistes sont beaucoup moins affirmées chez Sanders, Iglesias et Corbyn que chez Mélenchon. Or leurs succès sont comparables. Ils découlent avant tout du caractère social de leur programme : le refus de l'austérité, des coupes budgétaires et du pouvoir sans limites des capitalistes. Le nationalisme français, quel qu'en soit le nom (« indépendantisme », « souverainisme » ou « patriotisme »), n'a pas un atome de contenu progressiste et ne peut en rien favoriser la croissance de la FI.
Réformes et révolution
Révolution considère l'émergence de la FI comme un développement très positif, car cela déporte vers la gauche l'axe politique du mouvement ouvrier français. Nous avons activement participé aux campagnes électorales de Mélenchon à la présidentielle et des candidats « insoumis » aux législatives. Cependant, comme organisation marxiste, nous avons un certain nombre de divergences avec le programme officiel de la FI. Depuis le début de notre investissement dans ce mouvement, nous avons formulé ces divergences de façon positive et constructive. Résumons-les.
Le programme de la FI, L'Avenir en commun, contient une longue série de mesures économiques et sociales très progressistes. Si elles étaient mises en œuvre, elles se traduiraient par une très nette amélioration du niveau de vie de l'écrasante majorité de la population. Pas de toute la population, cependant ; la petite minorité de grands capitalistes qui contrôlent l'économie y perdrait quelque chose, à quoi ils tiennent plus qu'à la prunelle de leurs yeux : une partie de leurs marges de profit. La baisse du temps de travail, l'augmentation des salaires et le développement des services publics – pour ne citer que ces trois mesures de L'Avenir en commun – impliquent nécessairement de ponctionner les marges de profits des bonzes du CAC 40, et donc aussi les dizaines de milliards d'euros de dividendes qu'ils distribuent aux actionnaires, chaque année. L'Avenir en commun le dit d'ailleurs clairement : « il faut taxer les profits ».
Nous sommes évidemment d'accord avec l'idée de taxer les profits. Sous le capitalisme, toute la lutte des classes, au fond, est une lutte pour la répartition des richesses créées (par les salariés) entre Travail et Capital. Cependant, il y a des limites aux conquêtes sociales qu'il est possible d'arracher et de consolider dans le cadre du système capitaliste, en particulier dans un contexte de profonde crise économique, comme aujourd'hui. Non seulement le patronat n'est pas disposé à concéder de nouvelles réformes progressistes, mais il exige sans cesse des contre-réformes brutales. Confrontée à un gouvernement dirigé par la FI, la classe dirigeante française ferait tout ce qui est en son pouvoir pour saborder les réformes et contraindre le gouvernement à faire marche arrière. Pour ce faire, elle utiliserait son contrôle de l'appareil productif, de l'industrie, des transports, de la grande distribution, des banques et des médias. Par exemple, elle organiserait une grève d'investissements et une fuite des capitaux (lesquels, d'ailleurs, fuiraient spontanément pour éviter les taxes). Comment un gouvernement de la FI répondrait à cette contre-offensive de la classe dirigeante ? L'Avenir en commun n'apporte pas la réponse – et, à vrai dire, ne pose pas la question.
Voici notre réponse : les mesures progressistes de L'Avenir en commun ne pourront être mises en œuvre qu'à condition de rompre avec le capitalisme lui-même, donc de s'en prendre de façon décisive à la grande propriété capitaliste. Cela passe par la nationalisation – sous le contrôle démocratique des salariés et des consommateurs – des principaux leviers de l'économie : banques, énergie, transports, industrie, distribution, etc. Or L'Avenir en commun propose seulement de nationaliser quelques entreprises : « des » banques (lesquelles ?), les autoroutes, EDF et Engie (ex-GDF). C'est très insuffisant. Nous ne proposons pas de nationaliser les petites entreprises : ce serait inutile et absurde. Mais pourquoi laisser la plupart des mastodontes du CAC 40 entre les mains des milliardaires qui les possèdent – et qui, n'en doutons pas, s'en serviraient pour opposer une résistance acharnée aux mesures contenues dans L'Avenir en commun ?
Il faut compléter le programme de la FI dans le sens que nous venons d'indiquer, c'est-à-dire y introduire des mesures visant la transformation révolutionnaire et socialiste de la société.
Les leçons de la crise grecque
L'histoire de la lutte des classes a maintes fois démontré la nécessité d'un programme de rupture avec le capitalisme. En France, par exemple, le premier gouvernement de Mitterrand, entre 1981 et 1984, s'est heurté à ce qu'il a lui-même appelé le « mur de l'argent », qui n'est rien d'autre, au final, que la propriété capitaliste des grands moyens de production. En refusant de briser ce mur, Mitterrand s'est condamné à répudier son propre programme : ce fut le « tournant de la rigueur » de 1983-84, l'abandon du programme officiel du PS et, au passage, le début de la longue dérive droitière de ce parti.
Plus récemment, c'est en Grèce que les limites du réformisme ont éclaté au grand jour. En janvier 2015, Syriza accédait au pouvoir sur la base d'un programme progressiste. Sa mise en œuvre se serait traduite par une très nette amélioration des conditions de vie des masses grecques, lesquelles avaient subi, depuis 2009, plusieurs plans d'austérité draconiens. Cependant, Alexis Tsipras nourrissait l'illusion qu'il pourrait à la fois mettre en œuvre son programme de campagne et négocier un « bon accord » avec la « troïka » (UE, BCE, FMI) sur la dette publique grecque. Mais la troïka et l'ensemble des classes dirigeantes européennes ont immédiatement soumis le gouvernement grec à de colossales pressions pour qu'il renonce à son programme officiel et poursuive les mesures d'austérité. On connaît la suite : en juillet 2015, Tsipras capitulait sur toute la ligne et s'engageait dans la voie des privatisations et de nouvelles coupes budgétaires.
On entend parfois que Tsipras n'avait pas le choix, que les travailleurs grecs n'étaient pas prêts à une rupture avec le capitalisme – et que, de toute façon, la Grèce est un trop petit pays pour s'engager sur la voie du socialisme, qu'elle aurait été « isolée », etc. Ces arguments ne tiennent pas une seconde. La détermination des jeunes et des travailleurs grecs à lutter contre la troïka et les capitalistes en général a été démontrée par leur mobilisation massive dans les jours qui ont précédé le référendum du 5 juillet 2015. Le résultat du référendum lui-même – 61 % des voix contre les exigences de la troïka – en fut une autre illustration limpide. Si, au lieu de capituler quelques jours plus tard, Alexis Tsipras s'était appuyé sur le résultat du référendum pour proposer la répudiation de la dette publique et un plan de rupture avec le capitalisme grec, il est très probable que les pauvres, les jeunes et les travailleurs l'auraient soutenu activement et avec enthousiasme. Et à tout le moins, pour connaître leur réaction à l'idée d'une rupture révolutionnaire, il fallait la proposer.
Bien sûr, une Grèce socialiste se serait immédiatement attirée les foudres du capitalisme mondial. Mais elle aurait aussi gagné la sympathie des travailleurs du monde entier, à commencer par les travailleurs d'Europe. On peut affirmer avec certitude – sur la base de toute l'expérience passée – que le renversement du capitalisme en Grèce aurait eu un énorme impact politique sur l'ensemble du continent. Une vague révolutionnaire n'aurait pas tardé à balayer l’Europe. La question aurait été posée à toutes les forces de gauche : « pour ou contre la Révolution grecque ? », de même qu’Octobre 1917 avait posé la question : « pour ou contre la Révolution russe ? ».
Il n’est pas décisif, au fond, que ce soit la Grèce, l’Espagne ou un autre pays qui commence la révolution socialiste. La puissance économique relative des différents pays d’Europe n’entre pas en ligne de compte dans les perspectives générales, car les conséquences politiques du renversement du capitalisme dans un seul pays, quel qu’il soit, seront très indépendantes de son PIB. Aussi, les raisonnements sur la différence entre la « petite » Grèce et la « puissante » France n’ont pas grand intérêt. Ils aboutissent en général à la conclusion doublement fausse que la Grèce est trop faible pour le socialisme – et la France assez puissante pour s’en passer.
L'exemple du Venezuela
Le Venezuela offre un deuxième exemple, lui aussi tragique, de l'impasse du réformisme. Rappelons brièvement l'histoire récente du Venezuela.
L'élection de Hugo Chavez à la tête du pays, en 1998, a marqué le début d'une authentique révolution, la « révolution bolivarienne ». Dans le domaine économique, le premier acte important de Chavez fut d'annuler le projet de privatisation de la puissante industrie pétrolière, PDVSA, qui est de loin la première source de recettes de l'Etat vénézuélien. Il a mis ces ressources au service de toute une série de « missions sociales » dans les domaines de la santé, du logement et de l'éducation. L'analphabétisme a été rapidement résorbé. Des millions de pauvres ont vu un médecin pour la première fois de leur vie. De nombreux logements sociaux ont été construits. Le Code du travail a été modifié au profit des salariés. Une réforme agraire – au profit des paysans les plus pauvres – a été engagée.
La bourgeoisie vénézuélienne et ses maîtres impérialistes, aux Etats-Unis, ne pouvaient pas tolérer cette situation. Le 11 avril 2002, l'opposition de droite et des généraux réactionnaires – appuyés par les sommets de l'Eglise, de grands médias et l'administration américaine – ont organisé un coup d'Etat. Le palais présidentiel a été investi ; Chavez et des ministres ont été arrêtés. Mais en 48 heures, le coup d'Etat a été balayé par une mobilisation révolutionnaire des masses, dans les rues de Caracas et de tout le pays. Quelques mois plus tard, en décembre 2002, le patronat a organisé un vaste lock-out, là encore dans le but de renverser le gouvernement bolivarien. Mais là encore, la mobilisation révolutionnaire des travailleurs a fait échouer cette tentative.
L'un des grands mérites de Chavez fut de tirer des conclusions radicales de cette expérience. A partir de 2005, il déclare que les objectifs de la révolution vénézuélienne sont « socialistes », que l'émancipation du peuple vénézuélien est impossible dans les limites du système capitaliste. Cette idée rencontra un écho enthousiaste dans les masses vénézuéliennes. Par exemple, la création du Parti Socialiste Unifié du Venezuela, en 2007, fut un énorme succès. Il attira sous sa bannière plusieurs millions de jeunes, travailleurs et paysans – dont un grand nombre de femmes.
Cependant, le « socialisme » existait davantage dans les discours que dans la réalité. Quelques entreprises furent nationalisées, mais abstraction faite de PDVSA, l'essentiel de l'économie – à commencer par le secteur bancaire – restait dans des mains privées. Le vieil appareil d'Etat était infesté d'éléments réactionnaires, carriéristes ou corrompus. Les initiatives des travailleurs pour instaurer le contrôle ouvrier dans les entreprises nationalisées se heurtaient à l'opposition et au sabotage des hauts fonctionnaires. De manière générale, Chavez lui-même s'efforçait de trouver un impossible compromis avec la bourgeoisie vénézuélienne. Celle-ci ne pouvait pas se réconcilier avec la révolution bolivarienne. Elle voulait son écrasement pur et simple.
Après la mort de Chavez, en 2013, la crise économique et politique s'est accélérée. La chute des cours du pétrole a joué un rôle important dans la crise, comme le soulignent les dirigeants de la France insoumise. Mais on ne peut réduire cette crise à la question du pétrole. Le problème, c'est que la bourgeoisie vénézuélienne refuse d'investir dans l'économie. Elle préfère spéculer sur la crise. Elle table sur le fait que le chaos économique, la pénurie et l'hyper-inflation créeront les conditions matérielles d'un renversement du gouvernement Maduro, les masses perdant patience. Or Maduro s'efforce – en vain – de trouver un compromis avec la droite et les capitalistes vénézuéliens. Cette politique mène tout droit à la défaite de la révolution vénézuélienne. La révolution ne peut être sauvée que par l'expropriation de l'oligarchie et la mise en place d'un contrôle démocratique des ouvriers sur l'économie et l'Etat. Autrement dit, par une révolution socialiste, laquelle aurait un puissant écho dans toute l'Amérique latine – et au-delà. Vingt années de révolution bolivarienne ont démontré qu'il n'y a pas d'autre voie.
L’Union Européenne
La crise grecque de 2015 a exposé la véritable nature de l'Union Européenne. En complète contradiction avec leurs beaux discours sur l’« unité » et les « valeurs » de l'UE, les classes dirigeantes d'Europe – à commencer par la plus puissante, la classe dirigeante allemande – ont soumis le gouvernement Tsipras et le peuple grec à un chantage brutal. Pour Angela Merkel et ses semblables, l'expression démocratique du peuple grec ne pèse rien face aux intérêts des banques et des multinationales. Les capitalistes français, bien sûr, ont exactement la même conception de la démocratie. Si le gouvernement Hollande a figuré en deuxième ligne de l'offensive contre le gouvernement Tsipras, c'est parce que les capitalistes allemands dominent l'UE, désormais, et y tranchent toutes les questions où leurs intérêts sont en jeu. Ceci dit, toutes les classes dirigeantes d'Europe poussaient à la capitulation de Tsipras, d'une manière ou d'une autre.
Sur la base de cette expérience et de la politique réactionnaire de l'UE en général, la jeunesse et les travailleurs du continent sont de plus en plus critiques à l'égard des institutions européennes. Le discours sur « l'Europe sociale », grâce à une réforme de l'UE, sonne comme une mauvaise plaisanterie. En effet, l'UE ne peut pas être « réformée » conformément à nos intérêts de classe, pour cette raison simple que l'UE est un ensemble d'institutions pro-capitalistes. La raison d'être de l'UE, c'est la défense des banques et multinationales européennes – et rien d'autre. L'UE est donc entièrement réactionnaire et ne peut pas être réformée ; elle doit céder la place à une autre forme de coopération entre les peuples d'Europe. Laquelle ? Et sur quelles bases économique et sociale ?
L'Avenir en commun développe la proposition de « sortir des traités européens ». Les traités européens sont réactionnaires, car ils sont l’expression politique et juridique du caractère réactionnaire de l’UE. La FI a donc raison de proposer d'en « sortir ». Mais pour vraiment en sortir, pour en sortir non seulement juridiquement, mais aussi économiquement et socialement, il faut sortir du système capitaliste lui-même. Sans cela, rien ne sera réglé. Tant que les Bouygues, Dassault, Bolloré, Lagardère et compagnie contrôleront les grands leviers de l'économie française, il n'y aura pas d'issue pour les jeunes et salariés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'UE. Et ce qui vaut pour la France vaut pour tous les pays d'Europe.
Comme le soulignait déjà Lénine, le système capitaliste est incapable d’unifier l’Europe, d’harmoniser ses colossales ressources humaines et productives. Le problème, c’est le système économique et social, en France comme dans le reste de l'Europe. Seule une Fédération des Etats socialistes d’Europe permettra d’unifier le continent sur des bases progressistes. Cela peut sembler lointain et abstrait, mais c’est la seule voie, la seule perspective à la fois réaliste et conforme aux intérêts des masses. Une « Europe sociale » sur la base du capitalisme peut sembler plus accessible et plus raisonnable, à première vue. Mais c’est une chimère. Elle n’adviendra jamais.
Pour autant, la solution ne viendra pas d'une simple « sortie de l'UE ». Une France capitaliste ayant rompu avec l’UE ne marquerait pas un progrès pour les travailleurs. Plus d'un an après le Brexit, les travailleurs britanniques sont bien placés pour le savoir : leur niveau de vie continue de régresser, notamment du fait de l'inflation. Pour qu'elle ait un caractère progressiste, la sortie de l'UE doit être la conséquence d'une rupture avec le capitalisme lui-même.
La VIe République
La FI place la fondation d’une VIe République en tête de ses priorités, comme le premier acte d’une « révolution citoyenne ». Il est clair qu’il faut défendre des réformes démocratiques. Par exemple, il faut fermer le Sénat, cette institution composée de notables élus par d’autres notables et dont le budget annuel s’élève au chiffre incroyable de 300 millions d’euros. Utilisons cet argent pour construire des écoles et des hôpitaux : le pays en a besoin. Il faut également défendre le droit de vote des immigrés à toutes les élections et la régularisation de tous les travailleurs sans-papiers.
La Ve République est pourrie jusqu’à la moelle. Ses institutions sont gangrenées par les passe-droits et la corruption en tous genres. En dernière analyse, cependant, cette crise des institutions n’est que l’expression de la crise du système économique sur lequel elles reposent et qu’elles ont pour fonction de défendre. C’est, là aussi, la racine du mal.
Dans la Ve République française comme dans tous les autres types de régimes en Europe, le véritable pouvoir ne réside ni dans les assemblées élues au suffrage universel, ni dans les conseils des ministres, ni même dans les palais présidentiels ou royaux. Il réside dans les conseils d’administration des banques et des multinationales. En France, une centaine de grandes familles capitalistes a une influence décisive sur la politique menée par les gouvernements successifs. Lénine caractérisait la démocratie bourgeoise comme « le masque temporaire de la dictature du Capital ». C’est encore plus vrai aujourd’hui qu’à l’époque de Lénine, car la concentration du capital a pris depuis des proportions colossales.
Mélenchon souligne souvent les traits monarchiques de la fonction présidentielle, en France. Mais le « monarque présidentiel » Macron est lui-même à genoux devant le grand Capital, véritable roi du monde contemporain. Si la VIe République ne détrônait pas ce monarque moderne, elle ne serait qu’une république bourgeoise de plus.
La « planification écologique »
La FI accorde une place centrale aux questions écologiques. Le troisième chapitre de L’Avenir en commun est consacré à cette question. Il s’intitule : Face à la crise climatique, la planification écologique.
Au seul mot de « planification », les apologistes du capitalisme éprouvent une brusque montée d’angoisse. C’est le signe qu’on est sur la bonne voie. Révolution se félicite du retour de l’idée de « planification » dans un programme de gauche bénéficiant d’une très large audience. Ce retour fait suite à une longue disparition, consécutive à la chute des régimes staliniens, au début des années 90. A l’époque, les dirigeants du mouvement ouvrier subissaient de plein fouet la vague de propagande qui annonçait la victoire définitive de « l’économie de marché » (la loi de la jungle). Ils n’osaient plus parler de planification, de socialisme ou de révolution.
Il n’est pas étonnant que l’idée de planification revienne par la voie des préoccupations écologiques. Le capitalisme est en train de plonger l’humanité dans une crise écologique majeure. La course aux profits et le chaos du « libre marché » aggravent sans cesse les différentes formes de contamination de l’air, des sols, des mers et des cours d’eau. Les « pics de pollution » de l’air se multiplient. L’Organisation Mondiale de la Santé estime que les différents types de pollution sont déjà responsables d’un décès sur neuf, dans le monde. L’industrie agroalimentaire nous vend de la nourriture de plus en plus malsaine et empoisonnée. Le réchauffement climatique, conséquence des émissions de gaz à effet de serre, déstabilise gravement l’écosystème. Bref, si rien n’est fait, l’humanité court à sa perte, à sa propre destruction.
Jean-Luc Mélenchon a pris acte de cette situation et annonce vouloir y apporter des solutions radicales. Dans L’Avenir en commun, il écrit que « l’exigence écologique ne peut être réduite à des proclamations et des mesures qui épargnent le système. La finance n’en veut pas : elle préfère les grands rendements de la spéculation. La définanciarisation de l’économie est une condition incontournable de la transition écologique. »
C’est bien le cœur du problème : les grands capitalistes sont organiquement incapables de réaliser les énormes investissements nécessaires à la « transition écologique », et notamment le développement massif des énergies renouvelables – au détriment des énergies émettrices de gaz à effet de serre. Ce n’est pas simplement une affaire de mauvaise volonté, de leur part. Les lois et les mécanismes fondamentaux du capitalisme poussent les classes dirigeantes à rechercher la maximisation de leurs profits à court terme. Il en résulte un chaos et un gaspillage monstrueux. La sauvegarde des équilibres environnementaux est incompatible avec ce gigantesque casino qu’est devenue l’économie mondiale.
Il faut donc s’attaquer au « système », comme l’écrit Mélenchon. Comment ? L’Avenir en commun propose toute une série de mesures dans les domaines de l’énergie, des transports, du logement, de l’agriculture et de la gestion des déchets. On peut grosso modo ranger ces mesures en deux catégories. La première comprend des mesures punitives ou incitatives (taxes, arrêt des subventions) qui visent à restreindre les activités polluantes, le gaspillage et autres fléaux de cet ordre. Cette catégorie comprend aussi des mesures d’interdiction pure et simple (pesticides chimiques, OGM...) et l’arrêt de projets en cours (« fermes usines », nucléaire…). La deuxième catégorie comprend toute une série de mesures plus positives, visant à développer largement les énergies renouvelables, les transports publics, l’isolation des logements, le recyclage des déchets, l’agriculture biologique et d’autres choses encore.
On a donc, d’un côté, des mesures dont l’objectif est de contraindre les capitalistes à moins polluer, moins gaspiller – et, de l’autre, des mesures qui proposent de réaliser tout ce que les capitalistes refusent de réaliser. Mais ceci pose deux problèmes. D’une part, est-il possible de contraindre les capitalistes à limiter ou arrêter des activités qui leur sont extrêmement profitables ? L’expérience nous permet de répondre : non, c’est pratiquement impossible. Tant qu’ils contrôlent les grands moyens de production, ils ont mille et un moyens de contourner des mesures punitives et de résister aux contraintes légales qu’un gouvernement voudrait leur imposer. D’autre part, qui va réaliser les investissements colossaux nécessaires au développement des énergies renouvelables, au développement massif des transports publics et à la transition écologique en général ? Le secteur privé ? C’est impossible. Seul l’Etat, seule la « puissance publique » peut réaliser de tels investissements, à condition qu’elle soit dotée des moyens financiers et industriels à la hauteur de cet objectif.
Ainsi, ces deux problèmes ont une seule et même solution : la nationalisation des principaux moyens de production et la mise en place d’une planification démocratique de l’économie, sous le contrôle des salariés et des consommateurs. La planification écologique ne sera possible que sur la base d’une planification économique. Sans cela, elle restera suspendue dans les airs, tel un vœu pieux.
On ne peut planifier ce qu’on ne contrôle pas – et on ne peut contrôler ce qu’on ne possède pas. Or, comme nous l'avons déjà relevé plus haut, L’Avenir en commun reste beaucoup trop vague sur le périmètre des nationalisations à réaliser. Il mentionne les autoroutes, EDF, Engie et « des banques généralistes ». Lesquelles ? Pourquoi pas toutes les banques ? Pourquoi laisser aux capitalistes une seule de ces grosses banques « généralistes », c’est-à-dire spécialisées dans la spéculation et le pillage des ressources de la planète ? La planification écologique – et donc économique – devra s’appuyer sur un secteur bancaire entièrement public, centralisé et doté d’une capacité d’investissements optimale.
La nationalisation des grandes entreprises du secteur de l’énergie, comme EDF et Engie, est indispensable. Mais bien d’autres secteurs économiques sont impliqués dans le saccage de l’environnement – et devront être réorganisés pour y mettre un terme. Par exemple, le secteur des transports devra fonctionner d’une façon radicalement différente de ce que nous connaissons dans le système actuel, où une poignée de grands capitalistes font produire des millions de véhicules individuels polluants (mais très profitables) et où les transports publics sont à la fois négligés et soumis aux diktats de la rentabilité. Il faudra, au contraire, investir massivement dans les transports publics, au détriment des véhicules individuels polluants. Mais pour cela, il nous faudra contrôler ce secteur, et donc d’abord exproprier les parasites qui le contrôlent aujourd’hui. Il nous semble que le milliardaire Carlos Ghosn (Renault), pour ne citer que ce parasite, s’est assez largement payé sur la bête !
Poursuivons. L’isolation des logements est un enjeu important de la transition écologique, comme le souligne L’Avenir en commun. Il faudra non seulement isoler les logements existants, mais aussi intégrer ce paramètre aux nouveaux logements à construire – et il faudra en construire beaucoup, car il en manque beaucoup. On le peut ! Avec plus de cinq millions de chômeurs, en France, ce n’est pas la main-d’œuvre qui fait défaut, ni les compétences. Mais il n’est pas question qu’un plan de construction de logements publics serve à enrichir les grosses entreprises du BTP. Celles-ci devront être nationalisées et regroupées dans un secteur public centralisé permettant de bien planifier les vastes travaux de construction et de rénovation nécessaires.
Enfin, l’industrie agroalimentaire (qui nous empoisonne allègrement) et la grande distribution (qui vole tout le monde, des petits producteurs aux consommateurs) devront également passer dans le secteur public. Comment, sinon, pourrions-nous réorganiser et développer une agriculture capable de satisfaire les besoins de tous – en cessant, enfin, de ruiner la nature, notre santé et nos portefeuilles ?
L’expropriation des grands capitalistes est une nécessité à la fois d’un point de vue écologique et d’un point de vue social. Une planification démocratique de l’économie permettra la plus grande rationalisation des rapports de l’homme à la nature, mais aussi des rapports sociaux eux-mêmes. Elle ouvrira la possibilité d’éliminer toutes les formes d’exploitation et d’oppression. Les marxistes soulignent souvent qu’une telle perspective ne pourra se réaliser pleinement qu’à l’échelle internationale. C’est évident en ce qui concerne la situation écologique : la pollution ne connaît pas de frontières. C’est un problème mondial, que seul le socialisme mondial, en définitive, pourra résoudre.
La question de la guerre
La question de la guerre – et des relations internationales en général – est à la fois complexe et fondamentale. Ici, nous nous appuierons sur ce qui est effectivement écrit dans L'Avenir en commun – et non, comme c’est trop souvent le cas, sur des phrases de Mélenchon extraites de leur contexte et exploitées de façon malhonnête.
Le chapitre 5 de L’Avenir en commun est intitulé : « Face à la guerre, instaurer l’indépendance de la France au service de la paix ». Ce que le texte du programme explicite ainsi, d’emblée : « Nous ne devons plus être à la remorque des folies impériales des Etats-Unis et de leur outil de tutelle militaire : l’OTAN ».
Il est exact que l’impérialisme français est à la remorque de l’impérialisme américain. De fait, la France n’est désormais qu’une puissance de second rang. C’est la conséquence du déclin de son poids économique relatif au cours des dernières décennies, qui ont été marquées par l’hyper-domination des Etats-Unis, l’ascension de la Chine et, plus récemment, le retour en force de la Russie. Dans ce contexte, le gouvernement de François Hollande – comme d’autres avant lui – a joué le rôle de bruyant caniche de l’impérialisme américain, lequel observait avec mépris le petit animal et, de temps à autre, lui flanquait un coup de botte. Il en ira de même avec le gouvernement Macron, malgré ses prétentions théâtrales à jouer un rôle important sur la scène mondiale.
Telle est la position réelle de l’impérialisme français. Dès lors, comment « l’indépendance » de la France à l’égard des Etats-Unis pourrait-elle contribuer à « préparer la paix », selon la formule de L’Avenir en commun ? Posons la même question autrement. Nous sommes favorables à la sortie de la France de l’OTAN ; mais en quoi cela empêcherait les autres puissances de l’OTAN – Etats-Unis en tête – de poursuivre leurs guerres impérialistes ?
L’Avenir en commun répond à cette question en proposant que l’Organisation des Nations Unies (ONU) joue un rôle central, décisif, dans les affaires du monde. Il faut « renforcer et réinvestir l’ONU pour faire vivre un monde ordonné », affirme le texte. C’est l’argument clé de toute cette partie du programme ; il y revient de différentes manières. Or c’est un argument sans consistance. Il est en complète contradiction avec ce qu’est l’ONU et son rôle réel dans les rapports internationaux.
Le rôle de l’ONU n’est pas d'empêcher les guerres. Cette institution n’a jamais joué un rôle progressiste. Elle n’est qu’un forum dans lequel les grandes puissances impérialistes débattent surtout des questions secondaires. Lorsqu’une question importante est à l’ordre du jour, l’ONU n’a pas le dernier mot : ce sont les grandes puissances qui décident, suivant leurs intérêts. On l’a vu, par exemple, dans le cas de l’invasion de l’Irak en 2003. Pour des raisons liées aux intérêts de l’impérialisme français, la France avait pris position, à l'ONU, contre l’intervention militaire. Qu’ont fait les impérialistes américains ? Ils ont tout de même envahi l’Irak, sans mandat de l’ONU. Et ce n’est là qu’un exemple parmi bien d’autres.
Il est vrai que, parfois, les cinq puissances du Conseil de Sécurité de l’ONU s’accordent sur certaines interventions militaires. Mais celles-ci n’en conservent pas moins leur caractère impérialiste et donc réactionnaire. La première guerre du Golfe (1990) était appuyée par l’ONU, tout comme l’embargo imposé à l’Irak entre 1991 et 2003, lequel a fait, selon les sources, entre 500 000 et 1,5 million de victimes, dont une majorité d’enfants. Plus récemment, il y a eu l’intervention en Libye (2011), dont chacun peut aujourd’hui apprécier les résultats. Et que dire de Haïti, ce pays martyr qui, depuis 2004, vit sous une dictature de facto des Casques bleus de l’ONU ?
L’énumération des crimes impérialistes « sous mandat de l’ONU » dépasse les limites de cette brochure. Mais ce qui précède suffit à justifier notre désaccord avec l’idée, formulée dans L’Avenir en commun, selon laquelle « le seul organe légitime pour assurer la sécurité collective est l’ONU ». De même, « refuser toute intervention militaire sans mandat de l’ONU » revient à éventuellement soutenir celles qui auraient un tel mandat. Ce n’est pas le bon critère. Et s’accrocher à ce critère, c’est tomber dans le piège des impérialistes, car l’une des fonctions de l’ONU est précisément de couvrir les guerres d’un voile de « légalité internationale », quand c’est possible. Il s’agit d’un élément de propagande non négligeable. Notre rôle est de dénoncer cette propagande et d’expliquer les véritables motivations des belligérants, dans chaque guerre.
Les auteurs de L'Avenir en commun n’ignorent pas les nombreux cas de guerres impérialistes « sous mandat de l’ONU ». Cela explique qu’ils proposent aussi d’« enclencher un processus de démocratisation » de l’ONU. Ils n’en disent rien de plus. Malheureusement, cette idée n’a aucun sens. L’ONU est une institution fondée par les grandes puissances impérialistes, contrôlée par ces puissances et n’ayant pas d’autre fonction que de défendre leurs intérêts, à commencer par ceux de l’impérialisme américain. La « démocratisation » de l’ONU a donc aussi peu de chance d’advenir que la démocratisation du Pentagone, par exemple.
Ce qui fait manifestement défaut, ici, c’est un point de vue de classe. De manière générale, L’Avenir en commun n’aborde pas la guerre d’un point de vue de classe. Par exemple, il est proposé d’« arrêter les guerres par une diplomatie active et indépendante au service de la paix ». Mais selon la formule célèbre et si juste du général Clausewitz, « la guerre n’est que le prolongement de la politique par d’autres moyens. » Autrement dit, les guerres impérialistes sont le prolongement inévitable de la lutte que se livrent les plus puissantes classes capitalistes pour des marchés, des sources de matière première et des zones d’influence. Tant que le capitalisme régnera sur notre planète, il y aura des guerres comme celles qui ravagent aujourd’hui le Moyen-Orient. La plus « active » et la plus « indépendante » des diplomaties pacifistes n’y changera rien.
En Syrie, par exemple, les dirigeants américains et russes luttent pour les intérêts de leurs classes dirigeantes respectives. Dès lors, que peut bien signifier l’idée, formulée dans L’Avenir en commun, de « mettre en place une coalition universelle sous mandat de l’ONU pour éradiquer Daesh et rétablir la paix et la stabilité en Syrie et en Irak » ? Une « coalition universelle » – réunissant tout le monde, par définition – suppose que les intérêts des grandes puissances impérialistes concordent complètement et tout le temps. Mais cette hypothèse est en complète contradiction avec toute l’histoire du capitalisme.
Souvent, l’horreur de la guerre pousse des militants de gauche à déclarer : « il faut faire quelque chose ! Tout de suite ! » Et trop souvent, cela se termine par le soutien à une intervention impérialiste. On voit ce que ça donne aujourd’hui en Libye, par exemple. Il faut en tirer les leçons. Et regarder les choses en face : la guerre est une caractéristique fondamentale, inévitable, du capitalisme moderne. On ne peut avoir l’un sans l’autre. Si nous voulons sérieusement lutter contre les guerres impérialistes, notre premier devoir est d’expliquer, à chaque occasion, quelle est la véritable nature de classe de la guerre et quels objectifs réels poursuivent les différentes forces engagées.
En France, il faut en priorité dénoncer les crimes de l’impérialisme français et mobiliser le mouvement ouvrier contre ces crimes. Et il faut inlassablement expliquer qu’une paix authentique, durable, universelle, ne sera possible que lorsque nous aurons débarrassé le monde du système capitaliste. Ce n’est peut-être pas pour « tout de suite », mais c’est la seule solution au fléau de la guerre.
Mouvement ou parti ?
Les militants de la FI débattent régulièrement de son avenir comme organisation. Est-ce qu'elle doit devenir un parti, comme l'est devenu Podemos en Espagne, ou doit-elle demeurer un mouvement ? Pour notre part, nous pensons que la transformation de la FI en un parti est nécessaire. Pour quelles raisons ?
Un parti est d'abord et avant tout un programme et des idées. Mais à la différence d'un mouvement, un parti est aussi un certain type de fonctionnement interne, qui vise à la fois un maximum d'efficacité et un maximum de contrôle démocratique des militants sur l'organisation, sa direction, son programme et sa stratégie. Bien sûr, dans les faits, beaucoup de partis ne sont ni démocratiques, ni efficaces – sinon pour faire avancer la carrière de leurs dirigeants. Le PS en offre un exemple écœurant. Cependant, ce n'est pas là une conséquence inévitable de la « forme parti ». Les causes de la bureaucratisation du PS ne sont pas à chercher du côté de son organisation ; elles sont à chercher du côté des pressions matérielles et idéologiques de la classe dirigeante sur sa direction, pressions qui ont fini par transformer la direction du PS en une clique de politiciens réactionnaires. La dégénérescence bureaucratique du PS a été déterminée par sa dégénérescence pro-capitaliste. Et elle ne date pas d'hier !
Un mouvement n'est pas à l'abri de déformations bureaucratiques. En un sens, il est même davantage exposé à ce danger, puisque la direction y est dégagée des mécanismes formels de contrôle démocratique qui caractérisent un parti. Encore une fois, ces mécanismes – élections internes, congrès, etc. – ne sont pas en eux-mêmes une garantie absolue contre le bureaucratisme, le carriérisme et les luttes d'appareil stériles. Il n'y a pas de garantie absolue dans ce domaine. Un parti n'existe pas dans le vide. C'est un organisme vivant qui subit les pressions de toutes les classes sociales, y compris la bourgeoisie. Mais il en va de même pour un mouvement. Simplement, en l'absence de mécanismes formels de contrôle démocratique du sommet par la base, un mouvement est encore plus exposé qu'un parti aux pressions de la classe dirigeante.
Enfin, un mouvement suffisait à organiser la campagne de Mélenchon à la présidentielle, l'enthousiasme aidant. Pour la campagne des législatives, par contre, l'absence de centralisations locales – de directions élues et capables de coordonner l'activité, d'orienter les forces militantes – s'est fait plus nettement sentir. Ce problème se reposera sans cesse à l'avenir. Chaque fois que la FI s'engagera dans de nouveaux combats, elle sera confrontée à la nécessité d'une plus grande structuration locale et nationale. Elle ne pourra pas pérenniser son travail et intégrer dans ses rangs la masse de jeunes et de travailleurs qui veulent y adhérer sans s'orienter vers la formation d'un parti. Dès lors, le mieux est de l'anticiper et d'y œuvrer consciemment. La FI n'en sera que mieux armée pour les grandes luttes qui l'attendent.