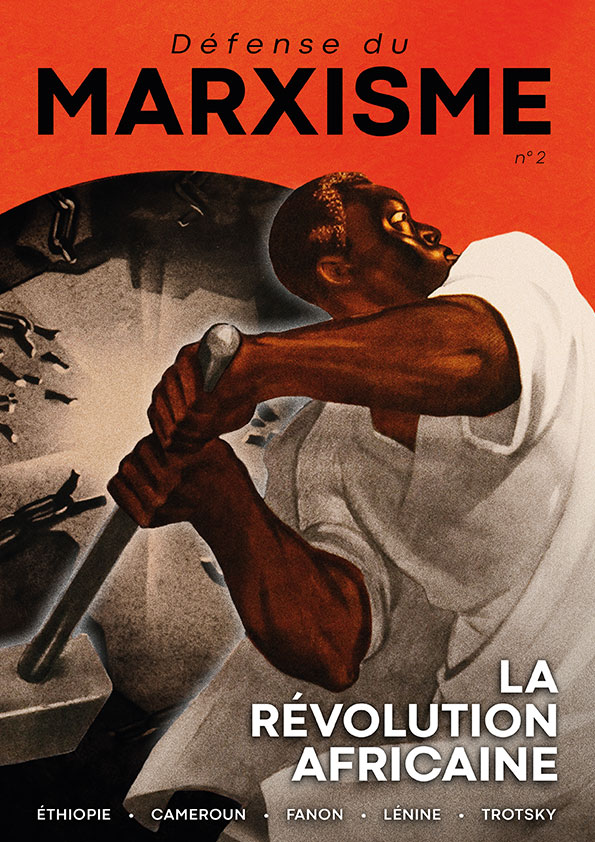Les esprits naïfs pensent que le titre de roi tient dans la personne même du roi, dans son manteau d’hermine et sa couronne, dans sa chair et son sang. En fait, le titre de roi naît des rapports entre les hommes. Le roi n’est roi que parce qu’au travers de sa personne se réfractent les intérêts et les préjugés de millions d’hommes. Quand ces rapports sont érodés par le torrent du développement, le roi n’est plus qu’un homme usé, à la lèvre inférieure pendante. Celui qui s’appelait jadis Alphonse XIII, pourrait nous fait part de ses impressions toutes fraîches sur ce sujet.
Le chef par la grâce du peuple se distingue du chef par la grâce de Dieu, en ce qu’il est obligé de se frayer lui-même un chemin ou, du moins, d’aider les circonstances à le lui ouvrir. Mais le chef est toujours un rapport entre les hommes, une offre individuelle en réponse à une demande collective. Les discussions sur la personnalité d’Hitler sont d’autant plus animées qu’elles cherchent avec plus de zèle le secret de sa réussite en lui-même. Il est pourtant difficile de trouver une autre figure politique qui soit, dans la même mesure, le point convergent de forces historiques impersonnelles. N’importe quel petit bourgeois enragé ne pouvait devenir Hitler, mais une partie d’Hitler est contenue dans chaque petit bourgeois.
La croissance rapide du capitalisme allemand avant la guerre ne signifia nullement la disparition pure et simple des classes intermédiaires ; en ruinant certaines couches de la petite bourgeoisie, il en créait de nouvelles : les artisans et les boutiquiers autour des usines, les techniciens et les administrateurs à l’intérieur des usines. Mais en se maintenant et même en se développant - elles représentent un peu moins de la moitié du peuple allemand - les classes intermédiaires se privaient de leur dernière parcelle d’indépendance, vivaient à la périphérie de la grande industrie et du système bancaire et se nourrissaient des miettes qui tombaient de la table des trusts monopolistes et des cartels, et des aumônes idéologiques de leurs théoriciens et politiciens traditionnels.
La défaite a dressé un mur sur le chemin de l’impérialisme allemand. La dynamique extérieure s’est transformée en dynamique intérieure. La guerre se changea en révolution. La social-démocratie, qui aida les Hohenzollern à mener la guerre jusqu’à son issue tragique, ne permit pas au prolétariat de mener la révolution jusqu’à son terme. La démocratie de Weimar a passé quatorze ans à essayer de se faire pardonner sa propre existence. Le Parti communiste a appelé les ouvriers à une nouvelle révolution, mais s’est avéré incapable de la diriger.
Le prolétariat allemand est passé par les hauts et les bas de la guerre, de la révolution, du parlementarisme et du pseudo-bolchevisme. Alors que les vieux partis de la bourgeoisie s’épuisaient complètement, la force dynamique de la classe ouvrière était minée.
Le chaos de l’après-guerre frappait les artisans, les marchands et les employés aussi durement que les ouvriers. La crise de l’agriculture ruinait les paysans. La décadence des couches moyennes ne pouvait signifier que leur prolétarisation dans la mesure où le prolétariat sécrétait lui-même une armée gigantesque de chômeurs chroniques. La paupérisation de la petite bourgeoisie, à peine dissimulée sous les cravates et les bas de soie synthétique, sapait toutes les croyances officielles et surtout la doctrine du parlementaire démocratique.
La multiplicité des partis, la fièvre froide des élections, les changements constants de gouvernements exacerbaient la crise sociale par un kaléidoscope de combinaisons politiques stériles. Dans l’atmosphère chauffée à blanc par la guerre, la défaite, les réparations, l’inflation, l’occupation de la Ruhr, la crise, le besoin et la rancune, la petite bourgeoisie se rebella contre tous les vieux partis qui l’avaient trompée. Ces vexations, vivement ressenties par les petits possédants qui ne pouvaient échapper à la faillite, par leurs fils qui sortaient de l’université et ne trouvaient ni emploi, ni client, et par leurs filles qui restaient sans dot et sans fiancé, réclamaient l’ordre et une main de fer.
Le drapeau du national-socialisme fut brandi par des hommes issus des cadres moyens et subalternes de l’ancienne armée. Couverts de décorations, les officiers et les sous-officiers ne pouvaient admettre que leur héroïsme et leurs souffrances aient été perdus pour la patrie, et surtout qu’ils ne leur donnent aucun droit particulier à la reconnaissance du pays. D’où leur haine pour la révolution et pour le prolétariat. Ils ne voulaient pas prendre leur parti du fait que les banquiers, les industriels, les ministres les reléguaient à des postes insignifiants de comptables, d’ingénieurs, d’employés des postes et d’instituteurs. D’où leur “ socialisme ”. Pendant les batailles de l’Yser et de Verdun, ils ont appris à risquer leur vie et celle des autres, et à parler la langue du commandement qui en impose tant aux petits bourgeois de l’arrière. C’est ainsi que ces hommes sont devenus des chefs.
Au début de sa carrière politique, Hitler ne se distinguait, peut-être, que par un tempérament plus énergique, une voix plus forte, une étroitesse d’esprit plus sûre d’elle-même. Il n’apportait au mouvement aucun programme tout prêt, si ce n’est la soif de vengeance du soldat humilié. Hitler commença par des injures et des récriminations contre les conditions de Versailles, la vie chère, le manque de respect pour le sous-officier méritant, les intrigues des banquiers et des journalistes de la foi de Moïse. On trouvait dans le pays suffisamment de gens qui se ruinaient, qui se noyaient, qui étaient couverts de cicatrices et d’ecchymoses encore toutes fraîches. Chacun d’eux voulait frapper du poing sur la table. Hitler le faisait mieux que les autres. Il est vrai qu’il ne savait pas comment remédier à tous ces malheurs. Mais ses accusations résonnaient tantôt comme un ordre, tantôt comme une prière adressée à un destin inflexible. Les classes condamnées, semblables à des malades incurables, ne se lassent pas de moduler leurs plaintes, ni d’écouter des consolations. Tous les discours d’Hitler étaient accordés sur ce diapason. Une sentimentalité informe, une absence totale de rigueur dans le raisonnement, une ignorance doublée d’une érudition désordonnée : tous ces moins se transformaient en plus. Cela lui donnait la possibilité de rassembler toutes les formes de mécontentement dans la besace de mendiant du national-socialisme, et de mener la masse là où elle le poussait. De ces premières improvisations, l’agitateur ne conservait dans sa mémoire que ce qui rencontrait l’approbation. Ses idées politiques étaient le fruit d’une acoustique oratoire. C’est ainsi qu’il choisissait ses mots d’ordre. C’est ainsi que son programme s’étoffait. C’est ainsi que d’un matériau brut se formait un “ chef ”.
Dès le début, Mussolini s’adressa de façon plus consciente à la matière sociale, qu’Hitler, qui se sent plus proche du mysticisme policier d’un quelconque Metternich que de l’algèbre politique de Machiavel. Du point de vue intellectuel, Mussolini est plus audacieux et cynique. Il suffit de nous rappeler que l’athée romain ne fait que se servir de la religion, comme il le fait de la police et de la justice, alors que son collègue berlinois croit réellement à la protection particulière de la Providence. A l’époque où le futur dictateur italien considérait encore Marx comme “ notre maître immortel à tous ”, il défendait, non sans habileté, la théorie qui voit avant tout dans la vie de la société actuelle l’interaction de deux classes fondamentales : la bourgeoisie et le prolétariat. Il est vrai, écrivait Mussolini en 1914, qu’entre elles se placent des couches intermédiaires très nombreuses, qui forment une sorte de “ tissu conjonctif du collectif humain ” ; mais “ dans les périodes de crise, les classes intermédiaires sont attirées, selon leurs intérêts et leurs idées, vers l’une ou l’autre des deux classes fondamentales ”. Généralisation très importante ! De même que la médecine scientifique permet de soigner un malade, mais aussi d’envoyer, de la manière la plus expéditive, un homme bien portant ad patres , l’analyse scientifique des rapports de classes, destinée par son auteur à mobiliser le prolétariat, a permis à Mussolini, quant il fut passé dans le camp adverse, de mobiliser les classes intermédiaires contre le prolétariat. Hitler accomplit le même travail, en traduisant dans la langue de la mystique allemande la méthodologie du fascisme.
Les bûchers, sur lesquels brûle la littérature impie du marxisme, éclairent vivement la nature de classe du national-socialisme. Tant que les nazis agissaient en tant que parti et non en tant que pouvoir d’Etat, l’accès de la classe ouvrière leur était presque entièrement fermé. D’autre part, la grande bourgeoisie, même celle qui soutenait financièrement Hitler, ne les considérait pas comme son parti. La “ renaissance ” nationale s’appuyait entièrement sur les classes moyennes - la partie la plus arriérée de la nation, fardeau pesant de l’histoire. L’habileté politique consistait à souder l’unité de la petite bourgeoisie au moyen de la haine pour le prolétariat. Que faut-il faire pour que ce soit encore mieux ? Avant tout écraser ceux qui sont en bas. La petite bourgeoisie, impuissante face au grand capital, espère désormais reconquérir sa dignité sociale en écrasant les ouvriers.
Les nazis baptisent leur coup d’Etat du nom usurpé de révolution. En fait, en Allemagne comme en Italie, le fascisme laisse le système social inchangé. Le coup d’Etat d’Hitler, en tant que tel, n’a même pas droit au titre de contre-révolution. Mais on ne peut pas le considérer isolément : il est l’aboutissement d’un cycle de secousses qui ont commencé en Allemagne en 1918. La révolution de novembre, qui donnait le pouvoir aux conseils d’ouvriers et de soldats, était fondamentalement prolétarienne. Mais le parti qui était à la tête du prolétariat, rendit le pouvoir à la bourgeoisie. En ce sens, la social-démocratie a ouvert une ère de contre-révolution, avant que la révolution n’ait eu le temps d’achever son œuvre. Toutefois, tant que la bourgeoisie dépendait de la social-démocratie, et par conséquent des ouvriers, le régime conservait des éléments de compromis. Mais la situation intérieure et internationale du capitalisme allemand ne laissait plus de place aux concessions. Si la social-démocratie sauva la bourgeoisie de la révolution prolétarienne, le tour est venu pour le fascisme de libérer la bourgeoisie de la social-démocratie. Le coup d’Etat d’Hitler n’est que le maillon final dans la chaîne des poussées contre-révolutionnaires.
Le petit bourgeois est hostile à l’idée de développement, car le développement se fait invariablement contre lui : le progrès ne lui a rien apporté, si ce n’est des dettes insolvables. Le national-socialisme rejette le marxisme mais aussi le darwinisme. Les nazis maudissent le matérialisme, car les victoires de la technique sur la nature ont entraîné la victoire du grand capital sur le petit. Les chefs du mouvement liquident “ l’intellectualisme ” non pas tant parce que eux-mêmes possèdent des intelligences de deuxième ou de troisième ordre, mais surtout parce que leur rôle historique ne saurait admettre qu’une pensée soit menée jusqu’à son terme. Le petit bourgeois a besoin d’une instance supérieure, placée au-dessus de la matière et de l’histoire, et protégée de la concurrence, de l’inflation, de la crise et de la vente aux enchères. Au développement, à la pensée économique, au rationalisme - aux XXe, XIXe et XVIIIe siècles - s’opposent l’idéalisme nationaliste, en tant que source du principe héroïque. La nation d’Hitler est l’ombre mythique de la petite bourgeoisie elle-même, son rêve pathétique d’un royaume millénaire sur terre.
Pour élever la nation au-dessus de l’histoire, on lui donne le soutien de la race. L’histoire est vue comme une émanation de la race. Les qualités de la race sont construites indépendamment des conditions sociales changeantes. Rejetant “la pensée économique” comme vile, le national-socialisme descend un étage plus bas : du matérialisme économique il passe au matérialisme zoologique.
La théorie de la race, qu’on dirait créée spécialement pour un autodidacte prétentieux et qui se présente comme la clé universelle de tous les secrets de la vie, apparaît sous un jour particulièrement lamentable à la lumière de l’histoire des idées. Pour fonder la religion du sang véritablement allemand, Hitler dut emprunter de seconde main les idées du racisme à un Français, diplomate et écrivain dilettante, le comte Gobineau. Hitler trouva une méthodologie politique toute prête chez les Italiens. Mussolini a largement utilisé la théorie de Marx de la lutte des classes. Le marxisme lui-même est le fruit de la combinaison de la philosophie allemande, de l’histoire française et de l’économie anglaise. Si l’on examine rétrospectivement la généalogie des idées, même les plus réactionnaires et les plus stupides, on ne trouve pas trace du racisme.
L’indigence infinie de la philosophie nationale-socialiste n’a pas empêché, évidemment, la science universitaire d’entrer toutes voiles déployées dans le chenal d’Hitler, une fois que sa victoire se fut suffisamment précisée. Les années du régime de Weimar furent pour la majorité de la racaille professorale, un temps de trouble et d’inquiétude. Les historiens, les économistes, les juristes et les philosophes se perdaient en conjectures pour savoir lequel des critères de vérité qui s’affrontaient, était le bon, c’est-à-dire quel camp resterait finalement maître de la situation. La dictature fasciste dissipe les doutes des Faust et les hésitations des Hamlet de l’Université. Sortant des ténèbres de la relativité parlementaire, la science entre à nouveau dans le royaume des absolus. Einstein fut obligé d’aller chercher refuge hors des frontières de l’Allemagne.
Sur le plan politique, le racisme est une variété hypertrophiée et vantarde du chauvinisme associé à la phrénologie. De même que l’aristocratie ruinée trouvait une consolation dans la noblesse de son sang, la petite bourgeoisie paupérisée s’enivre de contes sur les mérites particuliers de sa race. Il est intéressant de remarquer que les chefs du national-socialisme ne sont pas de purs Allemands, mais sont originaires d’Autriche comme Hitler lui-même, des anciennes provinces baltes de l’empire tsariste, comme Rosenberg, des pays coloniaux, comme l’actuel remplaçant d’Hitler à la direction du parti, Hess. Il a fallu l’école de l’agitation nationaliste barbare aux confins de la culture pour inspirer aux “ chefs ” les idées qui ont trouvé par la suite un écho dans le coeur des classes les plus barbares de l’Allemagne.
L’individu et la classe - le libéralisme et le marxisme - voilà le mal. La nation c’est le bien. Mais cette philosophie se change en son contraire au seuil de la propriété. Le salut est uniquement dans la propriété individuelle. L’idée de propriété nationale est une engeance du bolchevisme. Tout en divinisant la nation, le petit bourgeois ne veut rien lui donner. Au contraire, il attend que la nation lui distribue la propriété et le protège de l’ouvrier et de l’huissier. Malheureusement, le IIIe Reich ne donnera rien au petit bourgeois, si ce n’est de nouveaux impôts.
Dans le domaine de l’économie contemporaine, internationale par ses liens, impersonnelle dans ses méthodes, le principe de race semble sorti d’un cimetière moyenâgeux. Les nazis font par avance des concessions : la pureté de la race qui se contente d’un passeport dans le royaume de l’esprit, doit surtout prouver son savoir-faire dans le domaine économique. Cela signifie dans les conditions actuelles : être compétitif. Le racisme, débarrassé des libertés politiques, revient au libéralisme économique par la porte de derrière.
Pratiquement, le nationalisme en économie se réduit à des explosions d’antisémitisme impuissantes, malgré toute leur brutalité. Les nazis éloignent du système économique actuel, comme une force impure, le capital usurier ou bancaire : la bourgeoisie juive occupe précisément dans cette sphère, comme chacun sait, une place importante. Tout en se prosternant devant le capitalisme dans son entier, le petit bourgeois déclare la guerre à l’esprit mauvais de lucre, personnifié par le juif polonais au manteau long et, bien souvent, sans un sou en poche. Le pogrome devient la preuve supérieure de la supériorité raciale. .
Le programme avec lequel le national-socialisme est arrivé au pouvoir, rappelle tout à fait, hélas, le magasin “ universel ” juif dans les trous de province : que n’y trouve-t-on pas, à des prix bas et d’une qualité encore plus basse ! Des souvenirs sur le temps “ heureux ” de la libre concurrence et des légendes sur la solidité de la société divisée en états ; des espoirs de renaissance de l’empire colonial et des rêves d’économie fermée ; des phrases sur l’abandon du droit romain et le retour au droit germain et des proclamations sur le moratoire américain ; une hostilité envieuse pour l’inégalité, que symbolisent l’hôtel particulier et l’automobile, et une peur animale devant l’égalité, qui a l’aspect de l’ouvrier en casquette et sans col ; le déchaînement du nationalisme et sa peur devant les créanciers mondiaux... Tous les déchets de la pensée politique internationale sont venus remplir le trésor intellectuel du nouveau messianisme allemand.
Le fascisme a amené à la politique les bas-fonds de la société. Non seulement dans les maisons paysannes, mais aussi dans les gratte-ciel des villes vivent encore aujourd’hui, à côté du XXe siècle, le Xe et le XIIe siècles. Des centaines de millions de gens utilisent le courant électrique, sans cesser de croire à la force magique des gestes et des incantations. Le pape à Rome prêche à la radio sur le miracle de la transmutation de l’eau en vin. Les étoiles de cinéma se font dire la bonne aventure. Les aviateurs qui dirigent de merveilleuses mécaniques, créées par le génie de l’homme, portent des amulettes sous leur combinaison. Quelles réserves inépuisables d’obscurantisme, d’ignorance et de barbarie ! Le désespoir les a fait se dresser, le fascisme leur a donné un drapeau. Tout ce qu’un développement sans obstacle de la société aurait dû rejeter de l’organisme national, sous la forme d’excréments de la culture, est maintenant vomi : la civilisation capitaliste vomit une barbarie non digérée. Telle est la physiologie du national-socialisme.
Le fascisme allemand, comme le fascisme italien, s’est hissé au pouvoir sur le dos de la petite bourgeoisie, dont il s’est servi comme d’un bélier contre la classe ouvrière et les institutions de la démocratie. Mais le fascisme au pouvoir n’est rien moins que le gouvernement de la petite bourgeoisie. Au contraire, c’est la dictature la plus impitoyable du capital monopoliste. Mussolini a raison : les classes intermédiaires ne sont pas capables d’une politique indépendante. Dans les périodes de crise, elles sont appelées à poursuivre jusqu’à l’absurde la politique de l’une des deux classes fondamentales. Le fascisme a réussi à les mettre au service du capital. Des mots d’ordre comme l’étatisation des trusts et la suppression des revenus ne provenant pas du travail, ont été immédiatement jetés pardessus bord dès l’arrivée au pouvoir. Au contraire, le particularisme des “ terres ” allemandes, qui s’appuyait sur les particularités de la petite bourgeoisie, a fait place nette pour le centralisme policier capitaliste. Chaque succès de la politique intérieure et extérieure du national-fascisme marquera inévitablement la poursuite de l’étouffement du petit capital par le grand.
Le programme des illusions petites bourgeoises n’est pas supprimé ; il se détache simplement de la réalité et se transforme en actions rituelles. L’union de toutes les classes se ramène à un demi-symbolisme de service de travail obligatoire et à la confiscation “ au profit du peuple ” de la fête ouvrière du ler mai. Le maintien de l’alphabet gothique contre l’alphabet latin est une revanche symbolique sur le joug du marché mondial. La dépendance à l’égard des banquiers internationaux, et notamment européens, ne diminue pas d’un iota ; en revanche, il est interdit d’égorger les animaux selon le rituel du Talmud. Si l’enfer est pavé de bonnes intentions, les chaussées du Troisième Reich sont couvertes de symboles.
Une fois le programme des illusions petites bourgeoises réduit à une pure et simple mascarade bureaucratique, le national-socialisme s’élève au-dessus de la nation, comme la forme la plus pure de l’impérialisme. L’espoir que le gouvernement de Hitler tombera, si ce n’est aujourd’hui, demain, victime de son inconsistance interne, est tout à fait vain. Un programme était nécessaire aux nazis pour arriver au pouvoir ; mais le pouvoir ne sert absolument pas à Hitler à remplir son programme. C’est le capital monopoliste qui lui fixe ses tâches. La concentration forcée de toutes les forces et moyens du peuple dans l’intérêt de l’impérialisme, qui est la véritable mission historique de la dictature fasciste, implique la préparation de la guerre ; ce but, à son tour, ne tolère aucune résistance intérieure et conduit à une concentration mécanique ultérieure du pouvoir. Il est impossible de réformer le fascisme ou de lui donner son congé. On ne peut que le renverser. L’orbite politique du régime des nazis bute contre l’alternative : la guerre ou la révolution ?
Prinkipo, le 10 juin 1933
Post-scriptum à l’article "Qu’est-ce que le national-socialisme ?"
Le premier anniversaire de la dictature des nazis se rapproche. Toutes les tendances du régime ont eu le temps de s’affirmer et de se préciser. La révolution “ socialiste ” qui était présentée aux masses petites bourgeoises comme le complément nécessaire à la révolution nationale, est condamnée et liquidée officiellement. La fraternité des classes a trouvé son point culminant dans le faits que les possédants, le jour fixé par le gouvernement, se privent de hors-d’oeuvre et de dessert au profit des non-possédants. La lutte contre le chômage s’est ramenée à partager en deux la demi-portion de famine. Le reste est pris en charge par une statistique uniformisée. L’autarcie planifiée est simplement un nouveau stade du déclin économique.
Plus le régime policier des nazis est impuissant dans le domaine de l’économie, plus il est obligé de reporter ses efforts dans le domaine de la politique extérieure. Ce qui s’accorde pleinement à la dynamique intérieure du capitalisme allemand, foncièrement agressif. Le brusque revirement des chefs nazis qui se sont mis à tenir des propos pacifistes, ne pouvait étonner que les naïfs incurables ; Hitler avait-il une autre solution pour faire endosser la responsabilité des désastres intérieurs à des ennemis extérieurs, et accumuler sous la presse de la dictature la force explosive de l’impérialisme ? Cette partie du programme, mentionnée déjà ouvertement avant la venue des nazis au pouvoir, se réalise aujourd’hui avec une logique de fer aux yeux du monde entier. Le temps nécessaire à l’armement de l’Allemagne détermine le délai qui sépare d’une nouvelle catastrophe européenne. Il ne s’agit pas de mois, ni de décennies. Quelques années sont suffisantes pour que l’Europe se retrouve à nouveau plongée dans la guerre, si les forces intérieures à l’Allemagne elle-même n’en empêchent pas à temps Hitler.
Léon Trotsky, le 2 novembre 1933