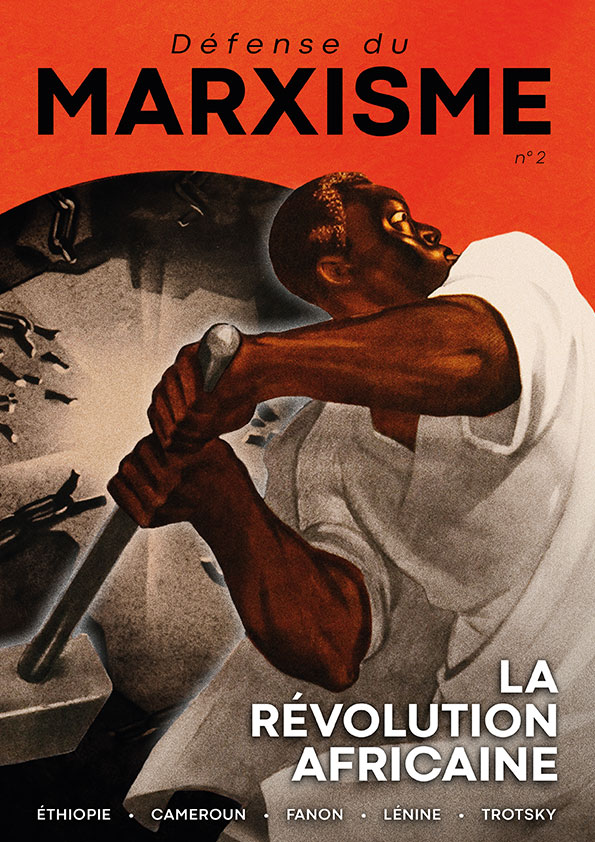Chapitre 1 – Avons-nous besoin de la philosophie ?
Avant de commencer, on pourrait être tenté de demander : « A quoi bon ? » Vaut-il vraiment la peine de s’embarrasser des questions compliquées de la science et de la philosophie ? Deux réponses sont possibles. S’il s’agit de savoir si on a besoin de connaître ces choses pour vivre au quotidien, la réponse est bien évidemment : non. Mais s’il s’agit d’acquérir une compréhension rationnelle du monde dans lequel on vit, ainsi que des processus à l’œuvre dans la nature, la société et notre propre mode de pensée – alors la question apparaît sous une tout autre lumière.
Cela peut paraître étrange, mais tout le monde a une « philosophie ». Une philosophie est une façon de concevoir le monde. Nous pensons tous savoir comment distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Ce sont pourtant des questions très complexes sur lesquelles se sont penchés les plus grands esprits de l’histoire. Lorsqu’ils sont confrontés à l’existence d’événements aussi terribles que la guerre fratricide en ex-Yougoslavie, la réémergence du chômage de masse ou la guerre civile au Rwanda, nombreux sont ceux qui admettent ne rien y comprendre. Souvent, ils font vaguement allusion à la « nature humaine ». Mais qu’est-ce que cette mystérieuse nature humaine, dont on fait la source de tous nos problèmes et qui est censée être de toute éternité égale à elle-même ? Voilà une question profondément philosophique, à laquelle peu de gens se risqueraient à répondre, sauf ceux qui, dotés d’un esprit religieux, diront que Dieu, dans sa grande sagesse, nous a créés tels que nous sommes. Quant à savoir pourquoi il faut adorer un Etre qui joue tant de mauvais tours à sa créature, c’est un autre problème.
Ceux qui maintiennent obstinément qu’ils n’ont pas de philosophie se trompent. La nature a horreur du vide. En l’absence d’une conception philosophique élaborée de façon cohérente, la pensée des gens reflète les idées et les préjugés de la société et du milieu dans lesquels ils vivent. Dans le contexte actuel, cela signifie que leur cerveau sera plein d’idées provenant des journaux, de la télévision, de l’Eglise, de l’école – bref, d’idées qui reflètent les intérêts et la morale de la société actuelle (capitaliste).
En général, la plupart des gens traversent la vie en s’arrangeant comme ils le peuvent, jusqu’à ce que de grands événements les obligent à reconsidérer les idées et les valeurs avec lesquelles ils ont grandi. La crise de la société les force à remettre en cause bien des choses qu’ils considéraient comme évidentes. En de tels moments, des idées qui leur semblaient invraisemblables leur apparaissent soudain d’une saisissante pertinence. Pour comprendre la vie autrement que comme une série d’accidents dénuée de sens, ou comme une routine aveugle, il faut s’intéresser à la philosophie, c’est-à-dire à un niveau de réflexion qui va au-delà des problèmes immédiats de la vie quotidienne. C’est le seul moyen de nous élever à un niveau qui nous permettra de commencer à réaliser notre potentiel d’êtres humains conscients, capables de contrôler leur propre destinée.
Il est généralement admis que tout ce qui vaut la peine, dans la vie, nécessite un certain effort. L’étude de la philosophie implique nécessairement des difficultés, puisqu’elle aborde des sujets très éloignés du domaine de l’expérience quotidienne. Même sa terminologie constitue une difficulté, dans la mesure où les mots y sont employés dans un sens qui ne correspond pas forcément à leur usage courant. Cela est vrai pour toutes les spécialisations scientifiques, de la psychologie à l’ingénierie.
Le deuxième obstacle est plus sérieux. Lorsque Marx et Engels, au siècle dernier, ont publié leurs ouvrages sur le matérialisme dialectique, ils pouvaient supposer qu’un bon nombre de leurs lecteurs possédaient au moins une bonne connaissance de la philosophie classique, y compris de la pensée de Hegel. Aujourd’hui, il en va tout autrement. La philosophie n’occupe plus la même place qu’avant. Les sciences occupent depuis longtemps la place qui revenait autrefois aux spéculations sur la vie et la nature de l’univers. Les puissants télescopes et les navettes spatiales ont rendu inutiles les hypothèses philosophiques sur la nature et l’étendue de notre système solaire. Même les mystères de l’âme humaine sont graduellement levés par les progrès de la neurobiologie et de la psychologie.
La situation est beaucoup moins satisfaisante dans le domaine des sciences sociales. La principale raison en est que le désir d’une connaissance exacte décroît souvent au fur et à mesure que la science s’approche des puissants intérêts matériels qui gouvernent la vie des hommes. Le présent ouvrage n’a pas pour sujet les énormes progrès réalisés par Marx et Engels dans les domaines de l’économie et des sciences sociales et historiques. Il suffit de dire que malgré les attaques permanentes et souvent malveillantes dont elles ont été l’objet depuis leur naissance, les théories marxistes relatives à la sphère sociale ont été le facteur décisif dans le développement des sciences sociales modernes. Quant à leur vitalité, elle s’exprime bien dans le fait que les attaques non seulement continuent, mais ont même tendance, avec le temps, à s’intensifier.
Dans un lointain passé, le développement de la science – qui a toujours été étroitement lié au développement des forces productives – n’avait pas atteint un niveau suffisant pour permettre aux hommes et aux femmes de comprendre le monde dans lequel ils vivaient. En l’absence d’un savoir scientifique, ou encore des moyens matériels de l’acquérir, ils étaient obligés d’utiliser le seul instrument à leur disposition pour comprendre le monde, et par suite le dominer – à savoir l’esprit humain. Cette lutte pour comprendre le monde allait de pair avec la lutte des hommes pour s’arracher aux conditions d’existence propres aux animaux, pour maîtriser les forces aveugles de la nature et pour devenir des êtres libres au sens réel – et non simplement juridique – du terme. Cette lutte est un fil rouge qui traverse toute l’histoire de l’espèce humaine.
Le rôle de la religion
« L’homme est insensé. Il ne saurait forger une punaise, et forge des dieux à la douzaine. » (Montaigne)
« Toute mythologie maîtrise, domine les forces de la nature et leur donne forme dans le domaine de l’imagination et par l’imagination ; elle disparaît donc quand ces forces sont dominées réellement. » (Marx)
Les animaux n’ont pas de religion, et on a souvent dit, dans le passé, que c’est ce qui constituait la principale différence entre l’homme et la « bête ». Mais ce n’était qu’une façon comme une autre de dire que seuls les hommes possèdent une conscience au plein sens du terme. Ces dernières années, il y a eu une réaction contre l’idée que l’homme était le produit d’un acte spécifique de création divine. Il est indubitable que les hommes se sont développés à partir du stade animal – et d’ailleurs, dans bien des domaines, demeurent des animaux. Non seulement nous partageons avec eux un grand nombre de fonctions corporelles, mais nous partageons aussi plus de 98 % du patrimoine génétique des chimpanzés. C’est là une réponse définitive aux absurdités que professent les créationnistes.
De récentes recherches sur les chimpanzés bonobos ont prouvé avec certitude que les primates les plus proches de l’homme sont capables d’avoir une activité mentale semblable, sous certains rapports, à celle d’un enfant humain. C’est une preuve frappante de la parenté qui relie les hommes aux primates les plus évolués. Mais l’analogie s’arrête là. Malgré tous les efforts des scientifiques, les bonobos en captivité ne sont jamais parvenus à parler ou à fabriquer un outil de pierre ressemblant, même de loin, aux outils les plus élémentaires confectionnés par les premiers hominidés. Les 2 % de différence génétique entre les hommes et les chimpanzés marquent le saut qualitatif entre l’homme et l’animal. Et cela s’est accompli, non par l’action du Créateur, mais grâce au développement du cerveau par le biais du travail manuel.
La fabrication des plus simples outils de pierre nécessite un très haut niveau d’abstraction et d’habileté mentale. La sélection du type de pierre adéquat, le choix du bon angle pour la frapper, le dosage exact de la force de frappe – ce sont là autant d’actions intellectuelles hautement complexes. Elles impliquent un niveau de prévision et de préparation que l’on ne retrouve chez aucun des primates les plus évolués. Cependant, l’ancêtre éloigné de l’homme n’a pas accédé à la fabrication et à l’usage d’outils de pierre par l’effet d’une intention consciente, mais sous la pression de la nécessité. Ce n’est pas la conscience qui a créé l’humanité, mais les conditions matérielles de l’existence humaine qui ont mené au développement du cerveau, au langage et à la culture – y compris la religion.
Le besoin de comprendre le monde était étroitement lié à la nécessité de survivre. Ceux, parmi les premiers hominidés, qui ont découvert l’utilité de racloirs en pierre pour découper les animaux morts à peau épaisse, étaient considérablement avantagés par rapport à ceux qui n’avaient pas accès à cette riche réserve de graisse et de protéine. Ceux qui perfectionnaient leurs outils de pierre et savaient où trouver les meilleurs matériaux avaient plus de chances de survivre que les autres. Le développement de la technique s’accompagna d’un accroissement des capacités mentales et du besoin d’expliquer les phénomènes naturels qui gouvernaient les hommes. Pendant des millions d’années jalonnées d’essais et d’erreurs, nos ancêtres ont commencé à établir certaines relations entre les choses. Ils commençaient à élaborer des abstractions, c’est-à-dire à penser en termes généraux à partir de l’expérience et de la pratique.
Pendant des siècles, le rapport entre l’être et la pensée était la question centrale de la philosophie. La plupart des gens vivent passablement bien sans se soucier de ce problème. Ils n’éprouvent pas pour autant la moindre difficulté à penser, agir, parler et travailler. En outre, il ne leur viendrait pas à l’esprit de considérer comme incompatibles les deux aspects les plus fondamentaux de l’existence humaine que sont l’être et la pensée. Ils sont, en effet, inséparablement liés. Si l’on exclut les simples réactions biologiquement déterminées, même l’action physique la plus élémentaire exige quelque pensée. C’est aussi vrai, dans une certaine mesure, des animaux, par exemple du chat qui guette une souris. Cependant, le niveau de la pensée et de la prévision consciente chez l’homme est qualitativement bien supérieur à celui de l’activité mentale du plus évolué des singes.
Ce fait est indissociable de l’aptitude à la pensée abstraite, laquelle permet à l’esprit humain de projeter son raisonnement beaucoup plus loin que ce qui lui est immédiatement donné par ses sens. Nous pouvons concevoir non seulement les situations passées (les animaux ont aussi une mémoire, comme l’atteste l’attitude d’un chien à la vue d’un bâton), mais aussi les situations futures. On peut anticiper des situations complexes, planifier des choses et, par conséquent, en déterminer l’issue, et même, dans une certaine mesure, déterminer notre propre avenir. On n’y réfléchit pas, en général, mais ce sont là des accomplissements colossaux, grâce auxquels l’humanité se distingue du reste de la nature. « Ce qui caractérise le raisonnement humain », écrit le professeur Gordon Childe, « c’est le fait qu’il puisse, bien plus que celui de toute autre forme de vie animale, s’éloigner de son environnement concret et immédiat » (What Happened in History, p. 19.) De cette faculté découlent toutes les œuvres de la civilisation, la culture, l’art, la musique, la littérature, la science, la philosophie et la religion. Nous devons comprendre que tout cela n’est pas tombé du ciel, mais constitue le produit de millions d’années de développement.
Le philosophe grec Anaxagore (500-428 av. J.-C.) formulait la brillante déduction suivante : le développement de l’esprit humain a dépendu de la libération de ses mains. Dans son important article, Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme, Engels montre avec précision comment cette transition s’est effectuée. Il y démontre comment la station verticale – en libérant les mains pour le travail – et la forme des mains – l’opposition du pouce aux autres doigts, qui permet de saisir des objets – constituaient les conditions physiologiques de la fabrication d’outils, laquelle, en retour, fut le principal facteur du développement du cerveau. De même, la production sociale est-elle à l’origine du langage (qui est indissociable de la pensée) : il découlait du besoin de coopération dans l’accomplissement de tâches complexes. Les découvertes les plus récentes de la paléontologie ont apporté une confirmation frappante aux théories d’Engels. Elles montrent en effet que les singes hominidés sont apparus, en Afrique, beaucoup plus tôt qu’on ne le croyait, et que leur cerveau n’était pas plus gros que celui d’un chimpanzé moderne. Autrement dit, le développement du cerveau est postérieur à la production d’outils et en est le résultat. Ainsi, on ne doit pas dire : « Au commencement était le Verbe », mais plutôt, suivant les mots du poète allemand Goethe : « Au commencement était l’Action ».
L’aptitude à penser par abstractions est indissociable du langage. D’après le célèbre préhistorien Gordon Childe : « Le raisonnement et ce que nous appelons plus généralement la pensée, y compris celle du chimpanzé, impliquent des opérations mentales utilisant ce que les psychologues appellent des images. L’image mentale d’une banane, par exemple, se rapprochera toujours de l’image d’une banane particulière dans un cadre particulier. A l’inverse, un mot est plus général et abstrait, puisqu’il élimine toutes les caractéristiques accidentelles qui donnent sa singularité à telle banane existante. Les images mentales des mots (l’image du son du mot ou des mouvements musculaires impliqués dans sa prononciation) constituent autant de supports bien commodes pour la pensée. A l’aide de ces images mentales, la pensée acquiert précisément cette généralité et cette abstraction qui semblent faire défaut aux animaux. Les hommes peuvent penser et parler au sujet de cette classe d’objets appelés “bananes” ; le chimpanzé ne va jamais plus loin que : “cette banane dans ce réceptacle”. En ce sens, l’instrument social que nous appelons le langage a contribué à “l’émancipation de l’homme vis-à-vis du concret” » [Ibid.].
Au terme d’une longue période, les premiers hommes ont formé des idées générales – disons, par exemple, celles d’animal et de plante. Ces idées sont apparues sur la base de l’observation concrète d’un nombre considérable de plantes et d’animaux. Mais lorsqu’on en arrive au concept général de « plante », nous ne pensons plus à telle fleur ou tel buisson, mais à ce qui leur est commun. On saisit alors l’essence de la plante, sa réalité intime. Comparées à cette essence, les caractéristiques particulières d’une plante donnée apparaissent comme secondaires et instables. Seul le concept général de plante en retient ce qui est permanent et universel. Certes, à la différence des plantes et des buissons particuliers, on ne peut voir le concept de plante. C’est une abstraction mentale. Mais c’est aussi une expression plus profonde et plus juste de ce qui constitue l’essence d’une plante, lorsqu’elle est dépouillée de toutes ses caractéristiques secondaires.
Cela dit, les abstractions des premiers hommes étaient loin d’avoir un caractère scientifique. Il s’agissait d’explorations naïves, semblables aux impressions d’un enfant – des suppositions et des hypothèses, parfois incorrectes, mais toujours audacieuses et imaginatives. Pour nos ancêtres éloignés, le soleil était un Grand Etre qui parfois les chauffait et parfois les brûlait. La terre était un géant endormi. Le feu était un animal féroce qui les mordait quand ils le touchaient. La foudre et le tonnerre devaient les effrayer, comme ils continuent d’effrayer les animaux et les hommes. Mais à la différence des animaux, ils cherchaient une explication générale à ce phénomène. Etant donnée l’absence de tout savoir scientifique, l’explication trouvée était invariablement surnaturelle : il s’agissait peut-être de quelque dieu frappant une enclume avec son marteau. De telles explications nous semblent aujourd’hui simplement amusantes, comme les explications naïves des enfants. Et pourtant, il s’agissait à l’époque d’hypothèses extrêmement importantes – de tentatives de trouver une cause rationnelle à ce phénomène. Les hommes cherchaient alors au-delà de l’expérience immédiate du phénomène, et trouvaient sa cause complètement en dehors de celle-ci.
La forme la plus caractéristique des premières religions est l’animisme – c’est-à-dire l’idée qu’un esprit habite toute chose, animée ou inanimée. Nous voyons le même type de croyance chez l’enfant qui frappe la table contre laquelle il vient de se cogner. De la même manière, les premiers hommes demandaient pardon à l’esprit d’un arbre avant de le couper, et certaines tribus le font encore aujourd’hui. L’animisme correspond à une époque où l’espèce humaine ne s’était pas encore complètement séparée du monde animal et de la nature en général. La proximité entre ces hommes et le monde animal est encore attestée par la fraîcheur et la beauté des peintures sur les parois de certaines grottes : des chevaux, des bisons et des biches y sont représentés avec un naturel qui ne pourrait plus être reproduit par un artiste moderne. C’était l’enfance de l’espèce humaine, que l’on ne retrouvera jamais. Nous ne pouvons qu’imaginer la psychologie de ces ancêtres éloignés. Mais en combinant les découvertes de la paléontologie et de l’anthropologie, il nous est possible de reconstituer, du moins dans ses grandes lignes, le monde dont nous sommes issus.
Dans sa célèbre étude anthropologique sur l’origine de la magie et de la religion, Sir James Frazer écrit : « Le sauvage conçoit à peine la distinction que font les peuples plus évolués entre ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. Pour lui, le monde est dans une large mesure habité par des agents surnaturels, c’est-à-dire des personnalités agissant selon des impulsions et des motifs semblables aux siens, et qui sont comme lui susceptibles d’être influencés si on en appelle à leur pitié, à leurs espoirs ou à leurs craintes. Dans un monde ainsi conçu, le sauvage ne voit pas de limites à son pouvoir de modifier à son avantage le cours de la nature. Les prières, les promesses ou les menaces inciteront peut-être les dieux à lui apporter le beau temps ou une bonne récolte. Et si, comme il le croit parfois, il advient qu’un dieu s’incarne dans sa propre personne, le sauvage n’a plus à en appeler à un être supérieur ; il possède alors en lui-même tous les pouvoirs nécessaires pour assurer son bien-être et celui de ses semblables. » (The Golden Bough, p. 10.)
L’idée que l’âme existe séparément et indépendamment du corps remonte aux temps les plus reculés de la sauvagerie. L’origine de cette idée est assez claire. Lorsque nous dormons, il semble que notre âme quitte notre corps et vagabonde sous la forme du rêve. Par analogie, la similitude entre la mort et le sommeil (cette « deuxième forme de la mort », disait Shakespeare) a suggéré l’idée que l’âme continue d’exister après la mort. Nos vieux ancêtres en ont déduit que quelque chose de distinct du corps existait en eux : l’âme, qui commande le corps et peut faire toutes sortes de choses incroyables, y compris lorsque le corps est endormi. De même, ils ont observé que des paroles sages sortaient de la bouche des personnes âgées, et en ont déduit que si le corps est périssable, l’âme vit pour toujours. Chez des peuples habitués à la notion de migration, la mort apparaissait comme une migration de l’âme, laquelle avait besoin, pour son voyage, d’être nourrie et équipée.
Dans un premier temps, ces esprits n’eurent pas de demeure fixe. Ils ne faisaient qu’errer sans but, provoquant en général des troubles, ce qui obligeait les hommes à recourir à des moyens extraordinaires pour les apaiser. Telle est l’origine des cérémonies religieuses. Finalement, l’idée a émergé que l’aide de ces esprits pouvait être obtenue au moyen de la prière. A ce stade, la religion (la magie), l’art et la science n’étaient pas encore différenciés. Dans la mesure où les premiers hommes ne disposaient pas de moyens pour maîtriser leur environnement, ils tentaient de soumettre la nature à leur volonté en établissant avec elle des rapports magiques.
L’attitude des premiers hommes à l’égard de leurs dieux-esprits et fétiches était éminemment pragmatique. Ils attendaient de leurs prières des résultats concrets. Un homme dessinait de ses propres mains une image et se prosternait devant elle ; mais si le résultat attendu ne venait pas rapidement, il se mettait à maudire et frapper l’image, de façon à obtenir par la violence ce qu’il ne parvenait pas à obtenir par la supplication. Dans ce monde étrange, peuplé de rêves et de fantômes, ce monde de religion, l’homme primitif voyait l’œuvre d’un esprit dans tout ce qui arrivait. Chaque buisson et chaque ruisseau était une créature vivante – bienveillante ou hostile. Un esprit était la cause de chaque incident, de chaque rêve, chaque souffrance et chaque sensation. Les explications religieuses comblaient le vide laissé par l’absence d’une connaissance des lois de la nature. Même la mort était considérée, non comme un événement naturel, mais comme la conséquence de quelque offense à l’égard des dieux.
Au cours d’une période constituant la plus grande partie de l’histoire humaine, ce genre de croyances a rempli l’esprit des hommes et des femmes. Et ce non seulement chez ce que les gens aiment considérer comme des sociétés primitives. Le même genre de croyances superstitieuses continue d’exister, aujourd’hui, sous des formes à peine différentes. Sous un mince verni de civilisation se cachent des tendances irrationnelles et des idées qui prennent racine dans un lointain passé à moitié oublié, mais dont l’humanité ne s’est pas encore émancipée. Nous ne pourrons d’ailleurs les extirper de la conscience humaine qu’à partir du moment où les hommes et les femmes auront définitivement acquis la maîtrise de leurs conditions d’existence.
La division du travail
Frazer explique que, dans les sociétés primitives, la division entre travail manuel et travail intellectuel est invariablement liée à la formation d’une caste de prêtres, de chamanes ou de magiciens :
« On le sait, le progrès social consiste essentiellement en une succession de différenciations des fonctions, ou, pour parler plus simplement, dans une division du travail. Le travail qui, dans les sociétés primitives, est plus ou moins également réalisé par tous, et par tous aussi mal, est par la suite graduellement réparti entre différentes classes de travailleurs et, partant, de mieux en mieux exécuté. Dans la mesure où les produits de ce travail spécialisé, qu’ils soient matériels ou immatériels, sont partagés entre tous, l’ensemble de la communauté profite de l’accroissement de la spécialisation. Les magiciens et les médecins apparaissent ainsi comme les plus anciennes classes artificielles, ou professionnelles, de l’évolution sociale. De fait, toutes les tribus sauvages qui nous sont connues ont leurs sorciers, et parmi les sauvages les plus arriérés, comme les Aborigènes australiens, ils constituent l’unique classe professionnelle existante. » (The Golden Bough, p. 104.)
A un certain stade de l’évolution sociale, la division du travail a donné une puissante impulsion au dualisme qui séparait l’âme du corps, l’esprit de la matière et la pensée de l’action. Historiquement, la séparation entre travail manuel et travail intellectuel coïncide avec la division de la société en classes sociales. Cela marquait un progrès considérable pour le développement humain. Pour la première fois, une minorité d’individus était libérée de la nécessité de travailler pour subvenir à ses besoins vitaux. L’acquisition de cette denrée particulièrement précieuse – le loisir – signifiait qu’ils pouvaient consacrer leur vie à l’étude des étoiles. Comme l’expliquait le philosophe matérialiste allemand Ludwig Feuerbach, la cosmologie fut la première véritable science théorique :
« L’animal n’est sensible qu’à la lumière ayant des conséquences vitales immédiates ; l’homme, au contraire, l’est aussi par le rayonnement de l’étoile la plus éloignée, qui lui est physiquement indifférent. L’homme seul a des joies et des passions purement intellectuelles et désintéressées. L’œil de l’homme, seul, célèbre des fêtes théoriques. L’œil qui regarde le ciel étoilé, qui fixe cette lumière à la fois inutile et inoffensive, sans communauté avec la terre et ses besoins – cet œil voit dans cette lumière sa propre essence, sa propre origine. L’œil est de nature céleste. C’est pourquoi l’homme ne s’élève au-dessus de la terre que par l’œil ; c’est pourquoi la théorie commence avec la contemplation des cieux. Les premiers philosophes étaient astronomes. » (L’essence du christianisme)
Bien qu’à ce stade primitif la science fût mélangée avec la religion, et intégrait les besoins et les intérêts de la caste de prêtres, elle marquait néanmoins la naissance de la civilisation humaine. Aristote, déjà, l’avait compris, et écrivait : « Ces arts théoriques ont été élaborés là où des hommes avaient du temps libre en abondance : les mathématiques, par exemple, sont apparues en Egypte, où une caste de prêtres jouissait de tout le loisir nécessaire. » (Métaphysique)
Le savoir est une source de pouvoir. Dans toutes les sociétés où l’art, la science et le gouvernement sont le monopole de quelques-uns, cette minorité en use et abuse suivant son propre intérêt. Les débordements annuels du Nil étaient un phénomène qui touchait aux intérêts vitaux du peuple égyptien : ses récoltes en dépendaient. La capacité des prêtres à prévoir, sur la base d’observations astronomiques, à quel moment le Nil sortirait de son lit, a dû accroître considérablement leur prestige et leur pouvoir. L’art de l’écriture, cette invention conférant un pouvoir considérable, était le secret bien gardé de la caste des prêtres. Comme l’écrivent Ilya Prigogine et Isabelle Stengers : « L’écriture fut découverte à Sumer. Les prêtres sumériens se figuraient que l’avenir pouvait être écrit, sous quelque forme cryptée, dans les événements du présent. Ils ont même systématisé cette croyance, en y mélangeant des éléments rationnels et des éléments de nature magique. » (Order Out of Chaos, p. 4.)
Le développement ultérieur de la division du travail a creusé un gouffre infranchissable entre l’élite intellectuelle et la majorité de l’espèce humaine condamnée au travail manuel. L’intellectuel – le prêtre babylonien comme le physicien théorique contemporain – ne connaît qu’un type de travail : le travail intellectuel. Au cours des millénaires, l’idée d’une supériorité de ce dernier sur le « vulgaire » travail manuel s’est profondément enracinée, au point d’acquérir la force d’un préjugé. Le langage, les mots et les pensées ont été investis de pouvoirs mystiques. La culture est devenue le monopole d’une élite privilégiée, qui garde jalousement ses secrets, usant et abusant de sa position pour son propre compte.
A l’époque antique, l’aristocratie intellectuelle ne cherchait pas à dissimuler son mépris pour le travail physique. La citation suivante est tirée d’un texte égyptien connu sous le nom de Satire des Métiers, qui fut écrit vers 2000 avant notre ère et qui est supposé être l’exhortation d’un père à son fils, qu’il envoie étudier à l’école d’écriture pour y devenir scribe :
« J’ai vu comment le laboureur laboure – tu devrais prendre à cœur la poursuite de l’écriture. J’ai vu aussi comment on peut se libérer de ses devoirs. Vois, il n’y a rien qui surpasse l’écriture...
« J’ai vu le ferronnier au travail devant la gueule de son fourneau. Ses doigts ressemblaient quelque peu à des crocodiles ; il puait plus que les œufs de poisson...
« Le journalier du bâtiment transporte de la boue... A force de marcher dans sa boue, il est plus sale que des vignes ou des cochons. La glaise a rigidifié ses habits...
« Le fabricant de flèches est misérable lorsqu’il se rend dans le désert [pour chercher des pointes de silex]. Ce qu’il donne à son âne vaut plus que le travail que celui-ci fournira par la suite...
« Le blanchisseur lave sur la rive ; il côtoie les crocodiles...
« Vois, il n’y a pas de profession sans patron – hormis celle de scribe : c’est lui le patron...
« Vois, aucun scribe ne manque de nourriture en provenance des terres de la maison du Roi – la vie, la prospérité, la santé ! – ; son père et sa mère remercient Dieu car il a trouvé le chemin des vivants. Pense à mes paroles, que je te confie ainsi qu’aux enfants de tes enfants. » (Cité dans M. Donaldson, Children’s Minds, p. 84.)
La même attitude prévalait parmi les Grecs : « Les arts qu’on appelle mécaniques », écrit Xénophon, « sont dans nos villes justement stigmatisés et déshonorés. En effet, ces arts abîment le corps de ceux qui les pratiquent et de leurs contremaîtres. Ils sont forcés de mener une vie sédentaire, sans pouvoir sortir, et doivent parfois passer toute la journée auprès du feu. Cette dégénérescence physique entraîne aussi la détérioration de l’âme. En outre, ceux qui pratiquent ces métiers n’ont même pas le temps d’accomplir les devoirs de l’amitié et de la citoyenneté. Par conséquent, ils sont considérés comme de mauvais amis et de mauvais patriotes. Dans certaines villes, en particulier les villes réputées guerrières, l’exercice d’un métier mécanique de la part d’un citoyen est interdit par la loi. » (Oeconomicus).
La séparation nette entre travail manuel et travail intellectuel renforce l’idée de l’existence indépendante des mots et de la pensée. Cette erreur est au cœur de la religion et de l’idéalisme philosophique.
Ce n’est pas Dieu qui a créé l’homme à son image, mais, à l’inverse, les hommes et les femmes qui ont créé Dieu à leur image et ressemblance. Ludwig Feuerbach disait que si les oiseaux avaient une religion, leur Dieu aurait des ailes. « La religion est un rêve dans lequel nos propres conceptions et émotions nous apparaissent sous la forme de réalités distinctes et indépendantes de nous-mêmes. L’esprit religieux ne distingue pas entre ce qui est subjectif et ce qui est objectif – il ne doute de rien ; il est capable, non de concevoir des choses autres que lui-même, mais de voir ses propres conceptions en dehors de lui-même en tant que phénomènes distincts. » (L’essence du christianisme). C’est ce qu’avait déjà compris Xénophane de Colophon (565-470 av J.-C.), qui écrivait : « Homère et Hésiode ont attribué à leurs dieux tous les comportements qui, chez l’homme, sont honteux et déshonorants : le vol, l’adultère, la tromperie... Les dieux des Ethiopiens sont noirs et ont un nez camus ; ceux des Thraces ont les yeux gris et les cheveux roux... Si les animaux pouvaient, comme l’homme, peindre et fabriquer des choses, les chevaux et les bœufs façonneraient eux aussi des dieux à leur image. » (Cité dans A. R. Burn, Pelican History of Greece, p. 132.)
Les mythes de la Création que l’on trouve dans presque toutes les religions puisent invariablement leurs images dans la vie réelle, par exemple celle du potier qui façonne de la glaise informe. D’après Gordon Childe, l’histoire de la Création, telle qu’elle est relatée dans le premier livre de la Genèse, trouve son origine dans le fait qu’en Mésopotamie la terre fut effectivement, « au Commencement », séparée des eaux – mais non par une intervention divine :
« La terre sur laquelle les grandes cités de Babylonie ont été construites devait être littéralement créée ; le site sur de la future ville biblique d’Erech était construit sur une sorte de plate-forme de roseaux entrelacés sur la boue alluviale. Le livre de la Genèse nous a familiarisés avec les traditions bien plus anciennes concernant la condition primitive de Sumer – un “chaos” dans lequel la démarcation entre les eaux et la terre sèche était encore mouvante. La séparation de ces éléments est un moment essentiel de la Création. Pourtant, ce n’est pas un dieu, mais les proto-sumériens eux-mêmes, qui ont créé la terre. Ils ont creusé des canaux pour irriguer la terre sèche et drainer les marais ; ils ont construit des digues et des plates-formes surélevées pour protéger des eaux les hommes et leur bétail ; ils ont été les premiers à défricher les banquises de roseaux et à explorer les canaux qui les séparaient. La ténacité du souvenir de cette lutte s’est pérennisée dans la tradition et donne la mesure des efforts imposés aux anciens Sumériens. Leur récompense fut une provision assurée de dates nourrissantes, des récoltes abondantes dans les champs qu’ils avaient drainés et des pâturages permanents pour leurs troupeaux. » (Man Makes Himself, pp. 107-8.)
Les premières tentatives de l’homme pour expliquer le monde et la place qu’il y occupait étaient pétries de mythologie. Les Babyloniens croyaient que le dieu Marduk avait créé l’Ordre à partir du Chaos, en séparant la terre des eaux et le ciel de la terre. Le mythe biblique de la Création a été pris aux Babyloniens par les Juifs, puis transmis à la culture chrétienne. La véritable histoire de la pensée scientifique débute lorsque les hommes et les femmes commencent à se dispenser de mythologie et s’efforcent d’acquérir une compréhension rationnelle de la nature, sans recourir aux interventions divines. C’est à partir de ce moment que s’engage réellement la lutte de l’humanité pour se libérer de ses entraves matérielles et spirituelles.
Une révolution dans la pensée
L’avènement de la philosophie a constitué une authentique révolution de la pensée humaine. Comme tant d’autres aspects de la civilisation moderne, nous le devons aux Grecs antiques. Bien que d’importants progrès aient aussi été réalisés par les Indiens, les Chinois et, plus tard, par les Arabes, ce sont les Grecs qui ont porté la philosophie et la science à leur plus haut niveau avant la Renaissance. L’histoire de la pensée grecque au cours des quatre siècles qui séparent le VIIe et le IIIe avant notre ère constitue l’un des chapitres les plus imposants des annales de l’histoire humaine.
Ici, nous avons une longue lignée de héros qui furent les pionniers du développement de la pensée. Les Grecs ont découvert que la Terre était ronde bien avant Colomb. Ils ont expliqué bien avant Darwin que les humains sont le produit d’une évolution à partir des poissons. Ils ont fait d’extraordinaires découvertes en mathématiques, notamment en géométrie, qui n’ont pas reçu d’améliorations majeures pendant un millénaire et demi. Ils ont inventé la mécanique et même la machine à vapeur.
Ce qui était étonnamment nouveau dans cette manière de voir le monde était qu’elle n’était pas religieuse. En contraste complet avec les Egyptiens et les Babyloniens, de qui ils avaient beaucoup appris, les penseurs grecs ne recouraient pas à des dieux et des déesses pour expliquer les phénomènes naturels. Pour la première fois, les hommes et les femmes cherchaient à expliquer les processus naturels en termes purement naturels. Ce fut un des plus grands tournants de toute l’histoire de la pensée. La vraie science commence ici.
La naissance de la philosophie
La philosophie occidentale est née sous le ciel clair et bleu du premier âge égéen. Les VIIIe et VIIe siècles avant notre ère furent une période d’expansion économique rapide en Méditerranée orientale. Ce fut une période de grands changements. Les Grecs des îles ioniennes, qui se trouvent au large de la Turquie d’aujourd’hui, entretenaient un commerce prospère avec l’Egypte, Babylone et la Lydie. Les Lydiens ont inventé la monnaie, qui s’est introduite en Europe par l’intermédiaire d’Egine aux environs de -625, stimulant considérablement le commerce et apportant dans son sillage de grandes richesses pour certains, l’impossibilité de solder ses dettes et l’esclavage pour les autres.
La philosophie grecque primitive représente le vrai point de départ de la philosophie. Elle constitue une tentative pour s’arracher aux liens ancestraux de la superstition et du mythe, pour se dispenser des dieux et des déesses, de telle sorte que, pour la première fois, des êtres humains ont pu se tenir face à la nature et face à des hommes et des femmes réels.
La révolution économique donna naissance à de nouvelles contradictions sociales. L’effondrement de l’ancienne société patriarcale provoqua un affrontement entre riches et pauvres. L’ancienne aristocratie dut faire face au mécontentement des masses et à l’opposition des « tyrans », fréquemment eux-mêmes des dissidents appartenant à la noblesse, qui étaient toujours partants pour se mettre à la tête des révoltes populaires. Une période d’instabilité s’ouvrit, durant laquelle les hommes et les femmes commencèrent à interroger les anciennes croyances.
La situation à Athènes à cette époque est décrite dans le passage que voici :
« Dans les mauvaises années, ils [les paysans] devaient emprunter à leurs riches voisins ; mais lorsque la monnaie fit son apparition, cela a signifié que, au lieu d’emprunter un sac de grains selon les usages du bon voisinage, il a fallu emprunter le prix de la quantité de blé pour se dépanner, avant la récolte, quand il était bon marché, ou sinon, payer de gros intérêts, de ceux qui suscitaient l’indignation à Mégare. Vers -600, alors que les riches exportaient vers des marchés profitables à Egine ou Corinthe, les pauvres étaient condamnés à la faim. Beaucoup, également, perdaient leur terre, gagée pour garantir les dettes, et jusqu’à leur liberté ; car le dernier recours du créancier contre le débiteur insolvable était de le saisir lui et sa famille pour les réduire en esclavage… La loi était dure ; c’était la loi de l’homme riche » (A.R. Burn, Pelican History of Greece, p. 119).
Ces lois furent consignées dans un code par un certain Dracon, d’où la formule devenue proverbiale de « lois draconiennes ».
Le turbulent VIe siècle avant notre ère fut une période de déclin des républiques grecques d’Ionie, en Asie Mineure, caractérisée par une crise sociale et une lutte des classes féroce entre riches et pauvres, maîtres et esclaves. « A Milet, en Asie Mineure », écrit Rostovtsev, « le peuple fut d’abord victorieux et massacra les femmes et les enfants des aristocrates ; ensuite, les aristocrates l’emportèrent et brûlèrent tout vifs leurs opposants, allumant des torches vivantes dans les espaces libres de la cité » (cité par Bertrand Russell dans son Histoire de la philosophie occidentale, p. 44).
Ces conditions étaient aussi typiques de la plupart des autres cités grecques d’Asie Mineure à l’époque. Les héros de cet âge n’avaient rien de commun avec l’idée, plus tardive, du philosophe retranché du reste de l’humanité dans sa tour d’ivoire. Ces « sages » n’étaient pas seulement des penseurs mais des acteurs, pas seulement des théoriciens mais des hommes agissant dans le monde. Du premier d’entre eux, Thalès de Milet (vers -640-546), nous ne connaissons presque rien, mais il est expressément mentionné que ce fut seulement tard dans sa vie qu’il se mit à la philosophie, et qu’il s’occupait aussi d’affaires commerciales, de mécanique, de géométrie et d’astronomie (il est réputé avoir prédit une éclipse, celle qui dut avoir lieu en -585).
Ce qui est indiscutable, c’est que les premiers philosophes grecs étaient tous matérialistes. Tournant le dos à la mythologie, ils cherchaient à trouver un principe général des mécanismes de la nature, à partir de l’observation de la nature elle-même. Les auteurs grecs postérieurs les nomment « hylozoïstes », ce qui peut être traduit par : « ceux qui pensent que la matière est vivante ». Cette conception d’une matière douée de son propre mouvement est étonnamment moderne, et très supérieure à la physique mécaniste du XVIIIe siècle. Etant donné l’absence d’instruments scientifiques modernes, leurs théories avaient fréquemment l’allure de conjectures inspirées. Mais, si l’on considère ce manque de ressources, on est émerveillé qu’ils soient arrivés si près d’une compréhension réelle des mécanismes de la nature. Ainsi, le philosophe Anaximandre (environ -610-545) découvrit que l’homme et tous les autres animaux s’étaient développés à partir d’un poisson qui avait abandonné la mer au profit de la terre.
Il est faux de supposer que ces philosophes étaient religieux simplement parce qu’ils utilisaient le mot « dieu (theos) » pour la substance première. J. Burnet affirme que ce terme n’avait pas plus de signification que les vieillies épithètes homériques comme « toujours jeune », « immortel », etc. Même chez Homère, le mot est utilisé en différents sens. Dans la Théogonie d’Hésiode il est clair que nombre de « dieux » n’ont jamais été l’objet d’un culte, mais n’étaient que des moyens commodes de personnifier des phénomènes naturels ou des passions humaines. Les religions primitives voyaient les Cieux comme divins et placés à part de la Terre. Les philosophes ioniens ont rompu radicalement avec cette conception. Se fondant eux-mêmes sur les nombreuses découvertes des cosmologies babylonienne et égyptienne, ils ont rejeté l’élément mythique qui confondait l’astronomie avec l’astrologie.
La tendance générale de la philosophie grecque avant Socrate était de chercher les principes sous-jacents de la nature :
« Ce fut la nature – ce qui est le plus immédiatement présent pour nous, ce qui gît au plus près de l’œil, ce qui est le plus palpable – qui attira d’abord l’esprit de recherche. Sous ces formes changeantes, ces apparences multiples, il doit y avoir, pensait-on, un principe premier, permanent et fondamental. Quel est ce principe ? Quel élément précisément, quel élément naturel, est l’élément de base ? » (Schwegler, Histoire de la philosophie, p. 6).
Ils donnèrent différentes réponses à cette question. Par exemple, Thalès proclamait que la base de toutes choses était l’eau. Ce fut un grand progrès pour la pensée humaine. Il est vrai que les Babyloniens avaient longtemps auparavant avancé l’idée que tout provenait de l’eau dans leur mythe de la Création, qui fut le modèle du récit hébraïque de la Création dans le livre de la Genèse. « Toutes les terres étaient la mer », dit la légende, jusqu’à ce que Marduk, le créateur babylonien, sépare la terre de la mer. La différence est qu’ici il n’y a pas de Marduk, pas de créateur divin séparé de la nature. Au lieu de cela, pour la première fois, la nature est expliquée en des termes purement matérialistes, c’est-à-dire dans les termes de la nature elle-même.
L’idée selon laquelle la nature est réductible à de l’eau n’est pas non plus si fantaisiste qu’il y paraît. Mis à part le fait que la grande majorité de la surface de la Terre est constituée d’eau, l’eau est essentielle à toutes les formes de vie, ce dont les Ioniens surtout avaient conscience. La masse de notre corps consiste en eau, et nous serions vite morts si nous en étions privés. En outre, l’eau change de forme, passant d’un état liquide à un état solide et à sa forme vapeur. Burnet commente ce point :
« Il n’est pas non plus difficile de voir combien les considérations météorologiques ont pu conduire Thalès à adopter sa vision des choses. De toutes les choses que nous connaissons, l’eau semble prendre les formes les plus variables. Elle nous est familière sous une forme solide, liquide ou gazeuse, et c’est ainsi que Thalès peut très bien avoir pensé qu’il voyait le processus du monde se développer sous ses yeux en partant de l’eau et en revenant à l’eau. Le phénomène d’évaporation suggère naturellement que le feu des corps célestes est entretenu par l’humidité qu’ils tiraient de la mer. Même de nos jours, on dit que “le Soleil puise de l’eau”. L’eau redescend sous forme de pluie et, à la fin, ainsi pensaient les premiers cosmologistes, elle se transforme en terre. Cela peut avoir semblé suffisamment naturel à des hommes qui étaient familiers des rivières d’Egypte qui avaient formé le delta du Nil, et des torrents d’Asie Mineure qui apportaient de grandes quantités d’alluvions ». (J. Burnet, Early Greek Philosophers, p. 49).
Anaximandre
Thalès fut suivi par d’autres philosophes qui avançaient d’autres théories quant à la structure fondamentale de la matière. Anaximandre est censé venir de Samos, où vivait aussi le fameux Pythagore. On dit qu’il a écrit sur la nature, sur les « étoiles fixes », la sphéricité de la terre et d’autres sujets. Il a produit quelque chose comme une carte montrant les limites de la terre et de la mer, et il fut responsable d’un certain nombre d’inventions mathématiques, dont un cadran solaire et une carte astronomique.
Comme Thalès, Anaximandre a considéré ce qu’était la nature de la réalité. Comme lui, il aborda la question d’un point de vue strictement matérialiste, sans recours aux dieux ni à aucun élément surnaturel. Mais, à la différence de son contemporain Thalès, il n’a pas cherché à trouver une réponse dans une forme particulière de matière, comme l’eau. Selon Diogène Laërce, « comme principe et élément il posait l’infini (l’indéterminé) ; il ne le définissait ni comme l’air, ni comme l’eau, ni comme aucune chose de ce genre (…). Il est le principe de tout naître et de tout périr ; de lui prennent naissance des mondes infinis (des dieux) qui à leur tour vont se perdre en lui » (Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, tome 1, Vrin, Paris, p. 60).
Voilà qui a placé pour la première fois l’étude de l’univers sur une base scientifique, et qui a permis aux premiers philosophes grecs de faire de remarquables découvertes, très en avance sur leur temps. Ils découvrirent d’abord que le Monde est sphérique et ne repose sur rien, que la Terre n’est pas le centre de l’univers, mais qu’elle tourne autour du centre avec les autres planètes. Selon un autre contemporain, Hippolitos, Anaximandre a dit que la Terre oscille librement, sans que rien la maintienne, parce qu’elle est équidistante de toutes choses, qu’elle est ronde et creuse, comme une colonne, de telle sorte que nous sommes sur une face de la Terre tandis que d’autres sont sur une autre. Ils découvrirent aussi la vraie théorie des éclipses lunaires et solaires.
Malgré toutes leurs lacunes et leurs déficiences, ces idées représentent une conception étonnamment audacieuse et originale de la nature, beaucoup plus proche, certainement, de la vérité que le mysticisme étroit du Moyen Âge, lorsque la pensée humaine fut de nouveau enchaînée par le dogme religieux. En outre, ces progrès importants ne furent pas seulement le résultat de simples hypothèses, mais celui d’une pensée attentive, de l’investigation et de l’expérience. Deux mille ans avant Darwin, Anaximandre a anticipé la théorie de l’évolution, avec ses étonnantes découvertes en biologie marine. L’historien A. R. Burn croit que cela n’a pas été un accident, mais le résultat d’une recherche scientifique : « il semblerait qu’il ait fait des observations sur les embryons et aussi sur les fossiles, comme le fit avec certitude l’un de ses successeurs ; mais cela ne nous est pas dit de manière explicite » (A.R. Burn, The Pelican History of Greece, p. 130).
Anaximandre effectua une grande révolution dans la pensée humaine. Au lieu de se limiter à telle forme concrète de la matière, ou à telle autre, il est arrivé au concept de matière en général, de matière au sens philosophique. Cette substance universelle est éternelle et infinie, changeant et évoluant constamment. Toutes les myriades de formes d’être que nous percevons grâce à nos sens sont les différentes expressions d’une même substance fondamentale. Cette idée était si nouvelle que pour beaucoup elle était incompréhensible. Plutarque a reproché à Anaximandre de ne pas avoir spécifié dans lequel des éléments – eau, terre, air ou feu – consistait son infini. Mais précisément, c’est là qu’est le caractère révolutionnaire de sa théorie.
Anaximène
Le dernier du grand trio des matérialistes ioniens était Anaximène (environ 585-528 avant notre ère). On dit qu’il serait né au moment où Thalès « florissait » et que lui-même « florissait » lorsque Thalès mourut. Il était plus jeune qu’Anaximandre. Contrairement à Anaximandre, et à la suite de Thalès, il adopta à titre de substance absolue un seul élément – l’air, duquel toutes choses proviendraient et auquel elles se réduiraient en définitive. En fait, l’utilisation du mot « air (aer) » par Anaximène est substantiellement différente de l’usage moderne ; elle inclut la vapeur, la brume et même l’obscurité. De nombreux traducteurs préfèrent le mot « brume ».
A première vue, cette idée représente un pas en arrière par rapport à la conception de la matière en général à laquelle est parvenu Anaximandre. En réalité, sa conception du monde est un pas en avant.
Anaximène a essayé de montrer comment l’« air », la substance universelle, est transformé par un processus de raréfaction et de condensation. Quand il est raréfié, il devient feu, quand il est condensé, vent. Avec une condensation plus forte, on obtient les nuages, l’eau, la terre et les pierres. Mais quoique la comparaison détaillée de sa conception avec celle d’Anaximandre ne soit pas à son avantage (il pensait, par exemple, que le monde avait la forme d’une table), cependant sa philosophie représentait un progrès dans la mesure où il essayait d’aller au-delà d’une simple qualification générale de la nature de la matière. Il a essayé de lui donner une détermination plus précise, non pas seulement qualitativement mais quantitativement, à travers le processus de raréfaction et de condensation. Selon le professeur Farrington :
« Observez, en suivant cette succession de penseurs, comment leur logique, leur stock d’idées, leur puissance d’abstraction, croissent à mesure qu’ils sont aux prises avec leur problème. Lorsque Thalès réduisit les multiples apparences des choses à l’unité d’un seul Premier Principe, ce fut un grand progrès de la pensée. Lorsque Anaximandre choisit, à titre de Premier Principe, non pas une forme visible de choses comme l’eau, mais un concept comme l’Indéterminé, ce fut un autre grand pas en avant. Mais Anaximène n’en fut pas encore satisfait. Quand Anaximandre a cherché à expliquer comme les différentes choses émergeaient de l’Indéterminé, sa réponse n’était qu’une simple métaphore. Il disait qu’il s’agissait d’un processus de “séparation”. Anaximène a senti que quelque chose d’autre était nécessaire, et il avança les idées complémentaires de Raréfaction et de Condensation, qui offraient une explication de la façon dont des changements quantitatifs pouvaient produire des changements qualitatifs » (Farrington, op. cit., p. 39).
Etant donné le niveau technique existant, il était impossible à Anaximène d’arriver à une caractérisation plus précise des phénomènes considérés. Il est facile de pointer les déficiences et même les absurdités de ses conceptions. Mais ce serait manquer l’essentiel. Les premiers philosophes grecs ne peuvent être blâmés pour avoir échoué à donner à leur image du monde un contenu détaillé, ce qui ne fut possible que sur la base d’un progrès économique, technique et scientifique ultérieur de plus de 2000 ans. Ces grands pionniers de la pensée humaine ont rendu à l’humanité ce service unique d’avoir rompu avec les habitudes invétérées de la superstition religieuse, et ainsi d’avoir posé les fondations sans lesquelles aucun progrès scientifique et culturel n’aurait été pensable.
En outre, la conception générale de l’univers et de la nature élaborée par ces grands penseurs révolutionnaires était sous bien des rapports proche de la vérité. Leur problème était que, étant donné le niveau de développement de la production et de la technologie, ils n’avaient pas les moyens de tester leurs hypothèses et de les établir sur une base solide. Ils ont anticipé beaucoup de choses qui n’ont pu être pleinement résolues que par la science moderne, reposant sur un développement beaucoup plus grand de la science et de la technique. Ainsi, pour Anaximène, l’« air » est seulement un abrégé de la matière dans sa forme la plus simple et la plus fondamentale. Comme Erwin Schrödinger, l’un des fondateurs de la physique moderne, l’a judicieusement remarqué : « s’il avait dit gaz hydrogène dissocié » (ce qu’on pouvait difficilement attendre de lui), « il n’aurait pas été très loin de notre conception actuelle » (cité dans A. R. Burn, op. cit., p. 131).
Les premiers philosophes ioniens de la nature sont allés aussi loin qu’ils pouvaient pour expliquer les mécanismes de la nature au moyen de la raison spéculative. Ce furent vraiment de grandes généralisations, qui pointaient dans la bonne direction. Mais pour aller plus loin, il fallait examiner les choses plus en détail pour procéder à l’analyse de la nature pièce par pièce. C’est Aristote qui a entrepris cela plus tard, ainsi que les penseurs grecs alexandrins. Mais une partie importante de ce travail a consisté à considérer la nature d’un point de vue quantitatif. Là, les Pythagoriciens ont incontestablement joué un rôle majeur.
Déjà Anaximène avait pointé dans cette direction en essayant de poser la question de la relation entre les changements de quantité et de qualité dans la nature (raréfaction et condensation). Mais sa méthode avait alors atteint sa limite et épuisé sa portée. Comme le précise J. D. Bernal : « Le triomphe de l’école ionienne a résidé en ce qu’elle a mis au point une image de la façon dont le monde est venu au jour et de la façon dont il fonctionne sans requérir l’intervention de dieux ou d’un dessein. Sa faiblesse fondamentale résidait dans son manque de précision et son caractère qualitatif. Par elle-même elle ne pouvait mener nulle part ; on ne pouvait rien faire d’elle. Ce qu’il fallait, c’était l’introduction des nombres et de la quantité en philosophie » (J. D. Bernal, Science in History, p. 122).
Du matérialisme à l’idéalisme
La période d’affirmation de la philosophie grecque fut caractérisée par une profonde crise de société, marquée par une remise en question de toutes les anciennes croyances, y compris la religion établie. La crise de la croyance religieuse donna naissance à des tendances athées et à la naissance d’une façon de voir authentiquement scientifique, fondée sur le matérialisme. Cependant, comme toujours dans la réalité sociale, le processus se déroula de manière contradictoire. A côté de tendances rationalistes et scientifiques, on voit aussi leur opposé – une propension croissante au mysticisme et à l’irrationalité. Un phénomène très similaire apparut à l’époque de la crise de la société romaine, à la fin de la république, avec la diffusion rapide des religions orientales, dont le christianisme était une version parmi bien d’autres.
Pour la masse des paysans et des esclaves, vivant en période de crise, les dieux de l’Olympe semblaient lointains. Ils représentaient une religion pour l’aristocratie. Il n’y avait guère en elle la perspective d’une future récompense après la mort pour les souffrances présentes. Les enfers des Grecs étaient un lieu triste, peuplé par des âmes perdues. Les cultes nouveaux, avec leurs danses imitatives et leurs chœurs (véritable origine de la tragédie grecque), leurs mystères (du verbe muô signifiant le fait de tenir sa bouche fermée), et la promesse d’une vie après la mort, étaient beaucoup plus attrayants pour les masses. Le culte de Dionysos, le dieu du vin (connu des Romains sous le nom de Bacchus) était particulièrement populaire ; il impliquait orgies et ivresse. C’était beaucoup plus séduisant que les anciens dieux de l’Olympe.
Comme dans la période de déclin de l’Empire romain, et dans la période présente de déclin du capitalisme, toutes sortes de cultes à mystères se répandirent, mélangés avec des rites exotiques nouveaux importés de Thrace, d’Asie Mineure et peut-être d’Egypte. Le culte d’Orphée revêtit une importance particulière ; c’était un raffinement du culte de Dionysos, avec beaucoup de points communs avec le mouvement pythagoricien. Comme les Pythagoriciens, les sectateurs du culte orphique croyaient en la transmigration des âmes. Ils avaient des rites de purification, par exemple l’interdiction de manger de la viande, sauf à des fins rituelles. Leur conception de l’homme était basée sur le dualisme – l’idée de la séparation de l’âme et du corps. Pour eux, l’homme était pour une part du Ciel et pour une autre de la Terre.
Ces idées sont si proches des doctrines pythagoriciennes que certains auteurs soutiennent que les Pythagoriciens constituaient en réalité une branche de l’Orphisme. C’est une exagération. En dépit de ses éléments mystiques, l’école pythagoricienne a apporté une contribution importante au développement de la pensée, spécialement en mathématiques. Elle ne peut pas être récusée comme secte religieuse. Néanmoins, il est impossible d’échapper à la conclusion selon laquelle les conceptions idéalistes du Pythagorisme ne sont pas seulement un écho d’une vision religieuse du monde, mais qu’elles trouvent directement leur source en elle. Bertrand Russell suit la trace du développement de l’idéalisme jusqu’au mysticisme de la religion orphique :
« Cet élément mystique est entré dans la philosophie grecque avec Pythagore, qui fut un réformateur de l’Orphisme comme Orphée fut un réformateur de la religion de Dionysos. Par l’intermédiaire de Pythagore, des éléments orphiques sont entrés dans la philosophie de Platon, et par Platon dans la plus grande partie de la philosophie postérieure dès lors qu’elle était un tant soit peu religieuse » (Russell, op. cit., p. 39)
La division entre travail manuel et travail intellectuel prend son expression la plus extrême avec la croissance de l’esclavage. Ce phénomène était directement lié à la diffusion de l’Orphisme. L’esclavage est une forme extrême d’aliénation. Sous le capitalisme, le travailleur « libre » aliène sa propre force de travail, qui se présente alors à lui comme une force séparée et hostile – le capital. Dans l’esclavagisme, cependant, l’esclave perd jusqu’à son existence en tant qu’être humain. Il n’est rien. Non pas une personne, mais un « outil qui parle ». Le produit de son travail, son corps, son esprit, son âme sont la propriété d’un autre qui en dispose sans considération de ses souhaits. Les désirs insatisfaits de l’esclave, son aliénation extrême par rapport au monde et à lui-même, donnent lieu à un sentiment de rejet du monde et de ce qui s’y réalise. Le monde matériel est le mal. La vie est une vallée de larmes. Le bonheur ne peut être trouvé ici-bas mais seulement dans la mort qui libère du labeur. L’âme, libérée de sa prison corporelle, peut devenir libre.
Dans toutes les périodes de régression sociale, les hommes et les femmes ont deux options : ou bien affronter la réalité et se battre pour la changer, ou bien accepter l’absence d’issue et se résigner à son sort. Ces deux perspectives opposées se reflètent inévitablement dans deux philosophies antagonistes – le matérialisme et l’idéalisme. Si nous désirons changer le monde, il est nécessaire de le comprendre. Nous devons regarder la réalité en face. L’optimisme joyeux des premiers matérialistes grecs correspondait tout à fait à cette façon de voir. Ils voulaient savoir. Plus tard, tout cela changea. La rupture de l’ordre ancien, la montée de l’esclavage et un sentiment général d’insécurité conduisirent à une certaine introversion et au pessimisme. En l’absence d’une alternative claire, la tendance à fuir la réalité, à chercher le salut individuel dans le mysticisme, gagnèrent du terrain. Les basses classes se tournaient vers les cultes à mystères, comme celui de Déméter, dispensateur du blé, de Dionysos, dispensateur du vin, et plus tard vers le culte d’Orphée. Mais les classes supérieures furent aussi touchées par les problèmes de cette période. Ce furent des temps troublés. Des cités prospères pouvaient être réduites en cendres du jour au lendemain et leurs citoyens tués ou vendus comme esclaves.
La cité de Sybaris, la puissante rivale commerciale de Crotone, était renommée pour sa richesse et son luxe. L’aristocratie y était si riche que toutes sortes d’histoires couraient à propos du style de vie « sybarite ». Même en faisant la part de l’exagération, il est clair que c’était une cité très prospère, où les riches vivaient dans un grand luxe. La croissance des inégalités donna toutefois naissance à une lutte des classes féroce.
C’était une période durant laquelle la division du travail s’était énormément intensifiée, accompagnée par une croissance rapide de l’esclavage et par un fossé toujours plus grand entre riches et pauvres. Les quartiers industriels et les quartiers résidentiels étaient complètement séparés. Mais la hauteur des murs et les gardiens n’ont pas sauvé les citoyens riches de Sybaris. Comme dans d’autres cités-Etats, une révolution éclata qui permit au « tyran », Telys, de s’emparer du pouvoir avec l’appui des masses. Cela donna à Crotone un prétexte pour déclarer la guerre à sa rivale, au moment où elle était affaiblie par les divisions internes. Après une campagne de 70 jours, la cité tomba entre leurs mains. A. R. Burn commente ainsi : « Ils la détruisirent complètement, détournant la rivière locale pour noyer son site, tandis que les survivants étaient dispersés, principalement sur la côte ouest. La sauvagerie toute particulière de cette guerre se comprend mieux quand on y voit une guerre de classe » (A. R. Burn, op. cit., p. 140).
C’est dans ce contexte spécifique que l’on doit considérer la naissance de l’école pythagoricienne en philosophie. Comme lors du déclin de l’Empire romain, une partie de la classe dirigeante était accablée par l’anxiété, la peur et la perplexité. Les anciens dieux n’offraient aucune consolation ni aucun espoir de salut, que ce soit aux riches ou aux pauvres. Même les bonnes choses de la vie avaient perdu de leur séduction auprès de ces hommes et de ces femmes qui avaient l’impression d’être assis au bord de l’abîme. Dans de telles conditions d’insécurité générale, alors que même les Etats les plus prospères et les plus forts pouvaient être renversés en un instant, les enseignements de Pythagore touchaient une corde sensible chez un certain nombre d’aristocrates, en dépit de leur caractère ascétique, ou même à cause de lui. La nature ésotérique et intellectuelle de ce mouvement ne séduisait en rien les masses, au sein desquelles le culte orphique avait gagné un soutien considérable.
Pythagore et son école
Il est plus sûr de parler de l’école plutôt que de son fondateur, parce qu’il est difficile de dissocier la philosophie de Pythagore des mythes et de l’obscurantisme qui sont le fait de ses sectateurs. Aucun fragment écrit de son œuvre ne nous est parvenu, et il n’est pas certain qu’il y ait eu d’écrits de Pythagore. L’existence même du personnage a été remise en question. L’influence de son école sur la pensée grecque a néanmoins été profonde.
On dit de Pythagore qu’il était originaire de l’île de Samos, une puissance commerciale prospère, comme Milet. Son dictateur local (« tyran »), Polycratès, avait renversé l’aristocratie foncière et régnait avec l’appui de la classe marchande. De lui, l’historien Hérodote rapporte qu’il volait tous les hommes indistinctement, car il disait que ses amis lui étaient plus reconnaissants s’il leur rendait leur propriété qu’ils l’auraient été s’ils ne la leur avaient jamais prise ! Dans sa jeunesse, Pythagore a travaillé apparemment comme « philo-sophos » (celui qui aime la sagesse) sous le patronage de Polycratès. Il voyagea en Phénicie et en Egypte, où l’on dit qu’il fut initié comme membre d’une caste de prêtres égyptiens. En -530, il s’enfuit à Crotone, en Italie du Sud, pour échapper à la guerre civile et à la menace perse qui pesait sur l’Ionie.
La prolifération luxuriante des mythes et des fables rend presque impossible de dire quoi que ce soit de sûr à propos de l’homme. Son école fut certainement un mélange remarquable de recherche mathématique et scientifique et de secte religieuse monastique. La communauté était dirigée selon des principes monastiques, avec des règles strictes, qui comprenaient, par exemple, l’interdiction de manger de la viande, l’interdiction de ramasser ce qui est tombé à terre, d’attiser le feu avec du fer, d’enjamber un pied-de-biche, etc. L’idée était d’échapper au monde, de rechercher le salut dans une vie de paisible contemplation fondée sur les mathématiques, lesquelles étaient revêtues de prétendues qualités mystiques. Reflétant probablement des influences orientales, les Pythagoriciens prêchaient la transmigration des âmes.
En opposition avec le joyeux attachement au monde des matérialistes ioniens, nous avons ici tous les éléments de la vision du monde idéaliste ultérieurement développée par Platon, et reprise par le christianisme, qui a entravé le développement de l’esprit scientifique pour de nombreux siècles. Le moteur de cette idéologie est exactement traduit, dans l’extrait suivant, par J. Burnet :
« Nous sommes des étrangers dans ce monde, et le corps est le tombeau de l’âme, et cependant nous ne devons pas chercher à nous échapper par le suicide, car nous sommes le troupeau de Dieu qui est notre berger, et sans son ordre nous n’avons aucun droit de nous échapper. Dans cette vie, il y a trois sortes d’hommes, de même qu’il y a trois sortes de gens qui viennent aux Jeux Olympiques. La catégorie inférieure est faite de ceux qui viennent acheter et vendre ; la catégorie suivante, ce sont ceux qui viennent pour concourir. La meilleure catégorie, cependant, réside en ceux qui viennent simplement regarder le spectacle. La plus grande purification consiste par conséquent dans la science désintéressée, et c’est l’homme qui se voue à elle, le vrai philosophe, qui s’est le plus effectivement libéré du “cycle de la vie” » (cité par Russell, op. cit., p. 52).
Cette philosophie, avec ses fortes connotations d’élitisme monastique, se révéla populaire dans les classes aisées de Crotone, quoique le nombre de ceux qui ont effectivement cessé de manger des fèves, ou quoi que ce soit d’autre, reste douteux ! Le dénominateur commun dans tout cela est la séparation radicale de l’âme et du corps. Cette idée, qui plonge ses racines dans la conception préhistorique de la place de l’homme dans la nature, s’est transmise sous différentes formes tout au long de l’histoire. Elle ressurgit même dans des traités hippocratiques :
« Quand le corps est éveillé, l’âme n’est pas son propre maître mais elle sert le corps, son attention se divise entre les différents sens corporels – la vue, l’ouïe, le toucher, la marche et toutes les actions du corps – qui privent l’esprit de son indépendance. Mais quand le corps est en repos, l’âme s’éveille, elle gouverne et conserve sa propre maison, et mène à bien toutes les activités du corps. Dans le sommeil, le corps ne ressent rien, mais l’âme éveillée connaît toutes choses ; elle voit ce qui est à voir, entend ce qui est à entendre, marche, touche, souffre, se souvient – en un mot toutes les fonctions du corps et de l’âme joints sont accomplies par l’âme seule dans le sommeil. Et donc quiconque sait interpréter ces questions possède une grande part de la sagesse ».
Par opposition aux philosophes matérialistes ioniens, qui ont délibérément tourné le dos à la religion et à la mythologie, les Pythagoriciens reprirent l’idée du culte à mystères orphique selon laquelle l’âme pouvait se libérer du corps par le moyen d’une « extase » (le mot extasis signifie « la sortie »). C’est seulement lorsque l’âme a quitté la prison du corps qu’elle est réputée exprimer sa véritable nature. La mort est la vie et la vie la mort. Ainsi, depuis sa création, l’idéalisme philosophique, comme son frère siamois religieux, a représenté une inversion de la relation réelle entre la pensée et l’être, l’homme et la nature, les hommes et les choses – inversion qui a persisté jusqu’à nos jours, sous une forme ou une autre, avec les plus pernicieux effets.
La doctrine pythagoricienne
En dépit de son caractère mystique, la doctrine pythagoricienne a marqué un pas en avant dans le développement de la philosophie. Il n’y a rien d’étrange à cela. Dans l’évolution de la pensée humaine, il y a de nombreux cas où le fait de poursuivre des buts irrationnels ou anti-scientifiques a néanmoins contribué à faire progresser la cause de la science. Pendant des siècles, les alchimistes se sont évertués en vain à découvrir la « pierre philosophale ». Tout cela en pure perte. Mais, en cours de route, ils ont fait des découvertes extrêmement importantes dans le domaine de l’expérimentation, lesquelles ont fourni la base sur laquelle la science moderne, en particulier la chimie, s’est développée plus tard.
La tendance fondamentale de la philosophie ionienne a consisté en un essai d’arriver à des généralisations à partir de l’expérience du monde réel. Pythagore et ceux qui l’ont suivi essayèrent d’arriver à une compréhension de la nature des choses par un chemin différent. Schwegler l’explique ainsi :
« On a la même abstraction, mais à un niveau supérieur, quand on détourne le regard de la matière sensible ; quand l’attention n’est plus tournée vers l’aspect qualitatif de la matière, comme l’eau, l’air, etc., mais à sa mesure et à ses relations quantitatives ; quand la réflexion est dirigée non pas vers ce qui est matériel mais vers la forme et l’ordre des choses en tant qu’elles existent dans l’espace » (Schwegler, History of Philosophy, p. 11).
Le progrès de la pensée humaine est d’une façon générale lié à la capacité d’abstraction, capacité de tirer des conclusions générales d’une foule de faits particuliers. Puisque la réalité a de multiples aspects, il est possible de l’interpréter de bien des façons qui reflètent chacune un élément ou un autre de la vérité. Cela, nous le voyons souvent dans l’histoire de la philosophie, lorsque de grands penseurs saisissent un aspect de la réalité et le prennent pour une vérité absolue et finale, vérité balayée par la génération suivante de penseurs, qui, à son tour, répète le processus. Mais l’ascension et la chute des grandes écoles philosophiques et des théories scientifiques signifient le développement et l’enrichissement de la pensée par un processus sans fin d’approximations successives.
Les Pythagoriciens abordèrent le monde du point de vue du nombre et des relations quantitatives. Pour Pythagore, « tout est nombre ». Cette idée était liée à la recherche de l’harmonie qui sous-tend l’univers. Ils croyaient que le nombre était l’élément à partir duquel toutes les choses se développaient. En dépit de cet élément mystique, ils firent d’importantes découvertes qui stimulèrent grandement le développement des mathématiques, en particulier de la géométrie. Ils inventèrent les termes de nombres pairs et impairs, les impairs étant mâles et les pairs femelles. Comme aucune femme n’était admise dans la communauté, ils déclarèrent naturellement divins les nombres impairs – et terrestres les pairs ! De la même manière, nos termes de carrés et cubes pour les nombres viennent des Pythagoriciens, qui découvrirent aussi la progression harmonique dans la gamme musicale, liant la longueur d’une corde à la hauteur de la note obtenue par sa vibration.
Ces importantes découvertes n’ont eu aucune portée pratique chez les Pythagoriciens, qui s’intéressaient à la géométrie uniquement d’un point de vue mystique. Les Pythagoriciens eurent cependant une influence déterminante sur la pensée à venir. La mystique des mathématiques en tant que sujet ésotérique, inaccessible aux hommes ordinaires, a persisté jusqu’à nos jours. Elle fut transmise par la philosophie idéaliste de Platon, qui avait fait placer à l’entrée de son école cette inscription : « nul n’entre ici s’il n’est géomètre ».
« La cosmologie des Pythagoriciens », écrit le professeur Farrington, « est très curieuse et très importante. Ils n’ont pas essayé, comme les Ioniens, de décrire l’univers en termes de comportement de certains éléments matériels et de processus physiques. Ils l’ont décrit exclusivement en termes de nombres. Aristote a dit longtemps après qu’ils considéraient le nombre comme la matière aussi bien que la forme de l’univers. Les nombres constituaient la vraie matière dont le monde était fait. Ils appelaient un point Un, une ligne Deux, une surface Trois, un solide Quatre, selon le minimum de points nécessaires pour définir chacune de ces dimensions » (Farrington, op. cit., p. 47). Ils attachaient une signification magique à certains nombres – trois, quatre, sept. Le nombre dix avait une importance particulière, lui qui est la somme de 1, 2, 3 et 4. Ces superstitions persistent encore dans la Sainte Trinité, les quatre cavaliers de l’Apocalypse, les sept péchés mortels, et le reste. « Cela apparaît aussi », ajoute Bernal, « dans la physique mathématique moderne à chaque fois que ses adeptes essaient de faire de Dieu le mathématicien suprême » (Bernal, op. cit., p. 124).
L’histoire de la science est caractérisée par l’esprit partisan le plus ombrageux, frisant par moment le fanatisme, pour défendre certaines écoles de pensée particulières, qui se présentent elles-mêmes comme les protagonistes d’une vérité absolue, et qui de fait incarnent le point le plus élevé atteint par l’esprit humain à un moment donné. Ce sont seulement les développements ultérieurs de la science elle-même qui révèlent les limites et les contradictions internes d’une théorie donnée, qui est alors réfutée par son opposée, puis réfutée à son tour, et ainsi de suite à l’infini. Ce processus est précisément la dialectique de l’histoire des sciences, qui a progressé en tandem avec l’histoire de la philosophie pendant des siècles – et qui, initialement, ne se distinguait pas d’elle.
« Tout est nombre »
Le développement de l’étude quantitative de la nature fut évidemment d’une importance cruciale. Sans elle, la science en serait restée au niveau de simples généralités incapables de progression. Toutefois, lorsqu’un tel progrès se produit, on a inévitablement tendance à l’exagérer. C’est particulièrement vrai dans le cas où la science est encore mêlée à la religion.
Les Pythagoriciens voyaient les nombres – les relations quantitatives – comme l’essence de toutes choses. « Tout est nombre ». En effet, il est possible d’expliquer de nombreux phénomènes naturels en termes mathématiques. Cependant, même les modèles mathématiques les plus avancés ne sont que des approximations du monde réel. L’insuffisance d’une approche purement quantitative est devenue évidente il y a déjà longtemps. G. W. F. Hegel, dont, en tant qu’idéaliste convaincu et formidable mathématicien, on aurait pu s’attendre à ce qu’il fût enthousiaste de l’école pythagoricienne, était en réalité loin de l’être. Hegel n’avait que mépris pour l’idée que le monde pourrait se réduire à des relations quantitatives.
Depuis les Pythagoriciens, les prétentions les plus extravagantes ont pu être formulées au bénéfice des mathématiques, qui ont été dépeintes comme la reine des sciences, la clé magique qui ouvre toutes les portes de l’univers. Rompant tout contact avec la grossière réalité matérielle, les mathématiques ont donné l’apparence de monter au ciel, où elles ont acquis une existence divine, ne reconnaissant plus d’autre autorité que la leur. Ainsi, le grand mathématicien Henri Poincaré, au début du XXe siècle, a-t-il pu affirmer que les lois de la science n’étaient pas du tout liées au monde réel mais représentaient des conventions arbitraires destinées à promouvoir une description plus commode et « utile » des phénomènes correspondants. De nombreux physiciens déclarent maintenant ouvertement que la validité de leurs modèles mathématiques ne dépend pas d’une vérification empirique mais des qualités esthétiques de leurs équations.
Ainsi, les théories mathématiques ont été, d’un côté, la source d’un extraordinaire progrès scientifique, et, de l’autre, l’origine de nombreuses erreurs et conceptions fausses qui ont eu, et ont encore, des conséquences profondément négatives. L’erreur fondamentale est d’essayer de réduire le fonctionnement complexe, dynamique et contradictoire de la nature à des formules quantitatives statiques et ordonnées, ce qui est le cas des Pythagoriciens, qui présentent la nature de manière formelle comme un point unidimensionnel, devenant une ligne, devenant un plan, un cube, une sphère, etc. A première vue, le monde des mathématiques pures est celui de la pensée pure, préservée de la souillure des choses matérielles. Mais on est loin du compte, comme le remarque Engels. Nous utilisons le système décimal non par l’effet d’un quelconque raisonnement logique ou d’une « libre volonté », mais parce que nous avons dix doigts. Le mot « digital » vient du terme latin qui signifie « doigt ». Et jusqu’à nos jours, un écolier comptera secrètement sur ses doigts matériels sous son bureau matériel avant d’arriver à la réponse à un problème abstrait de mathématiques. Ce faisant, l’enfant retrace inconsciemment la voie suivie par les premiers hommes lorsqu’ils apprirent à compter.
Les origines matérielles des abstractions mathématiques n’eurent aucun secret pour Aristote : « Le mathématicien », a-t-il écrit, « étudie des abstractions. Il élimine toutes les qualités sensibles comme le poids, la densité, la température, etc., et laisse seulement le quantitatif et le continu (en une, deux ou trois dimensions) et ses attributs essentiels ». (Métaphysique).
Le développement des mathématiques est le résultat de besoins humains très matériels. L’homme primitif n’eut d’abord que dix sons pour dénombrer, précisément parce qu’il comptait, comme un petit enfant, sur ses doigts. Les Mayas d’Amérique centrale font exception parce qu’ils ont eu un système numérique de base vingt au lieu de dix, sans doute parce qu’ils comptaient les doigts des pieds en plus de ceux des mains. Aucun homme vivant dans une simple société de chasseurs-cueilleurs, sans monnaie ni propriété privée, n’avait besoin de grands nombres. Pour communiquer un nombre plus grand que dix, il se contentait de combiner certains des dix sons en relation avec ses doigts. Ainsi, un plus dix est exprimé par « un-dix » (undecim en latin, ou ein-lifon – « un au-dessus » – en germain primitif, ce qui a donné eleven en anglais moderne). Tous les autres nombres ne sont que des combinaisons des dix sons originaux, à l’exception de cinq ajouts : cent, mille, million, milliard et trillion.
L’origine réelle des nombres fut déjà comprise par le grand philosophe matérialiste anglais du XVIIe siècle, Thomas Hobbes : « Et il semble qu’il fut un temps où ces noms de nombres n’étaient pas en usage, et les hommes étaient forcés de poser les doigts d’une main, ou des deux, sur les choses dont ils voulaient tenir le compte. Et c’est de là que vient qu’aujourd’hui que les noms de nombres ne sont que dix en toute nation, et ne sont que cinq dans certaines nations, après quoi ils recommencent » (Léviathan, I-4).
Alfred Hooper explique : « C’est seulement parce que l’homme primitif a inventé le même nombre de nombres-sons qu’il possédait de doigts, que notre échelle numérique est aujourd’hui décimale, c’est-à-dire une échelle fondée sur dix et consistant dans la répétition sans fin des mêmes nombres-sons premiers de base… Si les hommes avaient eu douze doigts au lieu de dix, nous aurions sans aucun doute aujourd’hui une échelle numérique duodécimale, c’est-à-dire une échelle fondée sur douze, consistant dans la répétition sans fin de douze nombres-sons de base » (A. Hooper, Makers of Mathematics, pp. 4-5). En réalité, un système duodécimal comporte certains avantages par rapport au décimal. Tandis que dix ne peut être divisé exactement que par deux et cinq, douze peut l’être par deux, trois, quatre et six.
Les chiffres romains sont des figurations des doigts. Le symbole pour cinq représentait probablement l’espace entre le pouce et les autres doigts. Le mot calculus (duquel dérive « calculer ») signifie une « petite pierre » en latin, ce qui est lié à la méthode de compter des perles sur un boulier. Cet exemple et bien d’autres servent à montrer que les mathématiques ne sont pas nées d’une libre opération de l’esprit humain, mais sont le produit d’un long processus d’évolution sociale, d’essais et d’erreurs, d’observation et d’expérience, qui a donné lieu progressivement à un corps de connaissances séparé d’un caractère apparemment abstrait.
De la même façon, notre système actuel de poids et mesures est dérivé d’objets matériels. L’origine de l’unité anglaise, le pied (foot), est évidente, comme le mot espagnol pulgada, qui renvoie au pouce, comme l’anglais inch. L’origine des symboles mathématiques de base + et - n’a rien à voir avec les mathématiques. Il s’agissait de signes utilisés au Moyen Âge par les marchands pour calculer l’excès ou l’insuffisance des quantités de marchandises dans les entrepôts.
La nécessité de construire des abris pour se protéger des éléments a forcé l’homme primitif à trouver le moyen le meilleur et le plus pratique de couper du bois de telle sorte que les emboîtements s’effectuent bien. Cela signifiait découvrir l’angle droit et l’équerre. La nécessité de construire une maison sur un sol plan a conduit à l’invention de cette sorte de niveau peint sur les tombes égyptiennes et romaines, consistant en trois pièces de bois jointes en un triangle isocèle, avec une corde attachée au sommet. De tels outils simples et pratiques étaient utilisés pour la construction des pyramides. Les prêtres égyptiens ont accumulé un corps immense de connaissances mathématiques dérivées en définitive d’une telle activité pratique.
Le mot même de « géométrie » trahit son origine pratique. Il signifie simplement « mesure de la terre ». La force des Grecs fut de donner une expression théorique achevée à ces découvertes. Cependant, en présentant leurs théorèmes comme le pur produit d’une déduction logique, ils se leurraient eux-mêmes – et leurraient les générations futures. En dernière analyse, les mathématiques dérivent de la réalité matérielle, et, de fait, ne pourraient avoir aucune application si ce n’était pas le cas. Même le fameux théorème de Pythagore, connu de tous les élèves, selon lequel un carré dessiné à partir du côté le plus long d’un triangle rectangle est égal à la somme des carrés dessinés à partir des deux autres côtés, avait déjà été trouvé en pratique par les Egyptiens.
Les Pythagoriciens, rompant avec la tradition matérialiste des Ioniens qui cherchaient à généraliser à partir de l’expérience du monde réel, affirmèrent que les plus hautes vérités des mathématiques ne pouvaient pas être dérivées du monde sensible mais seulement du travail de la raison pure, par raisonnement. Partant de certains principes qui doivent être posés comme vrais, le philosophe les développe par une suite d’étapes logiques jusqu’à arriver à une conclusion en utilisant uniquement des faits compatibles avec les principes ou dérivés d’eux. C’est ce qu’on appelle le raisonnement a priori, du latin signifiant « à partir de ce qui vient en premier ».
Usant de la déduction et du raisonnement a priori, les Pythagoriciens ont cherché à établir un modèle de l’univers fondé sur des formes parfaites et gouverné par l’harmonie divine. Le problème est que les formes du monde réel sont tout sauf parfaites. Par exemple, ils pensaient que les corps célestes étaient des sphères parfaites se déplaçant selon des cercles parfaits. C’était un progrès révolutionnaire pour l’époque, mais aucune de ces affirmations n’est exacte. La tentative d’imposer une harmonie parfaite à l’univers, de l’exempter de toute contradiction, s’est bientôt effondrée, même dans les questions proprement mathématiques. Des contradictions internes commencèrent à faire surface, ce qui conduisit à une crise de l’école pythagoricienne.
Au milieu du Ve siècle environ, Hippase de Métaponte découvrit que la relation quantitative entre le côté et la diagonale de figures simples comme le carré et le pentagone régulier était incommensurable, c’est-à-dire qu’elle ne pouvait être exprimée sous la forme d’une fraction déterminée. La racine carrée de deux ne peut être exprimée par aucun nombre. Elle consiste en ce que les mathématiciens nomment un nombre « irrationnel ». Cette découverte mit la confusion dans toute la théorie. Jusque-là les Pythagoriciens avaient enseigné que le monde était construit à partir de points. Même s’il se pouvait qu’on ne puisse dire combien de points comportait une ligne donnée, ils étaient toujours supposés en nombre fini. Maintenant, si la diagonale et le côté d’un carré sont incommensurables, il s’ensuit que ces lignes sont infiniment divisibles et que les petits points à partir desquels le monde est censé être construit n’existe pas.
A partir de ce moment, les Pythagoriciens entamèrent leur déclin. L’école se divisa entre des factions rivales, l’une d’entre elles s’enterrant dans une spéculation mathématique encore plus abstruse, tandis que l’autre cherchait à surmonter la contradiction au moyen d’innovations mathématiques ingénieuses qui posèrent les bases du développement des sciences quantitatives.