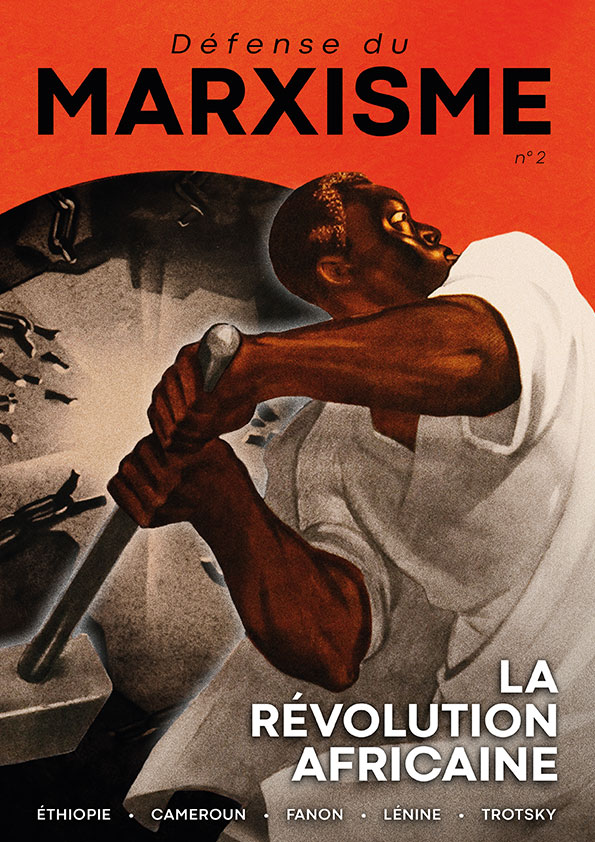Cet article est adapté d’un exposé présenté lors d’une école locale de formation marxiste, à Toulouse en mars 2019, sur la base d’un article de nos camarades belges.
Beaucoup de préjugés entourent Rosa Luxemburg : pour les réformistes, elle était réformiste ; pour les staliniens, c’était une menchévik, une trotskyste, ou encore une centriste, au sens où l’emploient les marxistes pour qualifier un dirigeant politique qui oscille entre le réformisme et la révolution. Pour certains anarchistes, c’est une figure libertaire, opposée à Lénine et à une conception prétendument autoritaire du parti, là où selon eux, Luxemburg est plutôt spontanéiste, s’appuyant sur le mouvement des masses. Tous ces préjugés diffamants, s’ils ont des objectifs différents, servent en réalité à la même chose : rejeter les idées authentiques du marxisme révolutionnaire. Pour les marxistes, la vie et les idées de Rosa Luxemburg sont très riches en enseignements et doivent être étudiées avec sérieux. Après son assassinat il y a un siècle, Lénine, qui avait beaucoup débattu avec elle, donna des instructions afin que toutes ses œuvres soient publiées dans la jeune Russie des soviets, et que les étudiants du marxisme puissent les lire.
Rozalia Luxemburg est née en Pologne dans une famille juive, le 5 mars 1871, quelques jours avant le soulèvement de la Commune de Paris, à une époque où la Pologne était intégrée à l’empire tsariste russe, qui opprimait les minorités nationales et la population juive. Vers l’âge de 16 ans, Rosa Luxemburg s’engage en politique : elle rejoint un petit groupe proche de l’organisation Proletariat. A cette époque, la plupart des révolutionnaires russes sont fascinés par les idées des « populistes » et du terrorisme individuel, mais contrairement à eux, le groupe Proletariat s’organise autour de la classe ouvrière pour diffuser les idées du marxisme. Très rapidement, en 1889, Rosa Luxemburg se fait remarquer par la police et doit fuir la Pologne à cause de ses activités. Elle arrive à Zurich, en Suisse, où se trouvent de nombreux réfugiés polonais et russes. C’est là qu’elle soutient une thèse en économie politique. C’est aussi en Suisse qu’elle rencontre les grands révolutionnaires polonais et russes, exilés en Suisse eux aussi, et s’engage très rapidement dans les débats politiques et théoriques intenses qui animaient l’exil révolutionnaire en Suisse. Elle rencontre par exemple Georges Plekhanov, qui avait formé Lénine.
En 1892, elle entreprend avec Leo Jogiches la fondation du SDKP, la Social-démocratie du royaume de Pologne, qui naît en 1893 et s’appellera plus tard Parti Socialiste du Royaume Polonais et de la Lituanie. A 22 ans, Rosa Luxemburg est déjà membre du bureau socialiste international et, en août 1893, elle assiste à son premier congrès de la IIe Internationale, l’Internationale Socialiste (IS), et plaide pour la reconnaissance de la SDKP. Sa première tentative échoue, mais la SDKP est finalement reconnue par l’Internationale en 1896. Pour Rosa Luxemburg, c’est une époque de querelles contre le nationalisme d’un autre parti qui se prétend socialiste, le Parti Socialiste Polonais, qui défend l’indépendance de la Pologne et articule une grande partie de son programme et de son agitation politique presque exclusivement autour de cette question, alors que pour la SDKP, c’est une révolution socialiste dans les empires austro-hongrois, russe et allemand qui libérera la Pologne. En 1899, la SDKP s’unifie avec l’Alliance des Travailleurs de Lituanie et devient la SDKPiL. A cette époque, l’expression « social-démocratie » signifie encore marxiste, révolutionnaire.
Très jeune, Rosa Luxemburg se fait remarquer dans les congrès de l’Internationale Socialiste par sa participation très active dans les débats politiques et théoriques. Elle déménage en Allemagne en 1898. S’ouvre alors pour elle un terrain d’action politique et théorique beaucoup plus vaste que la Suisse ou la Pologne : la classe ouvrière allemande est à l’époque la plus puissante, la mieux organisée, la plus avancée de l’Europe, voire du monde. Naturalisée allemande, Rosa Luxemburg adhère au Parti social-démocrate allemand, le SPD, et se révèle une formidable oratrice ; de nombreux vieux dirigeants du SPD redoutent sa profondeur théorique et sa capacité à mener des polémiques et à enfoncer les réformistes, qui n’osent pas encore se revendiquer comme tels, au sein du parti.
En plus de son activité théorique, Rosa Luxemburg prend part à tous les aspects de la vie du cadre révolutionnaire professionnel : elle prend la parole dans des discours de masse, se rend dans les usines, participe aux publications du parti et du mouvement syndical… Rosa Luxemburg met son talent littéraire au service du socialisme, dans de très nombreuses publications où elle s’empare de tous les sujets. Un talent bien lisible dans de magnifiques textes comme « Dans l’asile de nuit », écrit en janvier 1912, à propos d’un fait divers ayant éclaté peu après le réveillon de Noël.
Réforme sociale ou révolution ? (1899)
La première grande polémique dans laquelle se lance Rosa Luxemburg, ce n’est pas elle qui l’engage. Elle réagit à une série d’articles d’Eduard Bernstein, publiés entre 1896 et 1898 sous le nom de « Problèmes du socialisme », dans la revue Die Neue Zeit (Les Temps Nouveaux), la revue du SPD. C’est ce qu’on a appelé la « querelle du réformisme », ou « querelle révisionniste ». Bernstein écrit alors ce que de nombreux autres dirigeants du parti pensaient tout bas et appliquaient déjà dans la pratique. Pour lui, en une formule, le but final du socialisme n’est pas important, mais « le mouvement [vers le socialisme] est tout ».
Pour Bernstein, le capitalisme et la société bourgeoise ont bien changé depuis Marx, et dès les années 1890, les prévisions de Marx se révèlent fausses, selon lui ; dans une lettre au Congrès de Stuttgart, en octobre 1898, il écrit : « Le nombre des possédants n’a pas diminué, mais grandi. […] Dans le domaine politique, nous voyons disparaître petit à petit les privilèges de la bourgeoisie capitaliste devant les progrès des institutions démocratiques. […] Mais plus les institutions politiques des nations modernes se démocratisent, plus aussi la nécessité et l’éventualité des grandes catastrophes politiques [c’est-à-dire les révolutions] disparaissent. ». Autrement dit, pour Bernstein, le capitalisme ne connaîtra plus de crises, il atténue ses contradictions, les modère. Selon lui, les menaces de guerre s’écartent de plus en plus grâce à l’étendue du capitalisme, grâce au développement des trusts, des monopoles, et grâce au développement de l’impérialisme. La stratégie du SPD devait donc, selon Bernstein, consister essentiellement à restreindre petit à petit la propriété capitaliste de façon à ce que, le jour où les socialistes décideraient de transformer cette propriété capitaliste en propriété socialiste, les capitalistes ne pourraient plus résister. Karl Kautsky, autre grand dirigeant du SPD que beaucoup voyaient comme le pape du marxisme, répond à cette polémique avec timidité, énonçant une troisième voie, l’idée d’une contre-société socialiste, qui se développe face à la société bourgeoise, avec ses propres cadres, ses propres lieux et institutions, hérités des organisations de la classe ouvrière, notamment le SPD. Comme il le dit lui-même : « Le SPD est un parti révolutionnaire, mais non pas un parti qui fait la révolution ».
C’est Rosa Luxemburg qui apporte une opposition marxiste aux thèses de Bernstein, en publiant entre 1898 et 1899 une série d’articles, regroupés en 1899 sous le nom de Réforme sociale ou révolution ? Dans ce livre, elle explique comment réformes et révolution ne sont pas antagonistes, ne s’excluent pas mutuellement. Au contraire, le combat pour les réformes est extrêmement important, à condition de les lier à l’idée de la révolution socialiste. En effet, aucune réforme sociale, économique, politique, n’est garantie comme acquise sous le capitalisme. Si on veut les maintenir, il faut radicalement changer la société. Pour Rosa Luxemburg, la lutte pour les réformes fait partie d’un apprentissage indispensable pour la classe ouvrière. C’est à travers la lutte pour l’amélioration immédiate de ses conditions de vie et de travail que la classe ouvrière peut gagner en confiance, en organisation, et en connaissances politiques. « Entre la réforme sociale et la révolution, la social-démocratie voit un lien indissoluble : la lutte pour la réforme étant le moyen, et la révolution sociale le but. » Ce qu’elle explique, c’est que ce but final dont parle Bernstein est la seule distinction décisive entre eux et le radicalisme bourgeois, qui défend le sauvetage du capitalisme par l’action des travailleurs, alors que la social-démocratie a pour tâche l’abolition du capitalisme. Pour Rosa Luxemburg, la position de Bernstein remet en cause l’existence tout entière du mouvement socialiste.
Dans cette brochure, elle caractérise l’opportunisme petit-bourgeois de Bernstein, le décrit « en théorie et en pratique » et s’intéresse à ses conséquences, mais elle répond aussi aux arguments de Bernstein sur ce qu’il appelle « l’adaptation du capitalisme », et révèle, grâce à l’analyse marxiste, les contradictions qui habitent chacun des leviers sur lesquels Bernstein veut s’appuyer pour réaliser le socialisme grâce aux réformes. Entre autres choses, elle traite également des syndicats, qui permettent à la classe ouvrière de prendre conscience de la loi des salaires sans pouvoir la contrôler ni la supprimer, alors que Bernstein et ses partisans rêvent de se servir des syndicats pour tendre à l’infini vers la réforme.
Rosa Luxemburg anticipe l’exacerbation des contradictions du capitalisme, contrairement à Bernstein, qui fait reposer toute sa théorie sur la modération de ces contradictions. Ce n’était pas une chose évidente au moment où elle écrit, à la toute fin du XIXe siècle, où tout semblait justement aller dans le sens d’une atténuation des contradictions. La croissance de l’économie semblait écarter toute crise, les salaires augmentaient, des réformes sociales étaient engagées, etc. Le SPD était redevenu légal et représentait 20 % de l’électorat ; au vu de toutes ces conditions, le réformisme se développait sur un terrain fertile : une « aristocratie ouvrière », coupée de la classe ouvrière ne serait-ce que par son mode de vie de permanents, bénéficiait des lois sociales et poussait le parti vers le réformisme ; comme l’expliquent les marxistes, les conditions d’existence déterminent la conscience. La Première Guerre mondiale vient bousculer cet équilibre apparent et valide les thèses de Rosa Luxemburg, mais les vieilles figures réformistes n’en démordent pas et continuent d’affirmer que le développement du capitalisme empêchera les prochaines crises. Rosa Luxemburg polémique avec ces dirigeants, notamment avec Kautsky, qui n’avoue pas son réformisme, à une époque où Lénine le considère encore comme son maître.
Grève de masse, parti et syndicat (1906)
Rosa Luxemburg étudie des événements qui influencent sa conception de la grève générale, comme la grève générale de 1902 en Belgique, pour le suffrage universel. Mais ce qui est déterminant pour sa vision, c’est la grève générale révolutionnaire de 1905 en Russie, à laquelle elle participe : alors que les dirigeants du SPD se tiennent bien à l’écart de la Russie, elle s’y rend pour faire de l’agitation, écrit des articles, prend la parole lors de rassemblements, organise les ouvriers, et finit en prison avant d’être expulsée du pays. Cette série de grandes grèves conduisent à ce qu’on a qualifié de révolution russe de 1905. Lénine et Trotsky en parlent comme de la « répétition générale de 1917 », et c’est le premier soulèvement de masse sur le continent européen depuis la Commune de Paris. Rosa Luxemburg explique que cette grève contre le régime absolutiste du tsar a débouché sur de nombreuses grèves pour des motifs économiques (comme l’augmentation des salaires, par exemple), et a permis au prolétariat de s’organiser et de s’éduquer à la lutte.
Elle analyse ces événements dans un livre paru en 1906, Grève de masse, parti et syndicat. Dans cet ouvrage, elle établit un lien entre la grève et la lutte politique, une relation similaire à celle qui lie la réforme à la révolution : « C’est seulement dans la tempête révolutionnaire que chaque lutte partielle entre le capital et le travail prend les dimensions d’une explosion générale. » Elle appuie le rôle du parti dirigeant, mais explique néanmoins que le parti n’a pas tous les pouvoirs pour déclencher la grève, justement parce que la grève découle d’une série de phénomènes : en termes dialectiques, c’est ce qu’on appelle un saut qualitatif, une accumulation de phénomènes qui conduisent à un changement d’état. Sur ces bases-là, on a ensuite reproché à Rosa Luxemburg son spontanéisme, et on l’a opposé à Lénine sur cette question, comme si Lénine ne reconnaissait pas l’importance de la spontanéité dans le développement des révolutions. En 1905, aucune organisation politique russe n’avait de poids déterminant pour appeler à la grève générale. En février 1917, aucun état-major politique n’a convoqué la révolution. La spontanéité joue un rôle important dans le déclenchement de toute une série de mouvements sociaux, mais elle ne fournit aucun outil pour rendre ces luttes victorieuses. En réalité, Rosa Luxemburg réagit avec virulence contre le fétichisme de l’organisation, qui est particulièrement fort en Allemagne. Elle fait une critique du réformisme permis par la bureaucratisation des organisations.
Rosa Luxemburg insiste sur le lien entre syndicat et parti ; elle considère que séparer les deux types d’organisations est une erreur et une illusion, qu’ils ne sont pas parallèles, mais constituent les deux faces de la lutte des classes : « S’il est vrai qu’en période parlementaire les deux aspects de la lutte de classe se distinguent pour des raisons techniques, ils ne représentent pas pour autant deux actions parallèles, mais seulement deux phases, deux degrés de la lutte pour l’émancipation de la classe ouvrière. La lutte syndicale embrasse les intérêts immédiats, la lutte politique de la social-démocratie les intérêts futurs du mouvement ouvrier. » Pour Rosa Luxemburg, le parti socialiste est le lieu où se rencontrent la lutte parlementaire et la lutte économique, syndicale, comme deux aspects complémentaires de la lutte des classes ; elle affirme que le syndicat est une partie de la lutte des classes là où le parti en constitue le tout, l’organe central, et que par conséquent, les socialistes doivent refuser la thèse de « l’égalité des droits » entre parti et syndicat, qu’elle voit comme une déviation opportuniste et une concession au réformisme, plus précisément dans le mouvement ouvrier allemand, où SPD et syndicats sont particulièrement liés. Dans une période révolutionnaire, les deux organisations doivent nécessairement retisser leurs liens intrinsèques, sous peine d’être dépassées par le mouvement des masses : « Qu’il se produise en Allemagne, à telle ou telle occasion, à tel ou tel moment, de grandes luttes politiques, des grèves de masse, elles inaugureront simultanément une période de violentes luttes syndicales, sans que l’histoire demande aux dirigeants syndicaux leur approbation ou leur désapprobation […] il en serait de même, dans un cas analogue, des dirigeants du parti. »
Rosa Luxemburg bouleverse la stratégie du SPD, « la vieille tactique éprouvée », qui consistait à accumuler des forces pour la construction d’une contre-société au sein de la société capitaliste, ce qui tôt ou tard – on ne sait jamais quand exactement – devait donner lieu à une transformation qualitative vers le socialisme. Rosa Luxemburg est convaincue que cette vision-là est fausse et que, le jour décisif, cette tactique échouera. A la place, elle mène campagne pour la grève générale révolutionnaire, extrêmement importante dans la lutte pour le socialisme.
Officiellement, la social-démocratie allemande s’appuie sur la critique faite par Engels aux anarchistes, tout particulièrement à Bakounine dans un texte de 1873, « Les bakouninistes au travail » : ces militants anarchistes voyaient dans la grève le point de départ de la révolution, son « levier ». Mais en réalité, les dirigeants du SPD et des syndicats en 1906 sont effrayés par ce mot d’ordre de grève de masse, eux qui sont habitués à avoir le plein pouvoir sur les grèves, et à n’en organiser que pour de petites améliorations des conditions de vie ou de travail de la classe ouvrière. C’est avec ces dirigeants que Rosa Luxemburg polémique dans son livre en abordant la grève générale russe.
La faillite de la IIe Internationale et du SPD
A l’époque de Rosa Luxemburg, le SPD est le plus grand parti de l’Internationale Socialiste. Fondé en 1875, mais illégal de 1878 à 1890, le SPD a réussi en 30 ans à développer un appareil extraordinaire de 15 000 permanents, 90 quotidiens, l’obtention d’environ un tiers des voix aux élections, le contrôle des syndicats et de dizaines d’associations sportives, culturelles ou coopératives… Un parti modèle pour l’IS. Au tout début du XXe siècle, Lénine y voit le modèle pour la construction du parti ouvrier social-démocrate de Russie, comme il l’écrit dans Que faire ?
En 1912, alors que les puissances impérialistes commencent à s’affronter, un manifeste de la IIe Internationale dénonce la propagande nationaliste et hypocrite des bourgeoisies impérialistes et proclame qu’en cas de guerre, la social-démocratie la combattrait au moyen de grèves générales révolutionnaires. Mais finalement, en août 1914, presque tous les partis sociaux-démocrates de l’IS, à l’exception du parti serbe et des bolcheviks russes, se rangent au garde-à-vous derrière leurs bourgeoisies respectives et votent les crédits de guerre demandés par les gouvernements ; c’est le début de la Première Guerre mondiale. Cette trahison des dirigeants « socialistes » prend tout le monde par surprise. Lorsqu’il reçoit le journal du SPD qui annonce le vote des crédits de guerre par les députés socialistes, Lénine croit d’abord qu’il s’agit d’un faux fabriqué par l’état-major allemand. Mais Lénine avait en tête une réalité du SPD qui n’existait plus en 1914 ; par la suite, il admet que Rosa Luxemburg avait raison dans son approche du réformisme et de son impact sur la politique internationale, menant à l’abdication devant l’impérialisme et le militarisme.
Au sein de l’Internationale, une opposition à la guerre se met en place, mais la plupart de ses porte-paroles réclament une paix juste. En décembre 1914, en Allemagne, le jeune député social-démocrate Karl Liebknecht votait seul contre les crédits de guerre et appelait les travailleurs à combattre la bourgeoisie allemande, suivant sa célèbre formule : « l’ennemi principal est dans notre propre pays ».
Avec Liebknecht, Leo Jogiches et Clara Zetkin, Rosa Luxemburg fonde la Ligue Spartakus (Spartakusbund) qui s’efforce de rassembler la gauche révolutionnaire au sein du SPD. Au-delà de leur opposition à la guerre impérialiste, Luxemburg et Liebknecht soutiennent la nécessité de l’action révolutionnaire, là où la direction du SPD choisit de s’intégrer au processus parlementaire. En avril 1915, le groupe fait paraître une revue, L’Internationale, censurée dès la parution de son premier numéro. Ils font ensuite circuler clandestinement des publications politiques, comme le journal intitulé Lettres de Spartacus. La Ligue souligne le lien entre le réformisme d’avant-guerre et la trahison du mois d’août 1914. Pour autant, les spartakistes limitent leur activité à un réseau de correspondance – au lieu de regrouper les révolutionnaires, de les organiser et de les doter d’un programme et d’une direction, autrement dit au lieu d’organiser sérieusement une tendance marxiste.
Pour tous ces militants, la nécessité d’une conférence internationale marquant l’opposition des socialistes internationalistes à la guerre était évidente. Depuis le début de la grande boucherie, aucune réunion internationale n’avait rassemblé de socialistes des différents pays belligérants. Organisée par la direction du PS italien et par Christian Rakovsky, cette conférence finit par se tenir du 5 au 8 septembre 1915 à Zimmerwald, en Suisse, pays où Lénine était alors en exil. Peu de militants purent y assister, car bon nombre de délégués s’étaient vus refuser leurs visas de sortie. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht étant emprisonnés à l’époque, ils ne peuvent y participer. La majorité des présents étaient influencés par les idées pacifistes, qui appellent à la fin de la guerre et donc à la victoire d’un ensemble de pays sur l’autre. Mais Lénine parvint à organiser autour des bolcheviks une « gauche de Zimmerwald », qui allait jouer le rôle d’embryon de la future IIIe Internationale, autour des mots d’ordre du « défaitisme révolutionnaire », qu’on peut définir ainsi : combattre la guerre par des méthodes révolutionnaires ou, comme l’écrivait Lénine, « la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile ». Beaucoup de cadres du parti bolchevik étaient influencés par la propagande « pacifiste », et la formule du « défaitisme révolutionnaire » leur était destinée afin de les affermir. Pour Lénine, la guerre mondiale doit devenir une guerre de classes, et seule la révolution peut vraiment mettre un terme à la guerre. Il y a rupture nette entre sa position révolutionnaire, internationaliste, et celles des pacifistes, qui réclamaient la paix même si elle découlait de la victoire d’un pays impérialiste.
Dans un ouvrage de 1916 intitulé La Crise de la social-démocratie, contenant la célèbre Brochure de Junius (qui n’est pas signée), Rosa Luxemburg fait alors remarquer à Lénine que peu importe qu’un pays perde ou gagne la guerre, les deux issues sont mauvaises pour le prolétariat : « ni en Allemagne, ni en France, ni en Angleterre, ni en Russie, le prolétariat ne peut faire sien le mot d’ordre : victoire ou défaite, un mot d’ordre qui n’a de sens véritable que pour l’impérialisme ». C’est dans ce texte qu’elle présente la célèbre alternative « socialisme ou barbarie », la révolution face au chaos de la guerre. Dans un court texte de juillet 1916, A propos de la brochure de Junius, Lénine fait deux reproches à cette Brochure ; d’abord, elle ne rend pas évident le lien entre opportunisme, réformisme et chauvinisme ; ensuite, elle établit qu’il n’y aura désormais plus que des guerres impérialistes, et plus de guerres nationales (c’est-à-dire des guerres nationalistes, entre pays). Lénine pense que c’est faux, qu’il peut encore y avoir des guerres nationales, selon l’évolution de l’économie mondiale. De là, Lénine soulève d’autres erreurs : la position de l’auteur de Junius face au défaitisme révolutionnaire que Lénine théorise, mais aussi l’absence de soutien aux luttes nationales – il précise néanmoins que ce ne sont pas les erreurs individuelles de « Junius », mais celles de toute la gauche allemande à cause des errances réformistes.
La révolution allemande
Pendant la guerre, de nombreux groupes révolutionnaires apparaissent en Allemagne. Opposés à la Première Guerre mondiale et à la politique chauvine du SPD, ils rompent avec lui pour constituer des petites organisations, coupées aussi bien de Spartakus que de la majorité de la classe ouvrière. Dans le même temps apparaissent les « délégués révolutionnaires » : clandestins et coordonnés au niveau national à l’intérieur des syndicats de masse, ils organisent en 1917 des dizaines de milliers de travailleurs combatifs.
Au fil des mois et des années, une partie des dirigeants du SPD se rend compte de l’impopularité grandissante de la guerre. Ils commencent à critiquer la politique du parti. Pour la plupart d’entre eux, il ne s’agit pas de mettre fin à la guerre en renversant le capitalisme, mais d’obtenir que les belligérants s’accordent sur une « paix sans annexion », pour revenir à la situation d’avant 1914 – c’est-à-dire à la situation qui a mené à la guerre ! Malgré les contradictions et le caractère modéré de ces dirigeants « pacifistes », leur opposition à la majorité de la direction du SPD se renforce. Celle-ci finit par réagir. Assurée du soutien du gouvernement, elle exclut l’ensemble des oppositionnels au début de l’année 1917 : les « pacifistes », comme Kautsky et Bernstein, et les révolutionnaires, comme Liebknecht ou Luxemburg. Tous ces exclus se réunissent pour fonder le Parti Social-Démocrate Indépendant (USPD), qui conserve le programme du parti d’avant 1914 – et dans lequel la Ligue Spartakiste reste une tendance informelle.
A l’automne 1918, il est clair que l’Allemagne sortira perdante de la guerre. Les amiraux allemands lancent cependant une dernière offensive. La marine de guerre se prépare donc à quitter ses ports pour attaquer la Royal Navy britannique. Mais du point de vue des marins allemands, qui savent que la paix est proche, la perspective de mourir « glorieusement » en mer n’a rien d’enthousiasmant. Le 30 octobre 1918, à la veille de l’appareillage de la flotte, les marins de Chillig se mutinent et forment des Conseils de marins et d’ouvriers, suivant l’exemple de la Révolution russe. Le 3 novembre, les marins de Kiel les rejoignent. En quelques jours, le mouvement s’étend à tous les ports et gagne l’intérieur des terres. Le 9 novembre, la révolution a gagné Berlin ; le Kaiser Guillaume II fuit l’Allemagne. Scheidemann, député du SPD, est contraint par la foule de proclamer la « République Allemande ». Deux heures plus tard, Liebknecht, qu’une manifestation avait libéré de prison, proclame la « République Socialiste Libre d’Allemagne ».
Alors qu’il a tout fait pour préserver l’Empire, le SPD, sous la figure de Friedrich Ebert, se retrouve à la tête du gouvernement « révolutionnaire ». En effet, pour des millions de travailleurs allemands qui s’éveillent à la vie politique, le SPD reste le principal parti d’opposition, comme il l’était avant 1914. De plus, les différences entre le SPD et l’USPD paraissent floues. Pour restaurer le plus vite possible la « normalité » bourgeoise, le gouvernement annonce l’élection prochaine d’une Assemblée constituante. Le but de cette manœuvre est de dissoudre les Conseils d’ouvriers et de soldats dans le jeu parlementaire. Pour écraser les révolutionnaires, les dirigeants du SPD ont aussi besoin d’une force armée, car la révolution a brisé l’armée régulière. Le ministre Noske organise donc à partir de décembre des Freikorps (corps francs) composés d’officiers et de sous-officiers volontaires, politiquement hostiles à la révolution.
Depuis la révolution de novembre, les spartakistes ont admis la nécessité d’une organisation révolutionnaire centralisée. Les cadres expérimentés, comme Luxemburg et Jogiches, repoussent la fondation du Parti communiste pour gagner à eux le plus de militants possible de l’USPD. Mais plutôt que de constituer une tendance révolutionnaire au sein de ce parti – auquel adhèrent des dizaines de milliers de travailleurs avancés, dont les « délégués révolutionnaires » – la majorité inexpérimentée des spartakistes pousse à la scission pour créer le Parti Communiste d’Allemagne (KPD). Fin décembre, le Congrès fondateur du KPD voit sa majorité ultra-gauchiste imposer à la direction spartakiste la rupture avec les syndicats et le refus d’une direction centralisée. Malgré les débats, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht n’arrivent pas à faire changer d’avis les congressistes, et à peine fondé, le KPD se coupe déjà de la majorité de la classe ouvrière, mais aussi de beaucoup d’éléments de l’avant-garde révolutionnaire allemande. En outre, le Congrès fondateur impose aussi le boycott des élections à la Constituante, ce qui est une erreur, car les masses allemandes iront voter. Les marxistes savent que les outils de la bourgeoisie ne permettront pas d’en finir avec le capitalisme. Néanmoins, tant que la majorité de la classe ouvrière n’adhère pas à un programme révolutionnaire, nous ne devons pas hésiter à nous servir de ce biais pour propager nos idées et gagner les masses, notamment dans les pays capitalistes avancés comme l’était l’Allemagne de l’époque, en crise à la sortie de la guerre. En outre, dans une situation où la majorité de la classe ouvrière va voter, l’organisation qui appelle au boycott des élections se discrédite aux yeux des masses. Contrairement à ce qu’affirment les mensonges portés plus tard par les anarchistes et les réformistes, Rosa Luxemburg défend bien une position marxiste et révolutionnaire à propos de l’Assemblée constituante et de la question parlementaire ; dans plusieurs articles percutants, et tout en appelant à participer aux élections pour ne pas se couper des masses, elle n’a cessé de souligner le rôle contre-révolutionnaire que pouvait jouer une Assemblée constituante élue au suffrage universel, si cette dernière était dirigée contre les Conseils d’ouvriers.
L’insurrection de janvier et la mort de Rosa Luxemburg
Afin de liquider leur travail, les dirigeants du SPD multiplient les provocations à l’encontre des révolutionnaires ; la presse sociale-démocrate publie des appels à assassiner Luxemburg et Liebknecht. Le 4 janvier 1919, le gouvernement annonce la destitution du préfet de police de Berlin, Emil Eichhorn, qui est aussi membre de l’USPD. Une campagne de solidarité est organisée par l’USPD et le KPD. Le lendemain, des manifestations de masse défilent dans Berlin : elles dépassent complètement leurs organisateurs, qui se demandent s’il ne faudrait pas en profiter pour renverser le gouvernement Ebert. Après des heures d’hésitation, Liebknecht, sans même consulter son parti, se rallie à cette option et l’insurrection est proclamée.
C’est une erreur aux conséquences désastreuses. Si les masses se sont mobilisées pour défendre le préfet Eichhorn, elles ne sont pas prêtes à renverser Ebert : il n’y avait pas eu de travail de mobilisation dans ce but auprès des comités d’ouvriers et de soldats, et aucune préparation militaire. En outre, Berlin est complètement isolé. Une insurrection limitée à la capitale ne peut que déboucher sur un massacre. Dans ces circonstances, le rôle d’un parti révolutionnaire est de contenir la poussée de l’avant-garde en lui expliquant la nécessité de rallier les masses de tout le pays.
Le communiste Karl Radek compare cette insurrection de janvier 1919 aux « journées de juillet » 1917 en Russie : en juillet 1917, la population de Petrograd entendit parler de l’offensive militaire organisée par le gouvernement provisoire russe pour prouver aux puissances alliées la valeur de leur armée, et la colère suscitée par cette offensive mit le feu aux poudres ; la population voulait la fin de la guerre, et l’avant-garde de la classe ouvrière envisagea de renverser le gouvernement et de transférer tout le pouvoir aux soviets, mais cela représentait un risque immense. Petrograd était très en avance par rapport au reste du pays, et cette explosion révolutionnaire risquait de déboucher sur une insurrection limitée à Petrograd, qui serait dès lors écrasée en même temps que la direction du mouvement révolutionnaire. C’est pourquoi les bolcheviks durent se résoudre à prendre la tête du mouvement pour l’encadrer, limiter sa portée, écarter les provocations et accompagner l’avant-garde dans sa lutte. Pour Radek, alors que les bolcheviks étaient plus puissants que le KPD ne l’était en janvier 1919, ils ont néanmoins battu en retraite, et cette tactique a fonctionné : les manifestations armées des 3 et 4 juillet 1917 restèrent limitées à des démonstrations de force.
Face à cette poussée révolutionnaire en Allemagne, le gouvernement Ebert réagit violemment et saute sur l’occasion de se débarrasser des dirigeants communistes. L’insurrection est rapidement écrasée par les corps francs. Arrêtés par des sous-officiers monarchistes aux ordres du gouvernement, Rosa Luxemburg puis Karl Liebknecht sont assassinés le 15 janvier 1919 : des soldats viennent chercher Rosa Luxemburg chez elle et la tuent sur le chemin de la prison, puis jettent son corps dans un des canaux de Berlin. Officiellement, c’est une foule en colère qui l’a tuée. Leo Jogiches, son compagnon, est assassiné au mois de mars, après avoir tenté de découvrir la vérité sur la mort de sa compagne. On repêche le 31 mai 1919 un corps identifié comme celui de Rosa Luxemburg, mais encore de nos jours, cent ans plus tard, il n’y a que peu de certitudes.
Sans Luxemburg, Liebknecht et Jogiches, le jeune KPD est décapité, et multiplie par la suite les erreurs ultra-gauchistes. La mort de ces dirigeants est un désastre pour l’ensemble du mouvement ouvrier international. L’échec de la révolution allemande démoralise le prolétariat du monde entier, particulièrement la classe ouvrière russe. Ces événements illustrent, d’une façon négative, ce que la révolution russe a démontré de façon positive : le rôle décisif du parti et d’une direction révolutionnaire. Il est toujours possible de forger le parti et la direction dans le feu d’une révolution, comme ont tenté de le faire Luxemburg et Liebknecht, mais c’est au prix de défaites énormes pour la classe ouvrière. Voilà pourquoi le parti révolutionnaire doit exister avant la révolution. En 1920, Paul Levi, dirigeant spartakiste, déclare : « nous sommes nombreux à regretter de ne pas avoir commencé la formation du noyau du Parti Communiste en 1903 », c’est-à-dire l’année de la fondation du noyau bolchevik en Russie.
Les polémiques avec Lénine
A partir de novembre 1918, tirant des leçons de la révolution allemande, Rosa Luxemburg passe les derniers mois de sa vie à organiser un parti centralisé, proche du modèle léniniste, contre le spontanéisme répandu dans la majorité du KPD. Le 11 janvier 1919, quelques jours avant de mourir, elle écrit dans Die Rote Fahne (Le Drapeau rouge), le journal du KPD : « L’absence d’une direction, la non-existence d’un centre pour organiser la classe ouvrière de Berlin, ne peut continuer. Si la cause de la révolution doit progresser, si la victoire du prolétariat, du socialisme, doit être autre chose qu’un rêve, les ouvriers révolutionnaires doivent mettre en place des organisations dirigeantes capables de guider et d’utiliser l’énergie combative des masses. » Comme l’écrit le marxiste russe Léon Trotsky dans Histoire de la révolution russe en 1930 : « Sans organisation dirigeante, l’énergie des masses se volatiliserait comme de la vapeur non enfermée dans un cylindre à piston. Cependant le mouvement ne vient ni du cylindre, ni du piston, mais de la vapeur. »
Néanmoins, pendant la majeure partie de sa vie, Luxemburg a bel et bien défendu des positions différentes, notamment lors de polémiques avec Lénine.
En 1904, elle publie dans Die Neue Zeit ainsi que dans l’Iskra (L’Etincelle), le journal du parti social-démocrate russe (POSDR), un article en deux parties intitulé Questions d’organisation de la social-démocratie russe, qui est une réponse aux conceptions sur le parti que Lénine développe dans Un pas en avant, deux pas en arrière (1904) : le contexte de cette polémique, c’est le second congrès du POSDR de juillet-août 1903, qui entame la scission entre bolcheviks et mencheviks.
S’appuyant sur son expérience militante personnelle, elle théorise que l’organisation émane du mouvement ouvrier et ne le précède pas : « Dans le mouvement social-démocrate, à la différence des anciennes expériences du socialisme utopique, l’organisation n’est pas le produit artificiel de la propagande, mais le produit de la lutte de classes, à laquelle la social-démocratie donne simplement de la conscience politique. ». Contrairement aux pays capitalistes avancés, la social-démocratie russe « se voit obligée de suppléer par son intervention consciente à toute une période du processus historique et de conduire le prolétariat, en tant que classe consciente de ses buts et décidée à les enlever de haute lutte, de l’état “atomisé”, qui est le fondement du régime absolutiste, vers la forme supérieure de l’organisation ». Selon Rosa Luxemburg, la social-démocratie russe a dégagé la centralisation comme mode d’organisation, en réaction à l’autonomie des précédents groupes, mais « au congrès [d’août 1903] et encore davantage après le congrès, on dut se persuader que la formule du centralisme était loin d’embrasser tout le contenu historique et l’originalité du type d’organisation dont la social-démocratie a besoin. ».
Elle définit le centralisme de Lénine comme ayant pour principes « d’une part, la sélection et la constitution en corps séparé des révolutionnaires actifs et en vue[1], en face de la masse non organisée, quoique révolutionnaire, qui les entoure, et, d’autre part, une discipline sévère, au nom de laquelle les centres dirigeants du parti interviennent directement et résolument dans toutes les affaires des organisations locales du parti. », et met en garde contre les dérives bureaucratiques et autoritaires de cette conception du parti. Forte de l’expérience allemande, elle prévient également de la déviation vers le parlementarisme bourgeois comme symptôme de l’opportunisme, en répondant à Lénine qui affirme, selon elle, que l’opportunisme a une préférence nette pour une forme précise d’organisation, ici la décentralisation et l’autonomie. Elle rappelle que « l’opportunisme ne connaît qu’un seul principe : l’absence de tout principe. Il choisit ses moyens d’action au gré des circonstances, pourvu que ces moyens semblent pouvoir le conduire aux buts qu’il poursuit. »
Concernant les révolutionnaires professionnels que décrit Lénine, elle voit leur rôle très à la baisse, et insiste sur la nécessité de faire progresser l’ensemble de la classe ouvrière : « Les erreurs commises par un mouvement ouvrier véritablement révolutionnaire sont historiquement infiniment plus fécondes et plus précieuses que l’infaillibilité du meilleur “comité central”. » Ce droit à l’erreur, en quelque sorte, lui a pourtant coûté la vie : dans le KPD, même les meilleurs cadres spartakistes ont été poussés sur leur gauche par les militants inexpérimentés et aux tendances gauchistes, à cause du manque de formation systématique de cadres.
Rosa Luxemburg est opposée à un centralisme à outrance. Pour elle, le centralisme n’est pas une panacée, ce qu’elle démontre à partir d’exemples concrets, mais elle appelle sans cesse à regarder le contexte social précis, à ne jamais extraire les éléments de leur contexte, avant d’en tirer des conclusions politiques.
La même année, Lénine répond fermement à cet article et condamne de très lourdes erreurs d’interprétation : « je dois dire que l’article de Rosa Luxemburg dans la Neue Zeit familiarise les lecteurs non avec mon livre, mais avec quelque chose d’autre ». Il répond qu’il ne réduit pas le parti aux révolutionnaires professionnels et qu’il est en faveur d’un parti centralisé (qui n’existait pas encore en Russie, contrairement à l’Allemagne), mais que la question n’est pas l’hyper-centralisation : « la discussion a surtout porté chez nous sur le fait de savoir si le Comité central et l’organe central devaient représenter l’orientation de la majorité du congrès ou non. ». Lénine militait pour une organisation soudée et disciplinée, composée de militants actifs, à l’inverse des futurs menchéviks, qui voulaient que le parti soit ouvert à tous ceux qui se qualifient de social-démocrates, même s’ils ne menaient aucune activité politique et se tenaient à l’écart des structures locales du parti. Mais Lénine ne considérait pas cette divergence comme suffisamment importante pour justifier la scission qui s’est produite. Après le congrès, il a cherché à surmonter la division. C’est seulement dans la foulée de la révolution de 1905 que s’est effectuée la différenciation politique entre les deux tendances : l’une réformiste, l’autre révolutionnaire.
Un autre débat important avec Lénine portait sur le droit à l’auto-détermination des peuples. Ce n’est pas un débat dans l’absolu, mais propre à une question précise : l’auto-détermination des Polonais, alors que la Pologne dépend de l’empire tsariste. Pour Rosa Luxemburg, le droit à l’auto-détermination des peuples est une question secondaire ; il ne peut pas être obtenu sous le capitalisme, et ne sera plus nécessaire sous le socialisme. Elle est influencée par sa lutte de jeunesse au sein de la SDKP contre le PSP. Pour Lénine, la seule façon de séparer les masses paysannes et ouvrières qui tombent sous l’influence du nationalisme bourgeois, ce n’est pas d’être nationaliste, mais de défendre à outrance toutes les libertés démocratiques, nationales, linguistiques des minorités opprimées. Selon lui, le programme du marxisme sur la question nationale est essentiellement un programme négatif, qui rejette toute forme d’oppression et de discrimination, mais qui doit défendre jusqu’à la revendication du droit à l’autodétermination des peuples. Cela ne signifie pas l’obligation de l’autodétermination des peuples, l’obligation de soutenir partout et sous n’importe quelles conditions la création de nouveaux Etats, mais que les marxistes doivent défendre le droit à l’autodétermination, voire la possibilité pour une nation opprimée de se séparer d’une nation opprimante. Lénine explique ceci pour que les marxistes du monde entier, en particulier de la Russie, qui est une prison des peuples, puissent gagner la confiance des minorités nationales opprimées. L’expérience de 1917 prouve que Lénine avait raison. Pour lui, le droit à l’auto-détermination est similaire au droit au divorce : c’est un droit qui doit être défendu, mais les marxistes – bien sûr – ne vont pas encourager tous les ménages à se séparer. La reconnaissance et la défense de ce droit ne sont pas un encouragement inconditionnel au séparatisme.
En 1918, alors qu’elle est encore emprisonnée, Rosa Luxemburg rédige une analyse de la révolution russe de 1917, qu’elle intitule La Révolution russe. Ce texte n’a jamais été publié de son vivant : elle reconnaît l’avoir écrit sans avoir une parfaite connaissance des événements et des forces en présence, et corrige par la suite une partie de ses analyses. Elle insiste pour que son travail ne soit pas publié, reconnaissant peut-être qu’elle a eu tort sur plusieurs points. C’est le militant allemand Paul Levi qui le fait publier, d’abord en 1922 : à l’époque, Levi est en plein conflit avec le KPD et la IIIe Internationale. Il se sert du travail de Rosa Luxemburg pour appuyer ses désaccords et rompre avec les autres communistes. Le texte intégral n’est publié qu’en 1928.
Ce texte est avant tout un appel de solidarité politique avec la révolution de 1917, de février et d’octobre. C’est un texte de solidarité avec le « bolchévisme » et avec Lénine et Trotsky. Mais Rosa Luxemburg se place encore une fois dans le cadre d’un débat entre révolutionnaires sincères qui veulent le succès de la révolution russe, et de la révolution mondiale : « Ce serait une erreur de craindre qu’un examen critique des voies suivies jusqu’ici par la révolution russe soit de nature à ébranler le prestige du prolétariat russe, dont le fascinant exemple pourrait seul triompher de l’inertie des masses ouvrières allemandes. »
Elle énonce quatre points de critique : la question de la terre et de la politique agraire ; la question nationale ; l’assemblée constituante et le rapport avec les Soviets ; les droits démocratiques des travailleurs.
Concernant la politique agraire, elle s’appuie sur la position que défendaient les bolcheviks avant octobre 1917 ; ils s’opposaient aux Socialistes Révolutionnaires (SR) et plaidaient pour une nationalisation immédiate de la terre, en commençant par les coopératives. Ils voulaient construire une politique agraire sur la base des moyennes et grandes propriétés rurales. Rosa Luxemburg critique le fait que les bolcheviks aient finalement accepté le programme des SR, qui consistait à donner la terre aux paysans : elle s’oppose à cette revendication, car elle pense que cela va former une couche petite-bourgeoise hostile au programme socialiste. Les bolcheviks ont toujours combattu les SR sur cette question-là, mais Lénine se rend bien compte que le mouvement paysan a pris les devants de son programme et que, partout en Russie, les paysans prennent les terres et les occupent. A ce moment, Lénine explique que si la révolution veut maintenir et consolider l’alliance entre ouvriers et paysans, entre villes et campagnes, elle doit reconnaître cette réalité de l’avancée paysanne. Les SR vont alors lui reprocher d’avoir volé leur programme. Ce changement assez radical dans la politique à court terme des bolcheviks montre très bien la flexibilité de Lénine sur les questions de programme.
La deuxième critique de Rosa Luxemburg porte à nouveau sur la question nationale. Elle répète sa critique des années 1903-1904 qui consiste à dire qu’il s’agit d’une concession aux revendications bourgeoises, et que les bolcheviks russes ne doivent pas défendre l’autodétermination, mais l’unité de la Russie, contre tout séparatisme : elle évoque un « dépècement de la Russie », et un mot d’ordre « nationaliste retentissant ». En réalité, pour elle, cette revendication portée par les bolcheviks consistait en un égarement, un abandon des masses à leur classe dominante et à ses revendications propres. Au vu des suites de la révolution, elle était totalement dans l’erreur.
En ce qui concerne l’Assemblée constituante, Rosa Luxemburg comprend les arguments avancés par les bolcheviks pour avoir dissout l’Assemblée constituante quelques heures après sa convocation en 1917. Elle estime cependant qu’ils auraient pu organiser de nouvelles élections pour cette assemblée, qui aurait alors mieux reflété le changement politique et les rapports de force dans le pays. Le parti bolchevik avait défendu la convocation de l’Assemblée constituante pendant des années ; mais la vérité, c’est qu’en 1917, après la révolution d’octobre, cette assemblée ne jouait plus aucun rôle aux yeux des masses paysannes et ouvrières. D’ailleurs, pour une raison de propagande, les bolcheviks avaient proposé dans leurs interventions à la première – et dernière – Assemblée constituante, le vote de toutes les mesures que les Soviets avaient déjà prises (sur la terre, sur la journée de 8 heures, sur le pouvoir ouvrier, etc.). Cette proposition a été rejetée par l’Assemblée constituante, et à ce moment, le petit nombre de soldats rouges qui étaient présents ont simplement demandé aux participants de quitter l’Assemblée constituante, dont personne ne s’est vraiment préoccupé.
En décembre 1917, Lénine résume ainsi la situation : « l’Assemblée constituante, convoquée d’après les listes des partis qui existaient avant la révolution prolétarienne et paysanne, sous la domination de la bourgeoisie, entre nécessairement en conflit avec la volonté et les intérêts des classes laborieuses et exploitées qui ont déclenché le 25 octobre la révolution socialiste contre la bourgeoisie ».
Il faut néanmoins souligner que l’expérience contre-révolutionnaire de l’Assemblée nationale constituante pendant la révolution allemande a ouvert les yeux de Rosa Luxemburg. Cette question est liée à la critique concernant les droits démocratiques des travailleurs ; elle reproche aux bolcheviks leur manque de démocratie. Mais le fait est qu’après la révolution d’octobre, tous les partis étaient autorisés, à l’exception du parti fasciste des Cent-Noirs. Plus tard, les partis qui avaient décidé de prendre les armes contre les Soviets ont été interdits. Il n’y a donc pas une opposition entre « la démocratie » d’un côté et la tyrannie des bolcheviks de l’autre, mais une lutte entre la démocratie soviétique naissante et les forces qui veulent en rester à la forme bourgeoise de la démocratie, autrement dit une lutte liée à la lutte des classes.
En outre, au sein même du parti bolchevik, le droit de fraction a existé jusqu’en 1921 (la guerre civile oblige les dirigeants bolcheviks à interdire les fractions), et le droit de tendance continua à exister sous Lénine après cela. Le stalinisme met un terme à la démocratie interne du parti communiste.
Malgré tout, ce texte de Rosa Luxemburg est bel et bien un témoignage de solidarité aux bolcheviks : « Il leur reste le mérite impérissable d’avoir, en conquérant leur pouvoir et en posant pratiquement le problème de la réalisation du socialisme, montré l’exemple au prolétariat international, et fait faire un pas énorme dans la voie du règlement de comptes final entre le Capital et le Travail dans le monde entier. En Russie, le problème ne pouvait être que posé. Et c’est dans ce sens que l’avenir appartient partout au “bolchévisme”. »
Défense du marxisme
La pensée de Rosa Luxemburg est traversée de grandes lignes directrices, aussi bien purement théoriques que pratiques. Les nombreuses polémiques auxquelles elle a pris part sont toujours ancrées dans un contexte particulier, mais sont encore de réelles leçons pour les luttes à venir.
C’est pour cela que Lénine, en 1922, écrit ces mots dans Notes d’un publiciste, répondant à ceux qui l’opposent à Rosa Luxemburg :
« Nous répondrons à cela en citant deux vers d’une ancienne fable russe : “Les aigles peuvent, parfois, voler plus bas que les poules, mais les poules ne peuvent jamais s’élever à la hauteur des aigles.” Rosa Luxemburg s’est trompée […]. Mais, malgré ses erreurs, elle est et reste un aigle ; et non seulement son souvenir sera toujours précieux pour les communistes du monde entier, mais encore sa biographie et ses œuvres complètes [...] constitueront une leçon très utile pour l’éducation de nombreuses générations de communistes du monde entier. »
C’est le devoir des révolutionnaires d’aujourd’hui d’étudier les œuvres et la vie de Rosa Luxemburg, car elles regorgent d’enseignements précieux pour la tâche que nous devons accomplir, dans la lignée des bolcheviks et des spartakistes : rien de moins que la révolution mondiale. Comme Rosa Luxemburg, c’est avec confiance et détermination que nous luttons pour renverser le capitalisme, et voir le socialisme de notre vivant.
[1] : Des militants dirigeants, identifiables, sur le devant de la scène (comme l’était Rosa Luxemburg elle-même).