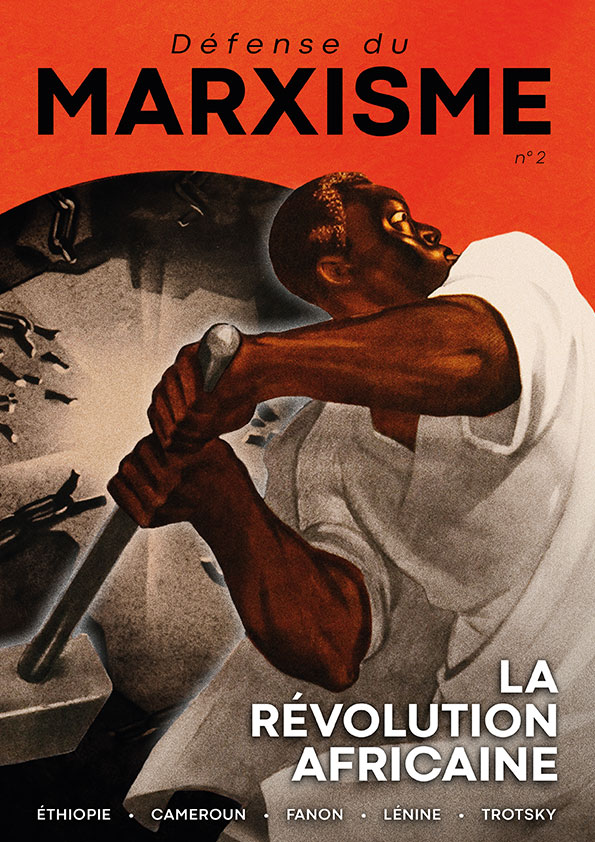La rédaction de ce Manifeste, qui a été traduit dans une dizaine de langues, date de la fin du mois d’octobre 2008. Depuis, comme nous l’annoncions, la crise financière s’est propagée à l’économie réelle. Son rythme s’accélère de jour en jour – et la crise sociale s’approfondit également. Les événements confirment notre analyse et renforcent la validité de ce programme d’action. Nous invitons tous nos lecteurs à faire circuler ce document le plus largement possible.
*
Une crise mondiale du capitalisme
La crise mondiale du capitalisme est un fait que nul ne peut ignorer. Il n’y a pas longtemps, les économistes nous assuraient qu’une crise du type de 1929 était impossible. A présent, ils évoquent le risque d’une nouvelle Grande Dépression. Le FMI souligne le risque accru d’un déclin économique grave et prolongé, à l’échelle mondiale. Ce qui a commencé aux Etats-Unis par une débâcle financière s’est propagé à l’économie réelle – et menace l’emploi, le logement et les conditions de vie de millions de personnes.
La panique s’est emparée des marchés. Richard Fuld, l’ancien PDG de Lehman Brothers, a déclaré au Congrès américain que sa banque avait été emportée par une « tempête de peur ». Cette tempête ne montre aucun signe d’affaiblissement. Non seulement les banques sont menacées de faillite – mais aussi des pays, comme le montre le cas de l’Islande. L’Asie, qui était censée sauver le monde d’une récession, est elle aussi entraînée dans le tourbillon général. De Shanghai à Tokyo, de Moscou à Hong-Kong, les marchés enregistrent sans cesse de nouvelles baisses.
C’est l’effondrement financier le plus important depuis celui de 1929. Et comme le « Grand Krach », il a été précédé d’une période de spéculation massive. Ces vingt dernières années, l’ampleur de la spéculation était inouïe. La capitalisation boursière des Etats-Unis est passée de 5400 milliards de dollars, en 1994, à 17 700 milliards en 1999, puis à 35 000 milliards en 2007. C’est beaucoup plus que le montant des capitaux spéculatifs avant la crise de 1929. Le marché mondial des « produits dérivés » s’élève à plus de 500 000 milliards de dollars, soit dix fois la production mondiale de biens et de services.
Pendant les années de croissance, lorsque les banquiers accumulaient d’incroyables quantités de richesses, il n’était pas question de partager leurs profits avec le reste de la société. Mais maintenant qu’ils sont en difficulté, ils se précipitent vers les gouvernements et réclament de l’argent. Si vous êtes un petit boursicoteur qui a perdu 1000 dollars et ne peut pas les rembourser, vous irez en prison. Mais si vous êtes un riche banquier qui a joué et perdu des milliards de dollars, vous n’irez pas en prison : vous recevrez, en récompense, de nouveaux milliards d’argent public.
Face au risque d’effondrement complet du système bancaire, les gouvernements prennent des mesures désespérées. Dans l’espoir de redonner vie à un système financier moribond, l’administration Bush a injecté 700 milliards dans les coffres des banques. Ceci équivaut à 2400 dollars par homme, femme et enfant des Etats-Unis. Le gouvernement britannique a annoncé un plan de sauvetage de plus de 400 milliards de livres (ce qui représente beaucoup plus, en proportion, que le plan des Etats-Unis), et l’Union Européenne a rajouté des milliards supplémentaires. Le plan de sauvetage de l’Allemagne – l’économie la plus puissante d’Europe – s’élève à environ 20% de son PIB. Le gouvernement de la Chancelière Angela Merkel a promis 80 milliards d’euros pour recapitaliser les banques en difficulté, le reste étant destiné à couvrir les garanties d’emprunts et les pertes. A ce jour, environ 2500 milliards de dollars ont été dépensés, dans le monde. Mais cela n’a pas arrêté la spirale descendante de l’économie mondiale.
Des mesures désespérées
La crise actuelle est loin d’être terminée. Elle ne sera pas réglée par les mesures des gouvernements et des Banques Centrales. En injectant d’énormes sommes d’argent dans les banques, ils obtiendront tout au plus un répit temporaire, ou une très légère accalmie de la crise – au prix de placer une énorme dette sur les épaules des générations futures. Mais tous les économistes sérieux savent que les marchés peuvent encore lourdement chuter.
D’un certain point de vue, la situation actuelle est pire que celle des années 30. La gigantesque vague spéculative qui a précédé et préparé la crise financière actuelle était beaucoup plus grande que celle qui a déclenché le krach de 1929. La quantité de capital fictif injectée dans le système financier mondial – qui, tel un poison, menace de le détruire complètement – est tellement énorme que personne ne peut la quantifier. La « correction » (pour reprendre cet euphémisme des économistes) sera donc encore plus longue et plus douloureuse.
Dans les années 30, les Etats-Unis étaient les plus grands créditeurs du monde. Aujourd’hui, ce sont les plus grands débiteurs. A l’époque du New Deal, quand Roosevelt essayait de sortir l’économie de la Grande Dépression, il avait à sa disposition d’immenses quantités d’argent. Aujourd’hui, Bush doit implorer un Congrès réticent de donner l’argent qu’il ne possède pas. Le plan de sauvetage de 700 milliards de dollars constitue un accroissement supplémentaire de l’endettement public. Cela se traduira par une longue période d’austérité et une baisse du niveau de vie de millions de citoyens américains.
Ces mesures prises dans la panique n’empêcheront pas la crise, qui ne fait que commencer. De même, contrairement à une idée reçue, le New Deal de Roosevelt n’a pas arrêté la Grande Dépression. A l’époque, la crise de l’économie américaine s’est poursuivie jusqu’en 1941, lorsque les Etats-Unis sont entrés dans la deuxième guerre mondiale et que d’énormes dépenses militaires ont fini par résorber le chômage. Une fois de plus, nous allons être confrontés à une longue période de baisse des niveaux de vie, de fermetures d’usines, de baisse des salaires, de réductions des dépenses sociales et d’austérité générale.
Les capitalistes sont dans une impasse. Ils ne voient pas d’issue. Tous les partis traditionnels sont dans un état de perplexité proche de la paralysie. Le président Bush a dit à la communauté internationale que « ça va prendre un moment » avant que son plan de sauvetage ne produise ses effets. Pendant ce temps-là, d’autres entreprises feront faillite, d’autres travailleurs perdront leur emploi et d’autres pays seront ruinés. La crise du crédit commence à prendre à la gorge les entreprises en bonne santé. Incapables de lever des capitaux, elles seront obligées de tailler d’abord dans leurs investissements fixes et dans leur main d’œuvre.
Les capitalistes implorent les gouvernements et les Banques Centrales de réduire leurs taux d’intérêt. Mais dans les circonstances actuelles, cela ne sera d’aucun secours. La réduction coordonnée des taux de 0,5 %, début octobre, a été suivie par de fortes baisses sur les places boursières mondiales. Lors d’une récession mondiale, personne ne veut acheter des actions et personne ne veut prêter de l’argent. Les banques arrêtent de prêter car elles doutent de pouvoir un jour récupérer leur argent. Le système tout entier est menacé de paralysie.
Malgré les efforts coordonnés des Banques Centrales pour injecter de l’argent dans le système, le marché du crédit reste gelé. Le gouvernement britannique a fait un cadeau de plus de 400 milliards de livres aux banques. Le résultat a été une chute de la bourse. Après l’annonce de ce don, les taux d’intérêt des prêts interbancaires ont même augmenté. Ces mesures n’ont pas résolu la crise et n’ont fait que verser de l’argent dans les coffres de ceux dont les activités spéculatives, si elles n’ont pas causé la crise, l’ont considérablement aggravée et lui ont donné un caractère incontrôlable et convulsif.
Les banquiers ne perdent jamais
Par le passé, le banquier était un homme respectable, vêtu d’un costume gris, que l’on supposait être un modèle de responsabilité et qui soumettait les gens à un interrogatoire sévère avant de leur prêter de l’argent. Mais tout cela a changé, ces derniers temps. Baissant les taux d’intérêt et brassant de vastes liquidités, les banquiers ont oublié toute prudence. Ils ont prêté des milliards – en escomptant de fortes marges – à des gens qui se sont rendus compte qu’ils ne pouvaient plus payer leur crédit lorsque les taux ont augmenté. Le résultat fut la crise des subprimes, qui a contribué à la déstabilisation de tout le système financier.
Dans l’espoir d’éviter une récession, les gouvernements et les Banques Centrales ont alimenté les feux de la spéculation. Sous Alan Greenspan, la Réserve Fédérale a maintenu des taux d’intérêt très bas. A l’époque, on le félicitait pour la sagesse de cette politique. De cette façon, ils ont retardé l’échéance de la crise – mais au prix de la rendre mille fois plus grave lorsqu’elle a finalement éclaté. L’argent bon marché a permis aux banquiers de se livrer à une véritable orgie spéculative. Les gens ont emprunté pour investir dans l’immobilier ou pour leur consommation courante. Les investisseurs ont utilisé la dette bon marché pour investir dans des actifs à plus haut rendement. Les prêts bancaires ont pris des proportions considérables par rapport aux dépôts des épargnants. Les activités douteuses ont été tenues à l’écart des bilans financiers de ces banques.
Désormais, tout cela s’est inversé. Tous les facteurs qui ont poussé l’économie vers le haut se combinent à présent pour créer une spirale descendante. Le manque de crédit menace de porter un coup d’arrêt sévère à l’économie. Si un ouvrier fait mal son travail, il est licencié. Mais quand les banquiers détruisent l’ensemble du système financier, ils s’attendent à être récompensés. Les hommes aux beaux costumes qui ont fait des fortunes en spéculant avec l’argent des autres exigent à présent que le contribuable les tire d’affaire. C’est une logique bien particulière, que la plupart des gens trouvent très difficile à comprendre.
Dans les années de croissance, d’énormes profits ont été réalisés par les secteurs bancaire et financier. En 2006, aux Etats-Unis, les grandes banques ont, à elles seules, réalisé environ 40% de tous les profits. Dans ce secteur, les cadres dirigeants sont payés 344 fois plus que l’employé américain moyen. Il y a trente ans, les PDG gagnaient en moyenne 35 fois le salaire d’un ouvrier. L’an passé, les PDG des 500 plus grosses sociétés ont gagné, en moyenne, 10,5 millions de dollars de « compensations » chacun.
Les banquiers veulent qu’on oublie tout cela et qu’on se concentre sur l’urgence qu’il y a à sauver les banques. Tous les besoins pressants de la société doivent être mis de côté, et toutes les richesses de la société doivent être mises à la disposition des banquiers, dont les services rendus à la société sont supposés être beaucoup plus importants que ceux des infirmières, des docteurs, des enseignants ou des ouvriers du bâtiment. En une semaine, les gouvernements de l’UE et des Etats-Unis ont dépensé l’équivalent de ce qui serait nécessaire pour soulager la faim dans le monde pendant près de 50 ans. Alors que des millions de personnes souffrent de la faim, les banquiers continuent de recevoir des salaires et des bonus faramineux. Ils maintiennent leur style de vie extravagant aux dépens du contribuable. La crise ne change rien à cela.
« Dans l’intérêt de tous » ?
La plupart des gens ne sont pas convaincus par les arguments des banquiers et des politiciens. Ils vivent très mal le fait que le fruit de leur travail soit mis à la disposition des banquiers et des riches. Mais dès qu’ils formulent une objection, ils font face au chœur assourdissant des politiciens qui leur disent : « il n’y a aucune alternative ». Cet argument est répété si souvent et avec une telle insistance que cela fait taire la plupart des critiques – d’autant que pratiquement tous les partis sont d’accord, à ce sujet.
Démocrates et républicains, sociaux-démocrates et chrétiens-démocrates, conservateurs et travaillistes : tous ont uni leurs forces dans une véritable conspiration visant à persuader le public qu’il est « dans l’intérêt de tous » que les travailleurs ordinaires se fassent rouler pour donner plus d’argent aux gangsters de la finance. « Nous avons besoin d’un système bancaire sain (c’est-à-dire profitable) », expliquent-ils. « Nous devons restaurer la confiance, ou bien nous aurons l’apocalypse demain matin. »
Ce genre d’argument a pour but de créer une atmosphère de crainte et de panique, afin de rendre impossible toute discussion raisonnable. Mais que signifie vraiment cet argument ? Dépouillé de tout mensonge, il signifie seulement ceci : puisque les banques sont entre les mains des riches, puisque les riches ne « risquent » leur argent que s’ils obtiennent en retour des profits importants, et puisqu’ils ne font pas de profits à l’heure actuelle, mais seulement des pertes, le gouvernement doit intervenir et leur donner d’énormes sommes d’argent afin de restaurer leurs profits – et donc leur confiance. Alors, tout ira bien.
Le célèbre économiste américain John Kenneth Galbraith a résumé cet argument de la façon suivante : « les pauvres ont trop d’argent, et les riches pas assez. » L’idée, c’est que si les riches s’enrichissent toujours plus, à long terme une partie de leur richesse se diffusera vers le bas de la société, et nous en profiterons donc tous. Mais comme le faisait remarquer Keynes : à long terme, nous serons tous morts. En outre, l’expérience a montré que cette théorie est fausse.
L’idée qu’il serait absolument nécessaire de pomper d’énormes sommes d’argent public pour les injecter dans les banques, sans quoi on risquerait la catastrophe – cette idée ne convainc pas les hommes et les femmes ordinaires. Ils se posent cette question très simple : pourquoi devrions-nous payer pour les erreurs des banquiers ? S’ils se sont mis tous seuls dans cette situation, ils doivent la régler eux-mêmes. Outre une perte considérable d’emplois dans les secteurs financier et tertiaire, la crise financière affecte directement le niveau de vie des gens. La crise des marchés boursiers a déjà ruiné les économies de toute une section de la classe ouvrière et des classes moyennes.
A ce jour, les organismes de retraite des Américains ont perdu au moins 2000 milliards de dollars. Cela signifie que des gens qui ont travaillé dur toute leur vie, et qui ont économisé dans l’espoir d’une retraite relativement confortable, sont forcés de retarder leur départ à la retraite. Lors d’un récent sondage d’opinion, plus de la moitié des Américains interrogés ont dit s’inquiéter de devoir travailler plus longtemps du fait de la baisse de la valeur de leur épargne-retraite. Près d’une personne sur quatre déclare avoir augmenté son temps de travail hebdomadaire.
Beaucoup de gens font face à des saisies immobilières. Si une famille perd sa maison, on dit que c’est le résultat de son manque de prudence. Les lois d’airain du marché et de « la survie du plus fort » la condamnent à la rue. C’est une question privée – et non le problème du gouvernement. Mais si une banque est ruinée par la spéculation vorace des banquiers, c’est un malheur épouvantable pour toute la société. En conséquence, toute la société doit s’unir pour la sauver. Telle est la logique absurde du capitalisme !
Il faut combattre cette tentative honteuse de placer le fardeau de la crise sur les épaules de ceux qui peuvent le moins le supporter. Pour résoudre la crise, il faut arracher l’ensemble du système bancaire et financier des mains des spéculateurs et le soumettre au contrôle démocratique de la société, pour qu’il puisse servir l’intérêt de la majorité, et non celui des riches.
Nos revendications :
1) Non aux plans de sauvetage pour les riches ! Nationalisation des banques et des sociétés d’assurance, sous le contrôle et la gestion démocratique des salariés. Seuls les petits investisseurs doivent être indemnisés – sur la base de besoins prouvés. La nationalisation des banques est la seule façon de garantir les dépôts et les économies des gens ordinaires. Les décisions bancaires doivent être prises dans l’intérêt de la majorité, et non d’une minorité de riches parasites.
2) Contrôle démocratique des banques. Leurs conseils d’administration devraient être composés de la façon suivante : un tiers élu par les salariés de la banque ; un tiers élu par les syndicats, pour représenter les intérêts de toute la classe ouvrière ; et enfin un tiers représentant le gouvernement.
3) Pour une suppression immédiate des bonus exorbitants. La rémunération d’un dirigeant ne devrait pas dépasser le salaire d’un travailleur qualifié. Pourquoi un banquier devrait-il gagner plus qu’un docteur ou un dentiste ? Si les banquiers ne sont pas prêts à travailler sur ces bases, on doit leur montrer la porte et les remplacer par des diplômés qualifiés. Beaucoup cherchent du travail et désirent servir la société.
4) Une réduction immédiate des taux d’intérêt, qui devraient être limités aux coûts réels des opérations bancaires. Le crédit bon marché doit être disponible pour ceux qui en ont besoin, pour les petites entreprises et les travailleurs qui s’achètent une maison – pas pour les banquiers et les capitalistes.
5) Droit au logement : arrêt immédiat des saisies et des expulsions, réduction générale des loyers et programme massif de construction de logements sociaux abordables.
La cause de la crise
La cause profonde de la crise ne réside pas dans le mauvais comportement de quelques individus. Si c’était le cas, alors la solution serait simple : il suffirait d’amener ces individus à mieux se comporter, à l’avenir. C’est d’ailleurs ce qu’a fait Gordon Brown, en appelant à « la transparence, l’honnêteté et la responsabilité ». Mais tout le monde sait que la finance internationale est aussi transparente qu’un cloaque, et que la fraternité bancaire est aussi sincère qu’une promesse de mafieux et aussi responsable qu’un joueur compulsif. Ceci dit, même si tous les banquiers étaient des saints, cela ne changerait rien.
Il est faux d’attribuer la cause de la crise à la cupidité et la corruption des banquiers (bien qu’ils soient extrêmement corrompus et cupides). C’est plutôt l’expression de la maladie de tout un système – une expression de la crise organique du capitalisme. Le problème n’est pas la cupidité de certaines personnes, le manque de liquidités ou l’absence de confiance. Le problème est que le système capitaliste se trouve dans une impasse complète, à l’échelle mondiale. La cause profonde de la crise, c’est le fait que le développement des forces productives a dépassé les limites étroites de la propriété privée capitaliste et de l’Etat-nation. La contraction du crédit est souvent présentée comme la cause de la crise. Mais en fait, ce n’est que le symptôme le plus visible. Les crises font partie intégrante du système capitaliste.
Marx et Engels l’expliquaient déjà, en leur temps :
« Les conditions bourgeoises de production et d’échange, le régime bourgeois de la propriété, la société bourgeoise moderne, qui a fait surgir de si puissants moyens de production et d’échange, ressemblent au magicien qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu’il a invoquées. Depuis des dizaines d’années, l’histoire de l’industrie et du commerce n’est pas autre chose que l’histoire de la révolte des forces productives modernes contre les rapports modernes de production, contre le régime de propriété qui conditionne l’existence de la bourgeoisie et sa domination.
« Il suffit de mentionner les crises commerciales qui, par leur retour périodique, menacent de plus en plus l’existence de la société bourgeoise. Chaque crise détruit régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés, mais encore une grande partie des forces productives déjà existantes. Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s’abat sur la société – l’épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement ramenée à un état de barbarie momentanée ; on dirait qu’une famine, une guerre d’extermination lui ont coupé tous ses moyens de subsistance ; l’industrie et le commerce semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop d’industrie, trop de commerce.
« Les forces productives dont elle dispose ne favorisent plus le régime de la propriété bourgeoise ; au contraire, elles sont devenues trop puissantes pour ce régime qui alors leur fait obstacle ; et toutes les fois que les forces productives sociales triomphent de cet obstacle, elles précipitent dans le désordre la société bourgeoise tout entière et menacent l’existence de la propriété bourgeoise. Le système bourgeois est devenu trop étroit pour contenir les richesses créées dans son sein. Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D’un côté, en détruisant par la violence une masse de forces productives ; de l’autre, en conquérant de nouveaux marchés et en exploitant plus à fond les anciens. A quoi cela aboutit ? A préparer des crises plus générales et plus formidables et à diminuer les moyens de les prévenir. »
Ce passage du Manifeste du Parti Communiste, écrit en 1848, est aussi actuel et pertinent aujourd’hui qu’à l’époque. Il aurait pu être écrit hier.
La question la plus importante n’est pas le système bancaire, mais l’économie réelle : la production de biens et de services. Pour que les capitalistes fassent des profits, ces biens et services doivent trouver un marché. Mais la demande est en forte baisse, et cette situation est aggravée par le manque de crédit. Nous sommes confrontés à une crise classique du capitalisme, qui a déjà fait de nombreuses victimes innocentes. Aux Etats-Unis, l’effondrement des prix de l’immobilier a entraîné une crise de l’industrie de la construction, qui a détruit des centaines de milliers d’emplois. L’industrie automobile est en crise, elle aussi : les ventes, aux Etats-Unis, sont à leur plus bas niveau depuis 16 ans. Cela entraîne une baisse de la demande d’acier, de plastique, de caoutchouc, d’électricité, de pétrole et d’autres produits. Il y aura un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’économie, avec une flambée du chômage et une chute du niveau de vie des masses.
Anarchie capitaliste
Ces trente dernières années, on nous a expliqué que le meilleur système économique possible est cette chose ayant pour nom « économie de marché ». Depuis la fin des années 1970, la bourgeoisie avait pour mantra : « laissons les marchés fonctionner » et « tenons l’Etat à l’écart de l’économie. » Le marché était censé posséder des pouvoirs magiques lui permettant d’organiser les forces productives sans aucune intervention de l’Etat. Cette idée est aussi vieille qu’Adam Smith qui, au XVIIIe siècle, évoquait la « main invisible du marché. » Les politiciens et les économistes se vantaient d’avoir aboli les cycles économiques.
Pour eux, il n’était pas question d’introduire la moindre régulation. Au contraire, ils exigeaient haut et fort que toute régulation soit éliminée, comme « préjudiciable à l’économie de marché ». Ils jetèrent donc toutes les régulations dans un grand bûcher et permirent aux « libres forces du marché » de régner. La soif de profit fit le reste. D’énormes quantités de capitaux passèrent d’un continent à un autre, sans aucune entrave. D’un clic de souris, des industries étaient détruites et des monnaies nationales sabordées. C’est ce que Marx appelait l’anarchie du capitalisme. Nous en voyons aujourd’hui les résultats.
Une très ancienne loi, l’instinct grégaire, régit le comportement des marchés. La moindre odeur d’un lion rôdant dans la brousse jettera le troupeau de gnous dans un état de panique que rien ne calmera. C’est ce genre de mécanisme qui détermine le sort de millions de personnes. Telle est la réalité brute de l’économie de marché. Comme les bêtes sauvages sentent l’odeur du lion, les marchés sentent l’imminence d’une récession. La perspective d’une récession est la véritable cause de la panique. Une fois que cela se produit, rien ne peut l’arrêter. Tous les discours, toutes les baisses de taux d’intérêt et toutes les aides aux banques n’auront aucun effet sur les marchés financiers. Ceux-ci y liront la peur des gouvernements et des Banques Centrales – et ils en tireront les conclusions nécessaires.
La concurrence entre places financières était censée garantir un fonctionnement efficace du marché, grâce à sa « main invisible ». Mais à l’été 2007, la faillite des politiques de « laisser-faire » a été cruellement révélée. Désormais, ils s’auto-flagellent et se lamentent tous face aux conséquences de leurs propres actions. Ils présentent à la société la facture des politiques par lesquelles les capitalistes et leurs représentants politiques ont tenté de maintenir le boom en faisant gonfler différentes bulles spéculatives. Tous ont été impliqués dans cette fraude massive. Républicains et démocrates, travaillistes et conservateurs, sociaux-démocrates et anciens « communistes » : tous ont soutenu l’économie de marché et acclamé le joyeux carnaval des profits.
Il est très facile d’être sage après les événements : tous les ivrognes le sont, le lendemain d’une cuite. Après quoi ils jurent tous qu’ils ont appris la leçon et ne reboiront plus – une excellente résolution qu’ils envisagent sincèrement de respecter, jusqu’à leur prochaine cuite. Aujourd’hui, les « régulateurs financiers » scrutent jusqu’aux plus petits détails des affaires bancaires – après la débâcle. Mais où étaient-ils et que faisaient-ils, avant la crise ?
A présent, tout le monde accuse les banquiers avides d’avoir provoqué la crise. Mais hier, ces mêmes banquiers cupides étaient unanimement salués comme les sauveurs de la nation, les créateurs de richesses, ceux qui prennent des risques et créent des emplois. A la City de Londres et à Wall Street, de nombreux emplois vont être supprimés. Mais les traders ont gagné des millions en bonus sur des opérations spéculatives à court terme. Et les supérieurs hiérarchiques des traders, dans les conseils d’administration, ont laissé tourner ce casino parce que leurs propres rémunérations étaient liées à ces opérations à court terme.
Les autorités tentent désormais d’imposer des restrictions aux rémunérations des banquiers, comme un prix à payer pour leur sauvetage. Ils le font, non pas par principe ou par conviction, mais parce qu’ils craignent la réaction du public à l’énorme scandale que constitue le versement de primes, à partir de fonds publics, à des gens qui ont plongé l’économie dans le chaos. Les patrons sont généralement insensibles à la colère et à la haine qui montent des profondeurs de la société. A tout le moins, ils y sont indifférents. Mais les politiciens ne peuvent pas se permettre d’être totalement indifférents à l’égard de citoyens qui peuvent les éjecter, lors des prochaines échéances électorales.
Leur problème, c’est qu’il est impossible de réglementer l’anarchie capitaliste. Ils se plaignent de la cupidité des patrons, mais la cupidité est au cœur de l’économie de marché, et ne tolère aucune entrave. Toute tentative de limiter les primes et rémunérations « excessives » sera sabotée. Le marché exprimera sa désapprobation par une chute brutale des actions. Cela captera l’attention des gouvernements et leur rappellera qui est le vrai Electorat : ceux qui possèdent les richesses. Quand, une année, un travailleur sacrifie une augmentation de salaire, cet argent est perdu à jamais. Mais cette règle ne s’applique pas aux banquiers et aux capitalistes. Même si, exceptionnellement, ils acceptent de limiter leurs primes cette année, ils compenseront ce grand « sacrifice » en augmentant leurs primes l’année prochaine. Cela ne présente aucune difficulté, pour eux.
L’idée que les hommes et les femmes sont incapables de mieux organiser la société est une monstrueuse calomnie contre l’humanité. Depuis 10 000 ans, l’humanité s’est révélée capable de surmonter chaque obstacle et de progresser vers l’objectif final de la liberté. Les merveilleuses découvertes de la science et de la technologie nous ouvrent la possibilité de résoudre tous les problèmes qui nous ont tourmentés depuis des siècles et des millénaires. Mais ce potentiel colossal ne pourra jamais être pleinement développé tant qu’il sera subordonné à la loi du profit.
Pour une vie meilleure
Dans leurs efforts pour défendre le capitalisme, certains commentateurs n’hésitent pas à accuser les consommateurs d’être responsables de la crise. « Nous sommes tous coupables », affirment-ils sans sourciller. Après tout, expliquent-ils, personne ne nous a obligés à acheter un logement ou à partir en vacances. Mais dans une situation où l’économie se développe rapidement, où le crédit n’est pas cher, tous les pauvres sont tentés de « vivre au-dessus de leurs moyens ». De fait, il y a même eu une période où, aux Etats-Unis, les taux d’intérêts réels étaient négatifs (inférieurs à l’inflation), ce qui signifie qu’il était désavantageux de ne pas s’endetter !
Le capitalisme crée sans cesse de nouveaux besoins, et la publicité est désormais une immense industrie qui utilise les méthodes les plus sophistiquées pour convaincre les consommateurs qu’ils ont besoin de ceci ou de cela. Le style de vie des riches « célébrités » est exposé au regard des pauvres, qu’on soumet à un lavage de cerveau pour qu’ils désirent des choses qu’ils n’auront jamais. Après quoi les hypocrites bourgeois pointent un doigt accusateur sur les masses qui, comme Tantale, sont accusées de contempler un banquet tout en mourant de faim et de soif.
Il n’y a rien d’immoral ou d’illogique à souhaiter une vie meilleure. Si les hommes n’aspiraient pas constamment à de meilleures conditions de vie, il n’y aurait aucun progrès. Nous n’avons qu’une vie, et il est bien normal qu’on veuille l’améliorer. Si nous ne pouvions aspirer à rien de plus que ce que nous avons aujourd’hui, les perspectives de l’humanité seraient bien sinistres. Ce qui, par contre, est clairement immoral et inhumain, c’est la foire d’empoigne et l’avidité individuelle que crée le capitalisme, où le progrès humain est soumis à l’avidité d’une minorité de parasites.
La classe capitaliste croit à la prétendue « survie du plus méritant ». Or en réalité, il s’agit de la survie, non des plus méritants ou des plus intelligents, mais des plus riches, aussi stupides et incapables soient-ils, alors que tant de gens talentueux et intelligents meurent en cours de route. On cultive systématiquement l’idée selon laquelle mon avancement personnel doit se faire au détriment de tous les autres, si bien qu’il serait nécessaire, pour progresser, d’écraser les autres. Ce type d’individualisme bourgeois constitue la base psychologique et morale de bien des maux qui affectent la société, rongent ses entrailles et l’abaissent au niveau d’une barbarie primitive. C’est la morale du « chacun pour soi et sauve qui peut ».
Cette misérable caricature de la sélection naturelle est une insulte à la mémoire de Charles Darwin. De fait, ce n’est pas la compétition mais la coopération qui fut la clé de la survie et du développement de la race humaine, dès ses origines. Nos très vieux ancêtres des savanes d’Afrique orientale (dont nous descendons tous) étaient des créatures petites et faibles. Ils n’avaient ni griffes, ni dents puissantes. Ils ne couraient pas aussi vite que les animaux dont ils se nourrissaient – ou qui voulaient se nourrir d’eux. D’après la théorie de la « survie du plus méritant », notre espèce aurait dû s’éteindre il y a quelque trois millions d’années. Le principal avantage de nos ancêtres, du point de vue de l’évolution, c’était la coopération et la production sociale. Dans ces conditions, l’individualisme aurait signifié la mort.
Changements de la conscience
Il faut poser une question simple aux partisans de la théorie de la « survie du plus méritant » : comment se fait-il qu’on ne laisse pas mourir des banques qui se sont révélées complètement inaptes à la survie ? Pourquoi faut-il à tout prix les sauver grâce à une générosité qui, dans nos sociétés, n’est pas supposée exister ? Pour sauver des banques en déroute, dirigées par des banquiers stupides et inefficaces, la grande majorité – intelligente, méritante et laborieuse – est supposée se sacrifier avec joie. Mais cette majorité n’est pas du tout convaincue que pour servir cette cause, elle doit se passer de choses telles que des écoles et des hôpitaux, et accepter un régime d’austérité pendant une durée indéterminée.
La signification des chocs économiques que les journaux et la télévision annoncent chaque jour est assez claire pour tous : le système actuel ne fonctionne pas. Pour utiliser une expression américaine : ce système « ne livre pas la marchandise ». Il n’y a pas d’argent pour la santé, l’éducation publique ou les retraites – mais pour Wall Street, il y a tout l’argent du monde. Comme le dit le grand écrivain américain Gore Vidal, nous avons le socialisme pour les riches et la libre-entreprise pour les pauvres.
Beaucoup de gens ordinaires tirent les bonnes conclusions de cette situation. Ils commencent à remettre en cause le système capitaliste et cherchent des alternatives. Malheureusement, il n’y a aucune alternative immédiatement évidente. Aux Etats-Unis, les gens se tournent vers Obama et les Démocrates. Mais les Républicains et les Démocrates ne sont que les pieds droit et gauche du grand capital. Comme l’écrit Gore Vidal : « dans notre République, il n’y a qu’un seul parti, le Parti de la Propriété, avec deux ailes droites. » Obama et McCain ont tous deux soutenu le plan de sauvetage de 700 milliards de dollars au profit des capitalistes. Ils représentent les mêmes intérêts fondamentaux, et ne divergent légèrement que sur des questions tactiques.
Tout cela aura de puissants effets sur la conscience des gens. C’est une proposition élémentaire du marxisme que la conscience humaine est profondément conservatrice. En général, les gens n’aiment pas le changement. Les habitudes, les traditions et la routine pèsent de tout leur poids sur les idées politiques des masses, qui résistent normalement à la perspective de modifications importantes dans leurs vies et leurs habitudes. Mais lorsque de grands événements ébranlent jusqu’aux fondations de la société, les gens sont obligés de réviser leurs vieilles idées et leurs vieux préjugés.
Nous sommes précisément entrés dans une telle période. La longue période de prospérité relative, qui, dans les pays capitalistes avancés, a duré plus de deux décennies – abstraction faite de la légère récession de 2001 – a laissé sa marque. Malgré les injustices flagrantes du capitalisme, malgré les longues heures de travail, l’intensification de l’exploitation, les inégalités criantes, la richesse obscène de quelques-uns face au développement de la grande pauvreté, malgré tout cela, la plupart des gens pensaient que l’économie de marché fonctionnait et pouvait même leur bénéficier. C’était particulièrement le cas aux Etats-Unis. Mais à présent, un nombre croissant de gens perd ces illusions.
Comment lutter contre le chômage
Pendant la dernière phase de croissance, la plupart des travailleurs n’ont pas vu leur salaire réel augmenter – alors même que les profits explosaient. Les salariés étaient soumis à une pression croissante pour produire plus et travailler plus longtemps. Or, à présent, avec la crise économique, ils sont non seulement menacés de régression sévère, en terme de conditions de vie et de travail, mais aussi de perdre leur emploi. Les fermetures d’entreprises et l’augmentation du chômage sont à l’ordre du jour. A l’échelle mondiale, des centaines de millions de personnes sont menacées de sombrer dans la pauvreté.
Pendant dix ans, l’économie espagnole a été présentée comme un moteur de création d’emplois, en Europe. Mais en l’espace d’à peine un an, plus de 800 000 chômeurs supplémentaires ont été recensés, en Espagne. L’effondrement du boom immobilier, qui avait duré dix ans, a poussé le taux de chômage, dans ce pays, à 11,3%. « Ce n’est qu’un début, cela va empirer », a reconnu Daniel Antonucci, économiste à Merrill Lynch International. Il prévoit que le taux de chômage espagnol va passer la barre des 13% en 2009, pendant que celui de l’ensemble de l’UE passera de 7,5 à 8,1% d’ici la fin de l’année 2008. En réalité, le chômage réel est bien pire que ce qu’en disent les chiffres officiels, que tous les gouvernements trafiquent par différentes astuces statistiques. Quoi qu’il en soit, tous les pays connaissent la même situation que l’Espagne, à des degrés divers.
A défaut de pouvoir améliorer leurs conditions de vie, les travailleurs doivent les défendre. Le chômage menace la société de désintégration. La classe ouvrière ne peut tolérer le développement du chômage de masse. Le droit au travail est un droit fondamental. Quelle sorte de société condamne des millions d’hommes et de femmes à l’inactivité forcée, alors que leur travail et leurs compétences pourraient contribuer à satisfaire les besoins de la population ? Avons-nous besoin de davantage d’écoles, d’hôpitaux, de logements ? N’est-il pas nécessaire d’améliorer et de rénover les infrastructures et les transports publics ?
Tout le monde connaît la réponse à ces questions. Mais la réponse de la classe dirigeante est toujours la même : « les caisses sont vides ». A présent, tout le monde sait que c’est faux. Nous savons désormais que les gouvernements peuvent trouver des sommes d’argent extraordinaires, lorsque cela répond aux intérêts de cette minorité richissime qui possède et contrôle les banques et l’industrie. Les caisses ne sont vides que pour la grande majorité de la population : les travailleurs, les jeunes, les retraités et les chômeurs.
Qu’est-ce que cela prouve ? Cela prouve que dans ce système, les profits de quelques-uns sont plus importants que les besoins du plus grand nombre. Cela prouve que l’ensemble du système productif repose sur une seule chose : la course au profit – en clair : l’avidité. Lorsque des travailleurs font grève, la presse (qui est aussi contrôlée par une poignée de millionnaires), blâme leur « égoïsme ». Mais leur « égoïsme » se ramène à la lutte pour joindre les deux bouts : payer le loyer, les crédits, la nourriture, les factures et de quoi faire vivre dignement sa famille.
A l’inverse, l’égoïsme des banquiers et des capitalistes consiste à accumuler d’immenses fortunes grâce au travail d’autrui (car eux-mêmes ne produisent rien). Cet argent, ils le dépensent dans des œuvres d’art (non pour le plaisir, mais comme un nouvel investissement profitable), dans un mode de vie extravagant, ou encore dans une spéculation qui se termine toujours par un effondrement économique et la misère – par pour eux-mêmes, mais pour la majorité dont le travail productif fait tourner la société.
Par le passé, les patrons expliquaient que le développement de la technologie allègerait la charge du travail. Mais c’est l’inverse qui est vrai. L’UE vient de faire passer le temps de travail hebdomadaire maximum à soixante heures ! Et cela dans la première décennie du XXIe siècle, alors que les immenses progrès de la science et de la technologie ont porté la productivité de chaque heure travaillée à des niveaux inédits. Ainsi, l’Etat paye (mal) une masse de chômeurs à ne rien faire – pendant que dans les entreprises, on oblige les travailleurs à faire des heures supplémentaires.
C’est l’économie d’une maison de fous ! D’un point de vue capitaliste, c’est logique. Mais nous rejetons la folle logique du capitalisme ! Contre le fléau du chômage, nos avançons les mots d’ordre de travaux publics et de partage du travail sans perte de salaire. La société a besoin d’écoles, d’hôpitaux, de transports publics, de routes et de logements. Les chômeurs doivent être embauchés pour un vaste programme de travaux publics !
Les syndicats doivent veiller à ce que les chômeurs et les travailleurs soient liés par une solidarité et une responsabilité mutuelles. Il faut partager le travail disponible, sans perte de salaire ! Le travail disponible doit être divisé entre tous les travailleurs – et ce partage doit déterminer la durée de la semaine de travail, qui ne doit jamais dépasser 35 heures. Les salaires ne doivent pas descendre sous un minimum strictement garanti – et doivent suivre l’évolution des prix. C’est là le seul programme qui puisse protéger les travailleurs en période de crise économique.
Lorsqu’ils réalisent d’énormes profits, les capitalistes veillent jalousement au secret de leurs comptes. Mais à présent que l’économie est en crise, ils affichent leurs comptes comme une « preuve » qu’ils ne peuvent pas satisfaire les revendications des travailleurs. C’est tout particulièrement le cas des « petits » capitalistes. Mais la question n’est pas de savoir si nos revendications sont « réalistes » ou non du point de vue des employeurs. Nous avons le devoir de protéger les intérêts vitaux de la classe ouvrière des pires effets de la crise. Les patrons protesteront en expliquant que cela réduira leurs profits et ne les incitera pas à investir. A quoi nous répondrons que si les intérêts vitaux de la majorité ne sont pas compatibles avec les exigences du système capitaliste – alors ce système doit aller au diable !
En luttant pour se défendre contre la tentative de placer la crise sur leurs épaules, les travailleurs en viendront à comprendre le besoin d’un profond changement de l’ordre social. La seule réponse à la fermeture des entreprises, c’est leur occupation. « Usine fermée, usine occupée ! » : c’est le seul mot d’ordre efficace dans la lutte contre les fermetures. Les occupations d’usines doivent nécessairement mener au contrôle ouvrier. Par le contrôle ouvrier, les travailleurs acquièrent une expérience de l’administration de l’entreprise, ce qui leur permettra plus tard de diriger toute la société.
En Argentine, au Venezuela et au Brésil – entre autres – il y a eu et il y a toujours des occupations d’entreprises et des expériences de contrôle ouvrier. Au Venezuela, lors du lock-out patronal de 2002-2003, l’immense compagnie pétrolière PDVSA a été relancée et administrée par les travailleurs eux-mêmes. Un mouvement des usines occupées s’est développé, depuis 2005, à partir de l’entreprise Inveval, et gagne en puissance.
Dans tous ces cas et dans bien d’autres, les travailleurs ont réussi, malgré tous les obstacles, à diriger l’entreprise sous leur propre contrôle et leur propre gestion. Mais le contrôle ouvrier ne doit pas être une fin en soi. Il pose la question de la propriété. Il pose la question : qui est le maître des lieux ? Soit le contrôle ouvrier mène à la nationalisation, soit il n’est qu’un épisode éphémère. La seule solution définitive au problème du chômage, c’est une économie socialiste planifiée, reposant sur la nationalisation des banques et des principales industries, sous le contrôle démocratique des travailleurs.
Nos revendications :
1) Non au chômage ! Du travail ou des allocations décentes pour tous !
2) En finir avec le secret des comptes ! Ouvrez les comptes des entreprises ! Les travailleurs doivent tout savoir de la spéculation, des escroqueries comptables, des profits et des bonus faramineux. Ils doivent voir comment ils ont été trompés et qui est responsable de la pagaille !
3) Non aux fermetures d’entreprises ! Usine fermée, usine occupée !
4) Nationalisation, sous contrôle ouvrier, des entreprises menacées de fermeture !
5) Pour un vaste programme de travaux publics. Pour un programme massif de construction de logements, d’écoles, d’hôpitaux et de routes, de façon à donner du travail aux chômeurs.
6) Les 35 heures pour tous, sans perte de salaire !
7) Pour une économie socialiste planifiée, dans laquelle le chômage n’existera plus, et qui écrira sur sa bannière : DROIT UNIVERSEL AU TRAVAIL.
Luttons pour défendre nos conditions de vie !
Pendant que les banquiers et les industriels réalisaient de fabuleux profits, les salaires réels de la majorité stagnaient ou reculaient. Le gouffre entre riches et pauvres n’a jamais été aussi grand. Une toute petite minorité de la population baigne dans une richesse obscène, pendant que la part du revenu national qui revient aux travailleurs baisse constamment – et que la grande pauvreté se développe rapidement. L’ouragan Katrina, en 2005, a révélé au monde entier l’existence d’une sous-classe de citoyens qui, dans le pays le plus riche au monde, vit dans les conditions du Tiers-Monde.
Des millions de personnes, aux Etats-Unis, sont menacés de perdre leur emploi et leur maison. Au moment même où Bush faisait voter son plan de sauvetage de 700 milliards, on apprenait que le nombre de factures de gaz et d’électricité impayées atteignait un niveau record. Par exemple, les coupures d’électricité pour défaut de paiement ont augmenté de 22% dans l’Etat du Michigan et de 17% dans l’Etat de New-York. En Pennsylvanie, en Floride et en Californie, également, on rapporte d’importantes augmentations de ces coupures.
Les travailleurs américains produisent 30% de plus qu’il y a 10 ans. Mais les salaires n’ont pratiquement pas augmenté. Même dans le pays le plus riche au monde, d’énormes tensions sociales sont en train de s’accumuler. Cela prépare le terrain à une explosion de la lutte des classes. C’est vrai aux Etats-Unis comme ailleurs. A l’échelle mondiale, le dernier boom s’est accompagné d’un chômage élevé. Même au sommet du boom, les contre-réformes se multipliaient. La crise du capitalisme ne signifie pas seulement que la classe dirigeante ne peut pas accepter de nouvelles réformes. Elle signifie que les capitalistes ne peuvent même plus tolérer l’existence de réformes et de concessions que les travailleurs ont conquises, par leur lutte, au cours des dernières décennies.
Avancer l’idée d’une « unité nationale » pour combattre la crise, c’est tromper les travailleurs. Quels intérêts communs existe-t-il entre les millions de travailleurs ordinaires et leurs super-riches exploiteurs ? Les dirigeants des partis de gauche qui votent pour les « mesures de crise » – y compris les plans de sauvetage au profit des banquiers – trahissent les intérêts de ceux qui les ont élus. Les dirigeants syndicaux qui expliquent qu’en période de crise, « nous devons tous nous unir », et qui s’imaginent qu’il est possible d’obtenir des concessions en échange d’une modération salariale – ces dirigeants obtiendront le contraire de ce qu’ils annoncent. La faiblesse invite à l’agression ! A chaque pas en arrière des organisations syndicales, les capitalistes en demanderont trois de plus.
Pendant que le chômage repart à la hausse, le coût de la vie augmente, lui aussi. Le gaz, l’électricité, la nourriture – tout a augmenté, alors que les salaires sont gelés et que les profits des grandes entreprises explosent. Il y a peu, les économistes bourgeois se félicitaient d’avoir « dompté l’inflation ». Comme ces déclarations paraissent ridicules, désormais !
La seule réponse à l’inflation galopante est l’échelle mobile des salaires. Cela signifie que des accords collectifs doivent garantir une indexation automatique des salaires sur l’évolution des prix. Les banquiers et les capitalistes disent : nous ne pouvons augmenter les salaires car cela stimulerait l’inflation. Mais tout le monde sait que ce sont les salaires qui courent après l’augmentation des prix, et non l’inverse. La réponse, c’est l’échelle mobile des salaires. Cependant, même cela ne suffit pas. Les statistiques officielles sous-estiment volontairement le niveau réel de l’inflation. Par conséquent, ce doit être aux organisations syndicales de déterminer et de veiller sans cesse à l’évolution réelle de l’inflation. Ce calcul doit être basé sur les produits de première nécessité (y compris les loyers, l’essence, le gaz et l’électricité). Toutes les revendications salariales doivent se baser là-dessus.
Nos revendications :
1) Des salaires et des pensions décents pour tous !
2) Pour une échelle mobile des salaires, en les indexant sur l’évolution du coût de la vie.
3) Les syndicats, les coopératives et les associations de consommateurs doivent élaborer leur indice de l’inflation, les indices « officiels » ne reflétant pas la réalité de la situation.
4) Des comités de travailleurs, de femmes au foyer, de petits commerçants et de chômeurs doivent se constituer pour contrôler l’augmentation des prix.
5) Non à la taxation des pauvres ! Les riches doivent payer. Pour l’abolition de toute fiscalité indirecte (TVA, etc.). Pour l’augmentation de l’imposition des riches.
6) Pour une réduction drastique du prix du gaz, de l’essence et de l’électricité. Cela n’est possible que sur la base d’une nationalisation des entreprises du secteur énergétique, qui permettra un contrôle des prix à la consommation.
Les syndicats
Dans la période actuelle, les travailleurs ont plus que jamais besoin de leurs organisations de masse, à commencer par les syndicats. Il sera impossible de défendre les salaires et les conditions de vie sans de puissants syndicats. C’est pour cela que les capitalistes et leurs gouvernements cherchent constamment, à travers des législations anti-syndicales, à affaiblir les syndicats et à limiter leurs marges d’action.
Les dirigeants syndicaux ont été affectés par la longue période de croissance économique. Ils ont, à des degrés divers, adopté des politiques de collaboration de classe (« partenariat social ») – et ils persistent dans cette voie, alors même que les conditions objectives d’une telle politique ont disparu. Les dirigeants syndicaux droitiers sont la force la plus conservatrice de la société. Ils expliquent aux travailleurs qu’on doit tous faire des sacrifices pour résoudre la crise. Ils prêchent la « négociation » entre le Travail et le Capital, qu’ils considèrent comme du « réalisme ». Mais en réalité, c’est le pire des utopismes. Il est impossible de concilier des intérêts mutuellement exclusifs. Dans les conditions actuelles, la lutte seule permettra d’obtenir des réformes et des augmentations de salaire. En fait, il sera nécessaire de lutter pour simplement défendre les acquis sociaux, qui sont partout remis en cause. Cette réalité est en contradiction directe avec la politique de collaboration de classe des dirigeants syndicaux, qui reflètent le passé, et non l’avenir.
Dans ses efforts pour affaiblir les syndicats et les transformer en instruments de contrôle des ouvriers, la classe dirigeante utilise tout son pouvoir pour corrompre les directions et les intégrer à l’appareil d’Etat. Nous nous opposons à toutes ces tentatives et revendiquons le renforcement et la démocratisation des organisations syndicales, à tous les niveaux. Les syndicats doivent être indépendants de l’Etat. Les syndicalistes doivent contrôler leurs dirigeants et les obliger à mener une lutte sérieuse dans l’intérêt des salariés.
Même lorsque la pression de la base pousse les dirigeants syndicaux à appeler à des grèves, ils cherchent souvent à en limiter la portée et la durée. Pour les dirigeants, c’est un moyen d’ouvrir les vannes du mécontentement, pour faire retomber la pression. Au contraire, pour les syndicalistes sérieux, les grèves et manifestations sont un moyen de faire prendre conscience aux travailleurs de leur puissance collective et de préparer le terrain à une transformation fondamentale de la société.
Même dans la période précédente, il y avait une insatisfaction souterraine conséquente aux attaques contre les droits des salariés et les législations anti-syndicales. A présent, cela va faire surface et trouver une expression dans les organisations de la classe ouvrière, à commencer par les syndicats. La radicalisation de la base entrera en conflit avec le conservatisme des directions. Les travailleurs demanderont une transformation complète des syndicats, de la base au sommet, et s’efforceront d’en faire d’authentiques organisations de lutte.
Il faut construire des syndicats de masse, démocratiques et militants, capables d’organiser de larges couches de la classe ouvrière et de préparer les travailleurs, non seulement à la transformation radicale de la société, mais aussi à la direction et au contrôle démocratique de l’économie dans le cadre de la société socialiste à venir.
Nos revendications :
1) Complète indépendance des syndicats vis-à-vis de l’Etat.
2) Abolition de toute législation anti-syndicale, et notamment de toute limitation du droit de grève.
3) Démocratisation des syndicats, qui doivent être fermement contrôlés par leurs adhérents !
4) Pas de mandats à vie ! Pour l’élection de tous les dirigeants syndicaux, avec droit de les révoquer !
5) Contre la bureaucratie et le carriérisme ! Aucun permanent syndical ne doit être mieux payé qu’un travailleur qualifié !
6) Non à la collaboration de classe ! Pour un programme militant afin de mobiliser les travailleurs pour la défense de leurs emplois et de leurs conditions de vie.
7) Pour l’unité syndicale sur la base des revendications ci-dessus.
8) Pour le contrôle de la base. Lors d’une grève, il faut créer de comités de grève permettant la participation d’un maximum de travailleurs.
9) Pour la nationalisation des principaux leviers de l’économie et la création d’une économie socialiste, dans laquelle les syndicats joueraient un rôle clé dans l’administration et le contrôle de toutes les entreprises. Le syndicalisme n’est pas une fin en soi, mais un moyen d’accomplir la transformation socialiste de la société.
La jeunesse
La crise du capitalisme a des effets particulièrement négatifs sur la jeune génération, qui représente la clé de l’avenir de l’humanité. Le déclin sénile du capitalisme menace de ruiner la culture et de démoraliser la jeunesse. Ne voyant aucune issue à l’impasse, une section de la jeunesse tombe dans l’alcoolisme, la drogue, la petite délinquance et la violence. Quand de jeunes gens se font assassiner pour une paire de baskets, nous devons nous demander dans quel type de société nous vivons. Les capitalistes encouragent les jeunes à désirer des objets de consommation qu’ils ne peuvent se payer – puis ils lèvent les bras au ciel face au résultat.
Margaret Thatcher, cette grande prêtresse de l’économie de marché, a dit un jour que la société n’existe pas. Cette misérable philosophie, qui a été mise en pratique il y a trente ans, a eu des effets dévastateurs. Cet individualisme vulgaire a largement contribué à créer une psychologie d’égoïsme, d’avidité et d’indifférence à l’égard de la souffrance des autres – psychologie qui s’est introduite comme un poison dans le corps social. C’est l’essence pure de l’économie de marché.
La vraie mesure du niveau de civilisation d’une société se lit dans la façon dont elle traite les jeunes et les vieux. D’après ce critère, on ne peut pas vraiment qualifier nos sociétés de civilisées. En fait, elles vacillent aux marges de la barbarie. Même pendant la période de croissance économique, il y a avait des symptômes de barbarie (vagues de crimes, violences) et le développement d’une psychologie anti-sociale et nihiliste dans une section de la jeunesse. Cette psychologie est un reflet fidèle de la moralité du capitalisme.
Les réactionnaires poussent des cris d’horreur face à ce phénomène, car ils ne peuvent admettre qu’il est la conséquence du système social qu’ils défendent, et sont impuissants à trouver la solution. Leur seule réponse est de remplir les prisons de jeunes, qui y apprennent à devenir de vrais criminels, et non plus seulement des amateurs. C’est un cercle vicieux.
Le « réponse » de l’Etat capitaliste est de criminaliser la jeunesse, de la rendre responsable des problèmes générés par la société elle-même, d’accroître la répression policière, de construire de nouvelles prisons et de durcir les peines judiciaires. Au lieu de régler le problème, de telles mesures ne font que l’aggraver et générer un cercle vicieux du crime et de l’aliénation. C’est la conséquence logique du capitalisme et de l’économie de marché, qui traitent les gens comme de simples « facteurs de production » et soumettent tout à la loi du profit. La seule solution, c’est d’organiser la jeunesse pour qu’elle lutte, avec la classe ouvrière, contre le capitalisme et pour le socialisme !
Il faut des mesures d’urgence pour empêcher de nouvelles couches de la jeunesse de tomber dans le bourbier de la démoralisation. La lutte pour le socialisme est une lutte pour la culture au sens le plus large du terme, une lutte pour élever les aspirations de la jeunesse, pour donner à leur vie un but qui dépasse la simple lutte pour une survie quasi-animale. Si on traite les gens comme des animaux, ils se comporteront comme des animaux. Si on les traite comme des êtres humains, ils agiront en conséquence.
Les coupes dans l’éducation, à tous les niveaux, la suppression des bourses et l’augmentation des frais d’inscription signifient que la jeunesse d’origine ouvrière est toujours plus exclue de l’éducation supérieure. Au lieu d’être correctement formés à satisfaire les besoins de la société, la majorité des jeunes sont condamnés à enchaîner les emplois non-qualifiés et mal-payés. Dans le même temps, on laisse les entreprises privées interférer dans l’Education nationale, laquelle est toujours plus considérée comme une source de profits parmi d’autres.
Nos revendications :
1) Une éducation gratuite et de qualité pour tous les jeunes, à tous les niveaux. Un programme massif de construction d’écoles et d’universités.
2) Abolition immédiate des frais d’inscription et revalorisation du système de bourse aux étudiants de l’enseignement supérieur.
3) Un emploi garanti et un salaire décent, à la fin des études.
4) La fin de l’exploitation de l’éducation par les capitalistes. Les entreprises privées hors des écoles et des facs !
5) L’ouverture de clubs, librairies, centres sportifs, cinémas, piscines et autres centres culturels pour la jeunesse.
6) Un programme de construction de logements sociaux pour les étudiants et les jeunes couples.
La « faisabilité »
L’argument selon lequel il n’y a pas d’argent pour les réformes est un mensonge flagrant. Il y a plein d’argent pour l’armement ou les guerres impérialistes en Irak et en Afghanistan. Il y a plein d’argent pour subventionner les riches. Et il n’y a pas d’argent pour les écoles et les hôpitaux ?
En conséquence, l’argument sur la « faisabilité » d’une réforme n’a aucune valeur. En dernière analyse, la « faisabilité » d’une réforme – c’est-à-dire le fait qu’elle puisse être mise en pratique – dépend de la lutte des classes et du rapport de force réel. Lorsque la classe dirigeante est menacée de tout perdre, elle est toujours prête à faire des concessions « impossibles ». On l’a vu en mai 68, en France, lorsque la classe dirigeante française a consenti de grosses augmentations de salaire – entre autres – pour mettre un terme à la grève générale et à l’occupation des entreprises par les salariés.
Le choc du début de la crise pourrait, dans un premier temps, paralyser le mouvement ouvrier. Mais la colère ne tardera pas à faire irruption, lorsqu’on demandera aux salariés de payer le prix de la crise. Il y a aura de brusques changements dans la conscience, qui peut se transformer en l’espace de 24 heures. Un grand mouvement dans un seul pays peut provoquer un changement rapide de toute la situation, comme ce fut le cas en 68. Si ce n’est pas encore arrivé, c’est uniquement parce que les directions des organisations du mouvement ouvrier sont à la traîne des événements et ne présentent aucune alternative. Cependant, il y a d’ores et déjà des signes de changements.
Ces derniers temps, il y a eu des grèves générales et des manifestations de masse dans toute l’Europe. En Grèce, il y a eu neuf grèves générales depuis l’arrivée au pouvoir du parti de droite Nouvelle Démocratie, en 2004. Au cours des six premiers mois de 2008, on a assisté, en Belgique, à une vague de « grèves sauvages » qui fait penser aux années 70. En Allemagne, en Espagne, en Italie, la jeunesse et les travailleurs se sont mobilisés à une échelle massive contre la casse des services publics.
Tout ceci montre que les travailleurs ne resteront pas les bras croisés face aux attaques contre leur niveau de vie. Toutes les conditions d’une nette intensification de la lutte des classes sont réunies.
Défendre les droits démocratiques !
Depuis plus d’un demi-siècle, la plupart des travailleurs d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord pensent que la démocratie est acquise une fois pour toutes. Mais c’est une illusion. La démocratie est une construction très fragile. Elle n’est possible que dans les pays riches où la classe dirigeante peut faire des concessions aux travailleurs dans le but d’atténuer la lutte des classes. Mais lorsque les conditions changent, les classes dirigeantes des pays « démocratiques » peuvent se tourner vers la dictature avec la même facilité qu’un homme passe d’un compartiment de train à un autre.
Dans les conditions d’une intensification de la lutte des classes, les capitalistes commenceront à se tourner vers des solutions plus ouvertement répressives. Ils se plaindront du trop grand nombre de grèves et de manifestations – et demanderont la restauration de « l’ordre ». A l’avenir, du fait de la faiblesse des dirigeants réformistes, il est possible que la classe dirigeante parvienne à instaurer une forme de dictature bonapartiste (militaro-policière) dans un pays européen. Mais dans les conditions modernes, un tel régime serait très instable et ne durerait pas longtemps.
Dans les années 30, en Allemagne et en Espagne, il y avait une large petite bourgeoisie urbaine et paysanne. Elle formait la base sociale de la réaction. Depuis, cette couche sociale a pratiquement disparu. A l’époque, la plupart des étudiants étaient issus de familles riches et soutenaient le fascisme. Aujourd’hui, la plupart des étudiants sont de gauche. Les réserves sociales de la réaction sont assez limitées. Les organisations fascistes sont petites – même si elles peuvent être extrêmement violentes, ce qui est d’ailleurs un signe de faiblesse, et non de force. En outre, après l’expérience d’Hitler, les capitalistes ne sont pas disposés à confier le pouvoir à des fanatiques. Ils préfèreront s’appuyer sur des « respectables » officiers et généraux de l’armée, et n’utiliser les bandes fascistes que comme auxiliaires.
D’ores et déjà, les droits démocratiques ont été attaqués partout. Sous prétexte de législation anti-terroriste, la classe dirigeante introduit de nouvelles lois pour restreindre les droits démocratiques. Ce fut le cas aux Etats-Unis, au lendemain du 11 septembre, mais aussi en Grande-Bretagne et ailleurs.
Nous lutterons pour défendre tous les droits démocratiques qui ont été conquis par la classe ouvrière. Avant tout, nous défendrons le droit de faire grève et de manifester, et nous lutterons contre toute restriction de l’activité syndicale. Tout le monde doit avoir le droit d’adhérer à un syndicat et de s’unir à d’autres travailleurs pour défendre ses droits. Souvent, les partisans du capitalisme opposent le socialisme à la démocratie. Mais ils sont eux-mêmes de féroces ennemis de la démocratie. Ils font toujours mine d’oublier que les droits démocratiques actuels ont été conquis par la classe ouvrière dans une lutte longue et acharnée contre les riches et les puissants, qui se sont toujours opposés à toute revendication démocratique.
La classe ouvrière défend la démocratie dans la mesure où elle lui offre les meilleures conditions pour le développement de la lutte pour le socialisme. Mais nous comprenons que sous le capitalisme, la démocratie a nécessairement un caractère limité et superficiel. Que vaut la liberté de la presse, lorsque les grands journaux, les chaînes de télévision, les grandes radios, les salles de conférence et les théâtres sont tous concentrés entre les mains des riches ? Tant que la terre, les banques et les grandes entreprises resteront sous le contrôle d’une petite minorité, toutes les décisions importantes qui affectent nos vies seront prises, non dans les Parlements ou les gouvernements élus, mais derrière les portes closes des conseils d’administration des banques et des multinationales. La crise actuelle a révélé ce fait aux yeux de tous.
Le socialisme est démocratique ou il n’est rien. Nous sommes pour une authentique démocratie, dans laquelle la classe ouvrière contrôlerait l’industrie, la société et l’Etat. Ce serait là une authentique démocratie, contrairement à la caricature actuelle, où tout le monde peut dire (plus ou moins) ce qu’il veut, du moment que les décisions importantes affectant nos vies sont prises par des petits groupes de gens non-élus qui siègent à la tête des banques et des grandes multinationales.
Nos revendications :
1) L’abolition immédiate de toute loi anti-syndicale
2) Le droit, pour tous les travailleurs, de se syndiquer, de faire grève et de manifester.
3) La liberté d’expression et de réunion.
4) Aucune restriction aux droits démocratiques sous prétexte de lois anti-terroristes !
5) Les organisations ouvrières doivent rejeter l’idée fausse d’« unité nationale » avec des gouvernements et des partis capitalistes, sous prétexte de crise. Ces derniers sont responsables de la crise, et veulent faire payer la classe ouvrière.
Un autre monde est possible : le socialisme
Des esprits égarés prétendent que ce sont les progrès de la science qui posent problème. Ils pensent que nous serions plus heureux si vivions dans des cabanes et si nous nous cassions le dos à labourer les champs du matin au soir. C’est absurde. Le développement de l’industrie, de l’agriculture, de la science et de la technologie est la clé de la réalisation du potentiel de l’humanité. Le problème, c’est que ces puissants instruments du progrès humain sont entre les mains d’individus qui les soumettent à la loi du profit, les détournent de leurs objectifs, en limitent l’application et en restreignent le développement.
La science et la technologie ne pourront réaliser leur immense potentiel que lorsqu’elles auront été libérées des chaînes de l’économie de marché et mises au service de l’humanité dans un système de production rationnel et démocratique, basé sur le besoin, et non le profit. Cela nous permettrait de ramener au minimum le temps de travail et, ainsi, de développer le potentiel physique, intellectuel et spirituel des hommes et des femmes. Comme l’écrivait Marx, cela fera passer l’humanité « du royaume de la nécessité vers le royaume de la liberté ».
Après la chute de l’Union Soviétique, les apologues du capitalisme jubilaient. Ils parlaient de la fin du socialisme, de la fin du marxisme – et même de la fin de l’histoire. Ils nous promettaient une nouvelle ère de paix, de prospérité et de démocratie, grâce aux miracles de l’économie de marché. Aujourd’hui, moins de 20 ans plus tard, toutes ces illusions ont été réduites à l’état de cendres. Or, les problèmes sérieux exigent des mesures sérieuses. On ne soigne pas un cancer avec de l’aspirine ! Il faut un réel changement de société. Le problème fondamental est le système lui-même. Les « experts » qui nous expliquaient que Marx s’était trompé et qu’il n’y aurait plus de crises du capitalisme – ces « experts » se sont eux-mêmes trompés.
La dernière phase de croissance avait toutes les caractéristiques du cycle économique décrit par Marx, en son temps. Le processus de concentration du capital a atteint des proportions stupéfiantes. Il y a eu une orgie de fusions-acquisitions et un processus de monopolisation d’une ampleur inédite. Mais cela n’a pas mené à un développement des forces productives comparable à ce qu’on a connu par le passé. Des entreprises ont été fermées comme s’il s’agissait de boites d’allumettes – et des masses de travailleurs licenciés. Désormais, avec la crise, ce processus va s’accélérer, et le nombre de faillites et de fermetures s’accroître de jour en jour.
Qu’est-ce que tout cela signifie ? Nous assistons à la douloureuse agonie d’un système qui ne mérite pas d’exister, mais qui refuse de mourir. Ce n’est pas surprenant. Toute l’histoire nous montre qu’aucune classe dirigeante n’abandonne son pouvoir et ses privilèges sans se battre. Telle est la cause fondamentale des guerres, du terrorisme et de la violence qui dominent notre époque. Mais nous assistons également à l’accouchement d’une société nouvelle – une société juste, un monde digne des hommes et des femmes qui le peuplent. Une nouvelle force émerge de ces événements chaotiques, dans un pays après l’autre : la force révolutionnaire des travailleurs, des paysans et de la jeunesse.
Les impérialistes américains sont ivres de leur pouvoir, et s’imaginent qu’il n’a aucune limite. Malheureusement, il y a aussi des gens, à gauche, qui pensent la même chose. Ils se trompent. Une vague révolutionnaire balaye l’Amérique latine. La révolution vénézuélienne a eu de très importantes répercussions sur l’ensemble du continent. Les mouvements de masse en Amérique latine sont la réponse définitive à tous ceux qui expliquaient que des révolutions n’étaient plus possibles. Non seulement elles sont possibles, mais elles sont absolument nécessaires si on veut sauver le monde d’un désastre imminent. L’humanité est face à l’alternative : socialisme ou barbarie.
Pour une Fédération Socialiste des Etats Européens !
Le potentiel productif de l’Europe est immense. Avec 497 millions d’habitants et un revenu annuel par habitant de 32 300 dollars, c’est une puissance gigantesque – potentiellement. Mais ce potentiel ne pourra jamais être réalisé sous le capitalisme. L’unification de l’Europe se heurte sans cesse aux contradictions entre les différents intérêts nationaux. La récession aggravera ces divisions et placera un point d’interrogation sur le futur de l’UE elle-même.
La formation de l’Union Européenne était une reconnaissance tacite du fait qu’il est impossible de développer l’économie dans les limites étroites des marchés nationaux. Mais l’unité de l’Europe ne pourra jamais être réalisée sur la base du capitalisme. Avec la crise, les contradictions entre les classes dirigeantes des différents Etats nationaux remontent à la surface. Toute la démagogie sur l’unité de l’Europe apparaîtra au grand jour. Quoi qu’en dise Sarkozy, les relations entre dirigeants européens se dégradent sérieusement – notamment entre les dirigeants de la France et de l’Allemagne, les deux pays clés de l’UE.
Les gouvernements nationaux s’efforcent de défendre d’abord leurs propres intérêts. Dès qu’ils sont confrontés à une crise, les suspicions mutuelles remontent à la surface. Chacun doit faire face à la panique qui, partie des Etats-Unis, déferle sur les institutions financières européennes. Avec un seul gouvernement et un seul système politique, les Etats-Unis ont déjà bien du mal à faire face à la crise globale du crédit. Quant à l’Europe, malgré sa monnaie unique et son marché commun, elle est handicapée par ses 27 gouvernements et l’absence d’un système bancaire global et unique.
Il est impossible d’unifier des économies qui poussent dans différentes directions. Les gouvernements européens payent le prix d’une monnaie unique privée des institutions ou du système régulateur d’une seule économie. Dans la période à venir, les tendances protectionnistes se renforceront. Chaque gouvernement s’efforce d’attirer des milliards d’euros d’épargne au détriment des autres pays. C’est un avant-goût des politiques du « chacun pour soi » auxquelles il faut s’attendre, au fur et à mesure que la crise s’aggravera.
Les tensions entre Etats européens sont si grandes que l’existence même de la monnaie unique pourrait être remise en cause, à l’avenir. Il n’est pas exclu que l’UE finisse par se désagréger – ou tout au moins par voir ses structures radicalement transformées et son essence réduite à une vague union douanière.
L’UE n’est rien d’autre qu’un club capitaliste dominé par les banques et les grandes multinationales de ses Etats-membres. Les nouveaux Etats membres d’Europe de l’Est sont utilisés comme une source de main d’œuvre bon marché : ils combinent les prix « Européens » et les salaires « de l’Est ». D’un autre côté, l’UE est un bloc impérialiste qui exploite les anciennes colonies des puissances européennes en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et dans les Caraïbes. Elle n’a rien de progressiste. La seule façon de réaliser le véritable potentiel de l’UE, c’est l’établissement d’une Fédération Socialiste intégrant toutes les forces productives d’Europe dans un plan économique commun. Cela se combinerait avec une autonomie maximale pour tous les peuples d’Europe, y compris les Basques, les Catalans, les Ecossais, les Gallois et les autres minorités nationales et linguistiques. Cela poserait les bases d’un règlement pacifique et démocratique du problème national dans des pays comme l’Irlande ou Chypre. Une Fédération socialiste serait formée sur les bases du volontariat – avec égalité complète de tous ses citoyens.
Nos revendications :
1) Non à l’UE des bureaucrates, des banques et des monopoles !
2) Pour l’expropriation des banques et des monopoles. Pour la création d’un plan de production socialiste intégré et démocratique.
3) Non à la discrimination envers les immigrés, les femmes et les jeunes. A travail égal, salaire égal !
4) Pour le développement de liens entre les militants syndicaux à l’échelle européenne et mondiale. Pour un front unique des ouvriers contre les grandes multinationales !
5) Pour une Fédération Socialiste des Etats Européens !
L’Europe de l’Est, la Russie et la Chine
Le début d’une récession en Europe de l’Ouest exacerbe les problèmes des soi-disant « économies émergentes » d’Europe de l’Est, où les investisseurs se déchargent des investissements à haut risque au profit d’investissements plus sûrs. Les économies relativement faibles d’Europe de l’Est vont payer au prix fort leur intégration au capitalisme mondial. De sévères récessions et une aggravation de la pauvreté sont à l’ordre du jour en Russie, en Ukraine et en Roumanie. Malgré la croissance dans certaines régions, les observateurs s’attendent, pour toute cette partie de l’Europe, à une stagnation totale du PIB par habitant.
Lorsqu’ils ont rejoint l’UE, on expliquait aux peuples d’Europe de l’Est qu’ils allaient rapidement bénéficier des conditions de vie des Allemands ou des Français. Ces illusions sont désormais en cendres. Une toute petite minorité de gens s’est enrichie sur la base de la privatisation – c’est-à-dire du pillage – des économies nationalisées. La majorité des Polonais, des Tchèques, des Slovaques et des Hongrois n’ont pas bénéficié de la restauration du capitalisme. Pendant la phase de croissance, les travailleurs d’Europe de l’Est constituaient une main d’œuvre bon marché aux capitalistes des pays plus riches. Mais à présent, l’Europe de l’Est est au bord de la faillite.
Les conséquences de la restauration du capitalisme ont été particulièrement graves dans les Balkans. Le démembrement de la Yougoslavie était un acte criminel, qui a débouché sur toute une série de guerres fratricides, d’assassinats de masse et de génocides. Cette situation monstrueuse a eu des conséquences catastrophiques pour des millions de gens qui, jusqu’alors, vivaient en paix et bénéficiaient de bonnes conditions de vie et du plein emploi. Nombreux sont ceux qui regrettent l’époque de la Yougoslavie. Le capitalisme ne leur a apporté que guerres, misère et souffrances.
La situation de la Russie n’est guère plus enviable. Les contradictions y sont encore plus flagrantes qu’en Europe de l’Est. La restauration du capitalisme n’a bénéficié qu’à une infime minorité de la population de l’ex-Union Soviétique. L’oligarchie d’une richesse obscène qui s’est constituée est étroitement liée aux éléments criminels. A l’inverse, pour des millions de Russes, les deux dernières décennies ont été marquées par la misère, la faim, la souffrance et l’humiliation. La santé et l’éducation publiques – qui étaient gratuites, à l’époque soviétique – se sont effondrées, en même temps que la culture. Le paupérisme et les inégalités ont explosé.
Pendant un temps, les travailleurs pensaient que le pire était passé et que l’économie se relevait de la profonde récession économique qui a suivi l’effondrement de l’URSS. Mais à présent, la Russie est confrontée à sa pire crise financière depuis 1998. La chute du prix du pétrole, qui reflète la chute de la demande mondiale, pousse l’économie vers la crise. Du fait de leur chute et de leur extrême turbulence, les marchés boursiers ont dû fermer à plusieurs reprises. Le capitalisme russe a révélé l’extrême fragilité de ses fondations.
Cette crise a obligé le gouvernement russe à suivre la même voie que Londres et Washington. Ils dépensent des millions d’argent public pour sauver des entreprises privées. Plus de 200 milliards de dollars ont été injectés sous forme de prêts, d’allègements fiscaux – entre autres. Mais les citoyens russes ordinaires se demanderont pourquoi l’argent public est utilisé pour renflouer des oligarques qui, dans la dernière période, se sont enrichis en pillant l’Etat. Puisque la « libre entreprise » et le marché sont censés être plus efficaces que la planification de l’économie, pourquoi le secteur privé a-t-il besoin, à présent, du secours de l’Etat ?
La situation est encore plus grave dans les anciennes Républiques Soviétiques telles que l’Ukraine et la Géorgie, où l’appauvrissement des masses s’accompagne d’instabilité politique, de corruption et de chaos. Les peuples du Caucase et d’Asie Centrale ont traversé un enfer. La Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont dans un état de guerre constante, et les masses doivent supporter le lourd fardeau des dépenses militaires. Le terrorisme se répand de la Tchétchénie occupée vers d’autres républiques. La guerre en Afghanistan menace de déstabiliser, non seulement le Pakistan, mais également toute l’Asie Centrale.
Selon le vieux proverbe : « La vie enseigne ». En Russie, en Ukraine et en Europe de l’Est, beaucoup de gens se disent : nous avions des problèmes, avant, mais au moins nous avions le plein emploi, des logements, une santé et une éducation gratuites. A présent, ces pays sont menacés de ruine et de chômage massif. Les peuples du Caucase désirent ardemment le retour de la paix et de la stabilité. Certes, personne ne veut voir revenir la bureaucratie et la dictature totalitaire. Mais un régime authentiquement socialiste, comme le régime de démocratie ouvrière établi par la révolution d’Octobre, sous Lénine et Trotsky, n’a rien à voir avec sa caricature grotesque qui a émergé dans les années suivant la mort de Lénine, en 1924.
Le stalinisme était la conséquence de l’isolement de la révolution russe dans des conditions d’extrême arriération. Mais aujourd’hui, sur la base des progrès de l’industrie, de la science et de la technologie, ces 90 dernières années, les conditions objectives du socialisme sont plus que jamais développées. Ce qui est nécessaire, c’est une Fédération Socialiste dans laquelle l’économie serait sous le contrôle de l’Etat, et l’Etat lui-même sous le contrôle démocratique des travailleurs et des paysans. Mais la première condition, c’est l’expropriation des oligarques, des banquiers et des capitalistes.
Le ralentissement économique a un impact majeur sur l’économie chinoise. La croissance de l’économie chinoise dépend lourdement des exportations. A l’apogée du dernier boom, la croissance annuelle des exportations y a atteint 38% (en 2003). Ce chiffre est récemment tombé à 2%. Au cours des derniers mois, le secteur manufacturier a sérieusement ralenti. De grandes usines ferment et des millions de travailleurs chinois se retrouvent au chômage. Les observateurs bourgeois les plus sérieux se demandent s’il y aura un « ralentissement graduel » ou une « chute brutale » de la production chinoise.
En 2007, la croissance de l’économie chinoise était de 12%. En 2008, elle était déjà tombée à 9%. Dans la région de Hong Kong, des millions de travailleurs risquent de perdre leur emploi dans les mois à venir. A cela s’ajoutent l’éclatement de la bulle immobilière et la chute brutale des prix du logement.
Le gouvernement chinois a répondu avec un plan massif pour stimuler la croissance. Pour garantir un minimum de stabilité sociale, ils doivent maintenir la croissance au-delà de 8%. Mais le gouvernement ne pourra pas compenser les pertes causées par la chute de la demande mondiale. En conséquence, l’effervescence sociale se développe. Il y a eu des manifestations pour réclamer le versement de salaires impayés, avec blocage des routes et piquets devant les usines. Comme en Russie et en Europe de l’Est, il y aura un violent retour de flamme contre le capitalisme, en Chine. Les idées du marxisme y gagneront du terrain, préparant la voie à un mouvement irrésistible vers le socialisme.
Nos revendications :
1) La fin des privatisations et l’abandon des politiques « pro-marché ».
2) A bas les oligarques et les nouveaux riches ! Pour la renationalisation des entreprises privatisées, sans compensation !
3) Pour la démocratie ouvrière !
4) A bas la bureaucratie et la corruption ! Les syndicats doivent défendre les intérêts des ouvriers !
5) Les Partis Communistes doivent défendre des politiques communistes ! Pour un retour au programme de Marx et de Lénine !
6) Pour la réintroduction du monopole d’Etat du commerce extérieur !
La crise du « Tiers-monde »
Les pays pauvres d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Amérique latine seront les plus durement frappés par la crise. Même pendant le boom, la grande majorité de leur population n’en tirait pratiquement aucun bénéfice. Dans tous les pays, il y a eu une polarisation extrême entre riches et pauvres. 2% de la population mondiale possède la moitié des richesses de la planète. 1,2 milliard d’hommes, de femmes et d’enfants vivent dans des conditions d’extrême pauvreté. C’est 200 millions de plus qu’en 1993. Cette situation est ce que le capitalisme a de mieux à offrir. Et maintenant ?
En plus de l’effondrement des exportations, qui va toucher toutes les marchandises (à part l’or et l’argent), ces pays font face à l’inflation des produits alimentaires, qui est largement due à la spéculation. Un rapport récent de Banco Interamericano a prévenu que cette inflation menaçait de plonger 26 millions de latino-américains dans la pauvreté absolue.
La pauvreté et la faim vont s’accroître en conséquence de la crise financière et des mesures d’« ajustement structurel » dictées par le Fonds Monétaire International. Un rapport de la Banque Mondiale explique que le nombre de personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour pourrait atteindre 1,5 milliard à la fin de l’année. En Inde, le nombre de ces victimes de « pauvreté absolue » est estimé à 340 millions, contre 300 millions en 1980 – et ce alors que l’Inde a connu des taux de croissance économique de 10% ! A présent, la croissance indienne ralentit, même d’après les chiffres officiels. De même, les économistes anticipent une baisse du PIB par habitant en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
Le FMI demande aux pays pauvres d’ouvrir leur marché au capital international. Il leur demande de faire des coupes sombres dans leurs dépenses publiques, d’arrêter de subventionner la nourriture et autres produits de base, et de privatiser les entreprises publiques. L’objectif officiel est d’encourager une « croissance économique durable », dans ces pays. Mais en réalité, cela se traduit par la destruction de leur industrie et de leur agriculture nationales – ainsi que par une flambée du chômage et de la pauvreté.
Une étude récente montre qu’en 1997 et 1998, le solde net des transferts de capitaux entre le continent africain et le FMI était supérieur à 1 milliard de dollars – au détriment de l’Afrique. Et pourtant, la dette totale de l’Afrique a continué de croître (de 3%). Alors que les pays africains ont urgemment besoin d’accroître leurs dépenses de santé et d’éducation, les dictats du FMI ont eu pour effet de diminuer ces dépenses. Par exemple, entre 1986 et 1996, les dépenses pour l’éducation, par habitant, ont baissé.
La catastrophe que vit le Tiers-monde n’a rien d’inéluctable. En ce début de XXIe siècle, la famine n’a absolument aucune justification. L’argent qui a été donné aux banques aurait pu résoudre le problème de la famine mondiale et sauver des millions de vies. En juin 2008, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a demandé 30 milliards de dollars pour stimuler l’agriculture et prévenir des pénuries alimentaires. Elle n’en a obtenu que 7,5 milliards, payables en quatre ans, ce qui représente à peine 1,8 milliard par an.
Il est courant, en Occident, de présenter les « solutions » aux problèmes du Tiers-monde en termes d’aides. Les pays « riches » doivent donner de l’argent aux pays « pauvres ». Mais premièrement, les sommes dérisoires des soi-disant « aides » ne représentent qu’une minuscule partie du pillage de l’Asie, de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Amérique latine. Deuxièmement, ces aides sont généralement liées aux intérêts commerciaux, militaires ou diplomatiques des pays donateurs. Elles constituent en fait un moyen parmi d’autres d’accroître la subordination de ces pays aux puissances impérialistes.
Dans tous les cas, il est inacceptable que des pays disposant de vastes ressources en soient réduits à demander la charité, comme un mendiant convoite les miettes tombées de la table des riches. La condition première est de rompre avec la domination impérialiste et de renverser les régimes corrompus qui, au final, ne sont rien d’autre que les agents locaux de l’impérialisme et des grandes multinationales. Ce n’est pas la charité qui peut résoudre le problème de la pauvreté mondiale, mais un changement fondamental de la société.
Dans de nombreux pays, après des années de fatigue et de découragement, la classe ouvrière reprend le chemin des luttes. La lutte des Palestiniens contre l’oppression israélienne se poursuit. Mais la clé de l’avenir réside dans les puissantes classes ouvrières de pays comme l’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Egypte. L’Egypte a été balayée par une vague de grèves et d’occupations pour défendre l’emploi – dont la grève victorieuse des 20 000 travailleurs de l’industrie textile de Mahalla. Les travailleurs iraniens sont également en mouvement. Il y a eu en Iran une vague de grèves impliquant différentes sections de la classe ouvrière : les conducteurs de bus, les travailleurs des chantiers navals, de l’industrie textile, de l’industrie pétrolière, de l’industrie du sucre. Ces grèves commencent par des revendications économiques. Mais étant donnée la nature du régime iranien, elles prendront inévitablement un caractère politique et révolutionnaire.
Au Nigeria, il y a eu pas moins de huit grèves générales – en l’espace de huit années ! En Afrique du Sud, également, les puissantes organisations syndicales ont organisé toute une série de grèves générales (la dernière en août 2008). On a assisté à de puissants mouvements des travailleurs au Maroc, en Jordanie, au Liban et même en Israël – le bastion de la réaction au Moyen-Orient. Des mouvements massifs d’ouvriers et de paysans ont secoué le Pakistan, l’Inde et le Bangladesh. Au Népal, ces mouvements ont abouti au renversement de la monarchie.
Une vague révolutionnaire balaye toute l’Amérique latine. Le Venezuela en est l’avant-garde. Les appels de Chavez en faveur du socialisme ne sont pas passés inaperçus. L’idéal socialiste est de nouveau à l’ordre du jour. En Bolivie et en Equateur, le mouvement des masses contre le capitalisme et l’impérialisme se développe malgré la résistance des oligarchies appuyées par Washington. Il faut mettre à l’ordre du jour la solidarité ouvrière internationale et la lutte pour le socialisme. C’est la seule solution viable aux problèmes des masses.
Nos revendications :
1) Annulation immédiate de la dette du Tiers-Monde.
2) A bas le latifundisme et le capitalisme !
3) Pour l’expropriation des grands propriétaires terriens. Pour une réforme agraire. Là où c’est possible, les grands domaines terriens doivent être cultivés de façon collective et par des méthodes modernes, afin de stimuler la production.
4) Non à la domination de l’impérialisme ! Nationalisation des grandes multinationales !
5) Pour un programme massif d’alphabétisation et d’éducation.
6) Pour un système de santé universel, gratuit et de qualité.
7) A bas l’oppression des femmes ! Pour une complète égalité sociale et économique entre les hommes et les femmes !
8) A bas la corruption et l’oppression ! A bas les agences locales de l’impérialisme !
A bas l’impérialisme !
L’aspect le plus frappant de la situation actuelle est le chaos et le désordre qui se sont emparés de l’ensemble de la planète. L’instabilité est générale : économique, sociale, politique, diplomatique et militaire. Partout, il y a la guerre ou la menace de la guerre. L’invasion de l’Afghanistan a été suivie par celle, encore plus sanglante et criminelle, de l’Irak. Il y a eu des guerres partout : dans les Balkans, au Liban, à Gaza, au Darfour, en Somalie, en Ouganda, etc. Au Congo, 5 millions de personnes ont été tuées, ces dernières années, sans que l’ONU et la soi-disant communauté internationale ne lèvent le petit doigt.
Conscient de son immense puissance, Washington remplace la diplomatie « normale » par les menaces les plus éhontées. Son message est d’une brutalité limpide : « faites ce que nous disons, ou nous vous bombarderons et vous envahirons ». L’ancien Président du Pakistan, le général Pervez Musharraf, a révélé que peu de temps après les attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont menacé de bombarder son pays et de le ramener à « l’âge de pierre » s’il n’offrait pas sa coopération dans la lutte contre le terrorisme et les Talibans. Et à présent que Musharraf a été évincé, l’aviation américaine bombarde le territoire pakistanais.
L’impérialisme américain a envahi l’Irak sous le prétexte mensonger que ce pays possédait des armes de destruction massive. Ils ont fait valoir que Saddam Hussein était un dictateur brutal, qui a tué et torturé son propre peuple. Mais aujourd’hui, l’ONU est forcée d’admettre que dans l’Irak occupé, les massacres et la torture sont endémiques. Selon un récent sondage d’opinion, 70 % des Irakiens pensent que la vie est pire que sous Saddam Hussein.
La « guerre contre le terrorisme » a conduit, à l’échelle mondiale, à un développement inédit du terrorisme. Partout où ils mettent les pieds, les impérialistes américains provoquent les destructions et les souffrances les plus atroces. Les effroyables scènes de mort et de destruction, en Irak et en Afghanistan, rappellent les paroles de l’historien romain Tacite : « Et lorsqu’ils ont créé un désert, ils l’appellent la paix ». Mais par rapport à la puissance de l’impérialisme américain, la puissance de l’Empire romain était un jeu d’enfant. Non content du viol de l’Irak, les Etats-Unis menacent la Syrie et l’Iran. Ils déstabilisent l’Asie centrale. Ils tentent constamment de renverser le gouvernement démocratiquement élu du Venezuela, et cherchent à assassiner le président Chavez. Ils n’ont pas renoncé à ramener Cuba au rang de semi-colonie, et organisent des actes de terrorisme contre ce pays.
La plupart des gens se détournent de cette barbarie avec dégoût. Il leur semble que le monde est soudainement devenu fou. Cependant, une telle réaction est inutile et contre-productive. La situation actuelle à laquelle est confrontée l’humanité ne peut pas être interprétée comme une expression de folie ou de méchanceté intrinsèque des hommes et des femmes. Le grand philosophe Spinoza disait : « ni rire, ni pleurer, mais comprendre ! » C’est un très bon conseil, car si nous ne sommes pas en mesure de comprendre le monde dans lequel nous vivons, nous ne serons jamais capables de le changer. L’histoire n’est pas dénuée de sens. Elle peut être expliquée – et le marxisme fournit une explication scientifique.
Il ne sert à rien de considérer la guerre d’un point de vue sentimental. Clausewitz soulignait, il y a longtemps, que la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens. Ce chaos sanglant reflète quelque chose. C’est le reflet des contradictions insolubles de l’impérialisme, à l’échelle mondiale. Ce sont les convulsions d’un système socio-économique qui se trouve dans une impasse. Nous avons vu des situations similaires auparavant, dans l’histoire du monde, comme lors du long déclin de l’Empire romain, ou l’époque de la fin de la féodalité. L’instabilité mondiale actuelle est seulement l’illustration que le système capitaliste a épuisé son potentiel historique et n’est plus en mesure de développer les forces productives comme il l’a fait dans le passé.
Le capitalisme sénile, criblé de contradictions insolubles, trouve son prolongement dans l’impérialisme le plus brutal que le monde ait jamais vu. La course frénétique aux armements engloutit une part plus en plus grande des richesses créées par la classe ouvrière. Les Etats-Unis, qui sont désormais la seule superpuissance au monde, y consacrent chaque année environ 600 milliards de dollars. Cela représente près de 40 % de toutes les dépenses militaires à l’échelle mondiale. En comparaison, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne représentent environ 5% chacun – et 6 % pour la Russie.
A elles seules, les sommes gigantesques dilapidées dans l’armement permettraient de résoudre le problème de la pauvreté dans le monde. Selon une étude, la guerre en Irak a coûté aux Etats-Unis 3000 milliards de dollars, à ce jour. Tout le monde admet que c’est de la folie. Mais on ne peut arriver au désarmement que par un changement fondamental dans la société. La liquidation de l’impérialisme ne peut être atteint que par la liquidation du capitalisme et de la domination des banques et des monopoles, par la fondation d’un ordre mondial rationnel, reposant sur les besoins des individus, et non pas sur la lutte féroce pour des marchés, des matières premières et des sphères d’influence – lutte qui est la véritable cause des guerres.
Nos revendications :
1) Non aux guerres réactionnaires conduites par l’impérialisme.
2) Retrait immédiat de toutes les troupes étrangères en Irak et en Afghanistan.
3) Coupe drastique dans les dépenses en armements – et une augmentation massive des dépenses
sociales.
4) Les pleins droits civils pour les soldats, y compris le droit de se syndiquer et de faire grève.
5) Défense du Venezuela, de Cuba et de la Bolivie contre les plans d’agression de Washington !
6) Contre le racisme ! Défendre les droits de tous les peuples opprimés et exploités ! Pour l’unité de tous les travailleurs, indépendamment de leur couleur, de leur race, de leur nationalité ou de leur religion.
7) Pour l’internationalisme prolétarien ! Prolétaires de tous les pays unissez-vous !
Pour un monde socialiste !
Le marché ne peut être ni planifié, ni régulé. Il ne réagit pas aux mesures prises par les gouvernements nationaux. Le Président de la Banque mondiale l’a pratiquement reconnu lorsqu’il a dit : « le G8 ne fonctionne pas. Il nous faut un meilleur groupe, pour des jours meilleurs ». Mais il n’y a pas de jours meilleurs en vue. Le FMI ne peut pas soutenir financièrement le monde entier. Or la crise est mondiale. Aucun pays ne peut y échapper. La crise exige donc une solution mondiale – et le socialisme seul est cette solution.
Au Moyen-âge, la production était confinée au marché local. Même le transport de marchandises d’une ville à l’autre impliquait le paiement de péages, d’impôts et autres taxes douanières. Le renversement de ces barrières féodales et la constitution d’un marché national – et d’un Etat-nation – étaient une condition préalable au développement du capitalisme moderne. Mais aujourd’hui, au XXIe siècle, les Etats-nations et les marchés nationaux sont devenus trop étroits face à la formidable expansion de l’industrie, de l’agriculture, de la science et de la technologie. De l’ensemble des économies nationales a surgi le marché mondial. Karl Marx l’avait déjà brillamment anticipé dans le Manifeste du Parti Communiste, il y a 160 ans. L’écrasante domination du marché mondial est la caractéristique essentielle de l’époque moderne.
Dans sa jeunesse, le capitalisme a joué un rôle progressiste en balayant les vieilles barrières et entraves féodales – et en créant un marché national. Plus tard, le développement du capitalisme a créé un marché mondial. La mondialisation signifie que le développement des forces productives a dépassé les limites étroites des Etats-nations. Cependant, la mondialisation ne supprime pas les contradictions du capitalisme. Il ne fait que les reproduire à une échelle beaucoup plus vaste. Pendant un temps, le capitalisme a réussi à surmonter ses contradictions en développant le commerce mondial (mondialisation). Pour la première fois dans l’histoire, le monde entier a été intégré au marché mondial. Les capitalistes ont trouvé de nouveaux marchés, et de nouvelles zones d’investissement se sont ouvertes à eux, en Chine et dans d’autres pays. Mais ce processus a désormais atteint ses limites.
En dernière analyse, la crise actuelle est une expression de la révolte des forces productives contre ces camisoles de force que sont la propriété privée des moyens de production et l’Etat-nation. La crise actuelle a un caractère mondial. La mondialisation se manifeste comme une crise mondiale du capitalisme. Il est impossible de la résoudre à l’échelle nationale : tous les experts le reconnaissent. Par exemple, la crise alimentaire mondiale a été fortement aggravée par la production d’éco-carburants aux Etats-Unis – qui sert uniquement les intérêts des grandes firmes agro-alimentaires, et de personne d’autre. Seule une économie planifiée à l’échelle mondiale peut mettre un terme à cette folie.
Dans son insatiable soif de profits, le système capitaliste a mis en danger la planète entière. Un système économique qui ravage la planète, détruit les forêts tropicales, empoisonne l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons et la nourriture que nous mangeons – n’est pas digne de survivre. Les rues de nos grandes villes sont saturées de véhicules privés. Pour la seule année 2003, les gens ont passé 7 milliards d’heures dans des embouteillages, et y ont gaspillé 19 milliards de litres de carburant. L’absence de planification est en train de conduire à l’effondrement des infrastructures de transport et à une dégradation de l’environnement. Une grande partie de la pollution atmosphérique provient des véhicules.
Et ne parlons même pas de l’énorme coût humain de cette folie : accidents, personnes tuées et mutilées sur les routes, stress insupportable, nuisance sonore et chaos. En termes de productivité, c’est un gaspillage colossal. Pourtant, tout ceci pourrait être facilement résolu grâce à réseau rationnel de transports publics de bonne qualité et pratiquement gratuits. Le transport aérien, routier, ferroviaire et fluvial devrait appartenir à la collectivité et répondre aux besoins des hommes.
Le maintien du capitalisme n’est pas seulement une menace pour nos emplois et nos conditions de vie. C’est une menace pour l’avenir de la planète et la vie sur terre.
Est-ce utopique ?
Par leur participation accrue au marché mondial, les banquiers et les capitalistes ont réalisé des super-profits pharamineux. Désormais, ce processus a atteint ses limites. Tous les facteurs qui, sur la dernière période, poussaient l’économie mondiale vers le haut – se combinent à présent pour la pousser vers le bas. La demande, qu’ils ont artificiellement développée grâce à de faibles taux d’intérêt, s’est brusquement contractée. La sévérité de la « correction » est proportionnelle à la confiance exagérée et à « l’exubérance irrationnelle » de la période précédente.
De même que dans la période de déclin du féodalisme, les vieilles entraves – péages, impôts locaux et monnaies locales – étaient devenues des obstacles intolérables au développement des forces productives, de même les Etats-nations actuels, avec leurs frontières nationales, leurs passeports, leur contrôle des importations, leurs restrictions migratoires et leurs tarifs protectionnistes, sont devenus des entraves au libre mouvement des marchandises et des personnes. Le libre développement des forces productives – la seule garantie réelle du développement de la civilisation et de la culture humaines – exige l’abolition de toutes les frontières et une socialisation mondiale des richesses.
Un tel développement ne sera possible que sous le socialisme. La condition préalable est l’abolition de la propriété privée des secteurs clés de l’économie : socialisation des terres, des banques et de la grande industrie. Un plan de production global est le seul moyen de mettre en oeuvre le potentiel colossal de l’industrie, de l’agriculture, de la science et de la technique. Cela signifie un système économique reposant sur la production pour les besoins de la majorité – et non pour les profits de quelques-uns.
Une Europe socialiste, une Fédération socialiste de l’Amérique Latine ou du Moyen-Orient ouvriraient de nouvelles et formidables perspectives au développement humain. L’objectif final est une Fédération Socialiste Mondiale, dans laquelle les ressources de la planète entière seront exploitées pour le bénéfice de toute l’humanité. Les guerres, le chômage, la faim et les privations ne seraient plus que des mauvais souvenirs.
Certains diront que c’est une utopie, c’est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être réalisé. Mais si nous avions expliqué à un paysan du Moyen-âge qu’il y aurait une économie mondiale, des ordinateurs et des voyages dans l’espace, il aurait réagi exactement de la même façon. Or, quand on y pense, est-ce vraiment si difficile ? Le potentiel des forces productives est tel que tout ce qui accable le genre humain – la pauvreté, le manque de logements, la faim, la maladie, l’analphabétisme, etc. – pourrait facilement être éliminé. Les ressources existent. Ce qu’il faut, c’est un système économique rationnel pour exploiter pleinement ces ressources.
Les conditions objectives du socialisme existent déjà. Est-ce vraiment une utopie ? C’est ce que diront les sceptiques bornés, qui ne connaissent pas l’histoire et n’ont aucune perspective pour l’avenir. La question qu’on doit se poser est celle-ci : en ce début de XXIe siècle, est-il acceptable que la vie, les emplois et les logements des hommes soient soumis aux mêmes lois que celles ayant cours sur les tables d’un casino ? L’humanité ne peut-elle pas construire un meilleur système que le jeu aveugle des forces du marché ?
A cette question, les défenseurs du soi-disant libre marché ne peuvent pas répondre par des arguments rationnels. Au lieu d’avancer de tels arguments, ils affirment simplement que le capitalisme est l’état naturel et inévitable des choses – et qu’il n’y a de toute façon aucune alternative. Ce n’est pas un argument logique, mais seulement un préjugé. Ils espèrent qu’en le répétant constamment, les gens finiront par le croire. Mais la vie elle-même a réfuté le mensonge selon lequel « l’économie de marché fonctionne. » Notre propre expérience nous montre que cela ne marche pas, que c’est un système chaotique, barbare et irrationnel qui détruit des millions de vies pour le bénéfice de quelques-uns.
Le système capitaliste est condamné. Il n’est même pas capable de nourrir la population mondiale. Son maintien menace l’avenir de la civilisation et de la culture. Il menace la continuité de la vie elle-même. Le système capitaliste doit mourir pour que l’espèce humaine puisse vivre. Dans la future société socialiste, les hommes et les femmes libres regarderont notre monde actuel avec la même incrédulité que lorsque nous considérons le monde des cannibales. Et pour les cannibales, un monde dans lequel les hommes et des femmes ne se mangeraient pas semblait une utopie.
La crise de la direction
En 1938, Léon Trotsky écrivait : « Les bavardages de toutes sortes selon lesquels les conditions historiques ne seraient pas encore "mûres" pour le socialisme ne sont que le produit de l’ignorance ou d’une tromperie consciente. Les prémisses objectives de la révolution prolétarienne ne sont pas seulement mûres ; elles ont même commencé à pourrir. Sans révolution socialiste, et cela dans la prochaine période historique, la civilisation humaine tout entière est menacée d’être emportée dans une catastrophe. Tout dépend du prolétariat, c’est-à-dire au premier chef de son avant-garde révolutionnaire. La crise historique de l’humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire. »
La classe ouvrière a, de longue date, formé des partis pour défendre ses intérêts et changer la société. Qu’ils s’appellent Socialistes, Travaillistes ou Communistes – aucun, en fait, ne défend une politique socialiste ou communiste. La longue période de croissance capitaliste, après la seconde guerre mondiale, a scellé la dégénérescence réformiste et bureaucratique des organisations de masse de la classe ouvrière. Les dirigeants syndicaux, comme ceux des partis communistes et socialistes, ont plié sous la pression de la classe capitaliste, et la plupart ont abandonné toute prétention de changer radicalement la société.
En Russie, en Europe de l’Est et dans bien d’autres pays, les dirigeants des Partis Communistes ont complètement abandonné le programme révolutionnaire de Marx et de Lénine. Nous sommes confrontés à une contradiction criante : alors que le capitalisme est en crise, partout, les dirigeants des organisations de masse s’accrochent avec la dernière énergie à l’ordre établi. Comme le soulignait déjà Trotsky, en son temps : la situation politique mondiale se caractérise en premier lieu par la crise historique de la direction de la classe ouvrière.
Il est inacceptable que des dirigeants agissant au nom du socialisme, de la classe ouvrière ou même de la « démocratie », soutiennent – ou réalisent – des « sauvetages » de banques privées qui, dans les faits, signifient un accroissement massif de la dette publique qui sera financée par des années de coupes budgétaires et d’austérité. Ils le font au nom de « l’intérêt général » – alors qu’il s’agit en réalité d’une mesure dans l’intérêt des riches et contre les intérêts de la majorité. Mais cette situation ne pourra pas durer éternellement.
Il n’y a pas d’alternative, pour la classe ouvrière, en dehors de ses grandes organisations politiques et syndicales. Dans les conditions de crise du capitalisme, les organisations de masses seront secouées de haut en bas. Leurs dirigeants droitiers subiront la pression de la base – à commencer par les syndicats. Soit ils commenceront à refléter cette pression, soit ils seront poussés vers la sortie et remplacés par des gens plus en phase avec les aspirations des travailleurs. Notre tâche est d’enraciner les idées du marxisme dans le mouvement ouvrier, et de gagner la classe ouvrière aux idées du socialisme scientifique. Il y a 160 ans, dans le Manifeste du Parti Communiste, Marx et Engels proclamaient :
« Quelle est la position des communistes par rapport à l’ensemble des prolétaires ?
Les communistes ne forment pas un parti distinct opposé aux autres partis ouvriers.
Ils n’ont pas d’intérêts qui les séparent de l’ensemble du prolétariat.
Ils n’établissent pas de principes particuliers sur lesquels ils voudraient modeler le mouvement ouvrier.
Les communistes ne se distinguent des autres partis ouvriers que sur deux points :
1. Dans les différentes luttes nationales des prolétaires, ils mettent en avant et font valoir les intérêts indépendants de la nationalité et communs à tout le prolétariat.
2. Dans les différentes phases que traverse la lutte entre prolétaires et bourgeois, ils représentent toujours les intérêts du mouvement dans sa totalité.
Pratiquement, les communistes sont donc la fraction la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays, la fraction qui stimule toutes les autres ; théoriquement, ils ont sur le reste du prolétariat l’avantage d’une intelligence claire des conditions, de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien. »
Les marxistes comprennent le rôle des organisations de masse. Nous ne confondons pas les dirigeants avec la masse des travailleurs qui les soutiennent. Un abîme sépare les dirigeants opportunistes et carriéristes de la classe qui vote pour eux. Le développement de la crise dévoilera cet abîme et l’aggravera jusqu’au point de rupture. Ceci dit, la classe ouvrière s’accroche à ses organisations traditionnelles, malgré la politique de ses dirigeants – parce qu’il n’y a pas d’alternative. La classe ouvrière ne comprendra pas l’utilité des petites organisations. Toutes les tentatives des sectes gauchistes de construire des « partis révolutionnaires de masse » en dehors des organisations traditionnelles ont lamentablement échoué – et sont condamnées à échouer, à l’avenir.
Nous luttons contre la faillite politique des vieilles directions. Nous leur demandons de rompre avec les banquiers et les capitalistes – et de mettre en œuvre des politiques dans l’intérêt des travailleurs et des classes moyennes. En 1917, Lénine et les Bolcheviks disaient aux dirigeants mencheviks et socialistes-révolutionnaires : « Rompez avec la bourgeoisie, prenez le pouvoir ! » Mais les Mencheviks et les Socialistes-Révolutionnaires refusaient obstinément de prendre le pouvoir. Ils s’accrochaient à la bourgeoisie et, ainsi, préparaient la victoire des Bolcheviks. De la même façon, nous demandons aux partis et organisations qui reposent sur la classe ouvrière et parlent en son nom de rompre, politiquement, avec la bourgeoisie, et de lutter pour un gouvernement et un programme socialistes.
Nous donnons un soutien critique aux grands partis ouvriers contre les partis des banquiers et des capitalistes. Mais nous leur demandons de mener une politique dans l’intérêt de la classe ouvrière. Aucune mesure palliative des gouvernements et des banques centrales n’empêchera la crise de se développer et de provoquer ses dégâts sociaux. Le problème, c’est que les directions des organisations de masse des travailleurs n’ont pas de programme et de perspective pour changer fondamentalement la société. Or c’est précisément ce qui est nécessaire.
La réalité sociale détermine la conscience – et non l’inverse. En général, la classe ouvrière apprend à travers l’expérience, et l’expérience de la crise du capitalisme lui permet d’apprendre rapidement. Nous apprendrons aux travailleurs à tirer les conclusions nécessaires, non par des dénonciations hystériques, mais par un travail patient et systématique pour enraciner le marxisme dans les grandes organisations des travailleurs. Les gens se posent des questions et attendent des réponses. La tâche des marxistes, c’est de rendre consciente l’aspiration inconsciente ou semi-consciente des travailleurs à changer la société.
Contre le sectarisme !
Vers les organisations de masse de la classe ouvrière !
Lutter pour transformer les syndicats !
Lutter pour le programme marxiste !
Aider à construire la Tendance Marxiste Internationale !
Se plaindre de l’état du monde n’est pas suffisant. Il faut agir ! Ceux qui disent : « Je ne m’intéresse pas à la politique » ne sont pas nés à la bonne époque. Aujourd’hui, il n’est pas possible d’échapper à la politique. Essayez ! Vous pouvez vous enfermer chez vous et vous cacher sous votre lit : la politique viendra frapper à votre porte. La politique affecte tous les aspects de nos vies. Le problème, c’est que beaucoup de gens identifient la politique avec les partis et les dirigeants actuels. Ils sont rebutés par le théâtre parlementaire, le carriérisme, les discours et les promesses creuses.
Les anarchistes en tirent la conclusion que nous n’avons pas besoin de parti. C’est une erreur. Si ma maison se dégrade, je n’en tire pas la conclusion qu’il me faut dormir dans la rue – mais plutôt qu’il me faut d’urgence la restaurer. De même, si je ne suis pas satisfait de la direction actuelle des syndicats et des partis de gauche, je dois lutter pour une direction alternative, avec un programme et une politique conformes aux besoins des travailleurs.
La Tendance Marxiste Internationale lutte pour le socialisme dans 40 pays des cinq continents. Nous reposons fermement sur les fondations du marxisme. Nous défendons les idées, les principes, la politique et les traditions élaborés par Marx, Engels, Lénine et Trotsky. A ce stade, notre voix est toujours faible. Longtemps, les marxistes ont dû aller contre le courant. La Tendance Marxiste Internationale a prouvé sa capacité à rester ferme dans des conditions difficiles. Et à présent, nous allons dans le sens de l’histoire. Toutes nos perspectives ont été confirmées par le cours des événements. Cela nous donne une confiance inébranlable dans les idées et les méthodes du marxisme, dans la classe ouvrière et le futur socialiste de l’humanité.
A présent, nos idées vont atteindre la masse des travailleurs dans chaque entreprise, chaque syndicat, chaque école et chaque université – à commencer par les jeunes et les travailleurs les plus avancés. Pour mener ce travail, nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de gens pour écrire des articles, vendre des journaux, collecter de l’argent, défendre nos idées dans le mouvement ouvrier. Dans la lutte pour le socialisme, aucune contribution n’est trop modeste – et tout le monde peut jouer un rôle. Vous pouvez jouer un rôle. Ne pensez pas : « Mon engagement ne changera rien ». Ensemble, si nous sommes organisés, nous pouvons profondément changer les choses.
La classe ouvrière dispose d’un énorme pouvoir. Sans la permission des travailleurs, pas une lumière ne brille, pas une roue ne tourne, pas un téléphone ne sonne. Le problème, c’est que la plupart des travailleurs ne sont pas conscients de ce pouvoir. Notre tâche est de faire en sorte qu’ils en soient conscients. Nous lutterons pour chaque réforme et chaque avancée, aussi petite soit-elle, car c’est à travers cette lutte que les travailleurs acquièrent confiance en eux-mêmes et en leur capacité à changer la société.
Partout, l’humeur des masses est en train de changer. En Amérique latine, il y a une fermentation révolutionnaire qui s’intensifiera et gagnera d’autres continents. En Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et dans d’autres pays industrialisés, la plupart des gens ne remettaient pas en cause, jusqu’alors, l’ordre social existant. Désormais, ils se posent des questions. Des idées qui n’avaient l’écoute que d’une toute petite minorité vont trouver un écho beaucoup plus large. Toutes les conditions d’une intensification sans précédent de la lutte des classes, à l’échelle mondiale, sont réunies.
Lorsque l’URSS s’est effondrée, on nous expliquait qu’il s’agissait de la fin de l’histoire. Or, l’histoire ne fait au contraire que commencer. En l’espace de 20 ans, le capitalisme a complètement révélé sa faillite. Il faut lutter pour une alternative socialiste ! Notre objectif est d’accomplir une transformation fondamentale de la société et de lutter pour le socialisme à l’échelle nationale et internationale. Nous luttons pour la plus importante des causes : l’émancipation de la classe ouvrière et l’établissement d’une forme supérieure de société humaine. C’est la seule cause valable, en ce début de XXIe siècle.
Rejoignez-nous !
Le 30 octobre 2008