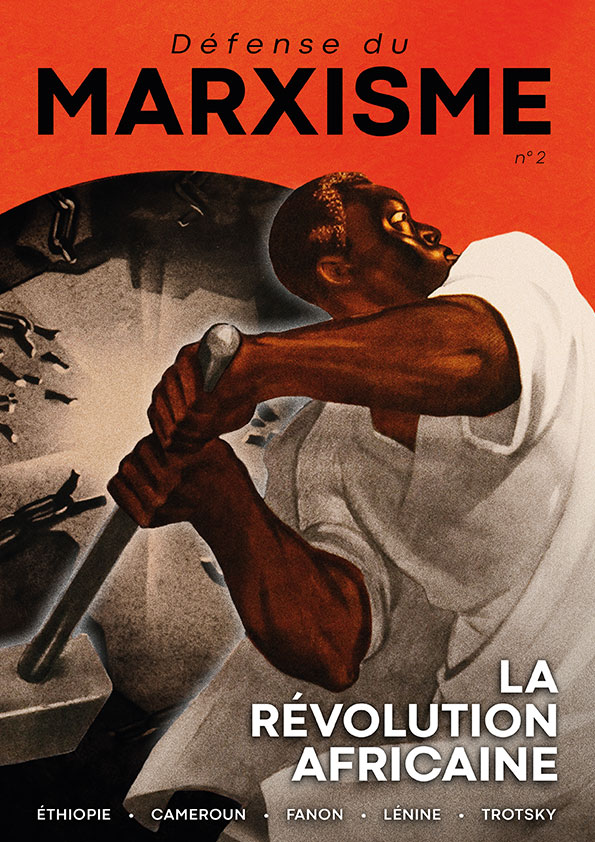Ce document a été adopté par les délégués du Congrès mondial 2021 de la Tendance Marxiste Internationale (voir compte-rendu). Il fournit notre analyse générale des principaux processus qui se déroulent dans la politique mondiale, à une époque marquée par une crise et une agitation sans précédent. Avec de la dynamite dans les fondations de l'économie mondiale – et la pandémie de COVID-19 qui jette encore son ombre sur la situation mondiale –, tous les chemins mènent à une intensification de la lutte des classes.
« Tout bien considéré, la crise a pénétré en profondeur, telle une bonne vieille taupe. »
(Marx à Engels, 22 février 1858)
La nature des perspectives
Le présent document, qui doit être lu conjointement avec celui que nous avons proposé en septembre 2020, sera quelque peu différent des perspectives mondiales que nous avons publiées par le passé.
Dans les périodes précédentes, alors que les événements se déroulaient à un rythme plus calme, il était possible de traiter de nombreux pays différents, au moins dans les grandes lignes. Néanmoins, aujourd’hui, le rythme des événements s’est accéléré au point qu’il nous faudrait un livre entier pour tout aborder. L’objectif des perspectives n’est pas de produire un catalogue d’événements révolutionnaires, mais de découvrir les processus fondamentaux sous-jacents.
Comme l’a expliqué Hegel dans l’Introduction à la Philosophie de l’Histoire : « C’est en fait, le désir d’une connaissance rationnelle, et non l’ambition d’accumuler un simple tas d’acquisitions, qui doit être présupposé dans tous les cas comme animant l’esprit de l’élève dans l’étude de la science. »
Nous traitons ici de processus généraux et nous ne pouvons nous intéresser qu’à quelques pays qui permettent d’illustrer le plus clairement possible ces processus au stade actuel. Bien entendu, les autres pays seront traités dans des articles séparés.
Des événements dramatiques
L’année 2021 a débuté par des événements dramatiques. La crise du capitalisme mondial crée des remous qui se propagent d’un pays et d’un continent à l’autre. De tous côtés, on retrouve le même tableau de chaos, de bouleversement économique et de polarisation des classes.
La nouvelle année avait à peine débuté qu’une foule d’extrême droite prenait d’assaut le Capitole à Washington à l’appel de l’ancien président américain, Donald Trump – donnant au centre de gravité de l’impérialisme occidental l’image d’un Etat en faillite.
Ces événements, conjugués aux manifestations bien plus grandes du mouvement Black Lives Matter l’été dernier, révèlent à quel point la polarisation de la société américaine est profonde.
En plus de cela, de grandes manifestations en Inde et en Russie ont mis à nu le même processus : la colère des masses grandit et la classe dirigeante n’arrive plus à gouverner comme elle le faisait auparavant.
Une crise mondiale sans précédent
Ces perspectives mondiales ne ressemblent à aucune autre que nous ayons traitée auparavant. Elles sont rendues particulièrement complexes par la pandémie qui plane comme un nuage noir sur l’ensemble du monde, condamnant des millions de personnes à la misère, la souffrance et la mort.
La pandémie continue à échapper à tout contrôle. Au moment où nous écrivons ces lignes, il y a eu plus de 100 millions de cas dans le monde et près de trois millions de décès. Ces chiffres sont sans précédent, si l’on excepte les guerres mondiales. Et ils continuent d’augmenter inexorablement.
Ce terrible fléau a eu des effets dévastateurs dans les pays pauvres autour du monde et il a aussi sérieusement touché certains des pays les plus riches.
Aux Etats-Unis, il y a 30 millions de cas, et le nombre de décès a dépassé le demi-million. Et la Grande-Bretagne est l’un des pays où le nombre de décès par habitant est le plus élevé : plus de 4 millions de cas, et bien plus de 100 000 décès.
La crise actuelle est donc différente d’une crise économique ordinaire. Il s’agit littéralement d’une situation de vie ou de mort pour des millions de personnes. Beaucoup de ces décès auraient pu être évités si des mesures appropriées avaient été prises à temps.
Le capitalisme ne peut pas résoudre le problème
Le capitalisme ne peut pas résoudre le problème : il est lui-même le problème.
Cette pandémie permet de révéler les intolérables divisions entre riches et pauvres. Elle a révélé les fractures profondes qui divisent la société. La ligne de démarcation entre ceux qui sont condamnés à tomber malades et à mourir, et ceux qui ne le sont pas.
Elle a mis à nu le gaspillage du capitalisme, son chaos et son inefficacité, et prépare la lutte des classes dans tous les pays du monde.
Les politiciens bourgeois aiment utiliser des métaphores militaires pour décrire la situation actuelle. Ils déclarent que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, ce terrible virus. Ils en concluent que toutes les classes et tous les partis doivent s’unir derrière le gouvernement en place. Mais un fossé béant sépare les paroles des actes.
La nécessité d’une économie planifiée et d’une planification internationale est incontestable. La crise est mondiale. Le virus ne respecte ni les frontières ni les contrôles douaniers. La situation exige une réponse internationale, la mise en commun de toutes les connaissances scientifiques et la mobilisation de toutes les ressources de la planète pour coordonner un véritable plan d’action mondial.
 Au lieu de cela, nous assistons au spectacle pathétique de la querelle entre la Grande-Bretagne et L’UE pour de rares vaccins, alors que certains des pays les plus pauvres se voient refuser l’accès à tout vaccin.
Au lieu de cela, nous assistons au spectacle pathétique de la querelle entre la Grande-Bretagne et L’UE pour de rares vaccins, alors que certains des pays les plus pauvres se voient refuser l’accès à tout vaccin.
Mais pourquoi y a-t-il une pénurie de vaccins ? Les problèmes de la production des vaccins – pour ne citer qu’un exemple – sont le reflet de la contradiction entre les besoins urgents de la société et les mécanismes de l’économie de marché.
Si nous étions réellement en guerre contre le virus, les gouvernements mobiliseraient toutes leurs ressources sur cette seule tâche. La politique la plus rationnelle et cohérente serait tout simplement d’accroître la production de vaccins aussi vite que possible.
Les capacités de production doivent être renforcées, ce qui ne peut se faire qu’en créant de nouvelles usines. Mais les grands fabricants privés de vaccins n’ont aucun intérêt à augmenter massivement la production, car cela nuirait à leur situation financière.
Si ces fabricants développaient leurs infrastructures de façon à pouvoir approvisionner le monde entier en six mois, ces installations nouvellement construites deviendraient inutiles dès que cela serait fait. Leurs bénéfices seraient alors beaucoup plus faibles que dans la situation actuelle, où les usines existantes produiront à pleine capacité pendant encore des années.
Un autre obstacle à la production massive et imminente du vaccin est le refus des grandes entreprises pharmaceutiques de renoncer aux droits de propriété intellectuelle sur « leurs » vaccins (qui, dans la majorité des cas, ont été développés grâce à des financements publics colossaux) afin que d’autres entreprises puissent les produire à moindre coût.
Les entreprises pharmaceutiques font des dizaines de milliards de bénéfices, mais les problèmes de production et d’approvisionnement entraînent partout des pénuries. Pendant ce temps, des millions de vies se retrouvent en danger.
La vie des travailleurs en danger
Dans leur empressement à relancer la production (et donc les profits), les politiciens et les capitalistes ont recours à des solutions expéditives. Les travailleurs sont renvoyés sans protection adéquate sur des lieux de travail surpeuplés. Cela équivaut à condamner à mort un nombre considérable de ces travailleurs et de leurs proches.
Tous les espoirs des politiciens bourgeois reposaient sur les nouveaux vaccins. Mais le déploiement des vaccins a été bâclé, et l’incapacité à contrôler la propagation du virus – qui augmente le risque de développement de nouvelles souches résistantes aux vaccins – a de graves implications, non seulement pour la santé et les vies humaines, mais aussi pour l’économie.
La crise économique
Selon la Banque d’Angleterre, la crise économique actuelle est la plus grave depuis 300 ans. En 2020, l’équivalent de 255 millions d’emplois ont été perdus dans le monde, soit quatre fois plus qu’en 2009.
Les économies soi-disant émergentes sont entraînées dans la chute avec le reste. L’Inde, le Brésil, la Russie, la Turquie sont tous en crise. L’économie sud-coréenne a reculé l’an dernier pour la première fois en 22 ans. Et ce, malgré des subventions publiques d’une valeur d’environ 283 milliards de dollars. En Afrique du Sud, le chômage a atteint 32,5 % et le PIB s’est effondré de 7,2 % en 2020. Il s’agit d’une baisse plus importante qu’en 1931, lors de la Grande Dépression, et ce malgré des dépenses équivalentes à 10 % du PIB dans le cadre d’un plan de relance budgétaire.
La crise plonge des millions de personnes dans une pauvreté toujours plus grande. En janvier 2021, la Banque mondiale a estimé que 90 millions de personnes vont basculer dans l’extrême pauvreté. Le 26 septembre 2020, The Economist écrit : « Les Nations unies sont encore plus pessimistes. Elles considèrent les gens comme pauvres s’ils n’ont pas accès à des commodités telles que l’eau potable, l’électricité, une alimentation suffisante et des écoles pour leurs enfants ».
« En collaboration avec des chercheurs de l’université d’Oxford, elles estiment que la pandémie pourrait plonger 490 millions de personnes dans la pauvreté dans 70 pays, effaçant ainsi près d’une décennie de progrès ».
Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations-Unis l’a formulé en ces termes : « Dans les 79 pays où le PAM a une présence opérationnelle et où des données sont accessibles, on estime que jusqu’à 270 millions de personnes seront en situation d’insécurité alimentaire aiguë ou à haut risque en 2021, soit une augmentation sans précédent de 82 % par rapport aux niveaux pré-pandémiques. »
 Ce seul chiffre donne une idée de l’ampleur mondiale de la crise.
Ce seul chiffre donne une idée de l’ampleur mondiale de la crise.
Outre les effets de la pandémie, la crise écologique mondiale risque d’aggraver cette situation, en alimentant la pauvreté et l’insécurité alimentaire. L’exploitation capitaliste de l’environnement menace de mener les principaux systèmes écologiques au bord de l’effondrement. Nous avons assisté à une augmentation des conflits liés à la rareté des ressources en eau et à la destruction de l’environnement, qui conduiront inévitablement à l’instabilité sociale et à des migrations climatiques massives.
L’instabilité générale dans le monde est organiquement liée à la pauvreté croissante. Elle est à la fois cause et effet. C’est la cause sous-jacente la plus élémentaire de bon nombre des guerres et des guerres civiles qui ont lieu. L’Ethiopie n’en est qu’un des exemples.
L’Ethiopie était présentée comme un modèle. Entre 2004 et 2014, son économie était en croissance de 11 % par an, et elle était considérée comme un pays où on pouvait investir. Aujourd’hui, il a été plongé dans le chaos avec l’éruption du conflit dans la province du Tigré, où 3 millions de personnes aujourd’hui ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence.
Il ne s’agit pas d’un cas isolé. La liste des pays touchés par les guerres au cours de la période passée est très longue, et le bilan des souffrances humaines est effroyable :
Afghanistan : deux millions de morts ; Yémen : 100 000 morts ; la guerre de la drogue au Mexique a fait plus de 250 000 morts ; la guerre contre les Kurdes en Turquie, 45 000 morts ; la Somalie, 500 000 morts ; l’Irak, au moins un million de morts ; le Sud-Soudan, environ 400 000 morts.
En Syrie, les Nations Unies ont estimé le nombre de morts à 400 000, mais cela semble trop faible. Le chiffre réel ne sera peut-être jamais connu, mais il est certain qu’il est d’au moins 600 000. Dans les terribles guerres civiles du Congo, plus de quatre millions de personnes ont probablement péri. Mais là encore, personne ne connaît le chiffre réel. Plus récemment, nous avons eu la guerre du Haut-Karabakh.
Et la liste continue encore et encore. De telles choses ne font plus la « une » des journaux. Mais elles expriment très clairement ce que Lénine disait : le capitalisme, c’est l’horreur sans fin. Le maintien du capitalisme menace de pousser un pays après l’autre dans de conditions barbares.
Une crise du régime
D’un point de vue marxiste, l’étude de l’économie n’est pas une question académique abstraite. Elle a des répercussions profondes sur le développement de la conscience de toutes les classes.
Où que nous regardions aujourd’hui, il y a une crise. Et pas seulement une crise économique, mais une crise du régime. Il y a des signes clairs que la crise est tellement grave et violente que la classe dirigeante perd le contrôle des moyens traditionnels qu’elle utilisait auparavant pour diriger la société.
Par conséquent, la classe dirigeante se retrouve de plus en plus incapable de contrôler les événements. C’est particulièrement clair dans le cas des Etats-Unis. Mais cela s’applique également à de nombreux autres pays. Il suffit de citer les noms de Trump, Boris Johnson et Bolsonaro pour se le rappeler.
Etats-Unis
Les Etats-Unis occupent à présent une place centrale dans nos perspectives mondiales. Pendant très longtemps, une révolution dans le pays le plus puissant et le plus riche du monde a semblé n’être qu’une perspective très lointaine, mais les Etats-Unis ont été frappés de plein fouet par la crise économique mondiale et tout s’en est trouvé bouleversé.
68 millions d’Américains se sont inscrits au chômage durant la pandémie, et comme toujours ce sont les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont les plus touchés. Les jeunes sont les plus touchés par le fléau de chômage : un quart des moins de 25 ans ont perdu leur emploi. Leur avenir leur a été arraché soudainement. Le rêve américain est devenu un cauchemar.
Ce changement brutal a amené de nombreuses personnes à remettre en question des idées qu’elles voyaient autrefois comme inébranlables, et à interroger la nature même de la société dans laquelle elles vivent. L’ascension rapide de Bernie Sanders d’un côté de l’échiquier politique et de Donald Trump de l’autre a tiré la sonnette d’alarme pour la classe dirigeante : ces choses-là n’étaient pas censées arriver !
Confrontée au danger inhérent à cette situation, la classe dirigeante a été forcée de prendre des mesures d’urgence. Souvenons-nous bien que, selon le dogme officiel des économistes bourgeois, l’Etat n’était pas supposé jouer un quelconque rôle dans l’économie.
Mais face au désastre qui se menaçait, la classe bourgeoise a été forcée d’abandonner toutes les théories économiques dominantes : alors que l’Etat était censé jouer un rôle économique faible, voire nul selon les théories libérales, il est à présent la seule chose qui maintienne le système capitaliste sur pieds.
Dans tous les pays, à commencer par les Etats-Unis, la soi-disant économie de marché est en réalité maintenue sous oxygène, à l’image d’un patient atteint du COVID-19. La plus grande partie de l’argent distribué par l’Etat est allée directement garnir les poches des riches, mais la classe dirigeante craignait les conséquences d’un énième renflouage des grandes entreprises. Ils ont par conséquent remis une allocation à chaque personne résidant dans le pays et ont massivement augmenté les aides pour les chômeurs, ce qui a quelque peu allégé l’impact de la crise pour les sections les plus pauvres de la société. Tôt ou tard, ces allocations seront réduites ou supprimées purement et simplement.
Dans le pays le plus riche du monde, la pire des pauvretés côtoie la richesse et le luxe les plus indécents. En octobre 2020, plus d’un foyer américain sur cinq se trouvait en situation d’insécurité alimentaire. Les banques alimentaires prolifèrent.
Inégalité et polarisation
Les niveaux d’inégalité ont battu tous les records. Le fossé qui sépare les riches des pauvres est devenu un infranchissable abîme. En 2020, la fortune des milliardaires a augmenté de 3 900 milliards de dollars. L’indice Nasdaq 100 est 40 % plus élevé qu’avant la pandémie. La valeur totale de toutes les actions cotées en bourse au niveau mondial a augmenté de 24 000 milliards de dollars entre mars 2020 et février 2021.
Le salaire moyen du PDG d’une entreprise cotée au S&P 500 est 357 fois supérieur à celui d’un travailleur non-cadre moyen. Ce rapport était de 20 au milieu des années 1960 et de 28 seulement à la fin de la présidence de Ronald Reagan, en 1989.
Pour ne citer qu’un seul exemple, Jeff Bezos gagne à présent plus d’argent chaque seconde que le travailleur américain moyen n’en gagne en une semaine. L’Amérique est revenue au temps des barons voleurs capitalistes que Théodore Roosevelt dénonçait avant la Première Guerre mondiale.
Et ceci n’est pas sans effet. Toute la démagogie à base « d’intérêt national », des phrases comme « nous devons faire preuve d’unité contre le virus » ou de « nous sommes tous dans le même bateau » apparaît comme de la pure hypocrisie.
Les masses sont prêtes à faire des sacrifices dans certaines circonstances. En temps de guerre, il est vrai que les gens sont prêts à s’unir pour combattre un ennemi commun. Ils sont prêts à accepter, au moins temporairement, un recul de leur qualité de vie, ainsi que, dans une certaine mesure, des restrictions sur leurs droits démocratiques.
Mais le gouffre qui sépare ceux qui ont tout de ceux qui n’ont rien exacerbe la polarisation sociale et politique, et fait flotter une atmosphère explosive dans la société. Cela fragilise tous les efforts mis en œuvre pour créer une impression d’unité et de solidarité nationale, alors qu’il s’agit de la principale ligne de défense de la classe dirigeante.
Les statistiques de la Réserve Fédérale montrent que les 10 % les plus riches aux Etats-Unis possédaient près de 80 700 milliards de dollars à la fin de l’année 2020. Cela équivaut à 375 % du PIB du pays, un niveau jamais atteint jusque-là.
Une taxe d’une valeur de 5 % sur cette fortune rapporterait 4 000 milliards de dollars, soit un cinquième du PIB des Etats-Unis. Cela couvrirait tous les coûts liés à la pandémie. Pourtant, ces riches barons voleurs n’ont aucunement l’intention de partager leur butin. La plupart d’entre eux (Donald Trump compris) affirment ouvertement leur réticence à payer des impôts quels qu’ils soient, sans même aller jusqu’à 5 %.
La seule solution serait l’expropriation des banquiers et des capitalistes. Cette idée va inévitablement devenir de plus en plus populaire, balayant les restes des préjugés sur le socialisme et le communisme, et ce même au sein des couches de la classe ouvrière qui ont été bernées par la démagogie de Trump.
Cette polarisation cause déjà des angoisses chez les stratèges sérieux de la classe capitaliste : Mary Callaghan Erdoes, responsable de la gestion d’actifs et de patrimoines pour JP Morgan, en arrive à l’inévitable conclusion : « tout cela va générer de très hauts risques d’extrémisme. Nous devons trouver une façon de nous adapter, sinon nous nous retrouverons dans une position très dangereuse ».
L’attaque du Capitole
L’attaque du Capitole le 6 janvier est un signe flagrant que les Etats-Unis sont confrontés non pas seulement à une crise de gouvernement, mais à une crise du régime lui-même.
Ces événements n’étaient ni un coup d’Etat ni une insurrection, mais ils ont mis en pleine lumière la vive colère qui existe dans les profondeurs de la société ainsi que l’émergence de graves divisions dans l’appareil de l’Etat. Au final, ces événements montrent que la polarisation de la société a atteint un point critique. Les institutions de la démocratie bourgeoise sont soumises à des pressions destructrices.
 Il y a une profonde haine des riches et des puissants, des banquiers, de Wall Street et de l’establishment de Washington en général (« le marécage »). Cette haine a été adroitement détournée par le démagogue réactionnaire Donald Trump.
Il y a une profonde haine des riches et des puissants, des banquiers, de Wall Street et de l’establishment de Washington en général (« le marécage »). Cette haine a été adroitement détournée par le démagogue réactionnaire Donald Trump.
Bien sûr, Trump n’est pas le plus malin et le plus vorace des alligators qui peuplent le « marécage ». Il ne poursuit que ses propres intérêts. Ce faisant, il a néanmoins sérieusement porté atteinte aux intérêts de la classe dirigeante dans son ensemble. Il a joué avec le feu et mobilisé des forces que ni lui ni personne n’est capable de contrôler.
En paroles et en actes, Trump était en train de détruire la légitimité des institutions bourgeoises et de créer une énorme instabilité. C’est pour cette raison que la classe dirigeante et les dirigeants politiques sont partout horrifiés par son comportement.
L’impeachment
Les Démocrates ont tenté d’obtenir l’impeachment de Trump et l’ont accusé d’avoir organisé une insurrection. Sans surprise, ils ont échoué à convaincre le Sénat de le reconnaître coupable, ce qui l’aurait empêché de se présenter à des élections à l’avenir.
La plupart des sénateurs Républicains auraient été ravis de le faire. Ils détestent ce parvenu politique autant qu’ils le craignent, et tous savent pertinemment qui a orchestré les événements du 6 janvier. Mitch McConnell, le chef de la majorité Républicaine du Sénat, a prononcé un jugement accablant sur l’ex-président, après avoir voté pour son acquittement.
En réalité, lui et les autres sénateurs Républicains étaient terrifiés de la réaction qu’auraient les enragés partisans de Trump s’ils se résolvaient à ce choix fatidique. Ils se sont donc ralliés à l’adage « prudence est mère de sûreté » et ont voté « non coupable » en se bouchant le nez.
S’il s’agissait d’une tentative d’insurrection, elle était bien médiocre. Plus qu’une insurrection, cela ressemblait davantage à une émeute à grande échelle. La foule enragée des partisans de Trump a forcé les portes du Capitole avec la complicité évidente d’au moins certains des gardes. Une fois en possession du Saint des Saints de la démocratie bourgeoise américaine, ils n’avaient néanmoins pas la moindre idée de ce qu’il leur fallait en faire.
La foule désorganisée et laissée pour compte a déambulé au hasard, en saccageant tout ce qui ne lui plaisait pas et en proférant de virulentes menaces contre la Démocrate Nancy Pelosi, le vice-président Républicain Mike Pence et Mitch McConnell, qu’ils accusaient d’avoir trahi Trump. Pendant ce temps, le « Commandant-en-Chef » des insurgés s’était eclipsé.
Si l’histoire se répète, d’abord comme sous la forme d’une tragédie puis comme une farce, il s’agissait là d’une farce de première catégorie. Au final, personne n’a été pendu ou envoyé à la guillotine. Fatigués d’avoir tant crié, les « insurgé » sont tranquillement rentrés chez eux ou se sont repliés au bar le plus proche pour se saouler et se vanter de leurs courageux exploits, ne laissant derrière eux rien de plus menaçant que des piles de déchets et quelques égos froissés.
Néanmoins, du point de vue de la classe dirigeante, ceci posait un précédent dangereux pour l’avenir. Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater Associates, le plus grand fonds spéculatif au monde, s’est fendu du commentaire suivant : « nous sommes au bord d’une terrible guerre civile. L’Amérique est à un tournant à partir duquel elle pourrait basculer d’une tension interne acceptable à une révolution. » L’attaque du Capitole a été un sérieux avertissement pour la classe dirigeante. Et elle aura sans aucun doute des conséquences. Malgré un bombardement d’hostilité médiatique, 45 % des membres du parti Républicain l’ont trouvé justifiée.
Il faut cependant comparer ces chiffres avec le fait bien plus significatif que 54 % de tous les Américains ont approuvé l’incendie du commissariat de police de Minneapolis, et que près de 10 % de la population américaine a participé aux manifestations Black Lives Matter, soit 20 000 fois plus que ceux qui ont pris d’assaut le Capitole. Tout cela montre la rapide croissance de la polarisation sociale politique aux Etats-Unis.
Les soulèvements spontanés qui ont balayé le pays d’un océan à l’autre après le meurtre de George Floyd, ainsi que les événements sans précédent qui se sont déroulés autour des élections présidentielles ont marqué un tournant dans la situation.
Changements dans les consciences
Les libéraux et les réformistes stupides n’ont évidemment rien compris de ce qu’il se passait. Ils ne sont capables que de voir l’extérieur des événements, sans comprendre les puissants courants qui coulent en profondeur et qui génèrent les vagues visibles à la surface.
Ils crient sans cesse au fascisme, ce qui, pour eux, désigne tout ce qui leur déplaît ou les effraie. Il va sans dire qu’ils ne savent absolument rien de la véritable nature du fascisme. En répétant sans discontinuer leurs slogans sur « les menaces contre la démocratie » (qui se limite pour eux au formalisme de la démocratie bourgeoise), ils sèment la confusion et préparent le terrain pour la collaboration de classe sous le drapeau du « moindre mal ». Leur soutien à Joe Biden aux Etats-Unis en est la parfaite illustration.
Nous devons prendre en compte le fait que la base de Donald Trump est de nature très hétérogène et contradictoire. Il s’y trouve une aile bourgeoise, dirigée par Trump lui-même, et un grand nombre de petits-bourgeois réactionnaires, de fanatiques religieux et d’éléments ouvertement fascistes.
Il faut cependant se souvenir que Trump a reçu 74 millions de voix aux dernières élections et que nombre d’entre elles étaient celles de membres de la classe ouvrière qui avaient précédemment voté pour Obama et ont perdu leurs illusions sur les Démocrates. Lorsqu’on les interviewe, ils répondent : « Washington se fiche de nous ! Nous sommes le peuple oublié ! »
 Il y a de brusques virages vers la gauche, mais aussi vers la droite. La nature a horreur du vide, et à cause de la complète faillite des réformistes, y compris des réformistes de gauche, cette colère et de frustration est détournée par des démagogues de droite, les soi-disant « populistes ». Aux Etats-Unis, il y a eu le phénomène du « Trumpisme ». Au Brésil, nous avons assisté à l’ascension de Bolsonaro.
Il y a de brusques virages vers la gauche, mais aussi vers la droite. La nature a horreur du vide, et à cause de la complète faillite des réformistes, y compris des réformistes de gauche, cette colère et de frustration est détournée par des démagogues de droite, les soi-disant « populistes ». Aux Etats-Unis, il y a eu le phénomène du « Trumpisme ». Au Brésil, nous avons assisté à l’ascension de Bolsonaro.
L’attrait des démagogues de droite s’évapore néanmoins dès qu’il entre en contact avec les réalités du pouvoir, comme le démontre le cas de Bolsonaro. Il est vrai que Trump a gardé le soutien de millions de personnes, mais cela ne l’a pas empêché de perdre quand même.
Il est intéressant de noter qu’au moment de l’attaque du Capitole, le sénateur républicain du Missouri Josh Hawley a déclaré : « Les Républicains de Washington vont avoir beaucoup de mal à intégrer ceci… Mais l’avenir est clair : nous devons devenir un parti de la classe ouvrière, pas un parti de Wall Street. » (cité par The Guardian)
Lénine disait que l’histoire connaissait toutes sortes de transformations surprenantes. Les marxistes doivent être capables de distinguer ce qui est progressiste de ce qui est réactionnaire. Nous devons comprendre qu’avec tous ces événements, on voit se dessiner les premiers contours de futurs développements révolutionnaires aux Etats-Unis.
Évidemment, ce sénateur Républicain réactionnaire n’a aucune intention d’organiser un véritable parti de la classe ouvrière aux Etats-Unis, et ce parti n’émergera pas d’une scission de droite des républicains. Mais les convulsions du système bipartite sont sans aucun doute le signe avant-coureur de quelque chose d’entièrement nouveau : l’émergence d’un troisième parti qui s’opposera aux Républicains comme aux Démocrates.
Un tel parti sera initialement extrêmement confus et hétérogène. Tôt ou tard, l’élément anti-capitaliste finira par prédominer. C’est là que réside la véritable menace contre le système. Lorsque les masses commencent à intervenir directement dans la politique, lorsqu’elles décident qu’il est temps pour elles de prendre leur destin en main, cela est, en soi, un symptôme de l’imminence de développements révolutionnaires.
Les stratèges sérieux du Capital comprennent bien mieux les implications des turbulences actuelles que les petits-bourgeois impressionnistes et paniqués. Le 30 décembre 2020, le Financial Times a publié un article des plus intéressants, signé du comité éditorial.
Cet article donnait une vision très différente des événements et de la manière dont ils se développeraient, et ses conclusions étaient très inquiétantes d’un point de vue bourgeois :
« Les groupes abandonnés par le changement économique en viennent de plus en plus à la conclusion que les responsables politiques ne se préoccupent pas de leur situation – voire pire qu’ils ont truqué l’économie à leur profit contre les populations marginalisées.
« Lentement mais sûrement, cette situation amène le capitalisme et la démocratie à entrer en tension l’un contre l’autre. Depuis la crise financière mondiale, ce sentiment de trahison a nourri une colère politique contre la mondialisation et les institutions de la démocratie libérale.
« Le populisme de droite peut prospérer grâce à cette colère tout en laissant les marchés capitalistes en place.
« Mais comme il est incapable de tenir ses promesses envers les défavorisés économiques, ce n’est qu’une question de temps avant que les fourches ne se pointent vers le capitalisme lui-même, et vers les richesses de ceux qui en bénéficient. »
Cet article montre une compréhension parfaite des dynamiques de la lutte des classes. Le choix des mots lui-même est significatif. Les fourches suggèrent une analogie avec la Révolution française, ou avec la Révolte des paysans de 1381, au cours de laquelle les paysans se sont rendus maîtres de Londres.
Les auteurs de ces lignes comprennent parfaitement qu’une vague vers le soi-disant populisme de droite peut n’être qu’un prologue à une explosion révolutionnaire. Les basculements violents de l’opinion publique vers la droite peuvent très bien être la préparation de basculements encore plus violents vers la gauche, de la part de masses en colère et à la recherche d’une issue à la crise.
C’est là une prédiction très perspicace de la manière dont les événements se développeront dans la prochaine période, et pas seulement aux Etats-Unis. Cette volatilité extrême s’observe dans plusieurs pays. Sous la surface se développe un sentiment de colère, d’amertume et de ressentiment contre l’ordre établi.
L’effondrement du centre
Les institutions de la démocratie bourgeoise sont basées sur le postulat que le gouffre entre les riches et les pauvres pourrait être masqué et contenu dans des limites gérables. Mais ce n’est plus le cas.
La constante augmentation des inégalités de classe a créé un niveau de polarisation sociale inconnu depuis des décennies. Les mécanismes habituels de la démocratie bourgeoise sont mis à l’épreuve jusque dans leurs derniers retranchements, et même au-delà.
L’antagonisme entre riches et pauvres devient chaque jour plus intense. Cela donne une force irrésistible aux forces centrifuges qui opposent les classes. C’est précisément la raison de l’effondrement du soi-disant Centre.
Cela inquiète de plus en plus la classe dirigeante, qui voit son pouvoir lui échapper des mains. Partout, les partis du pouvoir en place sont identifiés par les masses comme les représentants de l’austérité et des attaques sur les conditions de vie.
La colère monte dans la société. Ce sentiment se ressent dans l’effritement de la confiance envers les institutions officielles, les partis, les gouvernements, les responsables politiques, les banquiers, les riches, la police, l’appareil judiciaire, les lois en vigueur, la tradition, la religion et la moralité du système en place. Les gens ne croient plus ce que leur disent les journaux et la télévision. Ils comparent l’énorme différence entre ce qui est dit et ce qui se passe réellement, et ils réalisent que ce que l’on nous sert est un tissu de mensonges.
Cela n’a pas toujours été le cas. Dans le passé, la plupart des gens ne prêtaient pas beaucoup d’attention à la politique. C’est aussi valable pour les ouvriers. Au travail, les conversations portaient plutôt sur le football, le cinéma et les programmes télé. On ne mentionnait la politique que rarement, à l’exception peut-être des périodes électorales.
Maintenant, tout cela a changé. Les masses commencent à s’intéresser à la politique, parce qu’elles se rendent comptent qu’elle affecte directement leurs vies et celles de leurs familles. Ce seul fait est en soi le signe d’une avancée vers la révolution.
Auparavant, quand les gens prenaient la peine de voter aux élections, ils le faisaient en général en suivant le même parti que leurs parents et leurs grands-parents avant eux. Maintenant, pourtant, les élections sont devenues particulièrement imprévisibles. L’état d’esprit de l’électorat est à la colère, la défiance, et sujet à des virages brutaux de la gauche vers la droite, et de la droite vers la gauche.
Les perspectives de l’Administration Biden
Les stratèges du capital reconnaissent les dangers considérables de cette polarisation, et tentent désespérément de reconstruire le « Centre ». Mais il n’y a pas de base objective pour cela. Avec Joe Biden, ils s’appuient sur une branche pourrie.
Wall Street place tous ses espoirs dans l’administration Biden et sa campagne vaccinale. Mais Biden gère actuellement une lourde crise politique et économique dans une nation divisée et en déclin.
La caste dirigeante l’incite à accroître l’intervention de l’Etat dans l’économie, et il n’a pas perdu de temps pour dévoiler son plan de relance de 1 900 milliards de dollars pour l’économie américaine. Si nous y ajoutons l’enveloppe de 900 milliards de dollars déjà avalisée par le Congrès et les 3 000 milliards de dollars d’aide accordée au début de la pandémie, c’est une montagne de dettes qui s’élève. La classe au pouvoir tente désespérément de restaurer la stabilité politique.
Kenneth Rogoff, Professeur à l’Université de Harvard l’a décrit ainsi : « je suis tout à fait favorable à ce que fait Biden… Oui, nous courons le risque d’une instabilité économique dans les années à venir, mais nous vivons en ce moment une période d’instabilité politique. » Tout cela présage une énorme crise sur le long terme.
Pendant ce temps, des millions de citoyens mécontents ne croient même pas que Biden ait gagné l’élection. Quoi qu’il fasse sera inacceptable pour eux. D’autre part, les espoirs démesurés de ses nombreux partisans fondront comme neige au soleil, une fois que la première impression de soulagement après le départ de Trump sera dissipée. Et même si un état de grâce va lui bénéficier pendant un moment, une énorme déception s’ensuivra, et ouvrira la voie à de nouveaux bouleversements, des troubles et de l’instabilité.
L’Amérique latine
L’Amérique Latine est une des régions du monde frappées le plus durement par le Covid-19, du point de vue de la santé publique comme de la crise économique.
Le PIB de la région a baissé d’à peu près 7.7 % en 2020, la chute la plus forte en 120 ans. Cela vient juste après une décennie de stagnation, avec 0.3 % de croissance annuelle moyenne entre 2014 et 2019. Il ne faut pas s’attendre à ce que la région retrouve avant 2024 son niveau de PIB antérieur à la crise. Les niveaux de pauvreté extrême sont revenus à ce qu’ils étaient en 1990.
Les troubles politiques et sociaux avaient déjà commencé avant le début de la pandémie. En Amérique du Sud, les révoltes de 2019 (Equateur, Chili) qui faisaient partie d’un processus mondial (Algérie, Soudan, Irak, Liban…) ont été provisoirement stoppées par l’éclatement de la pandémie qui a balayé le continent avec des répercussions dévastatrices.
Le Brésil a subi un nombre de décès parmi les plus élevés au monde, et le Pérou, lui aussi, a été durement touché. En Equateur, les cercueils s’empilaient devant des morgues pleines à craquer et, dans certains endroits, des corps étaient abandonnés dans les rues.
 Pourtant, au cours du deuxième semestre de 2020, on a pu noter une résurgence des mouvements insurrectionnels de masse. En septembre 2020, il y a eu en Colombie un déchaînement de colère à cause d’un meurtre commis par un policier, ce qui a provoqué l’incendie de 40 commissariats. Au Pérou, un mouvement de masses a renversé deux gouvernements. Et au Guatemala, le parlement a été incendié par des manifestations. Cela s’est poursuivi en 2021, avec des conséquences politiques importantes. En Colombie, le mouvement a ressurgi avec un puissant mouvement de grève nationale qui a réduit au minimum la base sociale de soutien au gouvernement Duque. Au Pérou, nous avons eu l’élection inattendue du syndicaliste-enseignant Pedro Castillo aux élections présidentielles. De même, au Chili, nous avons assisté à la défaite électorale de la droite et à la montée en puissance des candidats liés au soulèvement de 2019, ainsi que du PC et du Front Large (Frente Amplia), lors des élections de l’assemblée constituante, des maires et des gouverneurs régionaux.
Pourtant, au cours du deuxième semestre de 2020, on a pu noter une résurgence des mouvements insurrectionnels de masse. En septembre 2020, il y a eu en Colombie un déchaînement de colère à cause d’un meurtre commis par un policier, ce qui a provoqué l’incendie de 40 commissariats. Au Pérou, un mouvement de masses a renversé deux gouvernements. Et au Guatemala, le parlement a été incendié par des manifestations. Cela s’est poursuivi en 2021, avec des conséquences politiques importantes. En Colombie, le mouvement a ressurgi avec un puissant mouvement de grève nationale qui a réduit au minimum la base sociale de soutien au gouvernement Duque. Au Pérou, nous avons eu l’élection inattendue du syndicaliste-enseignant Pedro Castillo aux élections présidentielles. De même, au Chili, nous avons assisté à la défaite électorale de la droite et à la montée en puissance des candidats liés au soulèvement de 2019, ainsi que du PC et du Front Large (Frente Amplia), lors des élections de l’assemblée constituante, des maires et des gouverneurs régionaux.
Au Brésil, où la gauche et les groupes sectaires avaient fait beaucoup de tapage autour de la soi-disant victoire du « fascisme », le soutien à Bolsonaro s’effondre. Le slogan lancé par nos camarades brésiliens « Fora Bolsonaro » (« Bolsonaro dégage ! »), qui avait rejeté comme utopique par la gauche, est maintenant unanimement accepté.
« L’homme fort » Bolsonaro est si faible qu’il n’a même pas réussi à lancer son propre parti. Bien qu’il tente désespérément de le faire, il a pour l’instant lamentablement échoué à seulement obtenir le nombre de signatures nécessaires pour déposer sa demande.
Le problème n’est pas la force de Bolsonaro, mais la faiblesse de la gauche. Alors qu’il pouvait auparavant compter sur le soutien écrasant des travailleurs, le PT a perdu largement aux dernières élections. Là aussi, il n’est pas question de difficultés objectives, mais de la faiblesse du facteur subjectif.
Dans le même temps, Cuba est confronté à une crise économique majeure, décuplée par la pandémie et aggravée par les mesures économiques et les sanctions de Trump, dont aucune n’a été annulée par Biden. L’économie de l’île a plongé de 11 % en 2020.
Cela a poussé ses dirigeants à mettre en œuvre une série de mesures d’économie de marché capitalistes qui étaient en discussion depuis 10 ans, mais n’avaient jamais été mises en œuvre complètement, notamment l’unification des devises, la concurrence entre entreprises du secteur public, la fermeture des entreprises étatiques « non rentables », l’arrêt des subventions sur le prix des denrées alimentaires de base, etc.
Ces mesures ont déjà contribué à augmenter encore plus les inégalités et suscitent de la colère. C’est un tournant dans le processus de restauration du capitalisme.
Ces facteurs économiques constituent la base objective des manifestations du 11 juillet. Il s’agissait des plus grandes manifestations à Cuba depuis le « maleconazo » de 1994, et elles ont eu lieu à un moment de crise économique profonde et avec un gouvernement qui n’a pas la même autorité que Fidel Castro avait à l’époque.
Le mouvement avait une composante authentique de protestation contre la pénurie et les difficultés que subit la classe ouvrière. Il y avait cependant une autre composante qui répondait à une campagne constante de propagande sur les réseaux sociaux et de provocations dans les rues par des éléments ouvertement contre-révolutionnaires, qui durait depuis des mois.
Les manifestants, qui étaient environ 2000 à La Havane, étaient composés de différentes couches : des pauvres des quartiers populaires durement touchés par la crise économique et les mesures prises par la bureaucratie ; des éléments lumpen et criminels ; des éléments pro-capitalistes petits-bourgeois qui ont prospéré au cours des dix dernières années de réformes du marché ; des artistes, des intellectuels et des jeunes préoccupés par la censure et les droits démocratiques dans l’abstrait.
Il faut expliquer clairement que les manifestations ont eu lieu sous les slogans « Patrie et vie » (Patria y vida), « A bas la dictature » et « A bas le communisme », clairement de caractère contre-révolutionnaire. Les problèmes et les difficultés sont réels et authentiques ; des éléments confus y participent ; mais au milieu de toute cette confusion, ce sont les éléments contre-révolutionnaires qui dominent ces manifestations. Ceux-ci sont organisés, motivés et ont des objectifs clairs. Il est donc nécessaire de s’y opposer et de défendre la révolution. Si les promoteurs de ces manifestations, ainsi que leurs mentors à Washington, parvenaient à atteindre leur objectif – le renversement du gouvernement – cela accélérerait inévitablement le processus de restauration capitaliste et ramènerait de facto Cuba à son ancien statut de colonie de l’impérialisme américain. Les problèmes économiques et sanitaires dont souffre la classe ouvrière cubaine ne seraient pas résolus, mais au contraire, seraient aggravés. Il suffit de regarder le Brésil de Bolsonaro ou son voisin Haïti pour s’en convaincre. La défaite de la révolution cubaine aurait un impact négatif sur la conscience des travailleurs du continent et du monde entier.
Dans la lutte qui s’ouvre, la Tendance Marxiste Internationale défend inconditionnellement la révolution cubaine. Le premier point que nous devons souligner est que nous sommes totalement opposés au blocus de l’impérialisme américain et que nous faisons campagne contre celui-ci. Cependant, notre défense inconditionnelle de la révolution ne signifie pas que nous ne sommes pas critiques. Nous devons expliquer clairement que les méthodes de la bureaucratie sont dans une large mesure responsables de la situation actuelle. La planification bureaucratique conduit à la mauvaise gestion, à l’inefficacité, au gaspillage et à l’indolence. L’imposition et l’arbitraire bureaucratiques conduisent à l’aliénation de la jeunesse. Les mesures pro-capitalistes conduisent à la différenciation sociale et à la pauvreté.
Une remise en question généralisée de la direction est apparue parmi de nombreux travailleurs et jeunes qui se considèrent comme des révolutionnaires. Nous devons expliquer que la seule façon efficace de défendre la révolution est de mettre la classe ouvrière aux commandes. Notre modèle devrait être la démocratie ouvrière de la Commune de Paris et L’Etat et la Révolution de Lénine. Nous sommes en faveur de la discussion politique la plus large et la plus libre entre révolutionnaires. Les médias d’Etat doivent être ouverts à toutes les nuances de l’opinion révolutionnaire. Dans tous les lieux de travail, les travailleurs eux-mêmes devraient avoir les pleins pouvoirs pour réorganiser la production afin de la rendre plus efficace. En outre, les privilèges de la bureaucratie (magasins spéciaux, accès préférentiel aux produits de base) doivent être abolis. Tous les fonctionnaires de l’Etat doivent être élus et révocables à tout moment.
Le sort de la révolution cubaine sera finalement décidé dans la sphère de la lutte des classes internationale. Les révolutionnaires cubains doivent adopter une position révolutionnaire socialiste internationaliste, par opposition à une position basée sur la géopolitique et la diplomatie. Nous défendons la démocratie ouvrière et le socialisme international.
Les événements révolutionnaires et insurrectionnels qui ont eu lieu dans différents pays d’Amérique latine et l’arrivée au pouvoir de dirigeants « progressistes » avec le soutien des travailleurs et des paysans (AMLO au Mexique, Arce en Bolivie, Castillo au Pérou, etc.) servent de réfutation à tous ceux (y compris les sectaires) qui prétendaient qu’il y avait une « vague conservatrice » en Amérique latine. Le capitalisme y est beaucoup plus faible que dans les pays capitalistes avancés, les effets de la pandémie ont été dévastateurs en termes sanitaires et économiques, et les masses gagnent en force dans les luttes impressionnantes auxquelles nous avons récemment assisté. Pour toutes ces raisons, l’Amérique latine est très probablement l’une des scènes des prochains événements révolutionnaires.
L’Europe
Le PIB réel a chuté de 7 % dans les Etats membres de l’UE en 2020. C’est la baisse la plus forte en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les chiffres officiels montrent que 13,2 millions de personnes sont sans emploi, mais même en laissant de côté les mesures de chômage partiel, le chiffre du chômage est plus proche de 12,6 % (à peu près 20 millions). Et 30 millions supplémentaires sont absents des chiffres officiels et considérés comme du « chômage dissimulé ».
La Commission Européenne a bâclé la distribution de vaccins pour le Covid-19, ce qui a eu pour conséquence de générer des pénuries importantes dans l’ensemble de l’Europe. Au départ, le Danemark n’en a reçu que 40 000 alors qu’ils en attendaient 300 000. Au début, les Pays-Bas n’ont quant à eux rien reçu du tout.
L’échec de l’approvisionnement en vaccins fait suite au fiasco des masques l’an dernier. Alors que l’Italie faisait face au pire de sa crise, la solidarité européenne a été entièrement oubliée. Cela a été le règne du chacun pour soi. Le programme vaccinal était une tentative de refonder l’Union Européenne, mais il a echoué.
Pour aggraver encore davantage la situation, l’intensification des mesures restrictives (confinements, etc.), qui visent à maîtriser la pandémie du coronavirus dans 21 pays de la zone euro, a considérablement réduit l’activité économique, à tel point que la zone a été confronté à une récession à double creux.
Alors qu’au printemps dernier, au moment où la pandémie frappait pour la première fois, l’économie de la zone euro avait été confrontée à un choc profond et soudain, la recrudescence des contaminations traîne maintenant en longueur, et cause un déclin plus lent, mais encore plus invalidant de l’économie.
Les secteurs du voyage, du commerce de détail et de l’hôtellerie, la confiance des entreprises et les dépenses de consommation ont tous été touchés pendant les premières semaines de 2021. Cela menace d’entraîner une vague de faillites à retardement, à moins que les gouvernements et les banques centrales ne continuent de renflouer l’économie par des mesures de soutien.
Partant de là, les économistes anticipent que la baisse de la production dans l’Eurozone d’entre 1,8 % et 2,3 % au cours des trois derniers mois de 2020 sera suivie d’une autre chute pendant le premier trimestre de 2021 dans de nombreuses économies importantes du bloc, notamment l’Allemagne et l’Italie. La zone euro subirait alors une seconde récession, définie comme deux trimestres consécutifs de croissance négative en moins de deux ans.
Après le Brexit et Trump, qui n’a jamais pris la peine de cacher son mépris pour tout ce qui concerne l’Europe, la bourgeoisie européenne a l’impression qu’elle ne peut plus compter sur ses alliés historiques. La tentative ridicule d’Emmanuel Macron de s’attirer les bonnes grâces de Trump s’est avérée un échec monumental.
Trump a été tout à fait clair en décrivant l’Europe comme un ennemi majeur, alors que la Russie n’était qu’une « rivale ». Il a traduit ses paroles en actes. Ses mesures protectionnistes ont été dirigées contre l’Europe autant que contre la Chine. Et il a gardé cette attitude offensive jusqu’aux derniers jours de son mandat. La veille du 1er janvier, les Etats-Unis ont annoncé une nouvelle hausse des tarifs douaniers sur les pièces détachées d’avion et les vins importés de France et d’Allemagne.
Biden a l’intention de renouer des liens avec l’Europe. Il a réengagé les Etats-Unis dans le multilatéralisme, y compris le retour au sein de l’OMS et de l’accord de Paris sur le climat. Il a aussi soutenu la nomination de la nouvelle Directrice Générale à l’OMC. Son attitude vis-à-vis de l’accord sur le nucléaire iranien est aussi différente. Tout ceci constitue des avancées bienvenues pour les Européens, qui ont absolument besoin que la Maison-Blanche change de cap. Trump nomme cette nouvelle stratégie « l’Amérique en dernier ».
Pourtant, certains conflits entre les deux parties sont beaucoup plus difficiles à résoudre. Les Européens ne sont pas convaincus de la stratégie des Etats-Unis concernant la Chine. De plus, ils espèrent aussi se servir de la guerre commerciale que les Etats-Unis mènent contre la Chine à leur profit. Le nouveau Traité bilatéral d’Investissement conclu entre la Chine et l’UE au cours des dernières semaines de la présidence de Trump a été largement reconnu comme un affront fait à Joe Biden, que le nouveau président a été obligé de digérer.
Il y a d’autres différends de longue date à résoudre : la discorde entre Airbus et Boeing sur les aides d’Etat traine depuis des décennies sans solution en vue. Le gazoduc Nord Stream 2 constitue aussi une énorme brèche entre l’Allemagne et les Etats-Unis, ceux-ci affirmant que ce gazoduc va renforcer l’influence russe en Europe. La toute nouvelle amitié entre Biden et les Européens sera mise à l’épreuve dans les mois à venir, au moment où les deux blocs tenteront de relancer leurs exportations dans le contexte d’après pandémie.
L’Allemagne a servi de point d’ancrage à l’Europe, un îlot de stabilité dans un océan souvent orageux. Angela Merkel incarnait le sérieux placé aux commandes du pays le plus important d’Europe. Mais avec la pandémie, de nouveaux problèmes sont apparus.
L’Europe connaissait déjà des tensions croissantes entre les Etats membres après la crise de 2008. Le Brexit a été un tournant dans cette dynamique, tout comme la crise pandémique et le nationalisme qui ont prévalu dans la gestion de la crise sanitaire. La profonde crise mondiale exercera une énorme pression dans ce sens : l’UE doit rivaliser avec les autres blocs impérialistes tandis que, dans le même temps, les différentes nations qui la composent rivaliseront entre elles pour exporter leurs propres crises.
 Les capitalistes allemands ont compris qu’ils devaient changer de méthodes pour mettre fin aux tendances centrifuges au sein de l’UE. Cette tendance a été encore renforcée lorsque la pandémie est survenue. L’automne dernier, l’Allemagne a été contrainte de consentir à un prêt de 750 milliards d’euros pour le Fonds de Relance européen, afin de maintenir l’unité de l’UE. Cette somme substantielle va apporter un répit temporaire à l’Union, mais ce n’est qu’un subside à usage unique. Des appels à poursuivre dans cette direction ont été repoussés par l’Allemagne. Au final, aucun des problèmes posés n’a été résolu.
Les capitalistes allemands ont compris qu’ils devaient changer de méthodes pour mettre fin aux tendances centrifuges au sein de l’UE. Cette tendance a été encore renforcée lorsque la pandémie est survenue. L’automne dernier, l’Allemagne a été contrainte de consentir à un prêt de 750 milliards d’euros pour le Fonds de Relance européen, afin de maintenir l’unité de l’UE. Cette somme substantielle va apporter un répit temporaire à l’Union, mais ce n’est qu’un subside à usage unique. Des appels à poursuivre dans cette direction ont été repoussés par l’Allemagne. Au final, aucun des problèmes posés n’a été résolu.
Merkel a dû prolonger le confinement en Allemagne. Sa coalition se divise sur les chiffres médiocres de la vaccination et sur les problèmes d’approvisionnements. L’humeur générale est passée de l’autosatisfaction à la morosité. Le Financial Times déclare que « le paysage politique à l’approche des élections de septembre semble de plus en plus atomisé et instable ».
En France, le gouvernement Macron est maintenant totalement discrédité, avec un taux d’insatisfaction de 60 %, un des plus hauts depuis les manifestations des gilets jaunes. Le taux officiel du chômage est à 9 %, mais il est en réalité beaucoup plus élevé.
Le « Grand débat national » n’a rien fait pour rétablir la confiance du public envers le gouvernement, pas plus que le renvoi du Premier ministre Edouard Philippe. Quant aux tentatives répétées de Macron pour jouer le rôle d’un « grand homme d’Etat » au niveau international, cela n’évoque guère que des rires sarcastiques à tous les niveaux.
La Grande-Bretagne
Il y a encore peu de temps, la Grande-Bretagne était sans doute le pays le plus stable d’Europe. Maintenant, c’est probablement devenu le plus instable.
La crise actuelle a cruellement mis à jour la faiblesse du capitalisme britannique. L’économie du Royaume-Uni a chuté de 9,9 % en 2020, deux fois plus que l’Allemagne et trois fois plus que les Etats-Unis. Maintenant, face aux effets de la pandémie et la catastrophe du Brexit, une récession plus sévère est inévitable.
Le Brexit était un geste de pure folie de la part du Parti Conservateur, qui échappe maintenant à tout contrôle de la classe dirigeante. Le gouvernement est contrôlé par un clown, et lui-même est sous l’influence de nationalistes réactionnaires déments.
Bien qu’il ait remporté une victoire décisive aux élections de décembre 2019, le parti Conservateur a été de plus en plus discrédité, en particulier à cause de sa gestion de la pandémie qui a causé une mortalité plus importante que dans n’importe quel autre pays d’Europe. Le nombre de morts proportionnellement à la population (largement sous-évalué dans les chiffres officiels) est parmi les plus élevés de tous les pays. Pourtant, les Conservateurs n’ont cessé de se refuser à adopter les mesures nécessaires, pour finir par s’y soumettre devant la gravité de la situation.
Ces gens ne s’intéressent ni aux vies humaines ni à la santé de la population. Ils ne se préoccupent pas davantage de l’état lamentable dans lequel se trouve le NHS, le Service National de Santé, dont ils sont responsables à travers les coupes budgétaires imposées durant des décennies. Ils ne sont motivés que par une seule chose : les profits.
Les Conservateurs tiennent à maintenir la production à n’importe quel prix. C’est pour cela qu’ils étaient déterminés à rouvrir les écoles. Cela a causé une protestation de masse pendant les premiers jours de janvier et une réunion en ligne groupant près de 400 000 enseignants. La menace explicite d’une grève a forcé le gouvernement à fermer les écoles.
Pourtant, malgré l’impopularité du gouvernement, le Parti Travailliste et sa direction droitière se traînent derrière les Conservateurs. Il n’y a aucune véritable opposition de la part des travaillistes.
La démission de Corbyn et de McDonnell, après la défaite électorale du Parti Travailliste en décembre 2019 a été un coup dur pour la gauche et un cadeau à la droite. La gauche avait toute latitude pour transformer le parti. Elle avait l’appui total des militants de base. Cela aurait nécessité de mettre en œuvre une purge complète de l’aile droite des députés du Parti Travailliste et de la bureaucratie. Mais ils se sont dérobés et ont refusé d’appuyer la proposition de de-sélection des députés travaillistes. Cette proposition était défendue par les marxistes et avait un large soutien parmi la base du parti.
En dernière analyse, la « gauche » a peur de porter la lutte jusqu’à son but ultime, qui implique une rupture totale avec l’aile droite. Mais l’aile droite ne fait en retour pas preuve de la même gentillesse vis-à-vis de la gauche. Encouragés par cette démonstration de faiblesse, ils ont mené à bien une purge de la gauche – y compris la suspension de Corbyn lui-même. Cette faiblesse de la gauche n’est pas seulement une question morale. C’est une question politique. C’est une caractéristique organique du réformisme de gauche.
Le grand capital tient maintenant les rênes chez les travaillistes. Keir Starmer ne parle pas comme le représentant de l’opposition, mais comme un membre servile du gouvernement de Johnson. Il attend que Johnson agisse pour dire « je suis d’accord ! ».
Mais maintenant, l’aile droite est allée trop loin. Par ses actions, elle pourrait forcer la gauche à engager le combat. Tout est en place pour une lutte à l’intérieur du Parti Travailliste.
Quoi qu’il se passe, la tendance marxiste y gagnera et beaucoup de nouvelles portes s’ouvriront à nous. L’art de la politique consiste à saisir chaque opportunité. Nous saisirons cette opportunité autant que possible, et nous y gagnerons sans nul doute.
L’Italie
L’Italie reste le plus faible maillon de la chaîne du capitalisme européen. La crise actuelle a fait apparaître sa faiblesse chronique au grand jour. Incapable de rivaliser avec les économies les plus fortes comme celle de l’Allemagne, elle prend de plus en plus de retard et sombre dans une dette toujours plus abyssale.
Son système bancaire se tient constamment en équilibre au bord d’un précipice et pourrait bien entraîner le reste de l’Europe au fond du ravin. C’est la raison pour laquelle l’UE doit la consolider, mais elle le fait en la maudissant à mi-voix.
Les banquiers allemands, en particulier, se montrent de plus en plus impatients et jusqu’à récemment, exigeaient l’adoption de mesures sérieuses pour réduire les dépenses publiques et attaquer le niveau de vie. C’est-à-dire qu’ils poussaient l’Italie vers l’abîme. Ils ont quelque peu changé de ton depuis que la pandémie les a tous obligés à se tourner vers l’Etat pour obtenir de l’aide. Une fois la pandémie terminée, ils reviendront à l’austérité avec encore plus de hargne.
Pour manœuvrer sa barque pendant la crise actuelle, la classe dirigeante italienne a besoin d’un gouvernement fort. Mais, en Italie, cela n’est pas une option. Le régime politique est pourri jusqu’à la moelle. Le manque de confiance envers les politiciens s’exprime par une succession perpétuelle de crises gouvernementales. Les coalitions instables se succèdent sans que rien ne change véritablement. Les masses sont désespérées et leur quête d’une solution s’exprime par des virages violents vers la droite et vers la gauche.
La crise a été énormément exacerbée par la pandémie, qui a frappé l’Italie plus tôt et plus durement que n’importe où ailleurs. Au moment où nous écrivons ces lignes, le nombre de morts du COVID-19 se rapproche de la barre des 100 000.
La classe dirigeante espérait maintenir la coalition de Centre-Gauche aussi longtemps que possible afin d’éviter une explosion sociale. Mais c’est devenu impossible, car les options politiques ont été épuisées l’une après l’autre. Comme Italia Viva, le parti de Renzi, commençait à sentir une odeur de roussi, il retira ses trois ministres de la coalition Conte en critiquant la gestion de la pandémie de COVID-19, ce qui a mené à l’effondrement du gouvernement et a ouvert la voie à la formation du gouvernement Draghi.
Le Président de la République est intervenu, et plutôt que de convoquer des élections anticipées, il a invité Draghi, ex-Président de la Banque Centrale Européenne, à former un gouvernement. C’est là encore un nouvel exemple du parachutage d’un « technocrate », imposé au pays comme Premier ministre, sans aucune élection.
La faillite du Centre-Gauche a ouvert une voie aux groupes d’extrême droite comme le parti des Frères d’Italie. Ils sont restés à l’écart de la coalition qui soutient Draghi, premièrement parce qu’ils n’y étaient pas indispensables, et, deuxièmement, parce qu’ils espèrent gagner des voix à droite aux dépens de la Ligue actuellement au gouvernement.
Pourtant, les petits arrangements parlementaires se transformeront tôt ou tard en une guerre ouverte entre les classes. Sur la base d’un système tel que celui-ci, il ne peut pas y avoir de stabilité. En Italie, il n’y a pas de parti ouvrier de masse. Mais la colère et la nervosité des masses augmentent chaque jour. Les actions militantes des travailleurs pendant le premier mois de la pandémie sont un avertissement de ce qui va suivre.
Les échecs gouvernementaux à répétition mènent inéluctablement à une explosion de la lutte des classes. À terme, les enjeux ne se régleront pas au parlement et on s’approche bien vite du moment où le centre de gravité passera d’un parlement discrédité aux rues et aux usines.
La Russie
La même instabilité et les mêmes turbulences sont observables partout. En Russie, le retour et l’arrestation d’Alexei Navalny ont marqué le début d’une vague de contestations dans tout le pays. Il y a eu des manifestations de 40 000 personnes à Moscou, 10 000 à Saint-Pétersbourg et des milliers d’autres dans 110 autres villes, y compris Vladivostok et Khabarovsk.
Ces contestations n’atteignaient encore pas l’envergure de celles que nous avons observées il y a quelque temps en Biélorussie, quand des millions de gens sont sortis dans la rue pour renverser Loukachenko. Mais dans le contexte russe, ces manifestations étaient importantes. Elles étaient très hétérogènes, avec beaucoup de membres de la classe moyenne, des intellectuels, des libéraux – mais aussi un nombre croissant de travailleurs, et de jeunes travailleurs en particulier.
La police a réagi par la répression. Des émeutes se sont produites dans plusieurs villes. Les gens ont renversé des barricades, blessant au passage une quarantaine de policiers. Plusieurs milliers de personnes ont été arrêtées.
Qu’est-ce que cela représente ? Il s’agissait en partie d’une expression d’indignation suite à l’arrestation de Navalny. Mais la question de Navalny n’est qu’un élément de la situation, et pas nécessairement le plus important.
Alexeï Navalny est présenté dans les médias occidentaux comme le défenseur héroïque de la démocratie. En réalité, c’est un opportuniste ambitieux qui traîne un passé politique douteux. Avec du recul, on le considérera comme un personnage accidentel.
Mais à certains moments, des figures accidentelles jouent aussi un rôle dans l’histoire. Comme en chimie un catalyseur peut être nécessaire pour déclencher une réaction particulière, dans le processus révolutionnaire, un point de référence est nécessaire pour servir de détonateur afin d’allumer la colère accumulée des masses. La nature exacte de ce catalyseur n’a pas d’importance. Dans ce cas-là, il s’est agi de l’arrestation de Navalny. Mais il aurait pu s’agir d’un autre facteur parmi tant d’autres.
La baisse du niveau de vie
Le plus important n’est pas l’accident par lequel s’est exprimée la nécessité, mais bien la nécessité elle-même. La véritable cause de ce soulèvement est à chercher dans l’accumulation de colère dans la population suite à la baisse du niveau de vie, à la crise économique et aux abus d’un régime corrompu et répressif.
Tout indique que le soutien à Poutine est en baisse. A un moment donné, les sondages lui donnaient régulièrement plus de 70 % d’opinion favorable. Au moment de l’annexion de la Crimée, ils dépassaient les 80 %. Mais maintenant, ils tournent autour des 63 %, et à son point le plus bas, à peine au-dessus de 50 %. Ces chiffres ont dû sérieusement préoccuper le Kremlin.
Dans le passé, Poutine avait pu se targuer de certaines réussites dans le domaine économique, mais ce n’est plus le cas. Entre 2013 et 2018, avant la pandémie, la croissance économique annuelle était à 0,7 %, c’est-à-dire une quasi-stagnation. A la fin de 2020, la croissance était négative de 5 %. Le chômage augmente rapidement et de nombreuses familles perdent leur logement.
Pendant un temps, notamment suite à l’annexion de la Crimée, peuplée d’une majorité de Russes, Poutine a joué la carte nationaliste. Cela a donné un coup de fouet à sa popularité, mais l’opium du chauvinisme s’est largement dissipé et les réserves de crédibilité de Poutine ont été largement entamées par sa réforme des retraites.
L’indignation monte face à la corruption monstre et au niveau de vie luxueux de l’élite au pouvoir. Deux jours après son arrestation, Navalny a publié une vidéo, vue par des millions de gens, qui révélait la corruption personnelle de Poutine, et montrait un immense palais qu’il s’est fait construire sur la mer Noire. Tout ceci contribue à créer un climat explosif.
La base de soutien du régime se réduit constamment. En dehors de la clique notoirement corrompue des oligarques du Kremlin, elle se réduit pour sa plus grande part à des officiels de l’Etat dont les emplois et la carrière dépendent du patron, un grand nombre de sbires qui dépendent de contrats de l’Etat et de relations d’affaires avec le Kremlin ainsi que d’autres qui ont prospéré grâce à ses largesses.
Enfin et surtout, il s’appuie sur les forces de sécurité et sur l’armée. Le régime de Poutine est un régime bonapartiste bourgeois. En dernière analyse, le bonapartisme est le règne de l’épée. Poutine est « l’homme fort » qui se tient au sommet de l’Etat et se tient en équilibre entre les différentes classes, se faisant passer pour l’incarnation de la nation russe.
Mais l’homme fort a des pieds d’argile. Plus sa base de soutien se rétrécit, plus il en est réduit à se maintenir par une combinaison de tricherie, de fraudes électorales éhontées et de répression brute.
Talleyrand aurait un jour fait remarquer à Napoléon que l’on peut faire beaucoup de choses avec des baïonnettes, sauf s’asseoir dessus. Poutine ferait bien de s’inspirer de ce conseil éclairé. Les arrestations, les emprisonnements et les empoisonnements d’opposants politiques ne sont pas des signes de force, mais de peur et de faiblesse.
De plus, la terreur est une arme qui peut être utilisée de manière efficace pendant un certain temps, mais qui est soumise à la loi des rendements décroissants. Tôt ou tard, les gens finissent par perdre leur peur. C’est le moment le plus dangereux pour un régime autoritaire. Les récentes manifestations sont la preuve que ce processus a déjà commencé.
En réalité, la seule chose qui maintienne le régime est l’inertie temporaire des masses. Il est impossible de dire avec certitude jusqu’à quand cet équilibre instable tiendra. Pour le moment, la répression massive est parvenue à mettre un frein à la contestation. Mais aucun des problèmes de fond n’a été réglé.
Les manifestations récentes ont inquiété le régime qui combine répression et concessions. Le gouvernement a annoncé un plan d’aide aux familles les plus pauvres. Cela peut lui faire gagner un peu de temps. Mais le prix relativement bas du pétrole va continuer à porter préjudice à l’économie russe et les sanctions imposées par les EU vont rester en place, et même se renforcer.
Le Parti « Communiste »
En Russie, le rôle du facteur subjectif est évident. Si le Parti Communiste de la Fédération de Russie (PCFR) était un vrai parti communiste, il serait maintenant en train de se préparer à pendre le pouvoir. Mais la clique de Zyouganov n’a aucun intérêt à prendre le pouvoir. Elle bénéficie d’un arrangement confortable avec Poutine, qui garantit ses privilèges à condition qu’elle ne fasse rien pour déstabiliser son pouvoir.
L’attitude des dirigeants du PCFR a généré un malaise croissant dans les rangs du parti. Il y a eu plusieurs révoltes locales et régionales, qui ont été réprimées par des purges et des exclusions. Des organisations régionales entières ont ainsi été détruites. Zyouganov craint la possibilité d’une montée du sentiment d’opposition radicale au sein du parti. Et une telle augmentation de l’opposition et l’accroissement de la crise au sein du parti communiste ouvrent la possibilité de renforcer une véritable influence marxiste parmi les communistes de base.
 La trêve précaire que l’on observe actuellement peut éventuellement durer plusieurs mois, voire même plusieurs années. Mais ce report ne fera que prolonger la croissance des contradictions, et préparer une explosion encore plus considérable à l’avenir. Dans cette équation, l’élément primordial reste la classe ouvrière russe, qui a encore le dernier mot à dire.
La trêve précaire que l’on observe actuellement peut éventuellement durer plusieurs mois, voire même plusieurs années. Mais ce report ne fera que prolonger la croissance des contradictions, et préparer une explosion encore plus considérable à l’avenir. Dans cette équation, l’élément primordial reste la classe ouvrière russe, qui a encore le dernier mot à dire.
Il est impossible de prédire le calendrier précis des événements. La Russie n’est pas encore entrée dans une situation pré-révolutionnaire, mais les événements se succèdent à toute vitesse. Nous devons suivre les événements dans ce pays et les progrès des marxistes russes avec beaucoup d’attention.
L’Inde
En Inde, nous avons pu observer ce qui s’apparente en substance à un mouvement insurrectionnel des fermiers, qui ont mis en place une manifestation de tracteurs pour perturber la fête nationale le 26 janvier à Delhi, pendant laquelle Modi célébrait la journée par une immense parade militaire.
Ces événements doivent être replacés dans le contexte de la crise mondiale du capitalisme. Dans la concurrence impitoyable du secteur agricole, les grandes firmes multinationales de l’alimentaire s’évertuent à baisser les prix que les petits ou moyens fermiers touchent pour leurs produits, au niveau de la production.
La mise en concurrence de l’agriculture indienne n’est pas une nouveauté. Cela dure depuis des années, comme on l’a vu sous le gouvernement précédent de Manmohan Singh. Le capital financier a pénétré le marché agricole indien à grande échelle, et a forcé les fermiers à recourir de plus en plus à des crédits, jusqu’à un degré insupportable, afin d’acheter des ressources agricoles essentielles, dont les coûts ont explosé.
Dès que les nouvelles lois ont été mises en application, les prix payés aux fermiers ont été coupés de moitié, alors que les prix du commerce alimentaire de détail augmentaient. C’est cette situation intolérable qui a mené à ce grand mouvement des agriculteurs indiens. Ils réclament l’abrogation de ces nouvelles lois. Mais aucune de leurs revendications n’a été satisfaite, et aucune de ces questions n’a été résolue pendant les pourparlers.
Ce qui a commencé en août 2020 sous la forme de manifestations limitées dans le Pendjab, quand les Lois sur les Fermes de Modi ont été rendues publiques, a grandi jusqu’à devenir un mouvement beaucoup plus large, étendu à d’autres Etats. En septembre 2020, les syndicats agricoles de toute l’Inde ont appelé à un Bharat Bandh (une grève générale dans tout le pays). Le mouvement a continué de progresser, alors que les discussions interminables avec le gouvernement ne donnaient aucun résultat tangible. En décembre 2020, 5 millions de personnes ont pris part à des manifestations à 20 000 endroits différents.
 Un tournant important dans ce mouvement se déroula avec les événements dramatiques du 26 janvier, quand des centaines de milliers de fermiers marchèrent sur Delhi pour faire entendre leurs revendications. Les paysans ont forcé le passage depuis les banlieues de la ville jusqu’au monument historique du Fort Rouge. Ces pauvres gens ont fait preuve d’un courage immense, en se battant contre une police lourdement armée, qui les fouettait et les frappait.
Un tournant important dans ce mouvement se déroula avec les événements dramatiques du 26 janvier, quand des centaines de milliers de fermiers marchèrent sur Delhi pour faire entendre leurs revendications. Les paysans ont forcé le passage depuis les banlieues de la ville jusqu’au monument historique du Fort Rouge. Ces pauvres gens ont fait preuve d’un courage immense, en se battant contre une police lourdement armée, qui les fouettait et les frappait.
Malgré cette lourde répression policière, les agriculteurs ont pris d’assaut le Fort Rouge, et en ont occupé les remparts. La police a dû déployer des efforts énormes pour les déloger. Un manifestant est mort, et plus de 300 policiers ont été blessés. Cela n’a fait qu’accroître la colère des fermiers, et de mobiliser encore davantage de manifestants de plusieurs autres Etats en solidarité avec le mouvement.
L’ampleur de cette lutte reflète aussi la fermentation existante dans toute la société, même dans les zones rurales, où des couches réputées relativement conservatrices passent à l’action et se radicalisent sous l’impact de la crise économique.
Il n’y a pas si longtemps, quand Modi a gagné les élections, les « gauches » et les ex-« gauches » se lamentaient de la montée du « fascisme » en Inde. Notre tendance avait pourtant compris que Modi au pouvoir préparerait les conditions d’une réaction à grande échelle. Loin du fascisme, nous assistons à une polarisation de classes et une intense lutte de classe.
Le rôle des staliniens
Modi a clairement été secoué par le soulèvement paysan, qui a donné un aperçu de la colère accumulée des masses. Mais la faiblesse du mouvement en Inde tient à la direction des syndicats, qui n’a pas su organiser sérieusement la puissante classe ouvrière du pays pour soutenir les agriculteurs.
Cela se déroule alors que l’on a assisté ces dernières années à des mobilisations massives du prolétariat indien, avec plusieurs immenses grèves générales de 24 heures, mobilisant jusqu’à 200 millions de travailleurs – les plus grandes grèves générales de l’histoire de la classe ouvrière internationale.
En septembre 2016, entre 150 et 180 millions de travailleurs du secteur public ont mené une grève générale de 24 heures. En 2019, près de 220 millions de travailleurs ont participé à une grève générale, et en janvier 2020 à nouveau, 250 millions d’entre eux sont entrés dans une grève générale de 24 heures.
Ces faits démontrent le potentiel révolutionnaire colossal du prolétariat indien : les travailleurs sont prêts à se battre. Néanmoins, les dirigeants staliniens n’ont pas voulu mobiliser les masses pour une confrontation décisive avec le régime de Modi. Ils se sont contentés de s’appuyer sur le mouvement de masse pour obtenir des concessions et des accords avec Modi.
En pratique, ils ont eu recours à la tactique des grèves de 24 heures pour « relâcher de la pression », en orientant la colère des masses vers des canaux inoffensifs. C’est la même tactique qui avait été utilisée par les dirigeants syndicaux en Grèce, avec des appels à toute une série de grèves générales de 24 heures. Cette manœuvre permet d’épuiser les travailleurs, et transforme la grève générale en une gesticulation futile, qui donne l’illusion de mener une action décisive, mais en réalité fragilise la mobilisation.
Le slogan de la grève générale
En Inde, objectivement, toutes les conditions sont réunies pour une grève générale illimitée. Les partis communistes et les dirigeants syndicaux auraient déjà pu jouer un rôle central dans son déclenchement, mais ils traînent des pieds. Ils auraient pu renverser le gouvernement Modi et mettre fin à sa politique réactionnaire, mais ils ne l’ont pas fait. A la place, ils multiplient les déclarations symboliques sans appeler sérieusement à l’action.
Cela ne fait que souligner le besoin urgent de construire les forces du marxisme en Inde. Mais nous devons garder le sens des proportions. Notre organisation n’en est encore qu’à ses débuts. Surestimer nos capacités serait une erreur fatale.
Notre tâche n’est pas de diriger le mouvement ni de gagner les masses, mais de travailler patiemment pour gagner à nous les meilleurs éléments, les militants les plus révolutionnaires – ceux qui deviennent impatients face aux tergiversations et aux vacillements de la direction.
Nous devons mettre en avant des revendications transitoires opportunes, qui correspondent aux besoins urgents de la situation et font avancer le mouvement, tout en révélant la conduite passive de la direction.
La lutte des fermiers a eu un écho dans les usines. Poussés par le mouvement, les dirigeants syndicaux ont commencé à évoquer l’idée d’une grève générale de quatre jours. Nous soutenons l’idée, mais les mots ne suffisent pas : il faut passer à l’action !
Nous devons dire : très bien, organisons une grève de quatre jours, mais parlons moins et agissons plus ! Fixez une date ! Lancez une campagne dans les usines. Convoquer des meetings de masse, formez des comités de grève. Ralliez les agriculteurs, les femmes, les jeunes, les chômeurs, et les couches opprimées de la société. Et liez ces organes de lutte de la base entre eux, à l’échelle des villes, des régions, jusqu’au niveau national. Autrement dit, organisez des soviets dans le but de transférer le pouvoir aux ouvriers et aux paysans.
Quand les masses de l’Inde seront organisées pour la prise du pouvoir, aucune force sur terre ne pourra les arrêter. Une grève générale de quatre jours se transformerait rapidement en une grève générale illimitée. Mais cela pose la question du pouvoir.
C’est cette perspective que nous devons patiemment expliquer aux ouvriers et aux paysans indiens. Ainsi, malgré notre petite taille, notre message saura toucher les travailleurs et les jeunes les plus avancés qui sont à la recherche d’une voie révolutionnaire.
Notre tâche est de gagner et de former suffisamment de cadres révolutionnaires, pour pouvoir intervenir efficacement dans les événements cruciaux qui se dérouleront dans la période à venir.
Myanmar
Le coup d’Etat militaire au Myanmar confirme que nous vivons une période de « changements brusques et soudains. » Le coup d’Etat a été une surprise pour beaucoup. L’armée avait rédigé une constitution qui leur garantissait 25 % des députés et le contrôle des ministères clés. Elle avait aussi inséré une clause qui leur permettait d’intervenir en cas « d’urgence ».
Mais où était l’urgence ici ? L’armée en a inventé une en dénonçant une imaginaire fraude électorale massive après l’écrasante victoire d’Aung San Suu Kyi et de la Ligue Nationale pour la Démocratie, en novembre 2020.
La véritable raison de ce coup d’Etat est la lutte persistante pour savoir qui devrait bénéficier du programme de privatisation commencé en 1988. Depuis lors, les officiers de l’armée ont été occupés à s’enrichir en s’accaparant des propriétés d’Etat à des prix défiant toute concurrence. D’un autre côté, les impérialistes, et en particulier les Etats-Unis, font pression pour que le Myanmar ouvre son marché aux multinationales.
Le problème auquel les impérialistes font face est que la puissance étrangère dominante au Myanmar est la Chine. La plus large part des exportations du Myanmar et de ses importations se fait avec la Chine. Donc, ce que nous avons là est une lutte pour une sphère d’influence, entre la Chine et les Etats-Unis, où Aung San Suu Kyi est l’agent de ces derniers.
Les chefs militaires se sont transformés en oligarques capitalistes, et ont vu la victoire écrasante de la LND comme une menace potentielle contre leurs intérêts. Les militaires sont haïs des masses, et la caste des officiers craignait qu’avec un tel soutien, le nouveau gouvernement ne restreigne leur pouvoir et leurs privilèges.
Les militaires craignaient aussi la confiance croissante des masses en elles-mêmes après les élections. Habitués par le passé à gouverner autoritairement le pays, ils pensaient pouvoir intervenir et imposer leur volonté. Cependant, ils n’ont pas pris en compte à quel point l’opposition aux militaires est forte. Les masses n’ont pas oublié comment était la vie sous leur règne, et elles voient la caste des militaires comme corrompue et cupide.
Nous avons ici un exemple de ce que Marx appelait le « fouet de la contre-révolution. » Le coup d’Etat, au lieu de terroriser et de paralyser les masses, les a stimulées. La perspective au Myanmar est donc une intensification de la lutte de classes, et non la paralysie ou la démoralisation.
La Chine
Auparavant, la Chine était une grande partie de la solution pour le capitalisme mondial, elle est désormais une grosse part du problème.
La Chine est la seule économie importante à avoir connu de la croissance en 2020. L’Etat chinois est intervenu de façon décisive pour contrer à la fois la pandémie et la crise économique. Cela a fonctionné du point de vue des capitalistes, mais le prix à payer a été cher. Les niveaux d’endettement de la Chine ont explosé depuis 2008, augmentant de 30 % pendant la pandémie et atteignant 285 % en 2020. Le pays a désormais dépassé de nombreux pays capitalistes en termes d’endettement.
La Banque mondiale prévoit une croissance de 8 % cette année. Depuis le printemps de l’année dernière, la Chine a enregistré des performances supérieures à celles du reste du monde. Mais ce succès même fera sa perte car sa reprise est tirée par les exportations. Les autorités de Pékin tentent depuis un certain temps de modifier la structure de l’économie chinoise, qui dépend fortement des investissements et des exportations, pour stimuler la demande intérieure. Elles ont également tenté de développer des industries dans les nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle, la 5G et l’énergie solaire, dont la productivité du travail est plus élevée. Ils tentent également de développer des accords commerciaux alternatifs pour contrer les tentatives américaines d’isoler la Chine.
Aucune de ces mesures ne résoudra les contradictions qui se développent dans l’économie chinoise. En fait, depuis le début de la pandémie, l’économie est devenue encore plus dépendante des exportations. En outre, la dette continue de croître de manière explosive, les conflits avec les voisins et les autres puissances impériales s’intensifient, et l’inégalité de la croissance se poursuit, les zones côtières devançant largement l’intérieur du pays. Tout cela va aggraver les contradictions sociales déjà existantes.
C’est une recette pour de nouvelles contradictions qui menacent la stabilité, non seulement de la Chine, mais aussi du reste du monde. La Chine intervient de façon agressive sur le marché mondial et devra intervenir encore plus agressivement, profitant de la crise dans le reste du monde. Cela signifie inévitablement de plus grandes tensions entre la Chine et les Etats-Unis, qui voient la Chine comme le principal danger pour leur économie et leur rôle mondial.
Ce n’est pas un hasard si, dans ses derniers jours, l’administration Trump a adopté une politique de la « terre brûlée » à l’égard de la Chine, mais sous Biden, la politique américaine envers la Chine ne changera pas fondamentalement. Les Républicains comme les Démocrates considèrent la Chine comme la principale menace pour les Etats-Unis à l’échelle mondiale.
Le conflit entre les Etats-Unis et la Chine menace de faire éclater une guerre commerciale encore plus grave. C’est la plus grande menace pour le capitalisme mondial aujourd’hui, car c’est la croissance du commerce mondial (la soi-disant « mondialisation ») qui a fourni l’oxygène nécessaire au capitalisme au cours de la dernière période.
Cela aura en retour des conséquences en Chine. Une crise économique constituerait une grave menace à sa stabilité sociale. Il y a déjà eu des fermetures d’usines et du chômage, qui ont été dissimulés, mais qui existent. Les entreprises privées ont fait peser le poids de leurs problèmes sur leurs travailleurs par des licenciements et des baisses de salaires. Le paiement des salaires est retardé de plusieurs mois, faisant croître une colère et un ressentiment colossal.
La classe dirigeante craint la possibilité d’explosions sociales comme résultats de la crise économique et de la croissance du chômage. C’est la raison principale pour laquelle Xi Jinping a été obligé de prendre des mesures drastiques à Hong Kong. Ce n’était pas une démonstration de force, mais de peur et de faiblesse. La classe dirigeante chinoise était terrifiée à l’idée que ce type de mouvement puisse se répandre dans le reste du pays, et il le fera dans le futur, comme le jour succède à la nuit.
Le régime a réussi pour l’instant à contenir le mécontentement bouillonnant dans toute la Chine. Mais il peut exploser à tout moment, et quand cela arrivera il ne sera pas possible de le réprimer comme à Hong Kong. Même là, le régime a perdu le contrôle des événements pendant un moment. Mais face à des centaines ou un millier de Hong Kong en Chine continentale, il sera immédiatement privé de tout appui.
De grands événements se préparent en Chine. Ils surgiront quand personne ne les attendra, précisément parce qu’il s’agit d’un régime totalitaire, où la plupart de ce qui se passe est dissimulé.
Des rapports de force bouleversés
Ce qui a permis aux Etats-Unis de sortir de la Dépression des années 1930 n’est pas le « New Deal » de Roosevelt, mais bien la Seconde Guerre mondiale. Cette option est aujourd’hui impossible. Le pouvoir de l’impérialisme américain a subi un déclin relatif par rapport aux autres grandes puissances, tout comme sa capacité à intervenir militairement.
Le besoin de conquérir des marchés et de mettre la main sur des matières premières force la Chine à se montrer plus agressive sur le marché mondial. Elle s’est accaparé l’accès à des ressources dans de nombreux pays. La Chine a par exemple pris possession d’un aéroport et d’un port au Sri Lanka, établi une base militaire à Djibouti, construit des chemins de fer en Ethiopie, obtenu du cuivre et du cobalt au Congo, du cuivre en Zambie, du pétrole en Angola, et la liste est encore longue. Elle proclame également sa souveraineté sur la mer de Chine méridionale, la voie la plus importante du commerce international.
Cela menace directement les intérêts de l’impérialisme américain. Tout ceci ne fait qu’aggraver les tensions entre la Chine et les Etats-Unis. Une telle situation aurait certainement déclenché une guerre dans les périodes précédentes, mais l’équilibre des forces est à présent totalement changé.
Trump n’a pas réussi à forcer la Corée du Nord à abandonner les armes nucléaires. Kim Jong Un, « le petit homme-fusée » comme le surnomme Trump, l’a mené en bateau. Mais alors pourquoi les Etats-Unis ne déclarent-ils pas la guerre au minuscule pays qu’est la Corée du Nord ?
Les Etats-Unis se sont déjà engagés dans une guerre en Corée sans en sortir vainqueurs. Au Vietnam, au prix de milliards de dollars et de dizaines de milliers de vies, ils subissaient leur première défaite. Ils ont été ensuite humiliés en Irak, en Afghanistan puis en Syrie.
Trump semblait préparer une frappe aérienne contre l’Iran, mais a reculé au dernier moment, par peur des conséquences. Tout cela souligne le fait que la guerre n’est pas une question abstraite, et qu’elle est au contraire on ne peut plus concrète.
Les Etats-Unis ne sont pas parvenus à défendre l’Ukraine ou la Géorgie contre la Russie, dont l’armée a démontré son efficacité en Syrie. Les Etats-Unis y ont été contraints de se retirer, en laissant à la Russie et à l’Iran un pouvoir presque total sur le pays. Les Américains ont envoyé quelques troupes dans les pays baltes pour les « protéger » de la Russie, mais Poutine n’a aucune intention d’envahir ces Etats, et cette manœuvre ne l’empêche certainement pas de dormir.
Le cas de la Chine est encore plus simple. Ce n’est plus un pays pauvre et sous-développé comme elle l’était par le passé. C’est à présent un Etat à l’économie développée doté d’une armée puissante, d’armes nucléaires et de suffisamment de missiles intercontinentaux pour frapper comme elle le souhaite n’importe quelle ville aux Etats-Unis.
Le fait que la Chine ait récemment envoyé un satellite en orbite autour de la Lune ainsi qu’une mission sur Mars en est la preuve, et Washington le sait pertinemment. Il ne peut donc aucunement être question de guerre entre les Etats-Unis et la Chine dans le futur proche, pas plus qu’entre les Etats-Unis et la Russie.
Un embrasement sur le modèle de celui de 1914-1918 ou de 1939-1945 est exclu à cause de ces changements dans les rapports de forces. Dans des conditions modernes, cela signifierait une guerre nucléaire, qui serait catastrophique pour le monde entier.
Cependant, ceci ne signifie pas que la prochaine période sera paisible, bien au contraire. Les guerres seront incessantes – des petites, mais dévastatrices guerres localisées – en Afrique et au Moyen-Orient en particulier. Les impérialistes américains, main dans la main avec les autres puissances impérialistes, ont été impliqués dans des guerres régionales en soutenant des armées locales pour mener une guerre par procuration à leurs concurrents, et ils feront de même contre la Chine à l’avenir. Ils sont en effet très réticents à l’idée de risquer la vie de soldats américains à l’étranger, ce à quoi leur opinion publique est foncièrement opposée.
Cette situation ne pourrait changer que dans le cas de la victoire d’un régime bonapartiste militaro-policier aux Etats-Unis, mais ceci ne pourrait avoir lieu qu’après une série de défaites décisives pour la classe ouvrière américaine, ce qui ne fait pas du tout partie de nos perspectives. Bien avant que cette possibilité n’apparaisse, la classe ouvrière aura eu de nombreuses opportunités de prendre le pouvoir. Les bêlements constants de la soi-disant gauche et des sectes sur le fascisme dont Trump serait le représentant ne sont que des enfantillages, et nous devons n’y accorder aucune attention.
A l’heure actuelle, l’impérialisme américain se sert de sa puissance économique pour maintenir sa domination globale. L’administration Trump a plusieurs fois eu recours à la menace de sanctions économiques pour forcer le reste du monde à suivre docilement les politiques écrites à Washington dans le domaine des affaires étrangères. L’impérialisme américain a transformé le commerce en une arme.
Après avoir unilatéralement rompu le traité avec l’Iran, que la précédente administration américaine ainsi que ses alliés européens avaient eu de grandes difficultés à mettre en place, Trump a durci les sanctions de façon à étouffer l’économie iranienne, puis a forcé les entreprises et les banques européennes à faire de même sous peine d’exclusion des marchés américains.
Par le passé, lorsque les impérialistes britanniques rencontraient un problème avec un pays semi-colonial comme la Perse, ils envoyaient une canonnière. De nos jours, l’impérialisme américain envoie une lettre de la commission du commerce. Et ses effets sont bien plus dévastateurs que quelques obus tirés depuis un navire de guerre.
Clausewitz disait que la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens. Nous pouvons ajouter que le commerce est une continuation de la guerre par d’autres moyens.
L’économie magique
Quand la classe dirigeante se trouve confrontée à la possibilité de tout perdre, elle a recours à des mesures extrêmes pour sauver le système. C’est ce dont nous sommes témoins en ce moment. Dans leur quête acharnée pour trouver des solutions à la crise, les bourgeois tanguent comme un homme saoul se traîne d’un lampadaire à l’autre.
Ils ont fouillé dans les poubelles de l’histoire et en ont exhumé les vieilles idées du keynésianisme. La bourgeoisie s’est subitement enivrée de ses nouvelles chimères, qui ne sont que de vieilles théories discréditées qu’elle avait elle-même rejetées auparavant avec mépris.
Ted Grant décrivait le keynésianisme comme de l’économie magique. La description est très juste. L’idée que les bourgeois pourraient éviter ou régler des crises en injectant de larges sommes d’argent public semble séduisante – en particulier aux réformistes de gauche, que cela dispense de la nécessité de se battre pour changer la société. Mais il reste un léger problème.
L’Etat n’est pas un arbre sur lequel pousse de l’argent magique. L’idée qu’il pourrait être une source de fonds illimités est une absurdité totale. Pourtant cette absurdité a été adoptée par pratiquement tous les gouvernements. C’est une mesure prise par pur désespoir. Elle a mené à l’accumulation de dettes astronomiques sans précédent excepté en temps de guerre.
En ce moment, partout dans le monde, les gouvernements dépensent sans compter. Ils parlent de dépenser des milliards de dollars, de livres ou d’euros comme s’ils dépensaient de la petite monnaie pour acheter des broutilles.
Par conséquent, la dette devient une bombe à retardement, imbriquée dans les fondations de l’économie. A long terme, ses effets seront plus dévastateurs que n’importe quel attentat terroriste. C’est ce qu’Alan Greenspan désigna un jour comme « l’exubérance irrationnelle du marché ».
Une terminologie plus appropriée serait « folie ». Cette folie entraînera une chute, que l’on désigne sous l’euphémisme de « correction » des marchés.
Le rôle de l’Etat dans l’économie
Le 8 mai 2020, le Financial Times publiait un éditorial signé de son comité de rédaction dans lequel on pouvait lire :
« en dehors d’une révolution communiste, il est difficile d’imaginer comment les gouvernements auraient pu intervenir dans les marchés privés – pour tout ce qui touche au travail, le crédit, l’échange de marchandises et de services – aussi rapidement et profondément que pendant les deux derniers mois du confinement ».
« Du jour au lendemain, des millions d’employés du secteur privé ont reçu leur salaire du budget public et les banques centrales ont inondé les marchés financiers d’argent électronique. »
Mais comment réconcilier ces déclarations avec le mantra, répété à l’envi, selon lequel l’Etat n’a absolument aucun rôle à jouer dans une « économie de marché ? » Le Financial Times donne une réponse très intéressante à cette question :
« … Mais le capitalisme libéral démocratique n’est pas autosuffisant, et doit être protégé et entretenu pour pouvoir rester résilient. »
 En d’autres termes, le « marché libre » n’est pas libre du tout. Dans les conditions actuelles, il doit s’appuyer sur l’Etat comme sur une béquille. Il ne peut exister que grâce à des aides financières sans précédent accordées par l’Etat. Le FMI estime le montant total des aides fiscales dans le monde au chiffre ahurissant de 14 000 milliards de dollars. La dette totale des gouvernements vient d’atteindre 99 % du PIB mondial pour la première fois de l’histoire.
En d’autres termes, le « marché libre » n’est pas libre du tout. Dans les conditions actuelles, il doit s’appuyer sur l’Etat comme sur une béquille. Il ne peut exister que grâce à des aides financières sans précédent accordées par l’Etat. Le FMI estime le montant total des aides fiscales dans le monde au chiffre ahurissant de 14 000 milliards de dollars. La dette totale des gouvernements vient d’atteindre 99 % du PIB mondial pour la première fois de l’histoire.
C’est un aveu de faillite – dans son sens le plus littéral. Le problème central de cette équation peut être résumé par un seul mot : la dette. À la fin de 2020, la dette totale mondiale (y compris le gouvernement, les ménages et les entreprises) a atteint 356 % du PIB, soit une hausse de 35 points depuis 2019, atteignant le record de 281 000 milliards de dollars. Et ce chiffre ne cesse d’augmenter. C’est le plus grand danger qui menace le système capitaliste.
Le Japon a dépensé à peu près 3 000 milliards de dollars pour amortir le choc économique du COVID-19. Cette somme s’ajoute à sa dette publique, qui fait déjà 2,5 fois la taille de son économie. Le problème est particulièrement grave en Chine, où la dette totale a dépassé les 280 % du PIB, ce qui met la Chine au niveau des pays capitalistes les plus développés, et cette dette augmente rapidement dans tous les secteurs de l’économie.
Au mois de janvier dernier, la Banque Mondiale tirait la sonnette d’alarme au sujet d’une « quatrième vague de dette », particulièrement sévère en dehors des pays capitalistes les plus développés. Ils redoutent particulièrement un krach financier qui aurait des conséquences à long terme.
Les bourgeois se comportent comme des joueurs irresponsables qui vont dépenser d’énormes sommes d’argent qu’ils ne possèdent pas. Ils souffrent des mêmes illusions et font l’expérience du même genre d’extase délirante en dilapidant de grosses sommes d’argent, tout en étant persuadés que leur chance ne s’arrêtera jamais… jusqu’à ce que le moment fatal se produise – comme c’est toujours le cas – au moment où les dettes doivent être payées.
Tôt ou tard, ces dettes les rattraperont. Mais à court terme, ils sont parfaitement heureux de poursuivre cette folie, en faisant tourner la planche à billets sans réelles garanties et en engloutissant l’économie sous des amas colossaux de capital fictif.
Cependant, il ne s’agit pas simplement d’une « crise de la dette », comme le prétendent certains libéraux et réformistes. Le véritable problème est la crise du capitalisme – une crise de surproduction, dont ces énormes dettes sont un symptôme. Les dettes importantes ne sont pas nécessairement un problème en soi. S’il y avait une forte croissance économique à long terme, comme dans la période d’après-guerre, alors ces dettes pourraient être gérées et progressivement éliminées. Mais une telle perspective est exclue. Le système capitaliste n’est pas dans une ère d’essor économique, mais de stagnation et de déclin. Par conséquent, le fardeau de la dette va devenir un frein de plus en plus énorme sur l’économie mondiale. La seule façon de réduire ce problème est de recourir à l’austérité, à l’inflation, qui se terminera à son tour par un effondrement et une nouvelle période d’austérité, ou encore à un défaut de paiement direct. Mais chacune de ces variantes conduirait à une plus grande instabilité et à une intensification de la lutte des classes.
Une reprise est-elle possible ?
Emportés par cette euphorie, ils vont jusqu’à publier des articles qui annoncent un rebond certain - pas une simple reprise, mais un essor exceptionnel. Dans les colonnes de la presse bourgeoise, on peut lire des pronostics convaincus d’une embellie. Ces pronostics remplis d’optimisme sont dramatiquement éloignés de réalités matérielles.
La crise actuelle se différencie des crises précédentes à plusieurs égards. Tout d’abord, elle est inextricablement liée à la pandémie du coronavirus, et personne ne peut prédire avec la moindre certitude combien de temps celle-ci va durer.
Pour toutes ces raisons, les pronostics économiques du FMI et de la Banque Mondiale ne peuvent être abordés que comme de simples conjectures.
Mais cela veut-il dire qu’une reprise est exclue ? Non, ce serait une erreur de tirer une telle conclusion. En fait, à un moment donné, une quelconque forme de reprise sera inévitable. Le capitalisme a toujours fonctionné par une succession de phases d’expansion et de crises. La pandémie a désaxé le cycle économique, mais ne l’a pas aboli.
Lénine expliquait que le système capitaliste se tirera toujours même de la pire crise qui soit. Il continuera à exister jusqu’à ce qu’il soit renversé par la classe ouvrière. Tôt ou tard, il finira par sortir aussi de la crise actuelle. Mais en disant cela, on en dit à la fois trop et trop peu.
La question doit être posée de manière concrète, sur la base de ce que nous savons déjà. La nature exacte de ces phases d’expansion et de ces crises peut varier considérablement. La question qu’il faut se poser est donc la suivante : de quelle sorte de reprise parlons-nous ?
S’agira-t-il de l’amorce d’une période durable de croissance et de prospérité ? Ou bien simplement une parenthèse temporaire entre deux crises ? Les théories les plus optimistes se basent sur l’existence d’une « demande contenue » (au moins dans les économies capitalistes les plus avancées).
Pendant la pandémie, les gens ne pouvaient pas dépenser beaucoup d’argent sur des marchandises, les restaurants, cafés et bars ou les voyages à l’étranger. La fin de la pandémie – d’après cette théorie – peut servir à libérer ces fonds inutilisés, et à engager dans l’économie un mouvement haussier important et un regain de confiance. Cette donnée, si on y ajoute de vastes apports d’argent public, peut mener à une reprise rapide.
La reprise et la lutte de classes
Admettons, un instant, qu’un tel scénario ne puisse pas être écarté à priori. Quelles en seraient les conséquences ? De notre point de vue, une telle évolution ne serait pas totalement négative. La pandémie et la hausse du chômage qui en a découlé ont assommé la classe ouvrière et provoqué une certaine paralysie.
Elle a servi de dissuasion pour empêcher des grèves et d’autres formes d’action de masse, et a permis aux gouvernements de mettre en place des mesures anti-démocratiques sous prétexte de « combattre le Covid-19 »
Mais même une légère reprise économique, avec une baisse du chômage, combinée avec les effets de la fin de la pandémie, aurait pour effet de ranimer la lutte économique, les travailleurs tentant alors de retrouver tout ce qu’ils ont perdu au cours de la période précédente.
Une telle reprise ne serait pourtant que temporaire et particulièrement instable, car elle reposerait sur une base très précaire et artificielle. Elle porterait en elle les germes de sa propre destruction. Et plus elle prendra de l’ampleur, plus dure sera la chute.
De plus, cette reprise serait aussi inégale, avec une Chine qui ferait probablement la course en tête au détriment des Etats-Unis, avec une Europe à la traîne. Cela contribuerait à exacerber davantage les tensions entre la Chine et les Etats-Unis, et également entre la Chine et l’Europe, et mènerait à une escalade dans la guerre commerciale et une course pour s’emparer des marchés raréfiés, ce qui fragiliserait davantage le commerce mondial et restreindrait l’économie.
C’est là le plus grand danger qui guette le capitalisme mondial. Rappelons-nous que la Grande Dépression n’a pas été causée par le krach boursier de 1929, mais par les politiques protectionnistes qui ont suivi.
Les « Années folles »
Quand les économistes prédisent un net rebond à la sortie de la pandémie, ils font souvent le parallèle avec les « Années folles ». Mais ce parallèle est particulièrement fragile et les conclusions que nous pouvons en tirer ne sont guère encourageantes du point de vue capitaliste.
Il est vrai qu’après 1924, il y a eu une reprise fébrile, caractérisée par une spéculation boursière massive qui produisit une quantité énorme de capital fictif. Mais il ne faut pas oublier qu’elle s’est terminée par le krach de 1929.
Il se peut très bien que nous vivions une situation identique. Avec une différence majeure : Les quantités records de capital fictif produites actuellement sont bien plus importantes que pendant les « Années folles » - en fait, plus importantes qu’à n’importe quelle période de l’histoire en temps de paix. Quand la chute arrivera – car elle arrivera –, elle n’en sera que d’autant plus profonde.
 Les bourgeois ont oublié un petit détail. L’argent doit représenter des valeurs réelles, sous peine de n’être que de petits bouts de papier – des reconnaissances de dettes dont la promesse ne sera jamais tenue. A l’origine, on utilisait l’étalon-or pour garantir les billets de banque. Chaque nation devait garder un stock d’or dans ses coffres, et en théorie, chacun devait pouvoir exiger la valeur de ses billets en or.
Les bourgeois ont oublié un petit détail. L’argent doit représenter des valeurs réelles, sous peine de n’être que de petits bouts de papier – des reconnaissances de dettes dont la promesse ne sera jamais tenue. A l’origine, on utilisait l’étalon-or pour garantir les billets de banque. Chaque nation devait garder un stock d’or dans ses coffres, et en théorie, chacun devait pouvoir exiger la valeur de ses billets en or.
Pourtant, en pratique, cela s’avéra impossible. Au fil du temps, les gens finirent par accepter qu’un dollar, une livre ou un euro « était aussi bon que l’or ». Bien sûr, cela aurait pu être autre chose. Avant l’or, c’était l’argent. Auparavant, cela pouvait être pratiquement tout, la production par exemple. Mais à moins d’être adossée à une valeur matérielle quelconque, ce ne sont que des bouts de papier inutiles.
Quand le lien avec l’or a été rompu par l’abolition de l’étalon-or, les gouvernements et les banquiers centraux ont pu émettre autant de papier-monnaie qu’ils le voulaient. Mais en injectant de larges quantités de ce qui revient à du capital fictif dans l’économie, le rapport entre la quantité d’argent en circulation et les biens et services qu’elle peut acheter est faussé. Dans l’économie des Etats-Unis, mesurée par l’agrégat M2, l’offre monétaire a augmenté de la somme ahurissante de 4 000 milliards de dollars en 2020. Ce qui constitue une augmentation de 26 % en un an – l’augmentation annuelle la plus importante depuis 1943. Cela finira forcément par s’exprimer par une flambée de l’inflation.
Ce fait est sciemment ignoré par les dirigeants politiques, les économistes et les banquiers centraux. Ils font remarquer que, pour l’instant, les craintes liées à l’inflation ne se sont pas concrétisées. C’est correct et cela traduit le profond recul de la demande – qui est un symptôme de la gravité de la crise. Comme elle ne trouve pas de débouchés dans les prix à la consommation, la pression inflationniste a nourri des bulles spéculatives sur le cours des actions, les crypto-monnaies, etc. Mais cette situation ne peut pas durer. L’euphorie initiale des investisseurs se transformera en son contraire.
Au cours de la période précédant la crise de 2008, l’inflation a été contenue par d’autres facteurs, notamment la croissance du commerce mondial, les nouvelles technologies et la recherche d’une main-d’œuvre à bas coût dans le soi-disant tiers monde. Ces éléments, qui ont joué un rôle important pendant près de 30 ans, se sont dans une large mesure épuisés au cours de la période plus récente. La croissance du commerce mondial a considérablement diminué depuis plusieurs années et les nouvelles technologies, qui ont permis une réduction significative des coûts de production, ont atteint un point de saturation.
Ce n’est pas un hasard si toutes les statistiques sur le commerce mondial semblent montrer une tendance à l’internalisation, c’est-à-dire à un retour à la production dans les pays capitalistes d’origine. Cette tendance s’est affirmée spontanément à travers les choix stratégiques des multinationales, mais elle a aussi été objectivement renforcée par les politiques protectionnistes de Trump et d’autres gouvernements impérialistes.
Après la crise de 2007, nous avons assisté à une expansion basée sur le crédit dans le cadre d’un régime d’austérité, qui avait un caractère très différent de celui d’aujourd’hui : dans le passé, l’argent servait à recapitaliser les banques, les compagnies d’assurance et les entreprises qui étaient au bord de la faillite, ou bien il allait à la Bourse ou à la spéculation immobilière, mais sans élargir la base de la consommation de masse.
Aujourd’hui, la situation a changé : l’effet combiné de ces nouvelles tendances est une recette pour l’inflation, et pose une série de questions d’un intérêt extrême, qui sont également discutées dans les plus hautes sphères de la classe dirigeante. La plus importante est de savoir ce qui se passera lorsque les banques centrales devront augmenter les taux d’intérêt et cesser d’acheter des obligations à haut risque (junk bonds) sur le marché pour contenir l’inflation croissante.
Paradoxalement, l’inflation est une sorte de « solution » capitaliste à la crise de la dette, dans la mesure où une hausse de l’inflation et des prix dévaloriserait la dette. Mais elle s’accompagne d’énormes coûts économiques et sociaux. Et une fois qu’elle a décollé, il devient très difficile de la maîtriser à nouveau. Dans les années 1970, Ted Grant expliquait que la bourgeoisie, alarmée par la montée de l’inflation, chevauchait un tigre, et que le problème était de savoir comment en descendre sans être dévoré.
Aujourd’hui, ces tentatives de contourner la plus grave crise de surproduction jamais vue avec ce que Marx appelait « les astuces de la circulation » sont un jeu très dangereux. Ici, nous avons dépassé Keynes de loin : Le keynésianisme demande à l’Etat de s’endetter en émettant des obligations ; ce qui est proposé aujourd’hui est qualitativement différent, c’est-à-dire suivre les suggestions folles de la théorie monétaire moderne (TMM) et donc imprimer de l’argent de façon illimitée.
Ce qui représente un véritable changement qualitatif dans le système capitaliste, c’est qu’une théorie complètement irrationnelle comme la TMM se retrouve dans la position privilégiée de conditionner, voire de déterminer, les choix économiques de la première puissance impérialiste du monde !
Cette question ne concerne pas seulement les Etats-Unis. Cette tendance est désormais mondiale. Récemment, l’ancien vice-gouverneur de la Banque du Japon, Kikuo Iwata, a affirmé que le Japon devait augmenter les dépenses fiscales en augmentant la dette du secteur public, financée par la banque centrale. Cette proposition de « monnaie hélicoptère » est présentée comme remède à la faible croissance et repose sur l’idée que la demande devrait être stimulée simplement en imprimant plus d’argent. Ce sont exactement les revendications de la TMM, auxquelles Draghi a également accordé du crédit en 2016, lorsqu’il était président de la BCE, bien que les contradictions internes de l’UE ne lui offrent pas les mêmes marges de manœuvre que les Etats-Unis et le Japon.
Même s’il n’est pas possible de savoir exactement comment cette crise se développera, à un moment donné, les tensions causées par les énormes dettes accumulées provoqueront une panique. Les taux d’intérêt devront augmenter drastiquement pour lutter contre l’inflation. L’afflux du crédit bon marché, qui maintient le système à flot jusqu’à aujourd’hui, se tarira du jour au lendemain. Les banques arrêteront de prêter aux petites et moyennes entreprises, qui feront faillite.
Comme en 1929, les réalités économiques jetteront un seau d’eau glacée sur « l’exubérance irrationnelle » des investisseurs. Il va sans dire qu’il y aura une panique dans les marchés boursiers du monde entier. Les investisseurs vendront leurs actions à perte, et provoqueront une chute libre inéluctable.
Les investisseurs voient déjà les dettes colossales s’accumuler aux Etats-Unis, et commencent à se poser la question de savoir si le dollar vaut vraiment autant qu’on le dit. Plus tard, à moins que des mesures correctives sévères ne soient prises, ce sera la course pour se débarrasser du dollar, et une chute abrupte de la valeur du dollar créera un effet domino sur les autres monnaies, générant le chaos dans les marchés monétaires internationaux.
Les capitalistes tenteront de se réfugier dans la sécurité de l’or, l’argent et le platine. Ce sera le prélude à une grave crise dans l’économie réelle, avec un effondrement de l’investissement, un assèchement du crédit et, en conséquence, une onde de choc de faillites, de fermetures d’usine et de chômage.
Enfin, la crise frappera les banques elles-mêmes. L’effondrement d’une seule des grandes banques peut causer une crise générale du système bancaire. C’est ce qui s’est produit le 11 mai 1931, quand la banque autrichienne Creditanstalt annonça qu’elle avait perdu plus de la moitié de son capital, seuil au-dessous duquel une banque était déclarée en faillite selon la loi autrichienne.
Tout ceci peut très bien se reproduire. Les économistes bourgeois tentent d’apaiser leurs nerfs à vif en répétant que cela ne se produira pas parce que nous avons retenu les leçons du passé. Mais comme Hegel le fit remarquer : « Ce qu’enseignent l’expérience et l’histoire, c’est que peuples et gouvernants n’ont jamais rien appris de l’histoire, ni agi selon des principes qui auraient pu en être déduits ».
Les voyants sont pourtant déjà au rouge, et certains économistes parmi les plus sensés s’en rendent compte. Mais malgré tous les avertissements, les bourgeois n’ont pas d’autre alternative que de suivre le chemin qu’ils ont déjà choisi.
A l’heure actuelle, le capitalisme montre tous les symptômes de la décadence sénile à un stade avancé. On peut affirmer avec certitude qu’une reprise ne signifiera pas une amélioration générale de la santé de ce système, mais seulement une reprise conjoncturelle préparant une crise encore plus profonde. C’est une dépression encore plus grave que celle des années 1930 qui se prépare. Ce sera le résultat immanquable des politiques qui sont mises en œuvre actuellement. Voilà la véritable perspective, et les conséquences sociales et politiques en seront incalculables.
Conséquences politiques et sociales
Pour les marxistes, l’étude de l’économie n’a d’importance que dans la mesure où elle s’exprime à travers la conscience des masses. Le scénario que nous venons de dessiner comporte des similitudes évidentes avec les années 1930, mais il y a aussi d’importantes différences.
A cette époque-là, les antagonismes de la société étaient résolus dans un laps de temps assez court, et ne pouvaient se conclure que par la victoire de la révolution prolétarienne, ou par la réaction sous forme du fascisme ou du bonapartisme. Aujourd’hui, une solution aussi rapide est exclue à cause de la transformation de l’équilibre des forces.
Aujourd’hui, la classe ouvrière est beaucoup plus nombreuse que dans les années 1930. Son poids spécifique dans la société est beaucoup plus important, alors que les réserves sociales de la réaction (la paysannerie et autres petits propriétaires, etc.) ont drastiquement diminué.
La bourgeoisie se retrouve confrontée à la pire crise de son histoire, mais elle est incapable de s’avancer rapidement vers la réaction. D’autre part, la classe ouvrière, malgré sa force réelle, est constamment retenue par sa direction, qui est encore plus dégénérée maintenant qu’elle ne l’était dans les années 1930.
Pour toutes ces raisons, la crise actuelle se prolongera dans le temps. Elle peut durer des années, voire des décennies, avec des hauts et des bas, du fait de l’absence du facteur subjectif. Pourtant, il ne s’agit là que d’une face de la médaille. Le fait que cette crise traînera en longueur ne signifie pas qu’elle sera moins agitée. Bien au contraire : il faut s’attendre à des changements brutaux et soudains.
 Le développement de la conscience de la classe ouvrière ne peut pas se réduire mécaniquement au nombre de grèves et de manifestations de masse. C’est l’idée fausse défendue par les sectaires et les ultra-gauches qui se reposent complètement sur un activisme insensé, et n’arrivent pas à voir les processus profonds et permanents de radicalisation qui se produisent en silence sous la surface. C’est ce que Trotski appelait le processus moléculaire de la révolution socialiste.
Le développement de la conscience de la classe ouvrière ne peut pas se réduire mécaniquement au nombre de grèves et de manifestations de masse. C’est l’idée fausse défendue par les sectaires et les ultra-gauches qui se reposent complètement sur un activisme insensé, et n’arrivent pas à voir les processus profonds et permanents de radicalisation qui se produisent en silence sous la surface. C’est ce que Trotski appelait le processus moléculaire de la révolution socialiste.
Les empiristes superficiels ne sont pas capables de voir que la surface des choses, mais les processus réels échappent complètement à leur attention. Ils sont donc immédiatement déstabilisés par les accalmies momentanées de la lutte des classes. Ils se découragent, deviennent pessimistes, et se sont complètement pris au dépourvu quand tout d’un coup, le mouvement fait irruption à la surface.
L’association entre la pandémie et le chômage de masse a agi comme un frein pour la lutte économique. Il y a eu une forte baisse du nombre des grèves quand les conditions étaient défavorables aux manifestations de masse, bien qu’elles se soient parfois produites. Mais l’absence de luttes de masse ne signifie en aucune façon que le développement de la conscience se soit interrompu. C’est en fait l’inverse.
La profondeur de la crise transforme la psychologie de millions d’hommes et de femmes. La jeunesse, en particulier, est largement ouverte aux idées révolutionnaires. Les contradictions criantes de la société, l’épouvantable souffrance des masses – tout cela crée une accumulation de colère et d’amertume, qui s’agrège en profondeur dans la société, silencieusement.
La classe ouvrière a été temporairement désorientée au début de la pandémie, bien qu’en Italie il y ait eu une importante vague de grève en mars et avril 2020.
Sous le prétexte de la pandémie, la classe dirigeante a exercé une pression énorme sur les travailleurs pendant plus d’un an. Mais cela a créé un climat d’amertume et de ressentiment, qui jette les bases d’une explosion de la lutte des classes.
Avec la diminution des cas de virus, les conditions seront créées pour de sérieuses mobilisations de la classe ouvrière sur les questions économiques et politiques.
Nous ne sommes plus en 2008-2009, lorsque les travailleurs ont été pris par surprise par la crise et par des restructurations pour la plupart inattendues, ce qui a contribué à paralyser temporairement l’initiative du mouvement ouvrier.
Après s’être remis de l’impact initial de la crise, les travailleurs reprennent confiance et croient que la lutte peut donner des résultats tangibles, ce qui entraîne une plus grande volonté de se mobiliser pour l’action.
Ce processus sera renforcé par la réouverture de l’économie, ainsi que par les expériences récentes lors de la pandémie, qui ont mis à nu le rôle essentiel de la classe ouvrière dans la société, en particulier dans les secteurs qui n’ont jamais été fermés (santé, transports, commerce, industrie) mais qui ont néanmoins été soumis à une pression intolérable et à une augmentation impitoyable du rythme de travail.
Les travailleurs ont payé un prix extrêmement élevé en termes de morts et de sacrifices dans la lutte contre le Covid, et par conséquent, aujourd’hui, ils sont non seulement plus conscients du rôle qu’ils occupent dans la société, mais ils veulent aussi que cela soit compensé par une augmentation de leurs salaires et une amélioration de leurs conditions de travail. C’est un facteur décisif dans le développement de la conscience de classe.
Les bureaucraties syndicales restent un obstacle, freinant le mouvement autant qu’elles le peuvent. Mais elles ne possèdent plus la même autorité qui leur permettait de contrôler les travailleurs comme par le passé. Elles s’appuient sur la force de l’appareil bureaucratique et de l’Etat bourgeois, mais cette autorité n’a jamais été aussi faible qu’elle ne l’est aujourd’hui.
La bourgeoisie va essayer d’utiliser des mesures coercitives et répressives pour limiter la lutte des classes, en introduisant de nouvelles lois anti-grève et des limitations du droit de manifester partout, mais l’histoire nous enseigne que, lorsque les masses commencent à bouger, aucune loi ne les arrêtera. Ces méthodes peuvent retarder le processus, mais elles ne feront que le rendre encore plus explosif par la suite.
Dans un premier temps, les mobilisations des travailleurs auront un caractère essentiellement économique. Mais au fur et à mesure, elles se radicaliseront en raison de la profondeur de la crise et des énormes frustrations qui se sont accumulées au fil des ans, pour finalement prendre un caractère politique. Un nouveau « Mai 68 », ou nouvel « automne chaud » (Autunno caldo en Italie en 1969-70), sera à l’ordre du jour dans un pays après l’autre.
Dans un tel contexte, loin de freiner le mouvement, l’inflation aura pour effet de le stimuler, comme on l’a vu à plusieurs reprises dans l’histoire. La pression généralisée sur les salaires de la grande majorité des travailleurs, combinée au scandaleux transfert de richesse du salariat vers le capital, fait que la croissance de l’inflation poussera les travailleurs à défendre leur pouvoir d’achat.
C’est sur ce terrain beaucoup plus fertile que les idées des marxistes vont s’épanouir. Les syndicats entreront en crise et la vieille direction en faillite sera remise en question. Bien sûr, nous devons garder le sens des proportions. Nous ne sommes pas encore en mesure de contester l’hégémonie des réformistes sur le mouvement ouvrier. Mais en appliquant habilement la tactique du front uni, nous pouvons faire des progrès dans les syndicats. Il est nécessaire de lutter contre l’opportunisme, mais aussi contre les déviations sectaires et anarcho-syndicalistes (comme dans le syndicat italien Cobas), qui ont montré leurs faillites dans cette crise.
Le sectarisme et l’aventurisme jouent un rôle des plus négatifs dans les syndicats, conduisant l’avant-garde de la classe dans une impasse, la séparant du mouvement de masse. En combinant la fermeté sur les principes avec des tactiques flexibles, nous pouvons démontrer la supériorité du marxisme, augmenter progressivement notre profil et commencer à émerger comme une force sérieuse au sein du mouvement ouvrier.
Plus cela durera, plus l’explosion sera violente quand elle finira par se produire. Et elle se produira, cela ne fait aucun doute. Comme Marx l’a écrit à Engels :
« Tout bien considéré, la crise a pénétré en profondeur, telle une bonne vieille taupe. »
Les syndicats
Trotski a écrit que la théorie est la supériorité de la prévision sur la surprise. Les réformistes et les sectaires sont toujours pris par surprise quand les travailleurs se mettent en mouvement après une période d’inertie apparente.
Au début de l’année 1968, les mandélistes et d’autres groupuscules avaient abandonné la classe ouvrière française dans son ensemble. Ils disaient que les ouvriers étaient embourgeoisés et américanisés. Un de ces messieurs avait même écrit qu’une grève générale était alors parfaitement impossible dans quelque pays d’Europe. Quelques semaines plus tard, les travailleurs français lançaient la plus grande grève générale révolutionnaire de l’histoire.
Ils étaient complètement induits en erreur par l’absence de grandes mobilisations pendant la période précédente. Aujourd’hui aussi, nombre de militants des syndicats ou du mouvement ouvrier ont été désorientés par les événements. Ils ont perdu confiance dans la capacité des travailleurs à lutter, et sont devenus pessimistes, sceptiques et cyniques. Ils sont eux-mêmes devenus un obstacle, et bloquent le chemin vers la lutte. Ce serait désastreux pour nous d’être guidés par leur vision amère et défaitiste.
Comme nous l’avons expliqué, même une fragile reprise de l’économie marquera le signal d’une explosion de la lutte de classe, qui secouera les syndicats jusque dans leurs fondations. Les dirigeants des syndicats réformistes sont déjà complètement dépassés. Ils incarnent le passé, le temps où leur vie était facile et où les relations avec les patrons étaient bonnes, quand ces derniers pouvaient accorder des concessions aux ouvriers sans entamer leurs profits.
Maintenant les choses sont très différentes. Les patrons tentent de faire porter tout le fardeau de la crise sur les épaules des travailleurs, qui se retrouvent dans une position intenable, où même leurs vies et celles de leurs familles sont mises en danger.
La profondeur de la crise rend impossible toute concession significative et durable. Les travailleurs devront se battre pour chaque revendication – non pas pour gagner de nouvelles avancées, mais pour préserver les acquis du passé.
Mais même là où ils réussiront, leurs gains seront balayés par l’inflation, qui réapparaîtra du fait des énormes montants de capital fictif qui ont été mis en circulation. Ce que les patrons donnent de la main droite, ils le reprendront de la main gauche.
Ce qui signifie que les syndicats seront soumis à la pression des travailleurs qui exigeront qu’ils passent à l’action pour défendre leurs droits, leurs conditions de travail et leur niveau de vie. Soit les dirigeants syndicaux plieront sous cette pression, soit ils seront révoqués et remplacés par d’autres qui sont prêts à se battre. Les syndicats seront transformés au cours de la lutte.
 Quand la voie leur sera bloquée dans les syndicats officiels et en l’absence d’une perspective de changement de direction, des travailleurs pourront aussi, sous certaines conditions, développer leurs propres initiatives depuis la base. L’émergence de telles formes d’auto-organisation de travailleurs en lutte, comme les Mareas en Espagne, Santé en lutte et le Collectif des 1 000 chauffeurs de bus en Belgique, les collectifs des soignants en France, etc. sont le résultat de la colère accumulée des travailleurs, du besoin immédiat d’une action collective et de la passivité des dirigeants des syndicats officiels.
Quand la voie leur sera bloquée dans les syndicats officiels et en l’absence d’une perspective de changement de direction, des travailleurs pourront aussi, sous certaines conditions, développer leurs propres initiatives depuis la base. L’émergence de telles formes d’auto-organisation de travailleurs en lutte, comme les Mareas en Espagne, Santé en lutte et le Collectif des 1 000 chauffeurs de bus en Belgique, les collectifs des soignants en France, etc. sont le résultat de la colère accumulée des travailleurs, du besoin immédiat d’une action collective et de la passivité des dirigeants des syndicats officiels.
La dialectique nous apprend que les choses peuvent se transformer en leur contraire, et nous devons nous y préparer. Même les plus réactionnaires et les plus passifs des syndicats seront entraînés dans la lutte. Ce processus a déjà commencé dans des pays comme la Grande-Bretagne. L’un après l’autre, les anciens dirigeants de la droite meurent, partent à la retraite ou sont remplacés.
Une nouvelle génération de jeunes combattants ouvriers commence à défier les directions syndicales. Le décor est planté pour la transformation des syndicats en organismes de lutte. Et nous, marxistes, nous devons être en première ligne de ce combat, sur lequel repose en dernière analyse le succès de la révolution socialiste.
La tâche qui nous incombe
L’année 2021 ne ressemblera à aucune autre, la classe ouvrière est entrée dans une école particulièrement difficile, il y aura de nombreux revers et de nombreuses défaites, mais de cette école, les travailleurs tireront les enseignements nécessaires.
L’accumulation des tensions sur plusieurs années peut mener à des changements soudains, nous plaçant face à des questions sérieuses. Et nous devons être préparés ! Dans la prochaine période, de nouvelles couches entreront dans la lutte. C’est ce que nous avons vu en France avec les « gilets jaunes ». Nous y assistons aujourd’hui avec le mouvement des fermiers en Inde. Aux Etats-Unis, nous avons assisté aux manifestations massives qui ont suivi la mort de George Floyd. Elles ont groupé près de 26 millions de personnes, dans 2 000 villes reparties dans l’ensemble des 50 Etats mais aussi à Washington et à Porto Rico, et ont forcé Trump à se réfugier dans son bunker.
Le problème fondamental est celui de la direction. La colère des masses existe, mais ne trouve pas d’expression dans les organisations officielles. Les dirigeants des syndicats essaient de retenir le mouvement en arrière. Mais, avec ou sans eux, le mouvement finira par trouver une façon de s’exprimer.
Les masses ne peuvent apprendre que d’une seule chose, l’expérience. Comme Lénine le disait : « la vie enseigne ». Les travailleurs apprennent de leur expérience de la crise. Mais c’est un processus d’apprentissage lent et douloureux. Il faut du temps aux masses pour tirer les mêmes conclusions que celles que nous avons tirées, pour des raisons théoriques il y a des années de cela.
Ce processus d’apprentissage serait grandement accéléré s’il existait une organisation révolutionnaire de masse, suffisamment grande et dotée de suffisamment d’autorité pour être entendue par les travailleurs. Potentiellement, ce parti existe dans les rangs de la TMI. Mais actuellement il n’existe que sous une forme embryonnaire. Et comme le vieux Hegel l’a écrit : « quand on souhaite voir un chêne avec son tronc puissant, ses larges branches et son feuillage touffu, on n’est pas satisfait si l’on nous montre un gland à la place. »
Nous avons fait de grands progrès, et nous nous attendons en faire bien d’autres. Mais il faut admettre en toute honnêteté qu’à l’heure actuelle, nous n’avons pas le nombre de militants nécessaire. Nous n’avons ni pas un enracinement suffisant dans la classe ouvrière et ses organisations pour faire la différence.
Pourtant, avec des idées valides et des slogans adéquats, nous pouvons toucher les travailleurs les plus avancés et les jeunes, et à travers eux, nous pouvons arriver ensuite à des couches plus importantes. Nous pouvons ici ou là être en position de diriger des luttes spécifiques. Mais d’une manière générale, nous devons chercher à obtenir de petites victoires, car celles-ci, aussi modestes qu’elles soient, nous serviront de tremplin vers de plus grands succès dans le futur.
Notre Internationale a montré une immense résilience et beaucoup d’audace, en faisant face aux difficultés et en expérimentant de nouvelles méthodes de travail. Par conséquent, au cours des 12 derniers mois, nous avons fait d’immenses progrès, alors que d’autres groupes ont vécu crises et scissions, et tombent rapidement dans un néant bien mérité.
Nous avons beaucoup moins de concurrents que dans le passé. Les sectes se décomposent et les staliniens, qui représentaient autrefois un sérieux obstacle, ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes. Ils s’accrochent encore à quelques postes hérités du passé dans les syndicats. Mais ils agissent immanquablement comme une caution de « gauche » pour l’aile droite de la bureaucratie. Ils seront balayés avec elle dès que les travailleurs se mettront en marche.
Nos principaux concurrents seront les réformistes de gauche, qui n’ont pas de perspectives politiques claires. Parmi eux, beaucoup ont abandonné la perspective d’une transformation socialiste de la société, même en paroles, et oscillent donc constamment entre la pression des bourgeois et des réformistes de droite d’une part, et celle de leur base ouvrière d’autre part. C’est un phénomène international.
Mais malgré leur manque d’idées claires (et partiellement grâce à cela), ils seront inévitablement portés au premier plan par les radicalisations de masse. Comme ils sont politiquement instables et manquent d’une idéologie claire, ils vont parfois prononcer des slogans très radicaux, voire même « révolutionnaires ». Mais il ne s’agira là que de mots, et ils pourront basculer vers la droite aussi rapidement qu’ils l’auront fait vers la gauche. Nous apporterons un soutien critique à ces réformistes de gauche, en les appuyant à chaque fois qu’ils combattent la droite, mais en critiquant toute tendance aux reculades, aux concessions et à la capitulation.
Une caractéristique commune à tous nos rivaux politiques – y compris les réformistes de gauche – est leur incapacité à rallier les jeunes. Notre réussite évidente à gagner le meilleur de la jeunesse indigne et fait enrager les sceptiques. Et par-dessus tout, cela les dépasse. Comment la TMI peut-elle attirer tant de jeunes dans la situation actuelle, alors que tout est si sombre et désespéré ? Ils secouent la tête et continuent à se lamenter sur le piteux état du monde.
Comme Lénine le faisait remarquer : celui qui a la jeunesse a l’avenir. La raison de notre réussite n’est pas difficile à comprendre. Les jeunes sont naturellement révolutionnaires. Ils exigent que le capitalisme soit combattu sérieusement et sont agacés par la frilosité et les théories confuses.
Notre force repose sur deux choses : la théorie marxiste et une orientation ferme en direction de la jeunesse. Nous avons démontré par notre expérience que c’était une formule gagnante. Ces réussites donnent de la confiance et de l’optimisme pour l’avenir. Mais il nous faut garder le sens des proportions en toutes circonstances. Nous n’en sommes encore qu’au début du début.
 Des défis bien plus importants nous attendent pour nous mettre à l’épreuve. L’autosatisfaction n’a pas sa place ici. Si nous nous demandons si nous sommes prêts à tirer profit des immenses opportunités qui existent, quelle est la réponse ? Pour être parfaitement honnêtes, nous devrions répondre par la négative. Non, nous ne sommes pas prêts – pas encore, du moins. Mais nous devons le devenir, aussitôt que possible. Et, cela, au bout du compte, signifie croître.
Des défis bien plus importants nous attendent pour nous mettre à l’épreuve. L’autosatisfaction n’a pas sa place ici. Si nous nous demandons si nous sommes prêts à tirer profit des immenses opportunités qui existent, quelle est la réponse ? Pour être parfaitement honnêtes, nous devrions répondre par la négative. Non, nous ne sommes pas prêts – pas encore, du moins. Mais nous devons le devenir, aussitôt que possible. Et, cela, au bout du compte, signifie croître.
Nous devons toujours commencer par la qualité, recruter patiemment, et éduquer et former des cadres. Mais ensuite il faudra transformer la qualité en quantité : construire une organisation plus grande et plus efficace. A l’inverse, la quantité est changée en qualité. Avec une centaine de cadres, on peut faire des choses qu’une douzaine seulement ne pourraient pas accomplir. Et imaginez seulement ce que l’on pourrait faire en Grande-Bretagne, au Pakistan ou en Russie avec un millier de cadres. Il s’agit là d’une différence qualitative !
La formation de cadres doit aller de pair avec la croissance. Il n’y a là aucune contradiction. L’organisation doit se développer à mesure que la situation change. Et elle doit changer avec la situation, en devenant plus professionnelle, plus disciplinée et plus mûre.
Nos idées, nos méthodes et nos objectifs sont corrects. Pourtant, nous avons besoin de bien plus que cela. Notre tâche consiste maintenant à transformer tout cela en croissance numérique et à créer une puissante armée révolutionnaire de cadres, capables de mener les travailleurs au combat. Nous faisons déjà de grands pas dans cette direction.
Au début, il semblait que la pandémie créerait des difficultés insurmontables aux marxistes. Elle a certainement réduit à néant toutes ces sectes pseudo-marxistes qui se basent sur un activisme irrationnel. Mais la TMI est allée de l’avant, jusqu’à atteindre 1 000 nouveaux membres l’année dernière. Et ce n’est que le début.
Camarades de l’Internationale ! Nous menons une course contre la montre. Notre tâche peut être résumée ainsi : il s’agit de rendre consciente la volonté inconsciente (ou à demi consciente) de la classe ouvrière de changer la société.
De grands événements se préparent. Pour nous élever à la hauteur de ces formidables objectifs, nous avons besoin d’une révolution interne, en commençant par une révolution de notre propre mentalité. Nous ne pouvons plus penser de la même façon que par le passé. Toute trace de mentalité de petit cercle et de routine doit être éliminée. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une approche professionnelle dans la construction du parti. Il n’y a rien de plus important dans nos vies. Et si nous continuons de suivre les idées, les tactiques et les méthodes correctes, nous y arriverons sans aucun doute.
Adopté à l’unanimité, le 25 juillet 2021