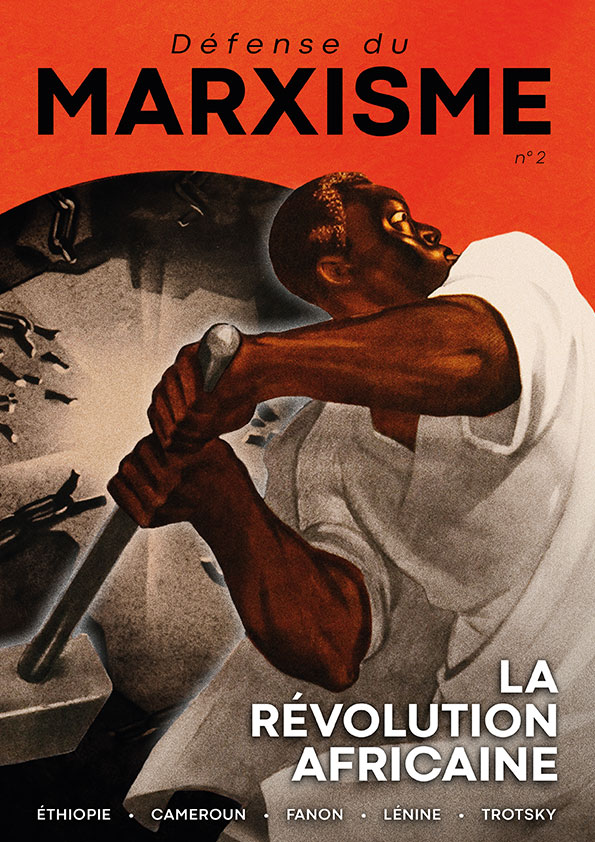La crise de l’Europe
Le caractère global de la crise signifie qu’il est impossible de « découpler » l’Europe et l’Amérique. L’annonce de la Fed américaine qu’elle allait réduire le recours à « l’assouplissement quantitatif » a immédiatement semé la panique sur les marchés et fait monter les taux d’intérêt à travers la zone euro. Cela risquait de resserrer la politique monétaire au moment où la récession et la croissance du chômage requerraient précisément le contraire.
La crise est particulièrement flagrante en Europe. La perspective d’une Europe capitaliste unifiée est réduite à néant. Toutes les contradictions nationales ont refait surface, menaçant l’avenir non seulement de l’euro, mais aussi de l’UE elle-même.
La dette pèse sur l’économie européenne comme un énorme fardeau, l’empêchant de retrouver rapidement le chemin de la croissance. Personne ne connait l’ampleur réelle des dettes des banques européennes. D’après le Wall Street Journal, les dettes pourries des banques européennes ont atteint au moins 1 050 milliards de d’euros, soit deux fois plus qu’en 2008. Mais ce n’est qu’une estimation (hasardeuse) et le chiffre réel est sans doute bien plus élevé. La plupart des banques d’investissement estiment que le secteur bancaire européen doit être purgé de 2000 à 2500 milliards d’euros pour atteindre une taille lui permettant d’être considéré comme adéquatement capitalisé.
Il y a eu une légère reprise en Allemagne, mais l’Italie, l’Espagne et la Grèce sont en récession. Depuis le début de la crise, le PIB de l’Italie a reculé de 9 %, celui de la Grèce d’au moins 25 %. L’Allemagne ne pourra pas continuer de croître en l’absence de reprise sur l’ensemble de la zone euro, principal marché pour ses exportations. En 2012, les ventes de voitures européennes sont tombées à leur plus bas niveau depuis qu’on a commencé à calculer ce chiffre, en 1990. En 2013, cette chute s’est poursuivie pendant six des huit premiers mois.
Le lancement de l’euro, en 1999, nous était présenté comme la garantie d’un avenir de paix, de prospérité et d’intégration européenne. Mais comme le prédisions à l’époque, l’euro s’est transformé, dans un contexte de crise, en un facteur de désintégration.
Bien que la monnaie unique ne soit pas la cause fondamentale des problèmes de la Grèce, de l’Italie et de l’Espagne (comme se l’imaginent des esprits étroits et nationalistes), il est clair qu’elle a énormément exacerbé ces problèmes.
Par le passé, ces pays pouvaient répondre à une crise par une dévaluation de leur monnaie nationale, afin d’accroître la compétitivité de leurs exportations. Ce n’est plus possible. Leurs gouvernements sont obligés de recourir à une « dévaluation interne » – c’est-à-dire à la mise en œuvre de politiques d’austérité drastiques. Mais cela a pour seul effet d’aggraver la récession (en minant la demande) et de renforcer les contradictions de classe.
La crise en Grèce a joué le rôle de catalyseur. Elle menace l’euro et l’UE elle-même. Comme c’était prévisible, la crise émerge à travers le maillon le plus faible de chaîne du capitalisme européen. Mais les répercussions de la crise grecque affectent toute l’Europe. Pendant la phase de croissance qui a suivi le lancement de l’euro, l’Allemagne a beaucoup exporté dans la zone euro. Mais ce qui était un énorme « + » s’est transformé en un énorme « – ». Lorsque Mario Dragui, président de la BCE, a promis d’utiliser toutes les ressources économiques à sa disposition pour sauver l’euro, il a oublié de préciser d’où viendraient ces ressources.
Toute forme de transfert fiscal pour sauver la zone euro se fera grâce aux contribuables allemands. Cela pose de sérieux problèmes à Angela Merkel. L’Allemagne se fait donc la championne de l’austérité et des restrictions budgétaires. Elle peut se le permettre ; elle est la première économie européenne. Or tôt ou tard, le pouvoir économique s’exprime en pouvoir politique. N’en déplaise aux vieilles illusions de la bourgeoisie française, c’est l’Allemagne qui décide de tout.
Ceci étant dit, les politiques d’austérité ont des limites sociales et politiques. Des pays comme la Grèce et le Portugal ont déjà atteint ces limites. L’Espagne et l’Italie ne sont pas loin derrière. Malgré l’optimisme recouvré de la bourgeoisie, rien n’a été réglé. Une nouvelle crise de la zone euro peut éclater à tout moment. Les politiques de rigueur drastiques ont provoqué une grave crise politique au Portugal, où d’immenses manifestations de masse ont failli renverser le gouvernement. La dette publique du Portugal augmente – et aura probablement dépassé les 130 % du PIB en 2015. À quoi bon, dès lors, tous ces sacrifices et toute cette souffrance ?
Une partie de la « gauche » européenne – par exemple Lafazanis, chef d’une tendance interne à Syriza – appelle à une sortie de l’euro, voire de l’UE, comme solution à la crise et aux problèmes de la classe ouvrière. Or, comme marxistes, nous savons que la crise n’est pas due à l’UE en elle-même. C’est une crise du système capitaliste.
L’UE n’est rien d’autre qu’un grand syndicat patronal au service des capitalistes européens les plus puissants. L’UE impose partout des politiques anti-ouvrières ; il n’est pas possible de la réformer dans le sens d’une « Europe sociale ». Mais l’alternative n’est pas l’addition de petits États capitalistes ; c’est la lutte commune des travailleurs européens pour une Fédération des États Socialistes d’Europe.
L’instabilité politique engendrée par les mesures d’austérité se reflète dans une série de gouvernements de coalition instables et dans de violentes oscillations de l’opinion publique. En Italie, ils ont eu le plus grand mal à former une coalition entre Berlusconi et le Parti Démocrate. Et les dirigeants de la coalition passent le plus clair de leur temps à s’attaquer publiquement. La principale préoccupation de Berlusconi est d’éviter la prison ; les intérêts généraux du capitalisme italien passent après.
Le spectacle des querelles et divisions au sommet, des scandales de corruption (Espagne), des promesses non tenues (France), des politiciens qui se remplissent les poches (Grèce) tout en infligeant la régression sociale au reste de la société – ce spectacle mine la crédibilité de tous les partis et dirigeants politiques. La bourgeoisie s’en inquiète, car cela signifie qu’elle utilise sa réserve d’armes politiques pour défendre son système. Une crise sociale et politique massive se prépare en Europe.
La bourgeoisie fixe l’abîme – et pourrait être forcée de faire marche arrière. Outre ses implications politiques et sociales, l’austérité n’a même pas réussi à réactiver l’économie. Au contraire, elle a énormément aggravé la situation. Mais quelle est l’alternative ? La bourgeoisie a le choix entre la peste et le choléra. Il n’est pas sûr que la zone euro éclatera complètement, une perspective qui terrifie la bourgeoisie – et pas seulement la bourgeoisie européenne. Pour éviter un effondrement complet, les dirigeants de l’UE devront abandonner certaines de leurs plus rigoureuses conditions. Au final, il ne restera pas grand-chose de l’idée originale d’unification européenne – qui est impossible sur la base du capitalisme.
Le problème de la bourgeoisie européenne peut être formulé simplement. Elle ne peut se permettre de maintenir les concessions arrachées par la classe ouvrière au cours des 50 dernières années ; mais la classe ouvrière, de son côté, ne peut accepter davantage de régression sociale. Partout, les niveaux de vie reculent et les salaires baissent. L’émigration de l’Europe du Sud vers des pays comme l’Allemagne reprend. Mais lorsque l’Allemagne sera frappée par la récession, où les Européens du sud émigreront-ils ?
La classe ouvrière s’est énormément renforcée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les réserves sociales de la réaction ont fondu. La paysannerie ne forme plus qu’une petite minorité de la population, alors que par le passé elle en constituait une partie importante dans des pays comme l’Espagne, l’Italie, la France, la Grèce – mais aussi l’Allemagne. Par le passé, des catégories telles que les enseignants, les fonctionnaires et les employés de banque se considéraient la « classe moyenne » et ne songeaient pas à faire grève ou se syndiquer. Aujourd’hui, ces travailleurs font partie des sections les plus militantes de la classe ouvrière. Cela vaut également pour les étudiants, qui avant 1945 étaient souvent de droite (voire fascistes), alors qu’ils sont aujourd’hui majoritairement de gauche et, souvent, ouverts aux idées révolutionnaires.
Les travailleurs européens n’ont pas subi de défaite décisive depuis des décennies. Il ne sera pas facile de leur reprendre tout ce qu’ils ont conquis. On l’a vu par exemple en octobre 2013, lorsque les pompiers belges ont garé 30 camions devant le parlement et l’ont arrosé d’eau et de mousse. Ils réclamaient 75 millions d’euros pour garantir un niveau d’embauche compatible avec leur sécurité. Le gouvernement a dû céder lorsque les cheminots ont proposé aux pompiers de les aider en bloquant les gares du pays. Cette réalité du rapport de force entre les classes pose un sérieux dilemme à la bourgeoisie, lorsqu’elle doit mettre en œuvre des politiques d’austérité. Reste que la crise l’oblige à lancer de nouvelles attaques.
L’Allemagne
En surface, l’Allemagne semble avoir échappé aux pires effets de la crise. Mais son tour viendra. Le talon d’Achille du capitalisme allemand est sa dépendance inédite à l’égard de ses exportations. En 2012, les exportations de l’Allemagne représentaient 44 % de son PIB (1 100 milliards d’euros). Ce succès apparent reposait sur le fait que les salaires réels des travailleurs allemands ont été maintenus au même niveau depuis 1992. Le FT explique : « L’Allemagne est désormais le pays d’Europe occidentale qui compte la plus grande proportion de travailleurs sous-payés, relativement au salaire médian ». Un quart des travailleurs gagne un « bas salaire ». Le nombre de salariés précaires a triplé en l’espace dix ans.
Les exportations allemandes, seul moteur de la croissance économique du pays sur la dernière période, reposaient donc sur des bas salaires et de hauts niveaux d’investissement. Les taux de productivité élevés imposés aux travailleurs allemands ont donné à l’industrie du pays un avantage important sur ses rivaux européens, comme le montrent les chiffres suivants.
Évolution de la production industrielle entre 2000 et octobre 2011 :
Allemagne : + 19,7 %
Portugal : - 16,4 %
Italie : - 17,3 %
Espagne : - 16,4 %
Grèce : - 29,9 %
De fait, l’Allemagne a progressé au détriment de ses plus faibles rivaux européens, qui ne pouvaient pas concurrencer son industrie. L’Allemagne a gagné ce qu’ils ont perdu. Et c’est surtout elle qui a profité de l’euro. Il fut un temps où les banques allemandes étaient ravies de prêter de l’argent à des pays comme la Grèce, qui achetaient alors des marchandises allemandes. Désormais, ce processus s’est inversé. Bien qu’ils ne puissent l’admettre publiquement, le procès-verbal (qui a fuité) des réunions du FMI sur le premier plan de sauvetage de la Grèce prouve ce que nous affirmions par le passé : les plans de sauvetage de la Grèce visent avant tout à sauver les banques allemandes (et françaises).
En Allemagne, des démagogues de droite maudissent l’Europe et l’euro. Mais les stratèges les plus sérieux du capitalisme allemand sont pleins d’appréhension. Ils comprennent que l’Allemagne ne pourra pas restaurer son équilibre économique tant que le reste de la zone euro ne sortira pas de la crise. Où exporterait-elle ses marchandises ?
Lors d’un important sommet économique qui s’est tenu à Hambourg, en Allemagne, l’ancien dirigeant du SPD Helmut Schmidt a prévenu que « les peuples n’ont plus confiance dans les gouvernements européens et l’Union Européenne ; l’Europe est au seuil d’une révolution. » Puis il a souligné sur la nécessité de changements économiques et politiques en Europe. Mais quels changements ? Et qui les mènera à bien ?
La Grande-Bretagne
L’ancien atelier du monde a perdu sa base industrielle et est entièrement dominé par le Capital parasitaire de la finance et des services. Le Royaume-Uni compte davantage de banquiers gagnant plus d’un million de livres que le reste de l’UE. La Grande-Bretagne se targuait d’une « reprise » économique, mais l’image sous-jacente est celle d’un déclin.
La période récente a vu la plus grande et la plus conséquente chute du niveau de vie en Grande-Bretagne depuis 1860 – il y a plus de 150 ans. Il y a eu des signes avant-coureurs d’une nouvelle explosion au sein de la jeunesse lors des émeutes qui ont embrasé les villes dans l’ensemble du pays, il y a quelques années. On estime que deux millions d’enfants vont à l’école le ventre vide chaque matin. Cette révélation a tellement choqué l’opinion publique que le gouvernement a hâtivement annoncé la mise en place de repas gratuits pour tous les enfants scolarisés à l’école primaire.
Les attitudes sociales ont connu de profondes mutations en Grande-Bretagne. Les vieilles attitudes de respect et déférence envers les institutions se sont transformées en haine. Les personnes qui étaient considérées avec respect par le passé – membres du Parlement, la presse, la magistrature et la police – sont considérées avec suspicion et mépris.
« L’opinion publique semble penser qu’il y a quelque chose de pourri dans les institutions », déclare John McDermott dans le FT. « En 2010, un sondage a révélé que 81 % des Britanniques approuvaient l’assertion : “Les politiciens ne comprennent pas du tout le monde réel”. L’enquête sur les attitudes sociales des Britanniques rapportait que seuls 18 % faisaient confiance au gouvernement pour mettre les besoins de la nation au-dessus de ceux des partis politiques, alors qu’ils étaient 38 % en 1986. Les banques s’en tirent encore moins bien. En 1983, 90 % des britanniques estimaient qu’elles étaient “bien gérées”, contre 19 % aujourd’hui, certainement le changement d’attitude le plus spectaculaire au cours des 30 dernières années.
« L’opinion des Britanniques sur leurs institutions fluctue – demandez-le à Sa Majesté. Mais les scandales successifs qui ont frappé le secteur bancaire, le parlement et les médias donnent le sentiment d’un effondrement de la confiance en ceux qui exercent le pouvoir dans le pays… Il y a une profonde ignorance, chez les puissants, de l’étendue du sentiment anti-élite, en Grande-Bretagne et au-delà. » (FT, 28/09/13)
Le chef de file des Travaillistes, Ed Miliband, a finalement été contraint de donner un écho (très modéré) à la colère grandissante contre les grandes entreprises et les banques, du fait d’une pression croissante dans les rangs du mouvement Travailliste. En dépit du caractère faible et limité de cette évolution, cela a provoqué une explosion de rage dans la presse bourgeoise. Le FT a accusé Miliband de se « compromettre dans des subterfuges populistes ». Nous avons ici un aperçu des pressions contradictoires, qui seront multipliées par mille, auxquelles sera confronté un gouvernement Travailliste dans des conditions de crise.
La France
À l’origine, l’UE était destinée à être un condominium dont la France serait le leader politique et l’Allemagne le moteur économique. Mais désormais, ces plans de la classe dirigeante française ont été réduits à néant. Berlin décide de tout, Paris de rien.
Lors des élections de 2012, le Parti Socialiste a remporté une large victoire. Mais très vite, le soutien à Hollande s’est évaporé. Comme tous les autres dirigeants réformistes, il a accepté de gérer la crise du capitalisme. En conséquence, il est le président plus impopulaire depuis 1958. Les derniers sondages enregistrent une augmentation du soutien à Marine Le Pen, Hollande étant à la traine, loin derrière.
Les médias vont essayer de présenter cela comme un glissement de l’électorat vers la droite. En fait, cela exprime un sentiment général de frustration et de mécontentement envers les partis existants et de désillusion envers « la Gauche », qui a promis beaucoup et fait peu. Il reste à voir si le Parti Communiste, malgré sa politique réformiste, pourra – grâce au Front de Gauche – regagner du terrain au détriment du PS.
En partie afin de détourner l’attention de ses échecs en politique intérieure, Hollande a lancé une série d’aventures militaires en Afrique (Mali et République Centrafricaine). Bloqué par l’Allemagne en Europe, il tente de relancer l’ancienne influence française en Afrique et au Moyen-Orient. Mais en réalité, l’impérialisme français ne dispose plus des forces nécessaires pour jouer un rôle indépendant à l’échelle mondiale. Ces aventures militaires finiront inévitablement dans les larmes, ajoutant de l’eau au moulin du mécontentement intérieur.
La France reste un pays clé pour la lutte des classes en Europe. Les travailleurs français ont maintes fois démontré qu’ils n’ont jamais oublié leurs traditions révolutionnaires. Les masses cherchent une issue à la crise. Elles ont accordé leur confiance aux Socialistes, mais ceux-ci sont organiquement liés au système capitaliste et à l’ordre existant. La « Gauche » trahit les espoirs des masses. Aux élections municipales, les dirigeants du PCF et du Parti de Gauche ont brisé le Front de gauche. Le PCF a fait alliance au premier tour avec le PS, un parti de gouvernement, alors que le Parti de Gauche a fait alliance avec les Verts dans certaines municipalités, qui à l’époque avaient deux ministres dans le gouvernement. En brisant le Front de Gauche – au moins au niveau municipal –, ils sont en train de décevoir ces travailleurs et cette jeunesse qui cherchent une alternative à la gauche du PS. C’est une indication du complet aveuglement réformiste des dirigeants du PC, qui sont accrochés au PS précisément au moment où Hollande et son gouvernement sont discrédités et profondément impopulaires. Au lieu de maintenir une opposition claire au gouvernement, ils tentent désespérément de préserver leurs positions dans les institutions locales. Les marxistes devraient exiger des dirigeants du Front de gauche de rompre avec les socialistes et les Verts et de renforcer le Front de gauche sur la base d’une véritable politique de gauche et socialiste.
Il y a un processus clair de polarisation entre les classes qui, à un certain stade, débouchera sur une explosion sociale. Frustrés sur le plan électoral, les travailleurs et la jeunesse peuvent descendre dans la rue comme ils l’ont fait si souvent par le passé. Une répétition de Mai 68 se prépare. Mais cette fois-ci, ce sera à un niveau supérieur, et les Staliniens ne possèdent plus ni la force, ni l’autorité pour trahir le mouvement.
L’Italie
L’Italie glisse dans la spirale descendante des dégradations de sa note et de la hausse des rendements obligataires. Les conséquences seront désastreuses, non seulement pour l’Italie, mais pour toute la zone Euro. La dette publique s’élève à près de deux mille milliards d’euros. Le coût des emprunts du gouvernement menace d’étrangler l’économie italienne, à terme.
Le chômage augmente. Au cours des trois dernières années, un million de personnes de 25 et 34 ans ont perdu leur emploi. Seuls 4 adultes sur 10 de moins de 35 ans travaillent. Officiellement, il y a plus de trois millions de chômeurs au total, mais de nombreuses personnes ont renoncé à chercher un travail et ne sont plus comptabilisées. En 2012, plus de 9 millions de personnes étaient considérées comme pauvres, parmi lesquelles 4,4 millions vivent dans des conditions de pauvreté absolue.
Une récente enquête réalisée par Legacoop (la principale chaîne de supermarchés) confirme ce qui est évident depuis un certain temps : trois millions de ménages, soit 12,3 % de la population, ne peuvent pas se permettre un repas riche en protéines tous les deux jours ; 9 millions d’Italiens seraient dans l’impossibilité de répondre à une dépense imprévue de 800 euros. Les Italiens abandonnent de plus en plus l’idée d’utiliser une voiture (25 % de la population), ne partent plus en vacances (4 millions de personnes en moins cet été) et n’achètent plus d’habits neufs (23 % de la population). Les dépenses en nourriture au cours des six dernières années ont chuté de 14 %, tombant au niveau de 1971 (2400 euros par tête).
Le FT décrit les tâches auxquelles est confrontée l’Italie comme « économiquement douloureuses et politiquement suicidaires ». (7/10/13) Le capitalisme italien ne peut pas rivaliser avec l’Allemagne et la France. Il est à la traîne. Par le passé, il aurait dévalué sa monnaie, mais avec l’euro, cette voie est bloquée. Au lieu de cela, il lui faut recourir à une « dévaluation interne », c’est-à-dire à de profondes coupes dans les niveaux de vie. Mais pour cela, il faut un gouvernement fort. Or c’est impossible.
Tous les partis italiens sont divisés. Dans le PD, il y a une scission entre le vieil appareil du PC et les éléments ouvertement bourgeois de la Démocratie Chrétienne. Le petit parti de Monti est déchiré par des fractions et on s’attend à ce qu’il tombe de 10 à 4 % aux prochaines élections. Même le Mouvement 5 Étoiles de Grillo est divisé, certains dirigeants s’orientant clairement vers une collaboration avec le PD.
Les dirigeants syndicaux ont joué un rôle pernicieux en appuyant le soi-disant gouvernement d’union nationale, avalant toutes les mesures d’austérité contre la classe ouvrière. C’est particulièrement vrai des dirigeants « de gauche » du syndicat des métallurgistes, la FIOM, qui après avoir suscité de l’espoir chez les travailleurs, les a ensuite démoralisés en se joignant au dirigeant Camusso de la CGIL pour signer un document commun pour le congrès du CGIL. Nous voyons ici le rôle du réformisme de gauche en action. Les dirigeants syndicaux de l’aile droite s’accrochent à la bourgeoisie – et les dirigeants syndicaux de gauche s’accrochent à l’aile droite. Aucun d’entre eux ne croit en la classe ouvrière, qui se retrouve sans direction à un moment critique.
La trahison des dirigeants peut mener temporairement à l’apathie et à la démoralisation. Mais ce ne sera pas la fin de l’histoire. Les travailleurs italiens – comme les Espagnols, les Grecs et les Français –, ont une longue tradition de mouvements insurrectionnels spontanés. Bloqués par leurs organisations traditionnelles de masse, ils trouveront une voie pour exprimer leur colère de manière explosive. Telle fut la signification de « l’Automne chaud » de 1969. Les cinq jours de grève reconductible des travailleurs des transports de Gênes, en novembre 2013, montrent l’humeur réelle qui se développe au sein de la classe ouvrière italienne. De tels développements sont implicites dans la situation actuelle en Italie. Et c’est encore plus vrai dans le cas de la jeunesse.
L’Espagne
Cinq ans après le début de la récession, l’économie de l’Espagne va encore chuter de 1,4 % en 2013. Le chômage est au niveau record de 27 % de la population active, avec un chômage des jeunes à 57 %. Plus de 6 millions d’emplois ont été détruits depuis 2007 ; des centaines de milliers de jeunes ont été forcés d’émigrer.
Après plusieurs années de mesures d’austérité massives, le déficit budgétaire en 2013 devrait atteindre 6,5 % du PIB, alors que la dette approche les 100 % du PIB. Les mesures d’austérité combinées à des contre-réformes radicales sur le marché du travail ont permis à l’Espagne de regagner en compétitivité vis-à-vis de ses voisins européens. En d’autres termes, les travailleurs ont payé le prix fort de la crise du capitalisme. Et malgré toutes ces souffrances, les économistes ne prévoient au mieux qu’une reprise de 0,2 % en 2014 – et peut-être 1 % en 2015. Sur cette base, il faudrait attendre 2021 pour en revenir tout juste le niveau d’avant la récession, soit près de 15 années de perdues !
La vérité est que l’énorme quantité de dettes des entreprises, des ménages et de l’État, accumulée durant les longues années de boom, n’a toujours pas été absorbée par le système. Or c’est la condition première pour qu’il y ait une reprise réelle et durable du capitalisme espagnol. Les prévisions « optimistes » actuelles sont basées sur l’hypothèse d’une reprise des exportations, ce qui dépend complètement de la sortie de l’Europe de la récession. La base de cet optimisme est donc très fragile.
L’impact de la crise économique sur la conscience des masses a été profond et sera durable. À la récession économique, nous devons ajouter les scandales de corruption qui l’accompagnent et affectent toutes les institutions de la démocratie bourgeoise (la justice, la Monarchie, le congrès, le parti au pouvoir). Ce que l’on voit en Espagne est une crise du régime qui défait tout l’édifice sur lequel la classe dirigeante a construit sa légitimité depuis la fin de la dictature de Franco. Tous les vieux fantômes du passé reviennent hanter la faible et rétrograde bourgeoisie espagnole. La question nationale en Catalogne, alimentée par la crise économique, est relancée. La lutte pour la justice pour les victimes du régime de Franco revient au premier plan, révélant le caractère réactionnaire de l’appareil d’État et de la classe dirigeante, sous un mince vernis de démocratie.
Il y a eu de nombreuses vagues de mobilisations de masse, particulièrement depuis 2011. Le mouvement des Indignés, le mouvement anti-expulsions, les grèves dans l’éducation, la lutte des mineurs, le mouvement spontané des fonctionnaires, deux grèves de 24h, etc. Bien sûr, les masses ne peuvent pas être en état de mobilisation permanente et il y aura des hauts, des bas et des périodes de pause. Cependant, la colère qui s’est accumulée sous la surface et qui ne trouve pas de canal d’expression est toujours là – et elle peut donner lieu des explosions à tout moment.
Le Portugal
Le Portugal est embourbé dans la récession, avec une prévision de contraction de son PIB pour 2013 située entre 1,6 et 2,7 %, et pour 2014 (peut-être) une légère croissance. Le chômage atteint le taux record de 16 %. Le gouvernement n’atteindra pas ses objectifs de réduction des déficits en 2013 (l’objectif était 5,5 % du PIB, mais le vrai chiffre sera plutôt 6 %), malgré des années de coupes budgétaires massives imposées par le renflouage de 78 milliards d’euros de l’UE.
Le budget 2014 prévoit de nouvelles coupes dans les salaires du secteur public – de 2 à 12 %, selon les catégories de travailleurs – ainsi que 728 millions d’économies sur les retraites. 3,3 milliards de coupes et un nouveau « plan de sauvetage » sont programmés pour 2014. Tout ceci a mené à un effondrement du soutien au gouvernement de droite. Les partis au pouvoir ont été sévèrement sanctionnés lors des élections locales de 2013. « L’environnement politique se détériore », se plaint le FT.
Après avoir servilement appliqué toutes les mesures d’austérité exigées par les dirigeants de l’UE et du FMI, le gouvernement portugais – qui a besoin d’un nouveau renflouage – leur demande « un peu de temps ». Mais les argentiers de la Troïka ne sont pas d’humeur patiente. Ils ne prêteront pas d’argent au Portugal sans des garanties solides que le programme d’austérité se poursuivra. Cela provoquera des nouvelles mobilisations massives des jeunes et des travailleurs.
Lorsqu’il a été élu en juin 2011, Passos de Coelho se flattait d’être le bon élève de la Troïka. À présent, c’est le dirigeant affaibli d’une coalition divisée et détestée du peuple. Le 27 juin 2013, son gouvernement a failli être renversé par une grève générale, qui faisait suite à d’autres puissantes mobilisations de masse.
La classe ouvrière portugaise redécouvre les traditions de la révolution de 1974-75. Un million de personnes est descendu dans la rue en septembre 2012, puis 1,5 million en mars 2013. Le problème, c’est la direction du mouvement. Le Parti Socialiste, qui avait signé les conditions drastiques du « sauvetage » juste avant de perdre le pouvoir, est toujours discrédité. Il ne progresse qu’en pourcentage, sur fond d’abstention croissante.
Le Parti Communiste Portugais (PCP) est le principal bénéficiaire de l’actuelle vague de mécontentement. Cependant, les deux partis à la gauche du PS (le PCP et le Bloc de Gauche) n’ont pas de programme sérieux. Le PCP avance la perspective d’une économie « patriotique et démocratique » ayant rompu avec la zone euro (sur la base du capitalisme). Quant au Bloc de Gauche, il défend le programme réformiste et keynésien d’une « Europe sociale » (là encore, sur la base du capitalisme).
La Grèce
Après cinq années de politiques de rigueur implacables, les problèmes de la Grèce sont plus graves que jamais. La politique sauvage de la Troïka a plongé le pays dans une profonde récession. 1,4 million de personnes sont au chômage, dont deux jeunes sur trois. Une grande pauvreté inédite depuis les années de guerre se généralise.
Le gouvernement d’Athènes se plaint (à juste titre) que les coupes exigées par Bruxelles aggravent la crise économique, minent les recettes fiscales, donc creusent les déficits et poussent la Grèce à s’endetter davantage. Mais les Allemands et autres prêteurs lui répondent que les pays d’Europe du Sud ont vécu au-dessus de leur moyen et doivent « apprendre la discipline ».
Chaque « plan de sauvetage » n’a permis que de gagner un peu de temps. Mais les marchés ne sont pas dupes. Le dénouement de la crise en Grèce n’est que retardé, mais il est inévitable.
En même temps, la Grèce présente de nombreuses opportunités aux spéculateurs financiers. Le FT a publié un article intitulé : La Grèce, terre d’opportunités pour les fonds de pension. On y lit :
« Le secteur bancaire grec a suscité beaucoup d’intérêt. Paulson & Co, Baupost, Dromeus, York Capital, Eaglevale et OchZiff ont acheté des parts d’Alpha Bank et de Piraeus Bank. Ils ont encaissé de beaux profits. Cette spéculation frénétique pourrait aboutir à la domination du secteur bancaire grec par les fonds de pension internationaux. »
Le pillage de la Grèce et l’effondrement des niveaux de vie ont provoqué une vague de grèves générales et de manifestations massives. Deux gouvernements ont déjà chuté. Celui de Samaras lutte pour maintenir une coalition fragile qui ne peut durer très longtemps. Le principal bénéficiaire en sera Syriza. Mais à droite, l’Aube Dorée a également grandi.
Certains en ont tiré la conclusion erronée qu’il y a un danger imminent de fascisme en Grèce. En fait, ce qui s’est passé avec l’Aube Dorée confirme nos perspectives à ce sujet. La bourgeoisie grecque est vicieuse et réactionnaire ; une partie serait sans doute prête à transférer le pouvoir à Aube Dorée, si elle le pouvait. Le fait est que la section la plus réactionnaire de la classe dirigeante (les armateurs) a ouvertement financé et soutenu Aube Dorée.
À la différence d’autres formations d’extrême droite en Europe qui, comme le FN en France ou Fini en Italie, cherchent à se dissocier du fascisme et à présenter une image « respectable », Aube Dorée est une organisation ouvertement fasciste dont les liens étroits avec les officiers de la police et de l’armée sont notoires. Ces fanatiques avaient leur propre agenda, qui semblait comprendre la conquête du pouvoir.
Cependant, la classe ouvrière est grecque est puissante, militante et n’a pas subi de défaite majeure au cours de la dernière période. Aussi la bourgeoisie grecque redoute-t-elle qu’une action prématurée des fascistes provoque une réaction massive incontrôlable. L’assassinat d’un rappeur de gauche connu, le 18 septembre dernier, a provoqué une explosion de colère dans les rues d’Athènes. En réponse, la classe dirigeante a dû prendre des mesures contre l’Aube Dorée.
Bien sûr, la bourgeoisie n’a pas l’intention d’éliminer les fascistes. Les mesures prises, très limitées, ne visaient qu’à calmer la colère des jeunes et des travailleurs. Les fascistes se regrouperont sous une autre bannière, sans doute dans le cadre d’une coalition de droite, en se donnant une image plus « respectable » (moins nazie). Dans le même temps, les éléments les plus enragés du lumpenprolétariat continueront de jouer le rôle d’auxiliaires de l’appareil d’État (auquel ils sont organiquement liés) : ils s’en prendront à des militants de gauche, des piquets de grève, des immigrés, etc.
La perspective immédiate, en Grèce, n’est ni le fascisme, ni le bonapartisme, mais une nouvelle poussée vers la gauche. L’inévitable chute du gouvernement de Samaras posera la question d’un gouvernement dirigé par Syriza. Or plus Tsipras s’approche du pouvoir, plus il modère son discours dans l’espoir de capter davantage de voix. Mais c’est l’inverse qui se produit : cette modération engendre un scepticisme croissant du peuple grec, qui a accumulé beaucoup d’expérience en matière de promesses non tenues.
Le véritable état d’esprit des masses est bien résumé dans un sondage récent, qui montre que les travailleurs commencent déjà à tirer des conclusions révolutionnaires. Ce sondage révèle que 63 % des Grecs veulent un « profond changement » dans la société (ce qui signifie une révolution), cependant que 23 % d’entre eux disent directement vouloir une révolution. Le problème, ce n’est pas la maturité révolutionnaire des masses, mais le fait qu’aucun parti ou dirigeant ne soit prêt à donner une expression consciente au brûlant désir des masses de changer la société.
Au cours des quatre ou cinq dernières années, les travailleurs grecs ont largement montré leur détermination à changer la société. Ils se sont engagés dans toute une série de grèves générales. Mais la gravité de la crise est telle que même les grèves et les manifestations ponctuelles, même très militantes, ne peuvent pas régler le problème. En conséquence, les appels à des grèves générales de 24 heures rencontrent de moins en moins d’écho dans les entreprises. Bloqués sur la voie des grèves et des manifestations, les travailleurs se mobiliseront sur le plan électoral. Tôt ou tard, ils éliront un gouvernement de gauche. Syriza sera confronté à l’alternative suivante : soit appliquer une politique véritablement socialiste, soit accepter de gérer le capitalisme grec corrompu et pourrissant. Cela marquera une nouvelle étape de la révolution grecque – et ouvrira de grandes possibilités aux marxistes grecs.