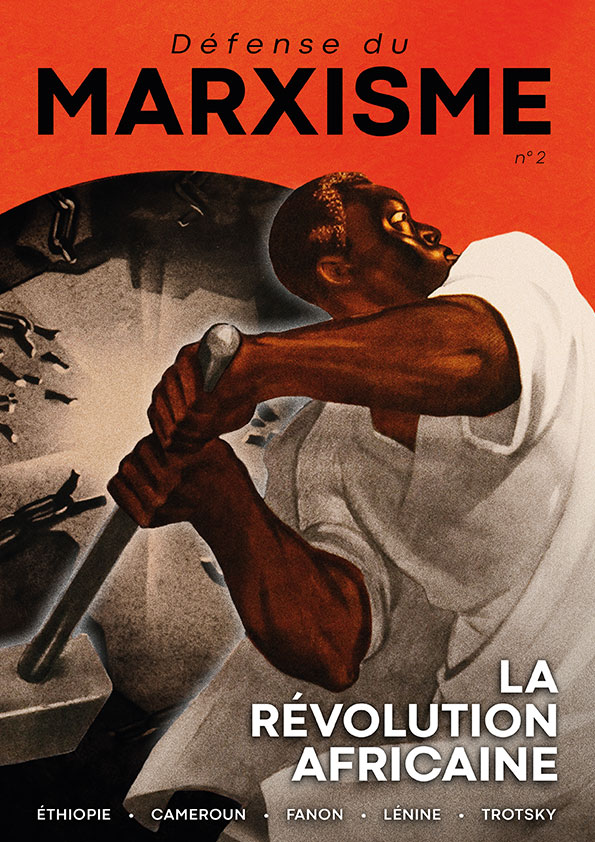La rédaction de ce texte a été achevée en mars 2006
Les leçons d’Haïti
L’impérialisme américain ne sait plus trop quoi faire. Face à la vague d’opposition, Washington ne dicte plus le cours des événements : il ne fait qu’y réagir. Toutes les initiatives qu’il tente échouent les unes après les autres. Par le passé, la situation au Venezuela aurait entraîné une intervention militaire - mais c’est aujourd’hui exclu, à court terme. Comme on l’a dit, Washington aimerait pouvoir s’appuyer sur d’autres pays de la région, et ont tenté d’utiliser la Charte Démocratique de l’OEA pour intervenir au Venezuela. Mais cela n’a mené nulle part. Des dirigeants comme Lula, que Washington considère, dans une certaine mesure, comme un allié, n’ose pas faire le sale boulot des Etats-Unis au Venezuela, car il en craint les répercussions politiques au Brésil même.
Washington en est donc réduit à des manoeuvres et des intrigues. Ils tentent de se constituer une base par une combinaison de corruption, de pressions et des menaces. Washington ne s’est risqué à intervenir militairement que dans des pays faibles des Caraïbes : Haïti et Grenade. Et même là, les résultats n’ont pas été ceux qu’il escomptait. Quiconque veut comprendre les véritables motivations de l’impérialisme américain n’a qu’à porter son regard sur la petite île d’Haïti.
En février 2004, l’armée américaine a enlevé le président haïtien Jean-Bertrand Aristide, avant d’envoyer une force d’occupation appuyée par les impérialistes canadiens et français. Aristide n’a jamais été un vrai révolutionnaire, et il s’est même laissé manipuler par l’impérialisme américain, qui a tenté d’en faire sa marionnette. Mais comme il s’est avéré un allié peu fiable, Washington l’a lâché sans autre forme de procès et, pour le renverser, s’est appuyé sur les éléments les plus mafieux et les plus dépravés de l’île.
Les événements haïtiens présentent un modus operandi semblable aux actions impérialistes sur tout l’hémisphère. Avant le coup d’Etat, les puissances occidentales ont redirigé l’aide vers des ONG opposées à Aristide, cependant que la CIA armait, entraînait et finançait les paramilitaires de droite. Avant que les paramilitaires ne puissent atteindre la capitale, les soldats américains et canadiens y sont entrés, ont occupé la « vacance de pouvoir » et ont préparé le terrain à une occupation des soldats de l’ONU.
Malgré la présence de 9000 soldats de l’ONU et policiers, les impérialistes ont été incapables de stabiliser Haïti. 76% des haïtiens vivent avec moins de 2 dollars par jour, et l’espérance de vie y est d’à peine 51 ans. Les pauvres des bidonvilles soutiennent toujours massivement le parti Lavalas d’Aristide, malgré les rafles fréquentes du gouvernement et des « escadrons de la mort » soutenus par les soldats de l’ONU. Il y a 700 prisonniers politiques dans les prisons du pays - dont l’ensemble de la direction du Lavalas.
Les « démocrates » impérialistes avaient placé tous leurs espoirs dans des élections truquées, qui ont été repoussées à maintes reprises. Mais lorsque ces élections ont enfin eu lieu - sur fond de fraude généralisée - des manifestations massives ont forcé la Commission Electorale Provisoire à accepter la victoire de René Préval. Les manifestations ont paralysé Port-au-Prince pendant 4 jours, terrorisant les impérialistes. Au terme de deux sombres et longues années, les Haïtiens, par l’action révolutionnaire de masse, ont fait échec au coup d’Etat qui avait renversé Aristide. Ce fut un coup dur pour les impérialistes et les forces réactionnaires de l’île.
Par le passé, lorsqu’il y avait un problème quelque part sur l’hémisphère occidental, Washington envoyait ses Marines. Le lendemain, la « une » des journaux annonçait : « les Marines ont débarqué et la situation est sous contrôle ». Les choses ont bien changé. La plus grande puissance mondiale a du mal contrôler une petite île extrêmement pauvre et sans armée. C’est une claire illustration des limites du pouvoir de l’impérialisme américain.
Cuba
A Cuba, on assiste aussi à d’importants changements. L’analyse des perspectives pour la révolution cubaine exige un document spécifique, mais une chose est claire : son destin est inextricablement lié à celui de la révolution dans le reste de l’Amérique latine. Le développement de la révolution vénézuelienne a déjà donné un certain répit à Cuba, et au fur et à mesure que la révolution au Venezuela et dans le reste du continent se développera, cette influence croîtra. C’est un fait qui renforce l’inquiétude des impérialistes.
Après la chute de l’Union Soviétique, la révolution cubaine s’est trouvée isolée dans un environnement international hostile. Elle a subi les pressions acharnées de l’impérialisme américain. Le blocus économique a infligé des souffrances intolérables à la population. Le sort de la révolution était en jeu. L’effondrement de l’URSS a naturellement provoqué une effervescence sur l’île, y compris aux plus hauts niveaux. Il est clair qu’à Cuba, comme autrefois en Russie, il y a des éléments qui souhaitent la restauration du capitalisme. Mais d’une part, Fidel Castro reste implacablement opposé à la restauration du capitalisme, et d’autre part, les masses restent fermement attachées aux idéaux de la révolution, au socialisme et à l’économie planifiée. Pour le moment, toutes les tentatives de l’impérialisme américain de restaurer le capitalisme à Cuba ont échoué. Castro reste populaire et les éléments pro-capitalistes sont fermement tenus sous contrôle.
La révolution vénézuelienne a indubitablement redonné un souffle à la révolution cubaine. Non seulement elle a fourni à Cuba le pétrole dont elle avait tant besoin, mais elle a aussi donné au peuple cubain l’espoir que son isolement serait bientôt brisé. Les destins de ces deux révolutions sont étroitement lié : elles vaincront ou tomberont ensemble. Un pas décisif vers l’économie planifiée, au Venezuela, non seulement affaiblirait les tendances pro-capitalistes de la bureaucratie d’Etat cubaine et renforcerait les éléments favorables à l’économie planifiée, mais cela pourrait aussi avoir une influence sur les masses et sur les secteurs de l’Etat cubain qui sont les plus à gauche, les plus liés au peuple.
Récemment, Fidel Castro a prononcé un discours où il a prévenu que la révolution cubaine n’est toujours pas irréversible. Qui plus est, il a affirmé que la menace de restauration capitaliste la plus importante résidait dans des facteurs intérieurs, et non extérieurs. C’est la première fois que Castro le formulait aussi clairement. Castro a même cité des exemples de corruption, de fraude et de vol - en particulier dans le domaine de l’essence. Il a proposé la création de brigades de jeunes militants pour effectuer des inspections dans les stations d’essence.
La restauration du capitalisme à Cuba serait un désastre, non seulement pour le peuple cubain, mais pour toute l’Amérique latine. Pour le peuple cubain, l’imposition d’une économie de marché sauvage constituerait une régression dramatique sur les plans économique, social et culturel. Plus généralement, cela aurait des effets très négatifs sur le moral des travailleurs et de la jeunesse du monde entier. Cela renforcerait la mainmise de l’impérialisme et ouvrirait la voie à une nouvelle offensive idéologique contre le socialisme, à l’échelle mondiale. Cela signifierait aussi une intensification immédiate des pressions impérialistes sur le Venezuela et la Bolivie.
Les hypocrites détracteurs occidentaux de Cuba, comme l’opposition bourgeoise locale, martèlent leur exigence de « démocratie » - par quoi ils entendent la démocratie bourgeoise, bien sûr. Ils veulent introduire un système comme celui qui existe aux Etats-Unis, où le poste de président revient, comme dans des enchères, au plus offrant (en l’occurrence, un multi-millionnaire texan mentalement déficient) ; où le Congrès est dirigé par des politiciens vénaux qui représentent les intérêts des grandes entreprises, lesquelles vendent et achètent les sénateurs comme n’importe quelle autre marchandise ; où les médias écrits et télévisuels, enfin, sont contrôlés par une poignée de millionnaires. Bien entendu, la revendication d’une telle « démocratie » est étroitement liée à la revendication de l’abolition de l’économie planifiée.
Dans les années 30, Trotsky prédisait que la bureaucratie stalinienne finirait par mener l’URSS à la restauration du capitalisme. Les bureaucrates, expliquait-il, ne se contenteraient pas de leur position privilégiée, et voudraient démanteler l’économie planifiée et nationalisée de façon à pourvoir se convertir en propriétaires individuels. Le droit d’héritage - le droit légal de transmettre ses richesses et privilèges à ses enfants - a joué un rôle clé dans ce processus. Après un long délai, la prédiction de Trotsky s’est réalisée.
Cependant, Trotsky pensait que la restauration du capitalisme en URSS ne pourrait être accomplie qu’au terme d’une guerre civile. Il pensait que la bureaucratie se diviserait suivant une ligne de classe, avec l’émergence d’une fraction de gauche (la « fraction Reiss ») et d’une fraction pro-capitaliste (la « fraction Butenko »). Mais les événements ont pris une autre tournure. Le stalinisme, en URSS, a duré beaucoup plus longtemps que Trotsky ne l’imaginait possible. Les vieilles traditions révolutionnaires ont été complètement détruites. La dégénérescence de la bureaucratie a atteint des degrés inouïs. La corruption et le bureaucratisme absorbaient une immense partie des richesses produites par la classe ouvrière soviétique, et minaient les succès de l’économie planifiée. En conséquence, tout s’est écroulé sous son propre poids : une seule poussée a suffi pour renverser tous les régimes bureaucratiques d’Europe de l’Est - et peu de temps après, le même processus s’est déroulé en Russie.
Il y a d’importantes différences entre ce qui s’est produit en Russie et la situation à Cuba. En Russie, la mémoire des traditions d’Octobre avait été complètement détruite. Cela a facilité le travail de la contre-révolution. Par contraste, la révolution cubaine est encore relativement proche, dans le temps, et vivante dans les mémoires. Parmi la vieille garde des révolutionnaires, nombreux sont prêts à lutter contre toute restauration du capitalisme. Une large partie des masses est prête, également, à défendre les conquêtes de la révolution. Cela signifie q’une transition « froide » vers le capitalisme est un scénario beaucoup moins probable qu’en Russie et en Europe de l’Est.
Fidel Castro et ses partisans essayent de résister aux pressions capitalistes et de défendre l’économie planifiée. C’est d’une immense importance. Mais les méthodes qu’ils veulent utiliser ne résoudront pas le problème. Seul un régime de démocratie ouvrière, un régime léniniste, peut y réussir. L’offensive contre les « nouveaux riches », les éléments corrompus, la bureaucratie, etc., ne peut être victorieuse que si elle est liée au programme de la démocratie ouvrière, c’est-à-dire au programme avancé par Lénine en 1917 et qui a constitué la base du programme de 1919 du Parti Communiste russe - lequel a été supprimé par Staline après la mort de Lénine.
Ce dont Cuba a besoin, ce n’est pas d’une caricature hypocrite de la démocratie bourgeoise, mais d’un encouragement à la critique et au débat - un débat ouvert à toutes les tendances politiques qui acceptent l’économie planifiée, et sont prêtes à défendre la révolution cubaine et à lutter contre la restauration capitaliste. Les trotskistes doivent participer à ce débat, au titre de courant légitime de la famille communiste. Ils proposeront un front uni avec les communistes cubains qui luttent contre la restauration capitaliste. Ils montreront, par leurs actions, qu’ils sont les défenseurs les plus loyaux de la révolution cubaine.
Par-dessus tout, il faut étendre la révolution socialiste au reste de l’Amérique latine. Cela brisera définitivement l’isolement de la révolution cubaine. Après tout, c’était là l’idée de Che Guevara - qui lui a sacrifié sa vie. Aujourd’hui, les conditions sont beaucoup plus favorables à la révolution socialiste dans les pays de l’Amérique latine. Il ne s’agit pas d’« exporter la révolution » (comme si on pouvait exporter les révolutions, à la façon de sacs de café). Les conditions objectives de la révolution socialiste mûrissent rapidement - ou sont dores et déjà mures - dans plusieurs pays du continent. Ce qu’il faut, c’est une direction courageuse et audacieuse : une direction de la trempe d’un Bolivar et d’un Guevara - et non de lâches réformistes.
La revolution latino-américaine
Aujourd’hui, l’Amérique latine est la région au monde la plus avancée, d’un point de vue révolutionnaire. Des mouvements révolutionnaires se développent à travers le continent. Nous n’avons pas affaire à la révolution vénézuélienne, mais avec la révolution latino-américaine, un chaînon essentiel de la révolution mondiale. La situation en Equateur et en Bolivie est connectée avec le Venezuela. Les impérialistes américains le savent - et nous le savons aussi. L’ensemble du processus est organiquement interconnecté. Partout, en Amérique latine, les conditions objectives de la révolution mûrissent rapidement. Le facteur subjectif est une autre question.
L’Amérique latine est par conséquent la clé de la révolution mondiale, et la révolution vénézuélienne la clé de la révolution latino-américaine. C’est pour cela que l’impérialisme américain est déterminé à écraser la révolution vénézuélienne avant qu’elle ne s’étende à d’autres pays. Hugo Chavez a dit publiquement que Trotsky avait raison contre Staline lorsqu’il disait que la révolution ne pouvait pas survivre si elle restait confinée à un pays. Pour être victorieuse, la révolution bolivarienne ne doit pas s’arrêter à mi-chemin. Elle ne peut vaincre qu’en expropriant les propriétaires terriens et les capitalistes - puis en appelant les travailleurs et paysans de l’Amérique latine et du monde entier à suivre l’exemple du Venezuela.
Malgré son incomplétude, ses confusions, ses contradictions internes, la révolution bolivarienne est un exemple pour le reste de l’Amérique latine. Chavez a lancé une chaîne de télévision, Telesur, qui diffuse sur l’ensemble du continent et des parties des Etats-Unis. Washington proteste vivement contre cet acte « d’interférence dans les affaires d’autres pays », en oubliant que la CNN déverse sa propagande dans le monde entier - sans parler de ces autres formes d’interférences que pratique la CIA à l’échelle mondiale.
Le mot d’ordre « Pour une fédération socialiste de l’Amérique latine » acquiert désormais une importance vitale. Le regain d’intérêt pour les idées de Bolivar a mis clairement à l’ordre du jour la question de l’unité de l’Amérique latine. La lutte des masses pour l’unité a un caractère révolutionnaire et anti-impérialiste. Les travailleurs, les paysans, la jeunesse révolutionnaire et l’intelligentsia progressive en sont arrivés à la conclusion correcte que la balkanisation de l’Amérique latine l’affaiblit et la met à la merci de l’impérialisme américain.
Il faut se poser la question : comment se fait-il que cet immense continent, qui regorge de minéraux, de pétrole, de bétail, de blé, et où existent toutes les conditions nécessaires pour créer un paradis sur terre - comment se fait-il qu’il soit un enfer pour des millions d’hommes et de femmes ? Pendant plus de deux siècles, les pays d’Amérique latine ont été formellement indépendants. Mais cette soi-disant indépendance n’est qu’une mince voile recouvrant une dépendance servile à l’égard des Etats-Unis et de ses entreprises multinationales, qui ont monstrueusement pillé les richesses de ce continent.
Quelle est la raison de la prostration de cet immense continent ? Après la mort de Simon Bolivar, les oligarchies - les propriétaires terriens, les banquiers et les capitalistes - d’Amérique latine ont trahi son rêve d’une unité de l’Amérique latine et des Caraïbes. Ils ont divisé le corps vivant du continent en une série de mini-Etats qui n’ont aucune véritable raison d’exister. La véritable source du servage de l’Amérique latine, c’est sa balkanisation. Et la véritable source de cette balkanisation, c’est la domination des oligarchies. Aucune avancée ne sera possible tant qu’elles n’auront pas été renversées. L’action révolutionnaire est la seule voie.
Dans La Guerre et la Quatrième Internationale (juin 1934), Trotsky écrivait :
« L’Amérique centrale et l’Amérique du Sud ne pourront s’arracher à l’arriération et à l’esclavage qu’en unissant leurs Etats dans une fédération puissante. Mais ce n’est pas la tardive bourgeoisie sud-américaine, agence vénale de l’impérialisme étranger, qui sera appelée à résoudre cette tâche, mais le jeune prolétariat sud-américain, dirigeant choisi par les masses opprimées. Le mot d’ordre, dans la lutte contre la violence et les intrigues de l’impérialisme mondial et contre la sanglante besogne des cliques indigènes compradores, est donc : Etats-Unis socialistes d’Amérique centrale et du Sud. »
Les marxistes sont inconditionnellement favorables à l’unification de l’Amérique latine. Mais on propose un amendement à l’idée de Bolivar. Les deux derniers siècles ont prouvé de façon nette qu’il n’est pas possible d’unir l’Amérique latine sur la base du capitalisme. Depuis la mort de Simon Bolivar, la bourgeoisie corrompue et dégénérée d’Amérique latine a vendu son héritage pour une poignée de dollars. Les propriétaires terriens, les banquiers et les capitalistes latino-américains ne sont que les valets de l’impérialisme. Ils sont incapables de jouer le rôle qu’ont joué, par le passé, les bourgeoisies britannique et française. Ils représentent, partout, un obstacle au progrès. C’est clairement démontré par la conduite de la bourgeoisie pourrissante et contre-révolutionnaire du Venezuela et des ses cousins boliviens. Aucun progrès ne sera possible tant que le pouvoir économique restera entre les mains des propriétaires terriens et des capitalistes. Il faut briser ce pouvoir. La seule classe qui peut accomplir cette tâche et réaliser l’ambition de Bolivar, c’est la classe ouvrière. Ce n’est que lorsque les travailleurs auront le pouvoir que les monstrueuses barrières artificielles pourront être balayées et l’Amérique latine unifiée - dans le cadre d’une Fédération Socialiste.
Une nouvelle vague révolutionnaire
Shakespeare écrivait : « il y a une marée dans les affaires humaines. » Cela vaut aussi pour la lutte des classes, qui procède par flux et reflux sur une longue période historique. Dans les années 70, il y avait une grande vague de luttes à l’échelle internationale. Commençant avec la révolution de 1968, en France, elle a traversé toute l’Europe, affectant un pays après l’autre : le Portugal, l’Espagne, l’Italie et la Grande Bretagne. Il y avait également une révolution au Pakistan, où la classe ouvrière a joué le rôle dirigeant, comme dans la Russie de 1917. Des situations révolutionnaires ont également émergé au Chili et en Argentine.
Dans tous ces pays, les travailleurs les plus conscients sentaient qu’ils avaient le pouvoir entre les mains. Et ils n’avaient pas tort. Au Portugal, ils avaient le pouvoir. A l’époque de la révolution portugaise, le London Times avait publié un éditorial ayant pour titre : Le capitalisme est mort au Portugal. Les travailleurs avaient le pouvoir, mais ils l’ont perdu à cause de la politique du Parti Socialiste et du Parti Communiste. Plus tard, la même histoire s’est répétée en Espagne et en Italie : le pouvoir a glissé des mains de la classe ouvrière.
Au Pakistan, la politique de Butto a sapé la révolution de 68 et mené à son propre assassinat et à l’instauration de la dictature de Zia al Huq. En Amérique latine, la vague révolutionnaire a été gâchée, en partie à cause du réformisme, et en partie à cause de la tactique incorrecte de la guérilla. Le résultat, ce fut l’instauration de dictatures militaires féroces au Chili, en Argentine et en Uruguay.
A cette époque, les classes dirigeantes de l’Europe « démocratique » se préparaient à la guerre civile et à la dictature militaire, non seulement en Italie, mais aussi en Belgique et en Grande Bretagne. Il y avait des conspirations militaires, comme la conspiration Gladio. C’est là un avertissement pour la période à venir. De nombreux travailleurs des pays capitalistes avancés pensent que la démocratie est acquise pour l’éternité. Mais en fait, lorsque les circonstances l’exigent, la classe dirigeante peut passer de la démocratie à la dictature aussi facilement qu’un homme change de chemise. La classe capitaliste ne tolère la démocratie qu’aussi longtemps que son pouvoir n’est pas menacé.
Dans la période à venir, il y aura une énorme polarisation de la société entre la droite et la gauche. La tendance révolutionnaire et la lutte des classes se développeront en même temps que des tendances fascistes et bonapartistes. Les attaques actuelles contre les droits démocratiques, au nom de la prétendue « guerre contre le terrorisme », n’en sont qu’une anticipation. Mais cela ne signifie pas que la réaction est une perspective immédiate. Avant que la classe dirigeante ne s’oriente vers une réaction ouverte, la classe ouvrière aura plusieurs occasions de changer la société.
Dans ces conditions, la conscience peut changer soudainement. C’est une loi générale que la conscience est à la traîne des évènements. Contrairement à ce que s’imaginent les idéalistes, la conscience humaine est profondément conservatrice. Elle résiste aux changements et aux nouvelles idées. Mais à un certain stade, la conscience rattrape brusquement son retard. C’est précisément cela, une révolution. La conscience de la classe ouvrière est à la traîne des évènements des vingt dernières années, en particulier en Europe et aux Etats-Unis. Il y a des raisons objectives à cela.
Quand le pouvoir échappe aux travailleurs alors qu’ils avaient l’opportunité de le prendre, cela a un effet profondément démoralisateur, en particulier sur l’avant-garde. Il faut beaucoup de temps avant que cet effet s’estompe. Une partie du problème vient de ce que l’avant-garde de la classe ouvrière, celle qui a dirigé les luttes des années 70, la vieille direction, est fatiguée et largement détruite. Pire : cette couche de la classe est devenue un obstacle. Elle est souvent victime de pessimisme et de démoralisation. Elle a perdu espoir dans sa classe et n’a pas de perspective.
La croissance économique des années 80 et 90 a renforcé ces tendances réactionnaires. La pression de la classe dirigeante et de son idéologie sur les organisations ouvrières - syndicats et partis de gauche - s’est aggravée. En conséquence, le caractère réformiste de ces organisations est devenu un obstacle sur la voie d’une transformation de la société. Cette période a mis le point final à la dégénérescence réformiste des Partis Socialistes et Communistes. Libérés de la pression de la classe ouvrière, ces partis sont allés très à droite.
Pour nous, les organisations de masse du salariat ne font pas partie du facteur subjectif, mais plutôt des facteurs objectifs - et elles sont un facteur très important. Ainsi, le « retard de la conscience » s’explique, dans une large mesure, par le fait que ces organisations n’étaient plus un point de référence pour la jeunesse et les travailleurs les plus avancés. Il est très à la mode, dans les cercles de l’intelligentsia de gauche, de mettre tous les problèmes sur le compte du « faible niveau de conscience des travailleurs ». Aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a même des gens qui tiennent ce discours au Venezuela. Mais il est très mauvais de blâmer les masses pour les erreurs de la direction.
Au cours de la dernière période, aucun dirigeant ne proposait un programme ou une perspective socialistes, sans parler de la prise du pouvoir. Les syndicats étaient passifs, cependant que le patronat détruisait des droits et des acquis sociaux arrachés de haute lutte. Les partis de gauche n’offraient aucune alternative aux réactionnaires bourgeois du type de Thatcher. Au contraire, ils imitaient les politiques de Thatcher, épousaient le « réalisme » - c’est-à-dire l’économie de marché - et expulsaient leurs ailes gauches.
Les travailleurs sont pragmatiques. Dans de telles conditions, alors leurs organisations ne les menaient pas au combat, ils ont cherché des solutions individuelles à leurs problèmes. La croissance économique leur a permis d’améliorer leur niveau de vie - quoique sur la base d’un énorme accroissement de la plus-value relative et absolue : allongement de la journée de travail, augmentation des cadences, de la productivité, etc.
Pendant toute une période, les travailleurs furent disposés à accepter la tyrannie patronale et tous ses abus : la pression à la productivité, les heures supplémentaires obligatoires, les attaques contre les droits syndicaux, etc. Ne voyant pas d’alternative, ils baissèrent la tête et continuèrent de se tuer à la tâche, avec moins de vacances, du travail le week-end et des heures supplémentaires. L’allongement de la durée du travail et l’épuisement qui l’accompagne ont eu pour conséquence une réduction de l’implication des salariés dans les syndicats et les partis de gauche. Cela, à son tour, a renforcé la main mise de l’aile droite sur ces organisations - et, en conséquence, le rejet de ces organisations par les salariés.
Mais cette recherche de solutions individuelles ne pouvait pas durer. Elle a eu des conséquences désastreuses : dépressions nerveuses, maladies physiques et psychiques, augmentations des accidents de travail, etc. L’accroissement massif de la plus-value relative et absolue a atteint ses limites. Les capitalistes ne peuvent indéfiniment pressuriser le salariat. Tôt ou tard, les travailleurs disent : « trop, c’est trop ! » A présent, on assiste aux débuts d’une réaction de la classe ouvrière, qui se reflète dans les statistiques des grèves, à l’échelle internationale. L’ensemble du processus repart dans la direction opposée.
Une perspective révolutionnaire
Lénine a écrit un article ayant pour titre : Matériel inflammable dans la politique mondiale. Aujourd’hui, le monde est plein de matériel inflammable. Il n’y a pas une région de la planète qui n’en est pas affectée. Il y a une énorme instabilité et une succession des chocs : guerre, terrorisme, violence et crises. Qu’est-ce que cela reflète ? L’impasse fondamentale d’un système socio-économique qui a atteint ses limites historiques.
Le capitalisme est dans l’impasse. Partout, on voit les symptômes de son terrible déclin. Nombreux sont ceux qui voient les symptômes négatifs : le déchaînement de la violence, les pertes en vies humaines, le gaspillage, la corruption, l’injustice, les inégalités, la faillite culturelle et le vide intellectuel. Ils voient tout cela et désespèrent. Mais les marxistes abordent l’histoire, non d’un point de vue sentimental ou moral, mais d’un point de vue scientifique et dialectique.
L’actuelle croissance économique n’est pas accompagnée par une augmentation du niveau de vie, mais plutôt par des coupes, une implacable pression sur les travailleurs et la destruction d’emplois. Cela mène, partout, à un regain de la lutte des classes. Telle est la phase par laquelle nous passons : un réveil général du mouvement ouvrier et une intensification de la lutte des classes. Du point de vue de la lutte des classes, une récession brutale, accompagnée d’une brusque flambée du chômage, pourrait provoquer une baisse du nombre de grèves. Mais elle pourrait aussi stimuler les occupations d’usines, et pousser les travailleurs à tirer des conclusions révolutionnaires. Dans tous les cas, les perspectives générales impliquent une augmentation de la lutte des classes, qui à un certain stade trouvera son expression dans les organisations de masse du salariat - aussi bien dans les partis de gauche que dans les syndicats. Cela ouvre, partout, des opportunités nouvelles et inédites pour la tendance marxiste, à condition de travailler correctement et de ne pas commettre trop d’erreurs.
Pris ensembles, tous les facteurs mentionnés ci-dessus indiquent très clairement que nous sommes à un tournant majeur de l’histoire mondiale. L’instabilité générale se reflète dans des modifications soudaines et profondes de la conscience des masses. De plus en plus de gens comprennent que la crise actuelle n’est pas secondaire ou conjoncturelle, mais profonde et de longue durée. L’idée que « le monde ne tourne vraiment pas rond » gagne toujours plus de terrain. Cela reflète, d’une façon confuse, une remise en cause du système capitaliste lui-même. La tache des marxistes, qui forment la section la plus consciente et la plus résolue de la classe, c’est de rendre conscient les efforts inconscients ou semi-conscients de la classe ouvrière pour changer la société.
Comme c’est souvent le cas, ce processus s’est d’abord exprimé dans la révolte de la jeunesse, en particulier des classes moyennes. Cela s’est reflété dans des développements tels que les manifestations altermondialistes, le mouvement contre la guerre et les Forums Sociaux. Ces mouvements n’avaient pas de dignification indépendante : ils étaient des symptômes de la crise grandissante du capitalisme international. La confusion politique de leurs idées et leur caractère amorphe correspondaient parfaitement à la première phase d’un processus révolutionnaire. Mais à présent, ces mouvements sont remplacés par un mouvement beaucoup plus sérieux, qui marque les premières manifestations d’un réveil de la classe ouvrière.
La principale raison du retard dans la mobilisation de la classe ouvrière est la faillite complète des directions des organisations traditionnelles du salariat. Ironie de l’histoire, c’est précisément au moment où le pendule politique repart rapidement vers la gauche que tous ces gens décident d’abandonner le socialisme et d’embrasser la collaboration de classe et la « modération ». Tony Blair n’est que l’exemple le plus flagrant. A divers degrés, tous les autres dirigeants « socialistes » et « communistes » se précipitent sur la même voie. Et tout ceci se passe au moment où les travailleurs et la jeunesse demandent une solution radicale à leurs problèmes.
Encore une fois, il y a le début d’une modification de la situation internationale. Il est évidemment impossible d’en prévoir le rythme exact. On peut seulement affirmer que le processus sera relativement long. Il y a à cela deux raisons fondamentales : d’une part, la profonde crise du système et la faiblesse des forces de la réaction ; d’autre part, l’absence du facteur subjectif, c’est-à-dire la crise de la direction de la classe ouvrière. En conséquence, la situation peut se prolonger pendant des années, avec des flux et des reflux.
Dans tous les pays, le rythme de la lutte des classes s’accélère. Cela n’ira pas en ligne droite. Des périodes d’avancées seront suivies de périodes de fatigue, d’apathie, de défaites et même de réaction. Mais chaque défaite ne sera que le prélude à de nouvelles luttes, jusqu’à ce que les choses soient finalement tranchées, dans un sens ou dans l’autre. La classe ouvrière se mobilisera, encore et encore, pour changer la société. Cela débouchera sur des situations révolutionnaires ou pré-révolutionnaires dans un pays après l’autre. La question du pouvoir se posera inéluctablement. En Amérique latine, c’est dores et déjà un fait.
Le devoir des marxistes, c’est d’apporter la clarté, d’expliquer aux travailleurs ce qui est nécessaire, de corriger les erreurs et de défendre le bon programme et la bonne stratégie. Cependant, on ne peut y parvenir par des proclamations sectaires, du bord de la touche. Il est absolument nécessaire d’avoir un programme correct, mais cela n’épuise nullement le problème. Il faut se frayer un chemin vers les masses, établir des liens avec elles, créer les conditions d’un dialogue fructueux entre les marxistes et les travailleurs, à commencer par les éléments les plus conscients et actifs de la classe (l’avant-garde). Et il va sans dire que pour toucher les masses, il faut être là où sont les masses.
La raison de notre succès, c’est le pouvoir de nos idées : les idées du marxisme. La théorie marxiste est un outil extraordinairement puissant. Lui seul nous permet de créer les cadres qui se connectent avec l’avant-garde du salariat et de la jeunesse, qui à leur tour nous lieront indissolublement aux masses. C’est ainsi que nous accumulons les forces nécessaires pour accomplir la révolution mondiale. Cependant, les idées en elles-mêmes ne suffisent pas. Nous devons avoir la volonté et l’enthousiasme nécessaires pour accomplir notre tâche principale : construire la Tendance Marxiste Internationale.
Nous devons recruter et éduquer les cadres à partir de la jeunesse révolutionnaire, des travailleurs militants et des vétérans du mouvement qui ont gardé leur esprit combatif et leur conscience de classe. Pour construire la tendance révolutionnaire, il faut de l’audace. Il n’y a pas de place pour le scepticisme dans notre mouvement. La direction doit donner le ton correct ; nous devons éduquer nos rangs dans l’esprit de l’optimisme révolutionnaire. Nous devons construire les forces du marxisme à l’échelle mondiale. Ce travail finira par être couronné de succès. Tôt ou tard, la classe ouvrière prendra le pouvoir dans un pays. Et la victoire de la classe ouvrière dans un pays transformera toute la situation à l’échelle mondiale.
Le 7 mars 2006