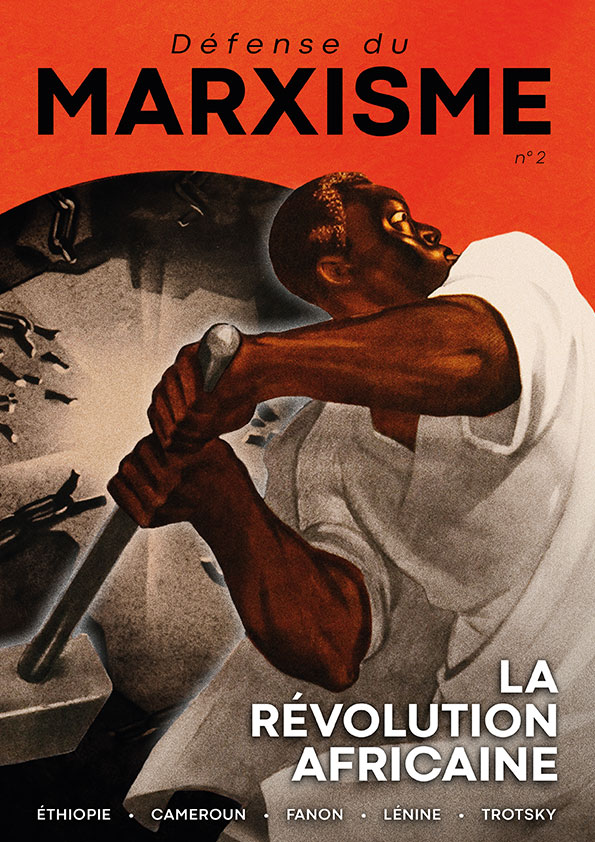PREFACE A LA PREMIERE EDITION
La question de l’Etat revêt de nos jours une importance particulière au point de vue théorique comme au point de vue politique pratique. La guerre impérialiste a considérablement accéléré et accentué le processus de transformation du capitalisme monopoliste en capitalisme monopoliste d’Etat. La monstrueuse oppression des masses laborieuses par l’Etat, qui se confond toujours plus étroitement avec les groupements capitalistes tout-puissants, s’affirme de plus en plus. Les pays avancés se transforment - nous parlons de leur "arrière" - en bagnes militaires pour les ouvriers.
Les horreurs et les calamités sans nom de la guerre qui se prolonge rendent la situation des masses intolérable et accroissent leur indignation. La révolution prolétarienne internationale mûrit manifestement. La question de son attitude envers l’Etat acquiert une importance pratique.
Accumulés pendant des dizaines d’années d’évolution relativement pacifique, les éléments d’opportunisme ont créé un courant de social-chauvinisme qui domine dans les partis socialistes officiels du monde entier. Ce courant (Plékhanov, Potressov, Brechkovskaïa, Roubanovitch, puis, sous une forme à peine voilée, les sieurs Tsérétéli, Tchernov et consorts en Russie ; Scheidemann, Legien, David et autres en Allemagne ; Renaudel, Guesde, Vandervelde en France et en Belgique ; Hyndman et les fabiens [1].en Angleterre, etc., etc.), ce courant, socialiste en paroles et chauvin en fait, se caractérise par une lâche et servile adaptation des "chefs du socialisme" aux intérêts non seulement de "leur" bourgeoisie nationale, mais plus précisément de "leur" Etat, car la plupart de ce qu’on appelle les grandes puissances exploitent et asservissent depuis longtemps nombre de peuples petits et faibles. La guerre impérialiste est précisément une guerre pour le partage et la redistribution de ce genre de butin. La lutte pour soustraire les masses laborieuses à l’influence de la bourgeoisie en général, et de la bourgeoisie impérialiste en particulier, est impossible sans une lutte contre les préjugés opportunistes à l’égard de "l’Etat".
Nous examinerons d’abord la doctrine de Marx et d’Engels sur l’Etat, et nous nous arrêterons plus particulièrement aux aspects de cette doctrine qui ont été oubliés, ou que l’opportunisme a déformés. Nous étudierons ensuite, spécialement, le principal fauteur de ces déformations, Karl Kautsky, le chef le plus connu de la Deuxième Internationale (1889-1914), qui a fait si lamentablement faillite pendant la guerre actuelle. Enfin, nous tirerons les principaux enseignements de l’expérience des révolutions russes de 1905 et surtout de 1917. A l’heure présente (début d’août 1917), cette dernière touche visiblement au terme de la première phase de son développement ; mais, d’une façon générale, toute cette révolution ne peut être comprise que si on la considère comme un des maillons de la chaîne des révolutions prolétariennes socialistes provoquées par la guerre impérialiste. Ainsi, la question de l’attitude de la révolution socialiste du prolétariat envers l’Etat n’acquiert pas seulement une importance politique pratique ; elle revêt un caractère d’actualité brûlante, car il s’agit d’éclairer les masses sur ce qu’elles auront à faire, pour se libérer du joug du Capital, dans un très proche avenir.
L’auteur, Août 1917.
CHAPITRE I
LA SOCIETE DE CLASSES ET L’ETAT
1. L’ETAT, PRODUIT DE CONTRADICTIONS DE CLASSES INCONCILIABLES
Il arrive aujourd’hui à la doctrine de Marx ce qui est arrivé plus d’une fois dans l’histoire aux doctrines des penseurs révolutionnaires et des chefs des classes opprimées en lutte pour leur affranchissement. Du vivant des grands révolutionnaires, les classes d’oppresseurs les récompensent par d’incessantes persécutions ; elles accueillent leur doctrine par la fureur la plus sauvage, par la haine la plus farouche, par les campagnes les plus forcenées de mensonges et de calomnies. Après leur mort, on essaie d’en faire des icônes inoffensives, de les canoniser pour ainsi dire, d’entourer leur nom d’une certaine auréole afin de "consoler" les classes opprimées et de les mystifier ; ce faisant, on vide leur doctrine révolutionnaire de son contenu, on l’avilit et on en émousse le tranchant révolutionnaire. C’est sur cette façon "d’accommoder" le marxisme que se rejoignent aujourd’hui la bourgeoisie et les opportunistes du mouvement ouvrier. On oublie, on refoule, on altère le coté révolutionnaire de la doctrine, son âme révolutionnaire. On met au premier plan, on exalte ce qui est ou paraît être acceptable pour la bourgeoisie. Tous les social-chauvins sont aujourd’hui "Marxistes" - ne riez pas ! Et les savants bourgeois allemands, hier encore spécialisés dans l’extermination du marxisme, parlent de plus en plus souvent d’un Marx "national-allemand", qui aurait éduqué ces associations ouvrières si admirablement organisées pour la conduite d’une guerre de rapine !
Devant cette situation, devant cette diffusion inouïe des déformations du marxisme, notre tâche est tout d’abord de rétablir la doctrine de Marx sur l’Etat. Pour cela, il est nécessaire d’emprunter toute une série de longues citations aux oeuvres mêmes de Marx et d’Engels. Sans doute ces longues citations alourdiront-elles l’exposé et ne contribueront-elles nullement à le rendre plus populaire. Mais il est absolument impossible de s’en dispenser. Tous les passages ou, du moins, tous les passages décisifs des oeuvres de Marx et d’Engels sur l’Etat doivent absolument être reproduits aussi complètement que possible afin que le lecteur puisse lui-même se représenter l’ensemble des conceptions des fondateurs du socialisme scientifique et le développement de ces conceptions, et aussi pour que leur déformation par le "kautskisme" aujourd’hui prédominant soit démontrée, documents à l’appui, et mise en évidence.
Commençons par l’ouvrage le plus répandu de F. Engels, L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat, dont une sixième édition parut à Stuttgart dès 1894. Il nous faudra traduire les citations d’après les originaux allemands, parce que les traductions russes, bien que très nombreuses, sont la plupart du temps ou incomplètes ou très défectueuses.
"L’Etat, dit Engels en tirant les conclusions de son analyse historique, n’est donc pas un pouvoir imposé du dehors à la société ; il n’est pas d’avantage "la réalité de l’idée morale", "l’image et la réalité de la raison", comme le prétend Hegel. Il est bien plutôt un produit de la société à un stade déterminé de son développement ; il est l’aveu que cette société s’empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même, s’étant scindée en oppositions inconciliables qu’elle est impuissante à conjurer. Mais pour que les antagonistes, les classes aux intérêts économiques opposés, ne se consument pas, elles et la société, en une lutte stérile, le besoin s’impose d’un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus de la société, doit estomper le conflit, le maintenir dans les limites de "l’ordre" ; et ce pouvoir, né de la société, mais qui se place au-dessus d’elle et lui devient de plus en plus étranger, c’est l’Etat" (pp. 177-178 de la sixième édition allemande) [2].
Ici se trouve exprimée en toute clarté l’idée fondamentale du marxisme sur le rôle historique et la signification de l’Etat. L’Etat est le produit et la manifestation de ce fait que les contradictions de classes sont inconciliables. L’Etat surgit là, au moment et dans la mesure où, objectivement, les contradictions de classes ne peuvent être conciliées. Et inversement : l’existence de l’Etat prouve que les contradictions de classes sont inconciliables.
C’est précisément sur ce point essentiel et capital que commence la déformation du marxisme, déformation qui suit deux lignes principales.
D’une part, les idéologues bourgeois et surtout petits-bourgeois, obligés sous la pression de faits historiques incontestables de reconnaître que l’Etat n’existe que là où existent les contradictions de classes et la lutte des classes, "corrigent" Marx de telle sorte que l’Etat apparaît comme un organe de conciliation des classes. Selon Marx, l’Etat ne pourrait ni surgir, ni se maintenir, si la conciliation des classes était possible. Selon les professeurs et publicistes petits-bourgeois et philistins - qui se réfèrent abondamment et complaisamment à Marx ! - l’Etat a précisément pour rôle de concilier les classes. Selon Marx, l’Etat est un organisme de domination de classe, un organisme d’oppression d’une classe par une autre ; c’est la création d’un "ordre" qui légalise et affermit cette oppression en modérant le conflit de classes. Selon l’opinion des politiciens petits-bourgeois, l’ordre est précisément la conciliation des classes, et non l’oppression d’une classe par une autre ; modérer le conflit, c’est concilier, et non retirer certains moyens et procédés de combat aux classes opprimées en lutte pour le renversement des oppresseurs.
Ainsi, dans la révolution de 1917, quand le problème de la signification et du rôle de l’Etat se posa dans toute son ampleur, pratiquement, comme un problème d’action immédiate et, qui plus est, d’action de masse, socialistes-révolutionnaires et menchéviks versèrent tous, d’emblée et sans réserve, dans la théorie petite-bourgeoise de la "conciliation" des classes par "l’Etat". D’innombrables résolutions et articles d’hommes politiques de ces deux partis sont tout imprégnés de cette théorie petite-bourgeoise et philistine de la "conciliation". Que l’Etat soit l’organisme de domination d’une classe déterminée, qui ne peut pas être conciliée avec son antipode (avec la classe qui lui est opposée), c’est ce que la démocratie petite-bourgeoise ne peut jamais comprendre. L’attitude que nos socialistes-révolutionnaires et nos menchéviks observent envers l’Etat est une des preuves les plus évidentes qu’ils ne sont pas du tout des socialistes (ce que nous, bolchéviks, avons toujours démontré), mais des démocrates petits-bourgeois à phraséologie pseudo-socialiste.
D’autre part, il y a la déformation "kautskiste" du marxisme, qui est beaucoup plus subtile. "Théoriquement", on ne conteste ni que l’Etat soit un organisme de domination de classe, ni que les contradictions de classes soient inconciliables. Mais on perd de vue ou l’on estompe le fait suivant : si l’Etat est né du fait que les contradictions de classes sont inconciliables, s’il est un pouvoir placé au-dessus de la société et qui "lui devient de plus en lus étranger", il est clair que l’affranchissement de la classe opprimée est impossible, non seulement sans une révolution violente, mais aussi sans la suppression de l’appareil du pouvoir d’Etat qui a été créé par la classe dominante et dans lequel est matérialisé ce caractère "étranger". Cette conclusion, théoriquement claire par elle-même, Marx l’a tirée avec une parfaite précision, comme nous le verrons plus loin, de l’analyse historique concrète des tâches de la révolution. Et c’est précisément cette conclusion que Kautsky - nous le montrerons en détail dans la suite de notre exposé - a ... "oubliée" et dénaturée.
2. DETACHEMENTS SPECIAUX D’HOMMES ARMES, PRISONS, ETC.
"Par rapport à l’ancienne organisation gentilice [tribale ou clanale], poursuit Engels, l’Etat se caractérise en premier lieu par la répartition de ses ressortissants d’après le territoire."
Cette répartition nous paraît "naturelle", mais elle a nécessité une lutte de longue haleine contre l’ancienne organisation par tribus ou par clans.
"En second lieu vient l’institution d’une force publique qui ne coïncide plus directement avec la population s’organisant elle-même en force armée. Cette force publique particulière est nécessaire, parce qu’une organisation armée autonome de la population est devenue impossible depuis la scission en classes... Cette force publique existe dans chaque Etat ; elle ne se compose pas seulement d’hommes armés, mais aussi d’annexes matérielles, de prisons et d’établissements pénitentiaires de toutes sortes, qu’ignorait la société gentilice [clanale]."
Engels développe la notion de ce "pouvoir" qui s’appelle l’Etat, pouvoir issu de la société, mais se plaçant au-dessus d’elle et lui devenant de plus en plus étranger. Ce pouvoir, en quoi consiste-t-il principalement ? En des détachements spéciaux d’hommes armés, disposant de prisons, etc.
Nous avons le droit de parler de détachements spéciaux d’hommes armés, parce que la force publique propre à tout Etat "ne coïncide plus directement" avec la population armée, avec "l’organisation armée autonome de la population".
Comme tous les grands penseurs révolutionnaires, Engels a soin d’attirer l’attention des ouvriers conscients précisément sur ce qui apparaît au philistinisme dominant, comme la chose la moins digne de retenir l’attention, la plus coutumière et consacrée par des préjugés non seulement tenaces, mais, pourrait-on dire, pétrifiés. L’armée permanente et la police sont les principaux instruments de la force du pouvoir d’Etat ; mais comment pourrait-il en être autrement ?
Pour l’immense majorité des Européens de la fin du XIXe siècle, auxquels s’adressait Engels et qui n’avaient ni vécu ni observé de près une seule grande révolution, il ne pouvait en être autrement. Ils ne comprenaient pas du tout ce qu’est "l’organisation armée autonome de la population". A la question de savoir pourquoi est apparue la nécessité de détachements spéciaux d’hommes armés (police, armée permanente), placés au-dessus de la société et lui devenant étrangers, les philistins des pays d’Europe occidentale et de Russie sont enclins à répondre par deux-trois phrases empruntées a Spencer ou à Mikhaïlovski, en rappelant la complication croissante de la vie sociale, la différenciation des fonctions, etc.
Ce rappel a une apparence "scientifique" ; il endort admirablement le vulgaire en estompant le principal, l’essentiel : la division de la société en classes irrémédiablement hostiles.
Sans cette division, "l’organisation armée autonome de la population" se distinguerait par sa complexité, le niveau élevé de sa technique, etc., de l’organisation primitive d’une troupe de singes s’armant de bâtons, ou de celle d’hommes primitifs ou associés en clans, mais elle serait possible.
Elle est impossible parce que la société civilisée est scindée en classes hostiles et, qui plus est, irrémédiablement hostiles, dont l’armement "autonome" entraînerait une lutte armée entre elles. L’Etat se forme ; il se crée une force spéciale, des détachements spéciaux d’hommes armés, et chaque révolution, en détruisant l’appareil d’Etat, nous montre de la façon la plus évidente comment la classe dominante s’efforce de reconstituer les détachements spéciaux d’hommes armés qui la servaient, et comment la classe opprimée s’efforce de créer une nouvelle organisation de ce genre, capable de servir non les exploiteurs, mais les exploités.
Dans le passage cité, Engels pose théoriquement le problème que toute grande révolution nous pose pratiquement, concrètement et à l’échelle d’une action de masse, à savoir : le problème des rapports entre les détachements "spéciaux" d’homme armés et l"organisation armée autonome de la population". Nous verrons comment ce problème est illustré concrètement par l’expérience des révolutions européennes et russes.
Mais revenons à l’exposé d’Engels.
Il montre que parfois, dans certaines régions de l’Amérique du Nord, par exemple, cette force publique est faible (il s’agit - exception bien rare dans la société capitaliste - de ces régions de l’Amérique du Nord où, dans la période préimpérialiste, prédominait le colon libre), mais que, d’une façon générale, elle se renforce :
"... elle se renforce à mesure que les contradictions de classes s’accentuent à l’intérieur de l’Etat et que les Etats limitrophes deviennent plus grands et plus peuplés ; considérons plutôt notre Europe actuelle, où la lutte des classes et la rivalité de conquêtes ont fait croître à tel point la force publique qu’elle menace de dévorer la société entière, et même l’Etat."
Ces lignes furent écrites, au plus tard, au début des années 90. La dernière préface d’Engels est datée du 16 juin 1891. A cette époque, le tournant opéré vers l’impérialisme, - domination absolue des trusts, toute-puissance des grosses banques, grande politique coloniale, etc., - ne faisait que s’amorcer en France ; il s’annonçait à peine en Amérique du Nord et en Allemagne. Depuis, la "rivalité de conquêtes" a fait un pas de géant, d’autant plus que peu après 1910 le globe s’est trouvé définitivement partagé entre ces "conquérants rivaux", c’est-à-dire entre les grandes puissances spoliatrices. Les armements militaires et navals se sont depuis lors démesurément accrus, et pendant la guerre de rapine de 1914-1917 pour la domination de l’Angleterre ou de l’Allemagne sur le monde, pour le partage du butin un pouvoir d’Etat rapace a "dévoré" toutes les forces de la société à un tel point qu’on se trouve au seuil d’une catasrophe totale.
Engels a su montrer dès 1891 que la "rivalité de conquêtes" était un des principaux traits distinctifs de la politique extérieure des grandes puissances, tandis qu’en 1914-1917, à un moment où cette même rivalité, énormément aggravée, a engendré la guerre impérialiste, les gredins du social-chauvinisme camouflent la défense des intérêts spoliateurs de "leur" bourgeoisie par des phrases sur la "défense de la patrie", "la défense de la république et de la révolution", etc.!
3. L’ETAT, INSTRUMENT POUR L’EXPLOITATION DE LA CLASSE OPPRIMEE
Pour entretenir une force publique spéciale, placée au-dessus de la société, il faut des impôts et une dette publique.
"Disposant de la force publique et du droit de faire rentrer les impôts, écrit Engels, les fonctionnaires, comme organes de la société, sont placés au-dessus de la société. La libre estime qu’on témoignait de plein gré aux organes de l’organisation gentilice [clanale] ne leur suffit point, même en supposant qu’ils pourraient en jouir... Des lois d’exception ont été décrétées proclamant la sainteté et l’inviolabilité des fonctionnaires. Le plus vil policier a plus "d’autorité" que le représentant du clan, mais même le chef militaire d’un Etat civilisé peut envier au représentant d’un clan l’estime spontanée dont il jouissait dans la société."
Le problème de la situation privilégiée des fonctionnaires en tant qu’organes du pouvoir d’Etat se trouve ainsi posé. L’essentiel est de savoir ce qui les place au-dessus de la société. Nous verrons comment cette question de théorie fut résolue dans la pratique par la Commune de Paris en 1871, et estompée dans un esprit réactionnaire par Kautsky en 1912.
"Comme l’Etat est né du besoin de refréner des oppositions de classes, mais comme il est né, en même temps, au milieu du conflit de ces classes, il est, dans la règle, l’Etat de la classe la plus puissante, de celle qui domine au point de vue économique et qui, grâce à lui, devient aussi classe politiquement dominante et acquiert ainsi de nouveaux moyens pour mater et exploiter la classe opprimée." Non seulement l’Etat antique et l’Etat féodal furent les organes de l’exploitation des esclaves et des serfs, mais "l’Etat représentatif moderne est l’instrument de l’exploitation du travail salarié par le Capital. Exceptionnellement, il se présente pourtant des périodes où les classes en lutte sont si près de s’équilibrer que le pouvoir de l’Etat, comme pseudo-médiateur, garde pour un temps une certaine indépendance vis-à-vis de l’une et de l’autre." Telle la monarchie absolue des XVIIe et XVIIIe siècles, tel le bonapartisme du Premier et du Second Empire en France, tel le régime de Bismarck en Allemagne.
Tel, ajouterons-nous, le gouvernement Kérenski dans la Russie républicaine, après qu’il a commencé à persécuter le prolétariat révolutionnaire, à un moment où les Soviets, du fait qu’ils sont dirigés par des démocrates petits-bourgeois, sont déjà impuissants, tandis que la bourgeoisie n’est pas encore assez forte pour les dissoudre purement et simplement.
Dans la république démocratique, poursuit Engels, "la richesse exerce son pouvoir d’une façon indirecte, mais d’autant plus sûre", à savoir : premièrement, par la "corruption directe des fonctionnaires" (Amérique) ; deuxièmement, par "l’alliance entre le gouvernement et la Bourse" (France et Amérique).
Aujourd’hui, dans les républiques démocratiques quelles qu’elles soient, l’impérialisme et la domination des banques ont "développé", jusqu’à en faire un art peu commun, ces deux moyens de défendre et de mettre en oeuvre la toute-puissance de la richesse. Si, par exemple, dès les premiers mois de la république démocratique de Russie, pendant la lune de miel, pourrait-on dire, du mariage des "socialistes" - socialistes-révolutionnaires et menchéviks - avec la bourgeoisie au sein du gouvernement de coalition, M. Paltchinski a saboté toutes les mesures visant à juguler les capitalistes et à refréner leurs exactions, leur mise au pillage du Trésor par le biais des fournitures militaires ; et si ensuite M. Paltchinski, sorti du ministère (et remplacé naturellement par un autre Paltchinski, tout pareil), est "gratifié" par les capitalistes d’une sinécure comportant un traitement de 120 000 roubles par an, qu’est-ce donc que cela ? De la corruption directe ou indirecte ? Une alliance du gouvernement avec les syndicats capitalistes, ou des relations amicales ? Quel rôle jouent les Tchernov et les Tsérétéli, les Avksentiev et les Skobélev ? Sont-ils les alliés "directs" ou seulement indirects des millionnaires dilapidateurs des deniers publics ?
La toute-puissance de la "richesse" est plus sûre en république démocratique, parce qu’elle ne dépend pas des défauts de l’enveloppe politique du capitalisme. La république démocratique est la meilleure forme politique possible du capitalisme ; aussi bien le Capital, après s’en être emparé (par l’entremise des Paltchinski, Tchernov, Tsérétéli, etc.), assoit son pouvoir si solidement, si sûrement, que celui-ci ne peut être ébranlé par aucun changement de personnes, d’institutions ou de partis dans la république démocratique bourgeoise.
Il faut noter encore qu’Engels est tout à fait catégorique lorsqu’il qualifie le suffrage universel d’instrument de domination de la bourgeoisie. Le suffrage universel, dit-il, tenant manifestement compte de la longue expérience de la social-démocratie allemande, est :
"... l’indice qui permet de mesurer la maturité de la classe ouvrière. Il ne peut être rien de plus, il ne sera jamais rien de plus dans l’Etat actuel."
Les démocrates petits-bourgeois tels que nos socialistes-révolutionnaires et nos menchéviks, de même que leurs frères jumeaux, tous les social-chauvins et opportunistes de l’Europe occidentale, attendent précisément quelque chose "de plus" du suffrage universel. Ils partagent eux-mêmes et inculquent au peuple cette idée fausse que le suffrage universel, "dans l’Etat actuel", est capable de traduire réellement la volonté de la majorité des travailleurs et d’en assurer l’accomplissement.
Nous ne pouvons ici que relever cette idée fausse, en indiquant simplement que la déclaration absolument claire, précise et concrète d’Engels est altérée à chaque instant dans la propagande et l’agitation des partis socialistes "officiels" (c’est-à-dire opportunistes). La suite de notre exposé des vues de Marx et d’Engels sur l’Etat "actuel" explique en détail toute la fausseté de la conception que réfute ici Engels.
Voici en quels termes celui-ci donne, dans son ouvrage le plus populaire, le résumé d’ensemble de ses conceptions :
"L’Etat n’existe donc pas de toute éternité. Il y a eu des sociétés qui se sont tirées d’affaire sans lui, qui n’avaient aucune idée de l’Etat et du pouvoir d’Etat. A un certain stade du développement économique, qui était nécessairement lié à la division de la société en classes, cette division fit de l’Etat une nécessité. Nous nous rapprochons maintenant à pas rapide d’un stade de développement de la production dans lequel l’existence de ces classes a non seulement cessé d’être une nécessité, mais devient un obstacle positif à la production. Ces classes tomberont aussi inévitablement qu’elles ont surgi autrefois. L’Etat tombe inévitablement avec elles. La société, qui réorganisera la production sur la base d’une association libre et égalitaire des producteurs, reléguera toute la machine de l’Etat là où sera dorénavant sa place : au musée des antiquités, à côté du rouet et de la hache de bronze."
On ne rencontre pas souvent cette citation dans la littérature de propagande et d’agitation de la social-démocratie contemporaine. Mais, même lorsqu’elle se rencontre, on la reproduit le plus souvent comme si l’on voulait s’incliner devant une icône, c’est-à-dire rendre officiellement hommage à Engels, sans le moindre effort de réflexion sur l’étendue et la profondeur de la révolution qu’implique cette "relégation de toute la machine de l’Etat au musée des antiquités". La plupart du temps, il ne semble même pas que l’on comprenne ce qu’Engels veut dire par machine de l’Etat.
4. "EXTINCTION" DE L’ETAT ET REVOLUTION VIOLENTE
Les formules d’Engels sur "l’extinction de l’Etat" jouissent d’une si large notoriété, elles sont si fréquemment citées, elle mettent si bien en relief ce qui fait le fond même de la falsification habituelle du marxisme accommodé à la sauce opportuniste qu’il est nécessaire de s’y arrêter plus longuement. Citons en entier le passage d’où elles sont tirées :
"Le prolétariat s’empare du pouvoir d’Etat et transforme les moyens de production d’abord en propriété d’Etat. Mais par là, il se supprime lui-même en tant que prolétariat, il supprime toues les différences de classes et oppositions de classes et également en tant qu’Etat. La société antérieure, évoluant dans des oppositions de classes, avait besoin de l’Etat, c’est-à-dire, dans chaque cas, d’une organisation de la classe exploiteuse pour maintenir ses conditions de production extérieures, donc surtout pour maintenir par la force la classe exploitée dans les conditions d’oppression données par le mode de production existant (esclavage, servage, salariat). L’Etat était le représentant officiel de toute la société, sa synthèse en un corps visible, mais cela, il ne l’était que dans la mesure où il était l’Etat de la classe qui, pour son temps, représentait elle-même toute la société : dans l’antiquité, Etat des citoyens propriétaires d’esclaves ; au moyen âge, de la noblesse féodale ; à notre époque, de la bourgeoisie. Quand il finit par devenir effectivement le représentant de toute la société, il se rend lui-même superflu. Dès qu’il n’y a plus de classe sociale à tenir dans l’oppression ; dès que, avec la domination de classe et la lutte pour l’existence individuelle motivée par l’anarchie antérieure de la production, sont éliminés également les collisions et les excès qui en résultent, il n’y a plus rien à réprimer qui rende nécessaire un pouvoir de répression, un Etat. Le premier acte dans lequel l’Etat apparaît réellement comme représentant de toute la société, - la prise de possession des moyens de production au nom de la société, - est en même temps son dernier acte propre en tant qu’Etat. L’intervention d’un pouvoir d’Etat dans des rapports sociaux devient superflue dans un domaine après l’autre, et entre alors naturellement en sommeil. Le gouvernement des personnes fait place à l’administration des choses et à la direction des opérations de production. L’Etat n’est pas "aboli", il s’éteint. Voilà qui permet de juger la phrase creuse sur "l’Etat populaire libre", tant du point de vue de sa justification temporaire comme moyen d’agitation que du point de vue de son insuffisance définitive comme idée scientifique ; de juger également la revendication de ceux qu’on appelle les anarchistes, d’après laquelle l’Etat doit être aboli du jour au lendemain" (Anti-Dühring, Monsieur E. Dühring bouleverse la science, pp. 30I-303 de la 3e édit. allemande)[3].
On peut dire, sans crainte de se tromper, que ce raisonnement d’Engels, si remarquable par sa richesse de pensée, n’a laissé, dans les partis socialistes d’aujourd’hui, d’autre trace de pensée socialiste que la notion d’après laquelle l’Etat "s’éteint", selon Marx, contrairement à la doctrine anarchiste de "l’abolition" de l’Etat. Tronquer ainsi le marxisme, c’est le réduire à l’opportunisme ; car, après une telle "interprétation", il ne reste que la vague idée d’un changement lent, égal, graduel, sans bonds ni tempêtes, sans révolution. "L’extinction" de l’Etat, dans la conception courante, généralement répandue dans les masses, c’est sans aucun doute la mise en veilleuse, sinon la négation, de la révolution .
Or, pareille "interprétation" n’est qu’une déformation des plus grossières du marxisme, avantageuse pour la seule bourgeoisie et théoriquement fondée sur l’oubli des circonstances et des considérations essentielles indiquées, par exemple, dans les "conclusions" d’Engels que nous avons reproduites in extenso.
Premièrement. Au début de son raisonnement, Engels dit qu’en prenant possession du pouvoir d’Etat, le prolétariat "supprime par là l’Etat en tant qu’Etat". On "n’a pas coutume" de réfléchir à ce que cela signifie. D’ordinaire, ou bien l’on en méconnaît complètement le sens, ou bien l’on y voit, de la part d’Engels, quelque chose comme une "faiblesse hégélienne". En réalité, ces mots expriment en raccourci l’expérience d’une des plus grandes révolutions prolétariennes, l’expérience de la Commune de Paris de 1871, dont nous parlerons plus longuement en son lieu.
Engels parle ici de la "suppression", par la révolution prolétarienne, de l’Etat de la bourgeoisie, tandis que ce qu’il dit de "l’extinction" se rapporte à ce qui subsiste de l’Etat prolétarien, après la révolution socialiste. L’Etat bourgeois, selon Engels, ne "s’éteint" pas ; il est "supprimé" par le prolétariat au cours de la révolution. Ce qui s’éteint après cette révolution, c’est l’Etat prolétarien, autrement dit un demi-Etat.
Deuxièmement. L’Etat est un "pouvoir spécial de répression". Cette définition admirable et extrêmement profonde d’Engels est énoncée ici avec la plus parfaite clarté. Et il en résulte qu’à ce "pouvoir spécial de répression" exercé contre le prolétariat par la bourgeoisie, contre des millions de travailleurs par une poignée de riches, doit se substituer un "pouvoir spécial de répression" exercé contre la bourgeoisie par le prolétariat (la dictature du prolétariat). C’est en cela que consiste la "suppression de l’Etat en tant qu’Etat". Et c’est en cela que consiste "l’acte" de prise de possession des moyens de production au nom de la société. Il va de soi que pareil remplacement d’un "pouvoir spécial" (celui de la bourgeoisie) par un autre "pouvoir spécial" (celui du prolétariat) ne peut nullement se faire sous forme "d’extinction".
Troisièmement. Cette "extinction" ou même, pour employer une expression plus imagée et plus saillante, cette "mise en sommeil", Engels la rapporte sans aucune ambiguïté possible à l’époque consécutive à la "prise de possession des moyens de production par l’Etat au nom de toute la société", c’est-à-dire consécutive à la révolution socialiste. Nous savons tous qu’à ce moment-là la forme politique de "l’Etat" est la démocratie la plus complète. Mais il ne vient à l’esprit d’aucun des opportunistes qui dénaturent sans vergogne le marxisme qu’il s’agit en ce cas, chez Engels, de la "mise en sommeil" et de "l’extinction" de la démocratie. Cela paraît fort étrange à première vue. Pourtant, ce n’est "inintelligible" que pour quiconque n’a pas réfléchi à ce fait que la démocratie, c’est aussi un Etat et que, par conséquent, lorsque l’Etat aura disparu, la démocratie disparaîtra également. Seule la révolution peut "supprimer" l’Etat bourgeois. L’Etat en général, c’est-à-dire la démocratie la plus complète, ne peut que "s’éteindre".
Quatrièmement. En formulant sa thèse fameuse : "l’Etat s’éteint", Engels explique concrètement qu’elle est dirigée et contre les opportunistes et contre les anarchistes. Et ce qui vient en premier lieu chez Engels, c’est la conclusion, tirée de sa thèse sur "l’extinction" de l’Etat, qui vise les opportunistes.
On peut parier que sur 10 000 personnes qui ont lu quelque chose à propos de "l’extinction" de l’Etat ou en ont entendu parler, 9 990 ignorent absolument ou ne se rappellent plus que les conclusions de cette thèse, Engels ne les dirigeait pas uniquement contre les anarchistes. Et, sur les dix autres personnes, neuf à coup sûr ne savent pas ce que c’est que "l’Etat populaire libre" et pourquoi, en s’attaquant à ce mot d’ordre, on s’attaque aussi aux opportunistes. Ainsi écrit-on l’histoire ! Ainsi accommode-t-on insensiblement la grande doctrine révolutionnaire au philistinisme régnant. La conclusion contre les anarchistes a été mille fois reprise, banalisée, enfoncée dans la tête de la façon la plus simpliste ; elle a acquis la force d’un préjugé. Quant à la conclusion contre les opportunistes, on l’a estompée et "oubliée" !
"L’Etat populaire libre" était une revendication inscrite au programme des social-démocrates allemands des années 70 et qui était devenue chez eux une formule courante. Ce mot d’ordre, dépourvu de tout contenu politique, ne renferme qu’une traduction petite-bourgeoise et emphatique du concept de démocratie. Dans la mesure où l’on y faisait légalement allusion à la république démocratique, Engels était disposé à "justifier", "pour un temps", ce mot d’ordre à des fins d’agitation. Mais c’était un mot d’ordre opportuniste, car il ne tendait pas seulement à farder la démocratie bourgeoise ; il marquait encore l’incompréhension de la critique socialiste de tout Etat en général. Nous sommes pour la république démocratique en tant que meilleure forme d’Etat pour le prolétariat en régime capitaliste ; mais nous n’avons pas le droit d’oublier que l’esclavage salarié est le lot du peuple, même dans la république bourgeoise la plus démocratique. Ensuite, tout Etat est un "pouvoir spécial de répression" dirigé contre la classe opprimée. Par conséquent, aucun Etat n’est ni libre, ni populaire. Cela, Marx et Engels l’ont maintes fois expliqué à leurs camarades de parti dans les années 70.
Cinquièmement. Ce même ouvrage d’Engels, dont tout le monde se rappelle qu’il contient un raisonnement au sujet de l’extinction de l’Etat, en renferme un autre sur l’importance de la révolution violente. L’appréciation historique de son rôle se transforme chez Engels en un véritable panégyrique de la révolution violente. De cela, "nul ne se souvient" ; il n’est pas d’usage, dans les partis socialistes de nos jours, de parler de l’importance de cette idée, ni même d’y penser ; dans la propagande et l’agitation quotidiennes parmi les masses, ces idées ne jouent aucun rôle. Et pourtant, elles sont indissolublement liées à l’idée de "l’extinction" de l’Etat avec laquelle elles forment un tout harmonieux.
Voici ce raisonnement d’Engels :
"... que la violence joue encore dans l’histoire un autre rôle [que celui d’être source du mal], un rôle révolutionnaire ; que, selon les paroles de Marx, elle soit l’accoucheuse de toute vieille société qui en porte une nouvelle dans ses flancs ; qu’elle soit l’instrument grâce auquel le mouvement social l’emporte et met en pièces des formes politiques figées et mortes - de cela, pas un mot chez M. Dühring. C’est dans les soupirs et les gémissements qu’il admet que la violence soit peut-être nécessaire pour renverser le régime économique d’exploitation, - par malheur ! Car tout emploi de la violence démoralise celui qui l’emploie. Et dire qu’on affirme cela en présence du haut essor moral et intellectuel qui a été la conséquence de toute révolution victorieuse ! Dire qu’on affirme cela en Allemagne où un heurt violent, qui peut même être imposé au peuple, aurait tout au moins l’avantage d’extirper la servilité qui, à la suite de l’humiliation de la Guerre de Trente ans, a pénétré la conscience nationale ! Dire que cette mentalité de prédicateur sans élan, sans saveur et sans force a la prétention de s’imposer au parti le plus révolutionnaire que connaisse l’histoire !" (Anti-Dühring, p. 193 de la 3e édit. allemande, fin du chapitre IV, 2e partie.)
Comment peut-on concilier dans une même doctrine ce panégyrique de la révolution violente qu’Engels n’a cessé de faire entendre aux social-démocrates allemands de 1878 à 1894, c’est-à-dire jusqu’à sa mort même, et la théorie de "l’extinction" de l’Etat ?
D’ordinaire, on les concilie d’une manière éclectique, par un procédé empirique ou sophistique, en prenant arbitrairement (ou pour complaire aux détenteurs du pouvoir) tantôt l’un, tantôt l’autre de ces raisonnements ; et c’est "l’extinction" qui, 99 fois sur 100 sinon plus, est mise au premier plan. L’éclectisme se substitue à la dialectique : c’est, à l’égard du marxisme, la chose la plus accoutumée, la plus répandue dans la littérature social-démocrate officielle de nos jours. pareil substitution n’est certes pas une nouveauté : on a pu l’observer même dans l’histoire de la philosophie grecque classique. Dans la falsification opportuniste du marxisme, la falsification éclectique de la dialectique est celle qui trompe les masses avec le plus de facilité ; elle leur donne un semblant de satisfaction, affecte de tenir compte de tous les aspects du processus, de toutes les tendances de l’évolution, de toutes les influences contradictoires, etc., mais, en réalité, elle ne donne aucune idée cohérente et révolutionnaire du développement de la société.
Nous avons déjà dit plus haut, et nous le montrerons plus en détail dans la suite de notre exposé, que la doctrine de Marx et d’Engels selon laquelle une révolution violente est inéluctable concerne l’Etat bourgeois. Celui-ci ne peut céder la place à l’Etat prolétarien (à la dictature du prolétariat) par voie "d’extinction", mais seulement, en règle générale, par une révolution violente. Le panégyrique que lui consacre Engels s’accorde pleinement avec de nombreuses déclarations de Marx (rappelons-nous la conclusion de La Misère de la Philosophie[4] et du Manifeste Communiste[5] proclamant fièrement, ouvertement, que la révolution violente est inéluctable ; rappelons-nous la critique du programme de Gotha[6] en 1875, près de trente ans plus tard, où Marx flagelle implacablement l’opportunisme de ce programme). Ce panégyrique n’est pas le moins du monde l’effet d’un "engouement", ni une déclamation, ni une boutade polémique. La nécessité d’inculquer systématiquement aux masses cette idée - et précisément celle-là - de la révolution violente est à la base de toute la doctrine de Marx et Engels. La trahison de leur doctrine par les tendances social-chauvines et kautskistes, aujourd’hui prédominantes, s’exprime avec un relief singulier dans l’oubli par les partisans des unes comme des autres, de cette propagande, de cette agitation.
Sans révolution violente, il est impossible de substituer l’Etat prolétarien à l’Etat bourgeois. La suppression de l’Etat prolétarien, c’est-à-dire la suppression de tout Etat, n’est possible que par voie "d’extinction".
Marx et Engels ont développé ces vues d’une façon détaillée et concrète, en étudiant chaque situation révolutionnaire prise à part, en analysant les enseignements tirés de l’expérience de chaque révolution. Nous en arrivons à cette partie, incontestablement la plus importante, de leur doctrine.
CHAPITRE II
L’ETAT ET LA REVOLUTION. L’EXPERIENCE DES ANNEES 1848-1851
1. LA VEILLE DE LA REVOLUTION
Les premières oeuvres du marxisme arrivé à sa maturité, La Misère de la Philosophie et le Manifeste Communiste, paraissent juste à la veille de la Révolution de 1848. Ce qui fait que, parallèlement à l’exposé des principes fondamentaux du marxisme, nous y trouvons, dans une certaine mesure, une évocation de la situation révolutionnaire concrète de ce temps. Aussi le plus rationnel sera-t-il, je crois, d’analyser ce que les auteurs de ces ouvrages ont dit de l’Etat juste avant de tirer les conclusions de l’expérience des années 1848-1851.
"La classe laborieuse, écrit Marx dans La Misère de la Philosophie, substituera, dans le cours de son développement, à l’ancienne société bourgeoise une association qui exclura les classes et leur antagonisme, et il n’y aura plus de pouvoir politique proprement dit, puisque le pouvoir politique est précisément le résumé officiel de l’antagonisme dans la société bourgeoise" (p. 182 de l’édition allemande 1885)[7].
Il est instructif de comparer à cet exposé d’ensemble de l’idée de la disparition de l’Etat après la suppression des classes l’exposé donné dans le Manifeste Communiste écrit par Marx et Engels à quelques mois de là, plus précisément en novembre 1847.
"En esquissant à grands traits les phases du développement du prolétariat, nous avons retracé l’histoire de la guerre civile, plus ou moins latente, qui travaille la société actuelle jusqu’à l’heure où cette guerre éclate en révolution ouverte, et où le prolétariat fonde sa domination par le renversement violent de la bourgeoisie."
"Nous avons déjà vu plus haut que la première étape dans la révolution ouvrière est la constitution" (littéralement : l’élévation) "du prolétariat en classe dominante, la conquête de la démocratie."
"Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher petit à petit tout le capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de production entre les mains de l’Etat, c’est-à-dire du prolétariat organisé en classe dominante, et pour augmenter au plus vite la quantité des forces productives" (pp. 31, 37 de la 7e édition allemande de 1906)[8].
L’on trouve formulée ici l’une des idées les plus remarquables et les plus importantes du marxisme au sujet de l’Etat, celle de la "dictature du prolétariat" (comme devaient s’exprimer Marx et Engels après la Commune de Paris) ; nous y trouvons ensuite une définition de l’Etat, intéressante au plus haut point, et qui est également au nombre des "paroles oubliées" du marxisme : "L’Etat, c’est-à-dire le prolétariat organisé en classe dominante."
Cette définition de l’Etat n’a jamais été commentée dans la littérature de propagande et d’agitation qui prédomine dans les partis social-démocrates officiels. Bien plus : elle a été très précisément oubliée parce qu’elle est absolument inconciliable avec le réformisme ; elle heurte de front les préjugés opportunistes habituels et les illusions petites-bourgeoises quant à "l’évolution pacifique de la démocratie".
Le prolétariat a besoin de l’Etat-tous les opportunistes, les social-chauvins et les kautskistes le répètent en assurant que telle est la doctrine de Marx, mais ils "oublient" d’ajouter, premièrement, que d’après Marx, il ne faut au prolétariat qu’un Etat en voie d’extinction, c’est-à-dire constitué de telle sorte qu’il commence immédiatement à s’éteindre et ne puisse pas ne point s’éteindre. Deuxièmement, que les travailleurs ont besoin d’un "Etat" qui soit le "prolétariat organisé en classe dominante".
L’Etat est l’organisation spéciale d’un pouvoir ; c’est l’organisation de la violence destinée à mater une certaine classe. Quelle est donc la classe que le prolétariat doit mater ? Evidemment la seule classe des exploiteurs, c’est-à-dire la bourgeoisie. Les travailleurs n’ont besoin de l’Etat que pour réprimer la résistance des exploiteurs : or, diriger cette répression, la réaliser pratiquement, il n’y a que le prolétariat qui puisse le faire, en tant que seule classe révolutionnaire jusqu’au bout, seule classe capable d’unir tous les travailleurs et tous les exploités dans la lutte contre la bourgeoisie, en vue de la chasser totalement du pouvoir.
Les classes exploiteuses ont besoin de la domination politique pour maintenir l’exploitation, c’est-à-dire pour défendre les intérêts égoïstes d’une infime minorité, contre l’immense majorité du peuple. Les classes exploitées ont besoin de la domination politique pour supprimer complètement toute exploitation, c’est-à-dire pour défendre les intérêts de l’immense majorité du peuple contre l’infime minorité des esclavagistes modernes, c’est-à-dire les propriétaires fonciers et les capitalistes.
Les démocrates petits-bourgeois, ces pseudo-socialistes qui ont substitué à la lutte des classes leurs rêveries sur l’entente des classes, se représentaient la transformation socialiste, elle aussi, comme une sorte de rêve sous la forme, non point du renversement de la domination de la classe exploiteuse, mais d’une soumission pacifique de la minorité à la majorité consciente de ses tâches. Cette utopie petite-bourgeoise, indissolublement liée à la notion d’un Etat placé au-dessus des classes, a abouti pratiquement à la trahison des intérêts des classes laborieuses, comme l’a montré, par exemple, l’histoire des révolutions françaises de 1848 et 1871, comme l’a montré l’expérience de la participation "socialiste" aux ministères bourgeois en Angleterre, en France, en Italie et en d’autres pays à la fin du XIXe siècle et au début du XXe.
Toute sa vie, Marx a lutté contre ce socialisme petit-bourgeois, ressuscité de nos jours en Russie par les partis socialiste-révolutionnaire et menchévik. Marx a développé d’une façon conséquente la doctrine de la lutte des classes pour aboutir à la doctrine du pouvoir politique, à la doctrine de l’Etat.
La domination de la bourgeoisie ne peut être renversée que par le prolétariat, classe distincte que ses conditions économiques d’existence préparent à ce renversement, et à qui elles offrent la possibilité et la force de l’accomplir. Tandis que la bourgeoisie fractionne et dissémine la paysannerie et toutes les couches petites-bourgeoises, elle groupe, unit et organise le prolétariat. Etant donné le rôle économique qu’il joue dans la grande production, le prolétariat est seul capable d’être le guide de toutes les masses laborieuses et exploitées que, souvent, la bourgeoisie exploite, opprime et écrase non pas moins, mais plus que les prolétaires, et qui sont incapables d’une lutte indépendante pour leur affranchissement.
La doctrine de la lutte des classes, appliquée par Marx à l’Etat et à la révolution socialiste, mène nécessairement à la reconnaissance de la domination politique du prolétariat, de sa dictature, c’est-à-dire d’un pouvoir qu’il ne partage avec personne et qui s’appuie directement sur la force armée des masses. La bourgeoisie ne peut être renversée que si le prolétariat est transformé en classe dominante capable de réprimer la résistance inévitable, désespérée, de la bourgeoisie, et d’organiser pour un nouveau régime économique toutes les masses laborieuses et exploitées.
Le prolétariat a besoin du pouvoir d’Etat, d’une organisation centralisée de la force, d’une organisation de la violence, aussi bien pour réprimer la résistance des exploiteurs que pour diriger la grande masse de la population-paysannerie, petite bourgeoisie, semi-prolétaires-dans la "mise ne place" de l’économie socialiste.
En éduquant le parti ouvrier, le marxisme éduque une avant-garde du prolétariat capable de prendre le pouvoir et de mener le peuple tout entier au socialisme, de diriger et d’organiser un régime nouveau, d’être l’éducateur, le guide et le chef de tous les travailleurs et exploités pour l’organisation de leur vie sociale, sans la bourgeoisie et contre la bourgeoisie. Au contraire, l’opportunisme régnant éduque, dans le parti ouvrier, des représentants des travailleurs les mieux rétribués qui se détachent de la masse : ils "s’accommodent" assez bien du régime capitaliste et vendent pour un plat de lentilles leur droit d’aînesse, c’est-à-dire qu’ils abdiquent leur rôle de chefs révolutionnaires du peuple dans la lutte contre la bourgeoisie.
"L’Etat, c’est-à-dire le prolétariat organisé en classe dominante", - cette théorie de Marx est indissolublement liée à toute sa doctrine sur le rôle révolutionnaire du prolétariat dans l’histoire. L’aboutissement de ce rôle, c’est la dictature prolétarienne, la domination politique du prolétariat.
Mais si le prolétariat a besoin de l’Etat en tant qu’organisation spéciale de la violence contre la bourgeoisie, une question s’impose : une telle organisation est-elle concevable sans que soit au préalable détruite, démolie, la machine d’Etat que la bourgeoisie a créée pour elle-même ? C’est à cette question que nous amène le Manifeste Communiste et c’est d’elle que parle Marx quand il résume l’expérience de la révolution de 1848-1851.
2. LE BILAN D’UNE REVOLUTION
Traitant de la question de l’Etat, qui nous préoccupe ici, Marx fait le bilan de la révolution de 1848-1851, dans son 18 Brumaire de Louis Bonaparte, en développant le raisonnement suivant :
"Mais la révolution va jusqu’au fond des choses. Elle ne traverse encore que le purgatoire. Elle mène son affaires avec méthode. Jusqu’au 2 décembre 1851" [date du coup d’Etat de Louis Bonaparte] "elle n’avait accompli que la moitié de ses préparatifs, et maintenant elle accomplit l’autre moitié. Elle perfectionne d’abord le pouvoir parlementaire, pour le renverser ensuite. Ce but une fois atteint, elle perfectionne le pouvoir exécutif, le réduit à sa plus simple expression, l’isole, dirige contre lui tous les reproches pour pouvoir concentrer sur lui toutes ses forces de destruction [souligné par nous], et, quand elle aura accompli la seconde moitié de son travail de préparation, l’Europe sautera de sa place et jubilera : Bien creusé, vieille taupe !"
"Ce pouvoir exécutif, avec son immense organisation bureaucratique et militaire, avec sa machine étatique complexe et artificielle, son armée de fonctionnaires d’un demi-million d’hommes et son autre armée d’un demi-million de soldats, effroyable corps parasite qui recouvre comme d’une membrane le corps de la société française et en bouche tous les pores, se constitua à l’époque de la monarchie absolue, au déclin de la féodalité qu’il aida à renverser." La première Révolution française a développé la centralisation, "mais, en même temps aussi, l’étendue, les attributs et l’appareil du pouvoir gouvernemental. Napoléon acheva de perfectionner ce mécanisme d’Etat". La monarchie légitime et la monarchie de Juillet "ne firent qu’y ajouter une plus grande division du travail..."
"La République parlementaire, enfin, se vit contrainte, dans sa lutte contre la révolution, de renforcer par ses mesures de répression les moyens d’action et la centralisation du pouvoir gouvernemental. Tous les bouleversements n’ont fait que perfectionner cette machine au lieu de la briser. Les partis qui luttèrent à tour de rôle pour le pouvoir considérèrent la conquête de cet immense édifice d’Etat comme la principale proie du vainqueur" (Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, pp. 98-99, 4e édition allemande, Hambourg, 1907)[9].
Dans ce remarquable aperçu, le marxisme accomplit un très grand pas en avant par rapport au Manifeste Communiste, où la question de l’Etat était encore posée d’une manière très abstraite, dans les notions et termes les plus généraux. Ici, la question est posée de façon concrète et la déduction est éminemment précise, définie, pratiquement tangible : toutes les révolutions antérieures ont perfectionné la machine de l’Etat ; or il faut la briser, la démolir.
Cette déduction est le principal, l’essentiel, dans la doctrine marxiste de l’Etat. Et c’est cette chose essentielle qui a été non seulement tout à fait oubliée par les partis social-démocrates officiels dominants, mais franchement dénaturée (comme nous le verrons plus loin) par le théoricien le plus en vue de la Deuxième Internationale, K. Kautsky.
Le Manifeste Communiste tire les leçons de l’ensemble de l’histoire, qui montre dans l’Etat un organisme de domination de classe et aboutit à cette conclusion nécessaire : le prolétariat ne saurait renverser la bourgeoisie avant d’avoir conquis le pouvoir politique, avant d’avoir établi sa domination politique, d’avoir érigé en Etat le "prolétariat organisé en classe dominante" ; et cet Etat prolétarien commencera à s’éteindre dès sa victoire, l’Etat devenant inutile et impossible dans une société où les contradictions de classes n’existent pas. La question de savoir en quoi doit consister, du point de vue du développement historique, cette substitution de l’Etat prolétarien à l’Etat bourgeois, n’est pas posée ici.
Cette question, Marx la pose et la résout en 1852. Fidèle à sa philosophie du matérialisme dialectique, il prend comme base d’expérience historique les grandes années de la révolution de 1848-1851. Là, comme toujours, la doctrine de Marx dresse un bilan de l’expérience vécue éclairé par une conception philosophique profonde et par une connaissance étendue de l’histoire.
La question de l’Etat est posée de façon concrète : comment est né historiquement l’Etat bourgeois, la machine d’Etat nécessaire à la domination de la bourgeoisie ? Quelles transformations, quelle évolution cette machine d’Etat a-t-elle subies au cours des révolutions bourgeoises et lorsqu’elle s’est heurtée aux mouvements d’indépendance des classes opprimées ? Quelles sont les tâches du prolétariat à son égard ?
Le pouvoir d’Etat centralisé, propre à la société bourgeoise, est apparu à l’époque de la chute de l’absolutisme. Les deux institutions les plus caractéristiques de cette machine d’Etat sont : la bureaucratie et l’armée permanente. Maintes fois, dans leurs oeuvres, Marx et Engels parlent des mille liens qui rattachent ces institutions à la bourgeoisie. L’expérience de chaque ouvrier illustre cette liaison avec une évidence et un relief saisissants. La classe ouvrière apprend à la connaître à ses dépens. C’est pourquoi elle saisit avec tant de facilité et s’assimile si bien la science qui révèle l’inéluctabilité de cette liaison, science que les démocrates petits-bourgeois nient par ignorance et par légèreté, à moins qu’ils n’aient la légèreté plus grande encore de la reconnaître "en général", en oubliant d’en tirer les conclusions pratiques.
La bureaucratie et l’armée permanente sont des "parasites" sur le corps de la société bourgeoise, des parasites engendrés par les contradictions internes qui déchirent cette société, mais très exactement des parasites qui "bouchent" ses pores vitaux. L’opportunisme kautskiste, aujourd’hui prédominant dans la social-démocratie officielle, estime que cette théorie de l’Etat considéré comme un organisme parasite est l’attribut particulier et exclusif de l’anarchisme. Cette déformation du marxisme est, évidemment, au plus haut point avantageuse aux petits bourgeois qui ont conduit le socialisme à cette honte inouïe : justifier et farder la guerre impérialiste en lui appliquant les notions de "défense de la patrie". Ce n’en est pas moins une déformation incontestable.
Le développement, le perfectionnement, la consolidation de cet appareil bureaucratique et militaire se poursuivent à travers la multitude des révolutions bourgeoises dont l’Europe a été le théâtre depuis la chute de la féodalité. C’est, en particulier, la petite bourgeoisie qui est attirée aux côtés de la grande et lui est soumise, dans une large mesure, au moyen de cet appareil qui dispense aux couches supérieures de la paysannerie, des petits artisans, des petits commerçants, etc., des emplois relativement commodes, tranquilles et honorables, plaçant leurs bénéficiaires au-dessus du peuple. Voyez ce qui s’est passé en Russie durant les six mois qui suivirent le 27 février 1917 : les postes de fonctionnaires, réservés jadis de préférence aux Cent-Noirs, sont devenus le butin des cadets, des menchéviks et des socialistes-révolutionnaires. Au fond, on ne songeait guère à des réformes sérieuses, on s’efforçait de les ajourner toutes "jusqu’à l’Assemblée constituante", et celle-ci, petit à petit, jusqu’à la fin de la guerre ! Mais pour partager le butin, s’installer aux postes lucratifs de ministres, de sous-secrétaires d’Etat, de gouverneurs généraux, etc., etc., on n’a pas perdu de temps et on n’a attendu aucune Assemblée constituante ! Le jeu des combinaisons ministérielles n’était, au fond, que l’expression de ce partage et de cette redistribution du "butin" qui se faisait de haut en bas, à travers le pays, dans toutes les administrations centrales et locales. Le résultat, le résultat objectif après six mois - du 27 février au 27 août 1917 - est indéniable : les réformes sont ajournées, les sinécures administratives attribuées, et les "erreurs" d’attribution ont été corrigées par quelques redistributions.
Mais plus on procède aux "redistributions" de l’appareil bureaucratique entre les divers partis bourgeois et petits-bourgeois (entre les cadets, les socialistes-révolutionnaires et les menchéviks, pour prendre l’exemple de la Russie), et plus évidente apparaît aux classes opprimées, prolétariat en tête, leur hostilité irréductible à la société bourgeoise tout entière. D’où la nécessité pour tous les partis bourgeois, même les plus démocratiques, y compris les "démocrates révolutionnaires", d’accentuer la répression contre le prolétariat révolutionnaire, de renforcer l’appareil répressif, c’est-à-dire précisément la machine d’Etat. Ce cours des événements oblige la révolution à "concentrer toutes les forces de destruction" contre le pouvoir d’Etat ; il lui impose pour tâche non d’améliorer la machine d’Etat, mais de la démolir, de la détruire.
Ce ne sont pas des déductions logiques, mais le développement réel des événements, l’expérience vécue des années 1848-1851, qui ont conduit à poser ainsi le problème. A quel point Marx s’en tient strictement aux données de l’expérience historique, on le voit par le fait qu’en 1852 il ne pose pas encore la question concrète de savoir par quoi remplacer cette machine d’Etat qui doit être détruite. L’expérience n’avait pas encore fourni, à l’époque, les matériaux nécessaires pour répondre à cette question, que l’histoire mettra à l’ordre du jour plus tard, en 1871. En 1852, on pouvait seulement constater, avec la précision propre aux sciences naturelles, que la révolution prolétarienne abordait cette tâche : "concentrer toutes les forces de destruction" contre le pouvoir d’Etat, "briser" la machine d’Etat.
On se demandera peut-être s’il est juste de généraliser l’expérience, les observations et les conclusions de Marx, et de les appliquer au-delà des limites de l’histoire de France de ces trois années : 1848-1851 ? Pour analyser ce problème, rappelons d’abord une remarque d’Engels. Nous passerons ensuite à l’examen des faits.
"La France", écrivait Engels dans la préface à la troisième édition du 18 Brumaire, "est le pays où les luttes de classes ont été menées chaque fois, plus que partout ailleurs, jusqu’à la décision complète, et où, par conséquent, les formes politiques changeantes, à l’intérieur desquelles elles se meuvent et dans lesquelles se résument leurs résultats, prennent les contours les plus nets. Centre du féodalisme au moyen âge, pays classique, depuis la Renaissance, de la monarchie héréditaire, la France a, dans sa grande Révolution, détruit le féodalisme et donné à la domination de la bourgeoisie un caractère de pureté classique qu’aucun autre pays n’a atteint en Europe. De même, la lutte du prolétariat qui s’éveille contre la bourgeoisie régnante y revêt des formes aiguës, inconnues ailleurs" (p.4 de l’édition de 1907).
Cette dernière remarque a vieilli, puisque depuis 1871 il y a eu une interruption dans la lutte révolutionnaire du prolétariat français. Toutefois, cette interruption, si longue soit-elle, n’exclut nullement la possibilité que, dans la révolution prolétarienne de demain, la France s’affirme comme le pays classique de la lutte des classes menée résolument jusqu’à la décision complète.
Mais jetons un regard d’ensemble sur l’histoire des pays avancés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Nous verrons que le même processus s’est opéré plus lentement, sous des formes plus variées, dans une arène beaucoup plus vaste ; d’une part, élaboration d’un "pouvoir parlementaire" aussi bien dans les pays républicains (France, Amérique, Suisse) que dans les pays monarchiques (Angleterre, Allemagne jusqu’à un certain point, Italie, pays scandinaves, etc.) ; d’autre part, lutte pour le pouvoir entre les différents partis bourgeois et petits-bourgeois qui se sont partagé et repartagé comme "butin" les sinécures administratives, les fondements de l’ordre bourgeois restant inchangés ; enfin, perfectionnement et consolidation du "pouvoir exécutif", de son appareil bureaucratique et militaire.
Nul doute que ce soient là les traits communs à toute l’évolution moderne des Etats capitalistes en général. En trois années, de 1848 à 1851, la France a montré sous une forme nette et ramassée, dans leur succession rapide, ces mêmes processus de développement, propres à l’ensemble du monde capitaliste.
Plus particulièrement, l’impérialisme - époque du capital bancaire, époque des gigantesques monopoles capitalistes, époque où le capitalisme monopoliste se transforme par voie de croissance en capitalisme monopoliste d’Etat - montre le renforcement extraordinaire de la "machine d’Etat", l’extension inouïe de son appareil bureaucratique et militaire en liaison avec une répression accrue du prolétariat, aussi bien dans les pays monarchiques que dans les républiques les plus libres. Aujourd’hui, l’histoire universelle conduit sans nul doute sur une échelle infiniment plus vaste qu’en 1852, à la "concentration de toutes les forces" de la révolution prolétarienne en vue de la "destruction" de la machine d’Etat.
Par quoi le prolétariat la remplacera-t-il ? La Commune de Paris fournit à ce sujet une documentation des plus instructives.
3. COMMENT MARX POSAIT LA QUESTION EN 1852
[ajouté lors de la seconde édition]
Mehring a publié en 1907 dans la Neue Zeit [10] (XXV, 2, 164) des extraits d’une lettre de Marx à Weydemeyer, en date du 5 mars 1852. Cette lettre renferme entre autres la remarquable observation que voici :
" En ce qui me concerne, ce n’est pas à moi que revient le mérite d’avoir découvert ni l’existence des classes dans la société moderne, ni leur lutte entre elles. Longtemps avant moi, des historiens bourgeois avaient exposé l’évolution historique de cette lutte des classes et des économistes bourgeois en avaient décrit l’anatomie économique. Ce que j’ai apporté de nouveau, c’est de démontrer : 1) que l’existence des classes n’est liée qu’à des phases historiques déterminées du développement de la production [historische Entwicklungsphasen der Produktion] ; 2) que la lutte des classes mène nécessairement à la dictature du prolétariat ; 3) que cette dictature elle-même ne représente que la transition à l’abolition de toutes les classes et à une société sans classes..." [11].
Dans ce texte, Marx a réussi à exprimer, avec un relief saisissant, d’abord, ce qui distingue principalement et foncièrement sa doctrine de celle des penseurs éclairés et les plus pénétrants de la bourgeoisie et, ensuite, l’essence de sa doctrine de l’Etat.
L’essentiel, dans la doctrine de Marx, c’est la lutte des classes. C’est ce qu’on dit et c’est ce qu’on écrit très souvent. Mais c’est inexact. Et, de cette inexactitude, résultent couramment des déformations opportunistes du marxisme des falsifications tendant à le rendre acceptable pour la bourgeoisie. Car la doctrine de la lutte des classes a été créée non par Marx, mais par la bourgeoisie avant Marx ; et elle est, d’une façon générale, acceptable pour la bourgeoisie. Quiconque reconnaît uniquement la lutte des classes n’est pas pour autant un marxiste ; il peut se faire qu’il ne sorte pas encore du cadre de la pensée bourgeoise et de la politique bourgeoise. Limiter le marxisme à la doctrine de la lutte des classes, c’est le tronquer, le déformer, le réduire à ce qui est acceptable pour la bourgeoisie. Celui-là seul est un marxiste qui étend la reconnaissance de la lutte des classes jusqu’à la reconnaissance de la dictature du prolétariat. C’est ce qui distingue foncièrement le marxiste du vulgaire petit (et aussi du grand) bourgeois. C’est avec cette pierre de touche qu’il faut éprouver la compréhension et la reconnaissance effectives du marxisme. Il n’est pas étonnant que, lorsque l’histoire de l’Europe eut amené la classe ouvrière à aborder pratiquement cette question, tous les opportunistes et les réformistes, mais aussi tous les "kautskistes" (ceux qui hésitent entre le réformisme et le marxisme) se soient révélés de pitoyables philistins et des démocrates petits-bourgeois négateurs de la dictature du prolétariat. La brochure de Kautsky La Dictature du Prolétariat, parue en août 1918, c’est-à-dire longtemps après la première édition du présent ouvrage, offre un modèle de déformation petite-bourgeoise du marxisme qu’elle répudie lâchement en fait, tout en le reconnaissant hypocritement en paroles (voir ma brochure : La Révolution prolétarienne et le renégat Kautsky, Pétrograd et Moscou, 1918).
L’opportunisme contemporain, en la personne de son principal représentant, l’ex-marxiste K. Kautsky, répond entièrement à la caractéristique, donnée par Marx, de l’attitude bourgeoise, car il circonscrit le cadre de la reconnaissance de la lutte des classes à la sphère des rapports bourgeois. (Il n’est pas un seul libéral instruit qui, dans ses limites, ne consente à admettre "en principe" la lutte des classes !) L’opportunisme n’étend pas la reconnaissance de la lutte des classes jusqu’à ce qui est précisément l’essentiel, jusqu’à la période de transition du capitalisme au communisme, jusqu’à la période de renversement et de suppression complète de la bourgeoisie. En réalité, cette période est nécessairement marquée par une lutte des classes d’un acharnement sans précédent, revêtant des formes d’une extrême acuité. L’Etat de cette période-là doit donc nécessairement être démocratique d’une manière nouvelle (pour les prolétaires et les non-possédants en général) et dictatorial d’une manière nouvelle (contre la bourgeoisie).
Poursuivons. Ceux-là seuls ont assimilé l’essence de la doctrine de Marx sur l’Etat, qui ont compris que la dictature d’une classe est nécessaire non seulement pour toute société de classes en général, non seulement pour le prolétariat qui aura renversé la bourgeoisie, mais encore pour toute la période historique qui sépare le capitalisme de la "société sans classes", du communisme. Les formes d’Etats bourgeois sont extrêmement variées, mais leur essence est une : en dernière analyse, tous ces Etats sont, d’une manière ou d’une autre, mais nécessairement, une dictature de la bourgeoisie. Le passage du capitalisme au communisme ne peut évidemment manquer de fournir une grande abondance et une large diversité de formes politiques, mais leur essence sera nécessairement une : la dictature du prolétariat.
CHAPITRE III
L’ETAT ET LA REVOLUTION.
L’EXPERIENCE DE LA COMMUNE DE PARIS (1871)
ANALYSE DE MARX
1. EN QUOI LA TENTATIVE DES COMMUNARDS EST-ELLE HEROIQUE ?
On sait que, quelques mois avant la Commune, au cours de l’automne 1870, Marx avait adressé une mise en garde aux ouvriers parisiens, s’attachant à leur démontrer que toute tentative de renverser le gouvernement serait une sottise inspirée par le désespoir. Mais lorsque, en mars 1871, la bataille décisive fut imposée aux ouvriers et que, ceux-ci l’ayant acceptée, l’insurrection devint un fait, Marx, en dépit des conditions défavorables, salua avec le plus vif enthousiasme la révolution prolétarienne. Il ne s’entêta point à condamner par pédantisme un mouvement , comme le fit le tristement célèbre renégat russe du marxisme, Plékhanov, dont les écrits de novembre l905 constituaient un encouragement à la lutte des ouvriers et des paysans, mais qui, après décembre 1905, clamait avec les libéraux : "II ne fallait pas prendre les armes."
Marx ne se contenta d’ailleurs pas d’admirer l’héroïsme des communards "montant à l’assaut du ciel", selon son expression. Dans le mouvement révolutionnaire des masses, bien que celui-ci n’eût pas atteint son but, il voyait une expérience historique d’une portée immense, un certain pas en avant de la révolution prolétarienne universelle, un pas réel bien plus important que des centaines de programmes et de raisonnements. Analyser cette expérience, y puiser des leçons de tactique, s’en servir pour passer au crible sa théorie : telle est la tâche que Marx se fixa.
La seule "correction" que Marx ait jugé nécessaire d’apporter au Manifeste Communiste, il la fit en s’inspirant de l’expérience révolutionnaire des communards parisiens.
La dernière préface à une nouvelle édition allemande du Manifeste Communiste, signée de ses deux auteurs, est datée du 24 juin 1872. Karl Marx et Friedrich Engels y déclarent que le programme du Manifeste Communiste "est aujourd’hui vieilli sur certains points".
"La Commune, notamment, a démontré, poursuivent-ils, que la "classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre la machine de l’Etat toute prête et de la faire fonctionner pour son propre compte"...[12]
Les derniers mots de cette citation, mis entre guillemets, sont empruntés par les auteurs à l’ouvrage de Marx, La Guerre Civile en France.
Ainsi, Marx et Engels attribuaient à l’une des leçons principales, fondamentales, de la Commune de Paris une portée si grande qu’ils l’ont introduite, comme une correction essentielle, dans le Manifeste Communiste.
Chose extrêmement caractéristique : c’est précisément cette correction essentielle qui a été dénaturée par les opportunistes, et les neuf dixièmes, sinon les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des lecteurs du Manifeste Communiste, en ignorent certainement le sens. Nous parlerons en détail de cette déformation un peu plus loin, dans un chapitre spécialement consacré aux déformations. Qu’il nous suffise, pour l’instant, de marquer que "l’interprétation" courante, vulgaire, de la fameuse formule de Marx citée par nous est que celui-ci aurait souligné l’idée d’une évolution lente, par opposition à la prise du pouvoir, etc.
En réalité, c’est exactement le contraire. L’idée de Marx est que la classe ouvrière doit briser, démolir la "machine de l’Etat toute prête", et ne pas se borner à en prendre possession.
Le 12 avril 1871, c’est-à-dire justement pendant la Commune, Marx écrivait à Kugelmann :
"Dans le dernier chapitre de mon 18 Brumaire, je remarque, comme tu le verras si tu le relis, que la prochaine tentative de la révolution en France devra consister non plus à faire passer la machine bureaucratique et militaire en d’autres mains, comme ce fut le cas jusqu’ici, mais à la briser. (Souligné par Marx ; dans l’original, le mot est zerbrechen). C’est la condition première de toute révolution véritablement populaire sur le continent. C’est aussi ce qu’ont tenté nos héroïques camarades de Paris" (Neue Zeit, XX, 1, 1901-1902, p. 709)[13]. Les lettres de Marx à Kugelmann comptent au moins deux éditions russes, dont une rédigée et préfacée par moi [Voir V. Lénine : "Préface à la traduction russe des lettre de K. Marx à L. Kugelmann", Oeuvres, tome 12 - Note du traducteur]."
"Briser la machine bureaucratique et militaire" : en ces quelques mots se trouve brièvement exprimée la principale leçon du marxisme sur les tâches du porlétariat à l’égard de l’Etat au cours de la révolution. Et c’est cette leçon qui est non seulement tout à fait oubliée, mais encore franchement dénaturée par "l’interprétation" dominante du marxisme, due à Kautsky !
Quant au passage du 18 Brumaire auquel se réfère Marx, nous l’avons intégralement reproduit plus haut.
Deux points surtout sont à souligner dans ce passage de Marx. En premier lieu, il limite sa conclusion au continent. Cela se concevait en 1871, quand l’Angleterre était encore un modèle du pays purement capitaliste, mais sans militarisme et, dans une large mesure, sans bureaucratie. Aussi Marx faisait-il une exception pour l’Angleterre, où la révolution et même la révolution populaire paraissait possible, et l’était en effet sans destruction préalable de la "machine d’Etat toute prête".
Aujourd’hui, en 1917, à l’époque de la première grande guerre impérialiste, cette restriction de Marx ne joue plus. L’Angleterre comme l’Amérique, les plus grands et les derniers représentants de la "liberté" anglo-saxonne dans le monde entier (absence de militarisme et de bureaucratisme), ont glissé entièrement dans le marais européen, fangeux et sanglant, des institutions militaires et bureaucratiques, qui se subordonnent tout et écrasent tout de leur poids. Maintenant, en Angleterre comme en Amérique, "la condition première de toute révolution populaire réelle", c’est la démolition, la destruction de la "machine de l’Etat toute prête" (portée en ces pays, de 1914 à 1917, à une perfection "européenne", commune désormais à tous les Etats impérialistes).
En second lieu, ce qui mérite une attention particulière, c’est cette remarque très profonde de Marx que la destruction de la machine bureaucratique et militaire de l’Etat est "la condition première de toute révolution véritablement populaire". Cette notion de révolution "populaire" paraît surprenante dans la bouche de Marx : et, en Russie, les adeptes de Plékhanov ainsi que les menchéviks, ces disciples de Strouvé qui désirent passer pour des marxistes, seraient bien capables de qualifier son expression de "lapsus". Ils ont réduit le marxisme à une doctrine si platement libérale que, en dehors de l’antithèse : révolution bourgeoise et révolution prolétarienne, rien n’existe pour eux ; encore conçoivent-ils cette antithèse d’une manière on ne peut plus scolastique.
Si l’on prend, à titre d’exemple, les révolutions du XXe siècle, force sera de reconnaître que, de toute évidence, les révolutions portugaise et turque sont bourgeoises. Mais ni l’une, ni l’autre ne sont "populaires", puisque la masse du peuple, son immense majorité, n’intervient d’une façon visible, active, autonome, avec ses revendications économiques et politiques propres, ni dans l’une, ni dans l’autre de ces révolutions. Par contre, la révolution bourgeoise russe de 1905-1907, sans avoir remporté des succès aussi "éclatants" que ceux qui échurent de temps à autre aux révolutions portugaise et turque, a été sans conteste une révolution "véritablement populaire". Car la masse du peuple, sa majorité, ses couches sociales "inférieures" les plus profondes, accablées par le joug et l’exploitation, se sont soulevées spontanément et ont laissé sur toute la marche de la révolution l’empreinte de leurs revendications, de leurs tentatives de construire à leur manière une société nouvelle à la place de l’ancienne en cours de destruction.
En 1871, le prolétariat ne formait la majorité du peuple dans aucun pays du continent européen. La révolution ne pouvait être "populaire" et entraîner véritablement la majorité dans le mouvement qu’en englobant et le prolétariat et la paysannerie. Le "peuple" était justement formé de ces deux classes. Celles-ci sont unies par le fait que la "machine bureaucratique et militaire de l’Etat" les opprime, les écrase, les exploite. Briser cette machine, la démolir, tel est véritablement l’intérêt du "peuple", de sa majorité, des ouvriers et de la majorité des paysans ; telle est la "condition première" de la libre alliance des paysans pauvres et des prolétaires ; et sans cette alliance, pas de démocratie solide, pas de transformation socialiste possible.
C’est vers cette alliance, on le sait, que la Commune de Paris se frayait la voie. Elle n’atteignit pas son but pour diverses raisons d’ordre intérieur et extérieur.
Ainsi donc, en parlant d’une "révolution véritablement populaire", et sans oublier le moins du monde les traits particuliers de la petite bourgeoisie (dont il a beaucoup et souvent parlé), Marx tenait compte avec la plus grande rigueur des véritables rapports de classes dans la plupart des Etats continentaux d’Europe en 1871. D’autre part, il constatait que la "démolition" de la machine de l’Etat est dictée par les intérêts des ouvriers et des paysans, qu’elle les unit et leur assigne une tâche commune : la suppression de ce "parasite" et son remplacement par quelque chose de nouveau.
Par quoi précisément ?
2. PAR QUOI REMPLACER LA MACHINE D’ETAT DEMOLIE ?
A cette question Marx ne donnait encore, en 1847, dans le Manifeste Communiste, qu’une réponse tout à fait abstraite, ou plutôt une réponse indiquant les problèmes, mais non les moyens de les résoudre. La remplacer par "l’organisation du prolétariat en classe dominante", par la "conquête de la démocratie", telle était la réponse du Manifeste Communiste.
Sans verser dans l’utopie, Marx attendait de l’expérience du mouvement de masse la réponse à la question de savoir quelles formes concrètes prendrait cette organisation du prolétariat en tant que classe dominante, de quelle manière précise cette organisation se concilierait avec la plus entière, la plus conséquente "conquête de la démocratie".
Aussi limitée qu’ait été l’expérience de la Commune, Marx la soumet à une analyse des plus attentives dans sa Guerre civile en France. Citons les principaux passages de cet écrit :
Au XIXe siècle s’est développé, transmis par le moyen âge, "le pouvoir centralisé de l’Etat, avec ses organes, partout présents : armée permanente, police, bureaucratie, clergé et magistrature". En raison du développement de l’antagonisme de classe entre le Capital et le Travail, "le pouvoir d’Etat prenait de plus en plus le caractère d’un pouvoir public organisé aux fins de l’asservissement de la classe ouvrière, d’un appareil de domination de classe. Après chaque révolution qui marque un progrès de la lutte des classes, le caractère purement répressif du pouvoir d’Etat apparaît de façon de plus en plus ouverte". Après la Révolution de 1848-1849, le pouvoir d’Etat devient "l’engin de guerre national du Capital contre le Travail". Le Second Empire ne fait que le consolider.
"L’antithèse directe de l’Empire fut la Commune". "La Commune fut la forme positive ... d’une république qui ne devait pas seulement abolir la forme monarchique de la domination de classe, mais la domination de classe elle-même."
En quoi consistait précisément cette forme "positive" de république prolétarienne socialiste ? Quel était l’Etat qu’elle avait commencé de fonder ?
"Le premier décret de la commune fut... la suppression de l’armée permanente, et son remplacement par le peuple en armes."
Cette revendication figure maintenant au programme de tous les partis qui se réclament du socialisme. Mais ce que valent leurs programmes, c’est ce qu’illustre au mieux l’attitude de nos socialistes-révolutionnaires et de nos menchéviks qui, justement après la révolution du 27 février, ont en fait refusé de donner suite à cette revendication !
"La Commune fut composée des conseillers municipaux, élus au suffrage universel dans les divers arrondissements de la ville. Ils étaient responsables et révocables à tout moment. La majorité de ses membres étaient naturellement des ouvriers ou des représentants reconnus de la classe ouvrière."
"Au lieu de continuer d’être l’instrument du gouvernement central, la police fut immédiatement dépouillée de ses attributs politiques et transformée en un instrument de la Commune, responsable et à tout instant révocable. Il en fut de même pour les fonctionnaires de toutes les autres branches de l’administration. Depuis les membres de la Commune jusqu’au bas de l’échelle, la fonction publique devait être assurée pour des salaires d’ouvriers. Les bénéfices d’usage et les indemnités de représentation des hauts dignitaires de l’Etat disparurent avec ces hauts dignitaires eux-mêmes... Une fois abolies l’armée permanente et la police, instruments du pouvoir matériel de l’ancien gouvernement, la Commune se donna pour tâche de briser l’outil spirituel de l’oppression, le "pouvoir des prêtres"... Les fonctionnaires de la justice furent dépouillés de leur feinte indépendance... ils devaient être électifs, responsables et révocables".[14]
Ainsi, la Commune semblait avoir remplacé la machine l’Etat brisée en instituant une démocratie "simplement" plus complète : suppression de l’armée permanente, électivité et révocabilité de tous les fonctionnaires sans exception. Or, en réalité, ce "simplement" représente une oeuvre gigantesque : le remplacement d’institutions par d’autres foncièrement différentes. C’est là justement un cas de "transformation de la quantité en qualité" : réalisée de cette façon, aussi pleinement et aussi méthodiquement qu’il est possible de le concevoir, la démocratie, de bourgeoise, devient prolétarienne ; d’Etat (pouvoir spécial destiné à mater une classe déterminée), elle se transforme en quelque chose qui n’est plus, à proprement parler, un Etat.
Mater la bourgeoisie et briser sa résistance n’en reste pas moins une nécessité. Cette nécessité s’imposait particulièrement à la Commune, et l’une des causes de sa défaite est qu’elle ne l’a pas fait avec assez de résolution. Mais ici, l’organisme de répression est la majorité de la population et non plus la minorité, ainsi qu’avait toujours été le cas au temps de l’esclavage comme au temps du servage et de l’esclavage salarié. Or, du moment que c’est la majorité du peuple qui mate elle-même ses oppresseurs, il n’est plus besoin d’un "pouvoir spécial" de répression ! C’est en ce sens que l’Etat commence à s’éteindre. Au lieu d’institutions spéciales d’une minorité privilégiée (fonctionnaires privilégiés, chefs de l’armée permanente), la majorité elle-même peut s’acquitter directement de ces tâches ; et plus les fonctions du pouvoir d’Etat sont exercées par l’ensemble du peuple, moins ce pouvoir devient nécessaire.
A cet égard, une des mesures prises par la Commune, et que Marx fait ressortir, est particulièrement remarquable : suppression de toutes les indemnités de représentation, de tous les privilèges pécuniaires attachés au corps des fonctionnaires, réduction des traitements de tous les fonctionnaires au niveau des "salaires d’ouvriers". C’est là justement qu’apparaît avec le plus de relief le tournant qui s’opère de la démocratie bourgeoise à la démocratie prolétarienne, de la démocratie des oppresseurs à la démocratie des classes opprimées, de l’Etat en tant que "pouvoir spécial" destiné à mater une classe déterminée à la répression exercée sur les oppresseurs par le pouvoir général de la majorité du peuple, des ouvriers et des paysans. Et c’est précisément sur ce point, particulièrement frappant et le plus important peut-être en ce qui concerne la question de l’Etat, que les enseignements de Marx sont le plus oubliés ! Les commentaires de vulgarisation - ils sont innombrables - n’en parlent pas. Il est "d’usage" de taire cela comme une "naïveté" qui a fait son temps, à la manière des chrétiens qui, une fois leur culte devenu religion d’Etat, ont "oublié" les "naïvetés" du christianisme primitif avec son esprit révolutionnaire démocratique.
La réduction du traitement des hauts fonctionnaires de l’Etat apparaît "simplement" comme la revendication d’un démocratisme naïf, primitif. Un des "fondateurs" de l’opportunisme moderne, l’ex-social-démocrate Ed. Bernstein, s’est maintes fois exercé à répéter les plates railleries bourgeoises contre le démocratisme "primitif". Comme tous les opportunistes, comme les kautskistes de nos jours, il n’a pas du tout compris, premièrement, qu’il est impossible de passer du capitalisme au socialisme sans un certain "retour" au démocratisme "primitif" (car enfin, comment s’y prendre autrement pour faire en sorte que les fonctions de l’Etat soient exercées par la majorité, par la totalité de la population ?) et, deuxièmement, que le "démocratisme primitif" basé sur le capitalisme et la culture capitaliste n’est pas le démocratisme primitif des époques anciennes ou précapitalistes. La culture capitaliste a créé la grande production, les fabriques, les chemins de fer, la poste, le téléphone, etc. Et, sur cette base l’immense majorité des fonctions du vieux "pouvoir d’Etat" se sont tellement simplifiées, et peuvent être réduites à de si simples opérations d’enregistrement, d’inscription, de contrôle, qu’elles seront parfaitement à la portée de toute personne pourvue d’une instruction primaire, qu’elles pourront parfaitement être exercées moyennant un simple "salaire d’ouvrier" ; ainsi l’on peut (et l’on doit) enlever à ces fonctions tout caractère privilégié, "hiérarchique".
Electivité complète, révocabilité à tout moment de tous les fonctionnaires sans exception, réduction de leurs traitements au niveau d’un normal "salaire d’ouvrier", ces mesures démocratiques simples et "allant de soi", qui rendent parfaitement solidaires les intérêts des ouvriers et de la majorité des paysans, servent en même temps de passerelle conduisant du capitalisme au socialisme. Ces mesures concernent la réorganisation de l’Etat, la réorganisation purement politique de la société, mais elles ne prennent naturellement tout leur sens et toute leur valeur que rattachées à la réalisation ou à la préparation de "l’expropriation des expropriateurs", c’est-a-dire avec la transformation de la propriété privée capitaliste des moyens de production en propriété sociale.
"La Commune, écrivait Marx, a réalisé ce mot d’ordre de toutes les révolutions bourgeoises, le gouvernement à bon marché, en abolissant ces deux grandes sources de dépenses : l’armée permanente et le fonctionnarisme d’Etat."
Seule une infime minorité de la paysannerie ainsi que des autres couches de la petite bourgeoisie "s’élève", "arrive" au sens bourgeois du mot, c’est-a-dire que seuls quelques individus deviennent ou des gens aisés, des bourgeois, ou des fonctionnaires nantis et privilégiés. L’immense majorité des paysans, dans tout pays capitaliste où il existe une paysannerie (et ces pays sont en majorité), sont opprimés par le gouvernement et aspirent à le renverser ; ils aspirent à un gouvernement "à bon marché". Le prolétariat peut seul, s’acquitter de cette tâche et, en l’exécutant, il fait du même coup un pas vers la réorganisation socialiste de l’Etat.
3. SUPPRESSION DU PARLEMENTARISME
"La Commune, écrivait Marx, devait être non pas un organisme parlementaire, mais un corps agissant, exécutif et législatif à la fois."
"Au lieu de décider une fois tous les trois ou six ans quel membre de la classe dirigeante "devait représenter" et fouler aux pieds [ver-und zertreten] le peuple au Parlement, le suffrage universel devait servir au peuple constitué en communes, comme le suffrage individuel sert à tout autre employeur en quête d’ouvriers, de surveillants, de comptables pour ses entreprises."
Cette remarquable critique du parlementarisme, formulée en 1871, est elle aussi aujourd’hui, du fait de la domination du social-chauvinisme et de l’opportunisme, au nombre des "paroles oubliées" du marxisme. Les ministres et les parlementaires de profession, les traîtres au prolétariat et les socialistes "pratiques" d’à présent ont entièrement laissé aux anarchistes le soin de critiquer le parlementarisme ; et, pour cette raison d’une logique surprenante, ils qualifient "d’anarchiste" toute critique du parlementarisme !! On ne saurait s’étonner que le prolétariat des pays parlementaires "avancés", écoeuré à la vue de "socialistes" tels que les Scheidemann, David, Legien, Sembat, Renaudel, Henderson, Vandervelde, Stauning, Branting, Bissolati etc., ait de plus en plus souvent accordé ses sympathies à l’anarcho-syndicalisme, encore que celui-ci soit le frère jumeau de l’opportunisme.
Mais, pour Marx, la dialectique révolutionnaire n’a jamais été cette vaine phraséologie à la mode, ce hochet qu’en ont fait Plékhanov, Kautsky et les autres. Marx a su rompre impitoyablement avec l’anarchisme pour son impuissance à utiliser même "l’écurie" du parlementarisme bourgeois, surtout lorsque la situation n’est manifestement pas révolutionnaire ; mais il a su, en même temps, donner une critique véritablement prolétarienne et révolutionnaire du parlementarisme.
Décider périodiquement, pour un certain nombre d’années, quel membre de la classe dirigeante foulera aux pieds, écrasera le peuple au Parlement, telle est l’essence véritable du parlementarisme bourgeois, non seulement dans les monarchies constitutionnelles parlementaires, mais encore dans les républiques les plus démocratiques.
Mais si l’on pose la question de l’Etat, si l’on considère le parlementarisme comme une de ses institutions, du point de vue des tâches du prolétariat dans ce domaine, quel est donc le moyen de sortir du parlementarisme ? Comment peut-on s’en passer ?
Force nous est de le dire et redire encore : les enseignements de Marx, fondés sur l’étude de la Commune, sont si bien oubliés que le "social-démocrate" actuel (lisez : l’actuel traître au socialisme) est tout simplement incapable de concevoir une autre critique du parlementarisme que la critique anarchiste ou réactionnaire.
Certes, le moyen de sortir du parlementarisme ne consiste pas à détruire les organismes représentatifs et le principe électif, mais à transformer ces moulins à paroles que sont les organismes représentatifs en assemblées "agissantes". "La Commune devait être non pas un organisme parlementaire, mais un corps agissant, exécutif et législatif à la fois."
Un organisme "non parlementaire mais agissant", voilà qui s’adresse on ne peut plus directement aux parlementaires modernes et aux "toutous" parlementaires de la social-démocratie ! Considérez n’importe quel pays parlementaire, depuis l’Amérique jusqu’à la Suisse, depuis la France jusqu’à l’Angleterre, la Norvège, etc., la véritable besogne "d’Etat" se fait dans la coulisse ; elle est exécutée par les départements, les chancelleries, les états-majors. Dans le parlements, on ne fait que bavarder, à seule fin de duper le "bon peuple". Cela est si vrai que, même dans la République russe, république démocratique bourgeoise, tous ces vices du parlementarisme sont apparus aussitôt, avant même qu’elle ait eu le temps de constituer un véritable parlement. Les héros du philistinisme pourri - les Skobélev et les Tsérétéli, les Tchernov et les Avksentiev - ont réussi à gangrener jusqu’aux Soviets, dont ils ont fait de stériles moulins à paroles sur le modèle du plus écoeurant parlementarisme bourgeois. Dans les Soviets, messieurs les ministres "socialistes" dupent les moujiks crédules par leur phraséologie et leurs résolutions. Au sein du gouvernement, c’est un quadrille permanent, d’une part, pour faire asseoir à tour de rôle, autour de "l’assiette au beurre", des sinécures lucratives et honorifiques, le plus possible de socialistes-révolutionnaires et de menchéviks ; d’autre part, pour "distraire l’attention" du peuple. Pendant ce temps, dans les chancelleries, dans les états-majors, on "fait" le travail "d’Etat" !
Le Diélo Naroda, organe des "socialistes-révolutionnaires", parti dirigeant, avouait récemment dans un éditorial, avec cette incomparable franchise des gens de la "bonne société", où "tous" se livrent à la prostitution politique, que même dans les ministères appartenant aux "socialistes" (passez-moi le mot !), que même là tout le vieil appareil bureaucratique reste en gros le même, fonctionne comme par le passé et sabote en toute "liberté" les mesures révolutionnaires ! Mais même sans cet aveu, l’histoire de la participation des socialistes-révolutionnaires et des menchéviks au gouvernement n’apporte-t-elle pas la preuve concrète qu’il en est ainsi ? Ce qui est caractéristique, en l’occurrence, c’est que, siégeant au ministère en compagnie des cadets, MM. Tchernov, Roussanov, Zenzinov et autres rédacteurs du Diélo Naroda poussent l’impudence jusqu’à raconter en public et sans rougir, comme une chose sans conséquence, que "chez eux", dans leurs ministères, tout marche comme par le passé !! Phraséologie démocratique révolutionnaire pour duper Jacques Bonhomme, bureaucratisme et paperasserie pour "combler d’aise" les capitalistes : voilà l’essence de "l’honnête" coalition.
Au parlementarisme vénal, pourri jusqu’à la moelle, de la société bourgeoise, la Commune substitue des organismes où la liberté d’opinion et de discussion ne dégénère pas en duperie, car les parlementaires doivent travailler eux-mêmes, appliquer eux-mêmes leurs lois, en vérifier eux-mêmes les effets, en répondre eux-mêmes directement devant leurs électeurs. Les organismes représentatifs demeurent, mais le parlementarisme comme système spécial, comme division du travail législatif et exécutif, comme situation privilégiée pour les députés, n’est plus. Nous ne pouvons concevoir une démocratie, même une démocratie prolétarienne, sans organismes représentatifs : mais nous pouvons et devons la concevoir sans parlementarisme, si la critique de la société bourgeoise n’est pas pour nous un vain mot, si notre volonté de renverser la domination de la bourgeoisie est une volonté sérieuse et sincère et non une phrase "électorale" destinée à capter les voix des ouvriers, comme chez les menchéviks et les socialistes-révolutionnaires, chez les Scheidemann et les Legien, les Sembat et les Vandervelde.
Il est extrêmement symptomatique que, parlant des fonctions de ce personnel administratif qu’il faut à la Commune comme à la démocratie prolétarienne, Marx prenne comme terme de comparaison le personnel "de tout autre employeur", c’est-à-dire une entreprise capitaliste ordinaire avec ses "ouvriers, surveillants et comptables".
Il n’y a pas un grain d’utopisme chez Marx ; il n’invente pas, il n’imagine pas de toutes pièces une société "nouvelle". Non, il étudie, comme un processus d’histoire naturelle, la naissance de la nouvelle société à partir de l’ancienne, les formes de transition de celle-ci à celle-là. Il prend l’expérience concrète du mouvement prolétarien de masse et s’efforce d’en tirer des leçons pratiques. Il "se met à l’école" de la Commune, de même que tous les grands penseurs révolutionnaires n’hésitèrent pas à se mettre à l’école des grands mouvements de la classe opprimée, sans jamais les aborder du point de vue d’une "morale" pédantesque (comme Plékhanov disant : "Il ne fallait pas prendre les armes", ou Tsérétéli : "Une classe doit savoir borner elle-même ses aspirations").
Il ne saurait être question de supprimer d’emblée, partout et complètement, le fonctionnarisme. C’est une utopie. Mais briser d’emblée la vieille machine administrative pour commencer sans délai à en construire une nouvelle, permettant de supprimer graduellement tout fonctionnarisme, cela n’est pas une utopie, c’est l’expérience de la Commune, c’est la tâche urgente, immédiate, du prolétariat révolutionnaire.
Le capitalisme simplifie les fonctions administratives "étatiques" ; il permet de rejeter les "méthodes de commandement" et de tout ramener à une organisation des prolétaires (classe dominante) qui embauche, au nom de toute la société, "des ouvriers, des surveillants, des comptables".
Nous ne sommes pas des utopistes. Nous ne "rêvons" pas de nous passer d’emblée de toute administration, de toute subordination ; ces rêves anarchistes, fondés sur l’incompréhension des tâches qui incombent à la dictature du prolétariat, sont foncièrement étrangers au marxisme et ne servent en réalité qu’à différer la révolution socialiste jusqu’au jour où les hommes auront changé. Nous, nous voulons la révolution socialiste avec les hommes tels qu’ils sont aujourd’hui, et qui ne se passeront pas de subordination, de contrôle, "surveillants et de comptables".
Mais c’est au prolétariat, avant-garde armée de tous les exploités et de tous les travailleurs, qu’il faut se subordonner. On peut et on doit dès à présent, du jour au lendemain, commencer à remplacer les "méthodes de commandement" propres aux fonctionnaires publics par le simple exercice d’une "surveillance et d’une comptabilité", fonctions toutes simples qui, dès aujourd’hui, sont parfaitement à la portée de la généralité des citadins, et dont ils peuvent parfaitement s’acquitter pour des "salaires d’ouvriers".
C’est nous-mêmes, les ouvriers, qui organiserons la grande production en prenant pour point de départ ce qui a déjà été créé par le capitalisme, en nous appuyant sur notre expérience ouvrière, en instituant une discipline rigoureuse, une discipline de fer maintenue par le pouvoir d’Etat des ouvriers armés ; nous réduirons les fonctionnaires publics au rôle de simples agents d’exécution de nos directives, au rôle "de surveillants et de comptables", responsables, révocables et modestement rétribués (tout en conservant, bien entendu, les spécialistes de tout genre, de toute espèce et de tout rang) : voilà notre tâche prolétarienne, voilà par quoi l’on peut et l’on doit commencer en accomplissant la révolution prolétarienne. Ces premières mesures, fondées sur la grande production, conduisent d’elles-mêmes à "l’extinction" graduelle de tout fonctionnarisme, à l’établissement graduel d’un ordre - sans guillemets et ne ressemblant point à l’esclavage salarié - où les fonctions de plus en plus simplifiées de surveillance et de comptabilité seront remplies par tout le monde à tour de rôle, pour ensuite devenir une habitude et disparaître enfin en tant que fonctions spéciales d’une catégorie spéciale d’individus.
Un spirituel social-démocrate allemand des années 70 a dit de la poste qu’elle était un modèle d’entreprise socialiste. Rien n’est plus juste. La poste est actuellement une entreprise organisée sur le modèle du monopole capitaliste d’Etat. L’impérialisme transforme progressivement tous les trusts en organisations de ce type. Les "simples" travailleurs, accablés de besogne et affamés, y restent soumis à la même bureaucratie bourgeoise. Mais le mécanisme de gestion sociale y est déjà tout prêt. Une fois les capitalistes renversés, la résistance de ces exploiteurs matée par la main de fer des ouvriers en armes, la machine bureaucratique de l’Etat actuel brisée, nous avons devant nous un mécanisme admirablement outillé au point de vue technique, affranchi de "parasitisme", et que les ouvriers associés peuvent fort bien mettre en marche eux-mêmes en embauchant des techniciens, des surveillants, des comptables, en rétribuant leur travail à tous, de même que celui de tous les fonctionnaires "publics", par un salaire d’ouvrier. Telle est la tâche concrète, pratique, immédiatement réalisable à l’égard de tous les trusts, et qui affranchit les travailleurs de l’exploitation en tenant compte de l’expérience déjà commencée pratiquement par la Commune (surtout dans le domaine de l’organisation de l’Etat).
Toute l’économie nationale organisée comme la poste, de façon que les techniciens, les surveillants, les comptables reçoivent, comme tous les fonctionnaires, un traitement n’excédant pas des "salaires d’ouvriers", sous le contrôle et la direction du prolétariat armé : tel est notre but immédiat. Voilà l’Etat dont nous avons besoin, et sa base économique. Voilà ce que donneront la suppression du parlementarisme et le maintien des organismes représentatifs, - voilà ce qui débarrassera les classes laborieuses de la corruption de ces organismes par la bourgeoisie.
4. ORGANISATION DE L’UNITE DE LA NATION
"Dans une brève esquisse d’organisation nationale que la Commune n’eut pas le temps de développer, il est dit expressément que la Commune devait être la forme politique même des plus petits hameaux de campagne..." Ce sont les Communes qui auraient également élu la "délégation nationale" de Paris.
"Les fonctions, peu nombreuses, mais importantes, qui restaient encore à un gouvernement central, ne devaient pas être supprimées, comme on l’a dit faussement, de propos délibéré, mais devaient être confiées à des fonctionnaires communaux, autrement dit strictement responsables".
"L’unité de la nation ne devait pas être brisée, mais au contraire organisée par la Constitution communale ; elle devait devenir une réalité grâce à la destruction du pouvoir d’Etat qui prétendait être l’incarnation de cette unité, mais voulait être indépendant de la nation même, et supérieur à elle, alors qu’il n’en était qu’une excroissance parasitaire. Tandis qu’il importait d’amputer les organes purement répressifs de l’ancien pouvoir gouvernemental, ses fonctions légitimes devaient être arrachées à une autorité qui prétendait se placer au-dessus de la société, et rendues aux serviteurs responsables de la société."
A quel point les opportunistes de la social-démocratie contemporaine n’ont pas compris - il serait peut-être plus juste de dire : n’ont pas voulu comprendre - ces considérations de Marx, c’est ce que montre on ne peut mieux le livre : Les Prémisses du Socialisme et les tâches de le Social-démocratie, par lequel le renégat Bernstein s’est acquis une célébrité à la manière d’Erostrate. Précisément à propos du passage de Marx, que nous venons de citer, Bernstein écrivait que ce programme, "par son contenu politique, accuse, dans tous ses traits essentiels, une ressemblance frappante avec le fédéralisme de Proudhon... En dépit de toutes les divergences existant, par ailleurs, entre Marx et le "petit-bourgeois" Proudhon (Bernstein écrit "petit-bourgeois" entre guillemets, entendant y mettre de l’ironie), leur façon de voir est sur ces points, semblable au possible". Sans doute, continue Bernstein, l’importance des municipalités grandit, mais "il me paraît douteux que la première tâche de la démocratie soit cette suppression ("Auflösung", littéralement : dissolution au sens propre comme au sens figuré) des Etats modernes et ce changement complet (Umwandlung, métamorphose) de leur organisation qu’imaginent Marx et Proudhon : formation d’une assemblée nationale de délégués des assemblées provinciales ou départementales, lesquelles se composeraient à leur tour de délégués des communes, de sorte que toute la forme antérieure des représentations nationales disparaîtrait complètement." (Bernstein, ouvr. cité, pp. 134 et 136, édit. allemande de 1899).
Voilà qui est tout simplement monstrueux : confondre les vues de Marx sur la "destruction du pouvoir d’Etat parasite" avec le fédéralisme de Proudhon ! Mais ce n’est pas un effet du hasard, car il ne vient même pas à l’idée de l’opportuniste que Marx, loin de traiter ici du fédéralisme par opposition au centralisme, parle de la démolition de la vieille machine d’Etat bourgeoise existant dans tous les pays bourgeois.
Il ne vient à l’idée de l’opportuniste que ce qu’il voit autour de lui, dans son milieu de philistinisme petit-bourgeois et de stagnation "réformiste", à savoir, uniquement les "municipalités" ! Quant à la révolution du prolétariat, l’opportuniste a désappris même d’y penser.
Cela est ridicule. Mais il est remarquable que, sur ce point, on n’ait pas discuté avec Bernstein. Beaucoup l’ont réfuté, en particulier Plékhanov parmi les auteurs russes, et Kautsky parmi les auteurs d’Europe occidentale ; cependant, ni l’un ni l’autre n’ont rien dit de cette déformation de Marx par Bernstein.
L’opportuniste a si bien désappris à penser révolutionnairement et à réfléchir à la révolution qu’il voit du "fédéralisme" chez Marx, ainsi confondu avec le fondateur de l’anarchisme, Proudhon. Et Kautsky, et Plékhanov, qui prétendent être des marxistes orthodoxes et vouloir défendre la doctrine du marxisme révolutionnaire, se taisent là-dessus. On découvre ici l’une des racines de cette extrême indigence de vues sur la différence entre le marxisme et l’anarchisme, qui caractérise les kautskistes aussi bien que les opportunistes et dont nous aurons encore à parler.
Dans les considérations déjà citées de Marx sur l’expérience de la Commune, il n’y a pas trace de fédéralisme. Marx s’accorde avec Proudhon précisément sur un point que l’opportuniste Bernstein n’apercoit pas. Marx est en désaccord avec Proudhon précisément là où Bernstein les voit s’accorder.
Marx s’accorde avec Proudhon en ce sens que tous deux sont pour la "démolition" de la machine d’Etat actuelle. Cette similitude du marxisme avec l’anarchisme (avec Proudhon comme avec Bakounine), ni les opportunistes, ni les kautskistes ne veulent l’apercevoir, car, sur ce point, ils se sont éloignés du marxisme.
Marx est en désaccord et avec Proudhon et avec Bakounine précisément à propos du fédéralisme (sans parler de la dictature du prolétariat). Les principes du fédéralisme découlent des conceptions petites-bourgeoises de l’anarchisme. Marx est centraliste. Et, dans les passages cités de lui, il n’existe pas la moindre dérogation au centralisme. Seuls des gens imbus d’une "foi superstitieuse" petite-bourgeoise en l’Etat peuvent prendre la destruction de la machine bourgeoise pour la destruction du centralisme !
Mais si le prolétariat et la paysannerie pauvre prennent en main le pouvoir d’Etat, s’organisent en toute liberté au sein des communes et unissent l’action de toutes les communes pour frapper le Capital, écraser la résistance des capitalistes, remettre à toute la nation, à toute la société, la propriété privée des chemins de fer, des fabriques, de la terre, etc., ne sera-ce pas là du centralisme ? Ne sera-ce pas là le centralisme démocratique le plus conséquent et, qui plus est, un centralisme prolétarien ?
Bernstein est tout simplement incapable de concevoir la possibilité d’un centralisme librement consenti, d’une libre union des communes en nation, d’une fusion volontaire des communes prolétariennes en vue de détruire la domination bourgeoise et la machine d’Etat bourgeoise. Comme tout philistin, Bernstein se représente le centralisme comme une chose qui ne peut être imposée et maintenue que d’en haut, par la bureaucratie et le militarisme.
Comme s’il avait prévu la possibilité d’une déformation de sa doctrine, Marx souligne à dessein que c’est commettre sciemment un faux que d’accuser la Commune d’avoir voulu détruire l’unité de la nation et supprimer le pouvoir central. Marx emploie intentionnellement cette expression : "organiser l’unité de la nation", pour opposer le centralisme prolétarien conscient, démocratique, au centralisme bourgeois, militaire, bureaucratique.
Mais... il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et les opportunistes de la social-démocratie contemporaine ne veulent justement pas entendre parler de la destruction du pouvoir d’Etat, de l’amputation de ce parasite.
5. DESTRUCTION DE L’ETAT PARASITE
Nous avons déjà cité les passages correspondants de Marx sur ce point ; nous allons les compléter.
"C’est en général le sort des formations historiques entièrement nouvelles, écrivait Marx, d’être prises à tort pour la réplique de formes plus anciennes, et même éteintes, de la vie sociale, avec lesquelles elles peuvent offrir une certaine ressemblance. Ainsi, dans cette nouvelle Commune, qui brise [bricht] le pouvoir d’Etat moderne, on a voulu voir un rappel à la vie des communes médiévales... une fédération de petits Etats, conforme aux rêves de Montesquieu et des Girondins... une forme excessive de la vieille lutte contre la surcentralisation..."
"La Constitution communale aurait restitué au corps social toutes les forces jusqu’alors absorbées par l’Etat parasite qui se nourrit sur la société et en paralyse le libre mouvement. Par ce seul fait, elle eût été le point de départ de la régénération de la France...
"...la Constitution communale aurait mis les producteurs ruraux sous la direction intellectuelle des chefs-lieux de département et leur y eût assuré, chez les ouvriers des villes, les dépositaires naturels de leurs intérêts. L’existence même de la Commune impliquait, comme quelque chose d’évident, l’autonomie municipale ; mais elle n’était plus dorénavant un contrepoids au pouvoir d’Etat, désormais superflu."
"Destruction du pouvoir d’Etat", cette "excroissance parasitaire" ; "amputation", "démolition" de ce pouvoir ; "le pouvoir d’Etat désormais aboli" ; c’est en ces termes que Marx, jugeant et analysant l’expérience de la Commune, parle de l’Etat.
Tout ceci fut écrit il y a moins d’un demi-siècle, et il faut aujourd’hui se livrer à de véritables fouilles pour retrouver et faire pénétrer dans la conscience des larges masses un marxisme non frelaté. Les conclusions tirées par Marx de ses observations sur la dernière grande révolution qu’il ait vécue ont été oubliées juste au moment où s’ouvrait une nouvelle époque de grandes révolutions du prolétariat.
"La multiplicité des interprétations auxquelles la Commune a été soumise, et la multiplicité des intérêts qui se sont réclamés d’elle montrent que c’était une forme politique tout à fait susceptible d’expansion, tandis que toutes les formes antérieures de gouvernement avaient été essentiellement répressives. Son véritable secret, le voici : c’était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l’émancipation économique du Travail."
"Sans cette dernière condition, la Constitution communale eût été une impossibilité et un leurre."
Les utopistes se sont efforcés de "découvrir" les formes politiques sous lesquelles devait s’opérer la réorganisation socialiste de la société. Les anarchistes ont éludé en bloc la question des formes politiques. Les opportunistes de la social-démocratie contemporaine ont accepté les formes politiques bourgeoises de l’Etat démocratique parlementaire comme une limite que l’on ne saurait franchir et ils se sont fendu le front à se prosterner devant ce "modèle", en taxant d’anarchisme toute tentative de briser ces formes.
De toute l’histoire du socialisme et de la lutte politique, Marx a déduit que l’Etat devra disparaître et que la forme transitoire de sa disparition (passage de l’Etat au non-Etat) sera "le prolétariat organisé en classe dominante". Quant aux formes politiques de cet avenir, Marx n’a pas pris sur lui de les découvrir. Il s’est borné à observer exactement l’histoire de la France, à l’analyser et à tirer la conclusion à laquelle l’a conduit l’année 1851 : les choses s’orientent vers la destruction de la machine d’Etat bourgeoise.
Et quand éclata le mouvement révolutionnaire de masse du prolétariat, malgré l’échec de ce mouvement, malgré sa courte durée et sa faiblesse évidente, Marx se mit à étudier les formes qu’il avait révélées.
La Commune est la forme, "enfin trouvée" par la révolution prolétarienne, qui permet de réaliser l’émancipation économique du Travail.
La Commune est la première tentative faite par la révolution prolétarienne pour briser la machine d’Etat bourgeoise ; elle est la forme politique "enfin trouvée" par quoi l’on peut et l’on doit remplacer ce qui a été brisé.
Nous verrons plus loin que les révolutions russes de 1905 et de 1917, dans un cadre différent, dans d’autres conditions, continuent l’oeuvre de la Commune et confirment la géniale analyse historique de Marx.
CHAPITRE IV
SUITE. EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES D’ENGELS
Marx a dit l’essentiel sur la portée de l’expérience de la Commune. Engels est revenu à maintes reprises sur ce même sujet, commentant l’analyse et les conclusions de Marx et éclairant parfois d’autres aspects du problème avec une telle vigueur et un tel relief qu’il est indispensable de nous arrêter spécialement sur ces commentaires.
1. LA "QUESTION DU LOGEMENT"
Dans son ouvrage qui traite de la question du logement (1872), Engels tient déjà compte de l’expérience de la Commune lorsque, à plusieurs reprises, il s’arrête sur les tâches de la révolution à l’égard de l’Etat. Il est intéressant de voir comment, sur ce sujet concret, l’on voit apparaître clairement, d’une part, les traits de similitude entre l’Etat prolétarien et l’Etat actuel,-traits qui permettent dans les deux cas de parler d’Etat,-et, d’autre part, les traits qui les distinguent et où se marque la transition vers la suppression de l’Etat.
"Comment donc résoudre la question du logement ? Dans notre société actuelle, comme toute autre question sociale : en établissant graduellement un équilibre économique entre l’offre et la demande ; cette solution, qui n’empêche pas le problème de se poser sans cesse à nouveau, n’en est donc pas une. Quant à la manière dont une révolution sociale résoudrait la question, cela dépend non seulement des circonstances dans lesquelles elle se produirait, mais aussi de questions beaucoup plus étendues, dont l’une des plus essentielles est la suppression de l’opposition entre la ville et la campagne. Comme nous n’avons pas à bâtir des systèmes utopiques pour l’organisation de la société future, il serait plus qu’oiseux de nous étendre sur ce sujet. Ce qui est certain, c’est qu’il y a dans les grandes villes déjà suffisamment d’immeubles à usage d’habitation pour remédier sans délai par leur emploi rationnel à toute véritable "crise du logement". Ceci ne peut naturellement se faire que par l’expropriation des propriétaires actuels, par l’occupation de leurs immeubles par des travailleurs sans abri ou immodérément entassés dans leurs logis ; et dès que le prolétariat aura conquis le pouvoir politique, cette mesure exigée par le bien public sera aussi facile à réaliser que le sont aujourd’hui les expropriations et réquisitions de logements par l’Etat" (p.22 de l’édit. allemande de 1887)[15].
On n’envisage pas ici un changement de forme du pouvoir d’Etat, mais uniquement le contenu de son activité. L’Etat actuel ordonne, lui aussi, des expropriations et les réquisitions de logements. Au point de vue formel, l’Etat prolétarien "ordonnera" également des réquisitions de logements et des expropriations d’immeubles. Mais il est clair que l’ancien appareil exécutif, la bureaucratie liée à la bourgeoisie, serait tout simplement inapte à appliquer les dispositions de l’Etat prolétarien.
"... il faut constater que la "prise de possession effective", par la population laborieuse, de tous les instruments de travail, de toute l’industrie est exactement le contraire du "rachat" proudhonien. D’après cette dernière solution, chaque ouvrier devient propriétaire de son logis, de sa ferme, de ses instruments de travail. D’après la première, la "population laborieuse" reste possesseur collectif des maisons, usines et instruments de travail et, du moins pendant une période de transition, elle en abandonnera difficilement la jouissance sans dédommagement de ses frais aux individus ou aux sociétés privées. Exactement comme la suppression de la propriété foncière n’est pas celle de la rente foncière, mais son transfert à la société, encore que sous une forme modifiée. L’appropriation effective de tous les instruments de travail par la population laborieuse n’exclut donc en aucune façon le maintien du louage et de la location" (p.68)
Nous examinerons au chapitre suivant la question effleurée ici, celle des bases économiques de l’extinction de l’Etat. Engels s’exprime avec une extrême prudence en disant que l’Etat prolétarien pourra "difficilement" distribuer des logements sans loyer, "du moins pendant une période de transition". La location de logements, propriété de tout le peuple, à telles ou telles familles, contre un loyer, suppose aussi la perception de ce loyer, ainsi qu’un certain contrôle et l’établissement de certaines normes de répartition des logements. Tout cela exige une forme d’Etat déterminée, mais ne requiert nullement un appareil militaire et bureaucratique spécial, avec des fonctionnaires bénéficiant d’une situation privilégiée. Tandis que le passage à un état de choses où les logements pourront être fournis gratuitement est lié à "l’extinction" totale de l’Etat.
Parlant des blanquistes qui, après la Commune et influencés par son expérience, adoptèrent la position de principe du marxisme, Engels définit en passant cette position de la façon suivante :
"... nécessité de l’action politique du prolétariat et de sa dictature comme transition à l’abolition des classes et, avec elles, de l’Etat" (p.55).
Des amateurs de critique littérale ou des bourgeois "destructeurs du marxisme" verront peut-être une contradiction entre cette reconnaissance de "l’abolition de l’Etat" et la négation de cette formule, considérée comme anarchiste, dans la citation reproduite plus haut de l’Anti-Dühring. On ne serait pas étonné de voir les opportunistes ranger Engels, lui aussi, parmi les "anarchistes" ; accuser les internationalistes d’anarchisme est, de nos jours, une pratique de plus en plus répandue parmi les social-chauvins.
Avec l’abolition des classes aura lieu aussi l’abolition de l’Etat, c’est ce que le marxisme a toujours enseigné. Le passage bien connu de l’Anti-Dühring sur "l’extinction de l’Etat" accuse les anarchistes non pas tant d’être partisans de l’abolition de l’Etat que de prêcher qu’il est possible d’abolir l’Etat "du jour au lendemain".
La doctrine "social-démocrate" qui règne aujourd’hui ayant complètement dénaturé l’attitude du marxisme à l’égard de l’anarchisme dans la question de la suppression de l’Etat, il est particulièrement utile de rappeler certaine polémique de Marx et d’Engels avec les anarchistes.
2. POLEMIQUE AVEC LES ANARCHISTES
Cette polémique remonte à 1873. Marx et Engels avaient publié des articles contre les proudhoniens "antiautoritaires" dans un recueil socialiste italien ; et ce n’est qu’en 1913 que ces articles parurent en traduction allemande dans la Neue Zeit [16].
"Si la lutte politique de la classe ouvrière, écrivait Marx, raillant les anarchistes et leur négation de la politique, revêt des formes révolutionnaires ; si, à la place de la dictature de la bourgeoisie, les ouvriers établissent leur dictature révolutionnaire, ils commettent un crime effroyable de lèse-principes, car, pour satisfaire leurs misérables et grossiers besoins du jour, pour briser la résistance de la bourgeoisie, ils donnent à l’Etat une forme révolutionnaire et passagère, au lieu de déposer les armes et d’abolir l’Etat" (Neue Zeit, 1913-1914, 32e année, tome I, p. 40).
C’est uniquement contre cette "abolition-là" de l’Etat que s’élevait Marx quand il réfutait les anarchistes ! Il ne s’élevait pas du tout contre l’idée que l’Etat disparaîtra avec les classes, ou sera aboli avec leur abolition, mais contre le refus éventuel, de la part des ouvriers, d’employer les armes, d’user de la violence organisée, c’est-à-dire de l’Etat, qui doit servir à "briser la résistance de la bourgeoisie".
Marx souligne expressément-pour qu’on ne vienne pas dénaturer le sens véritable de sa lutte contre l’anarchisme- la "forme révolutionnaire et passagère" de l’Etat nécessaire au prolétariat. Le prolétariat n’a besoin de l’Etat que pour un temps. Nous ne sommes pas le moins du monde en désaccord avec les anarchistes quant à l’abolition de l’Etat en tant que but. Nous affirmons que, pour atteindre ce but, il est nécessaire d’utiliser provisoirement les instruments, les moyens et les procédés du pouvoir d’Etat contre les exploiteurs, de même que, pour supprimer les classe, il est indispensable d’établir la dictature provisoire de la classe opprimée. Marx choisit la façon la plus incisive et la plus nette de poser la question contre les anarchistes : les ouvriers doivent-ils, en renversant le joug des capitalistes, "déposer les armes" ou les utiliser contre les capitalistes afin de briser leur résistance ? Or, si une classe fait systématiquement usage de ses armes contre une autre classe, qu’est-ce donc sinon une "forme passagère" de l’Etat ?
Que chaque social-démocrate s’interroge : est-ce bien ainsi qu’il posait lui-même la question de l’Etat dans la polémique avec les anarchistes ? Est-ce bien ainsi que posait cette question l’immense majorité des partis socialistes officiels de la IIe Internationale ?
Engels expose les mêmes idées d’une manière beaucoup plus détaillée et plus populaire encore. Tout d’abord, il raille la confusion d’idées chez les proudhoniens, qui s’intitulaient "antiautoritaires", c’est-à-dire qui niaient toute autorité, toute subordination, tout pouvoir. Prenez une usine, un chemin de fer, un navire en haute mer, dit Engels ; n’est-il pas évident que, sans une certaine subordination, donc sans une certaine autorité ou un certain pouvoir, il est impossible de faire fonctionner aucun de ces établissements techniques compliqués, fondés sur l’emploi des machines et la collaboration méthodique de nombreuses personnes ?
"Lorsque j’avance de semblables arguments contre les plus furieux antiautoritaires, écrit Engels, ceux-ci ne savent que me répondre : "Ah ! cela est vrai, mais il ne s’agit pas ici d’une autorité que nous donnons à des délégués, mais d’une mission !" Ces messieurs croient avoir changé les choses quand ils en ont changé les noms."
Après avoir ainsi démontré qu’autorité et autonomie sont des notions relatives ; que le domaine de leur application varie suivant les différentes phases de l’évolution sociale ; qu’il est absurde de les prendre pour des absolus ; après avoir ajouté que le domaine de l’emploi des machines et de la grande industrie s’étend de plus en plus, Engels passe, des considérations générales sur l’autorité, à la question de l’Etat.
"Si les autonomistes, écrit-il, se bornaient à dire que l’organisation sociale de l’avenir restreindra l’autorité aux seules limites à l’intérieur desquelles les conditions de la production la rendent inévitable, on pourrait s’entendre ; au lieu de cela, ils restent aveugles devant tous les faits qui rendent nécessaire la chose, et ils se dressent contre le mot.
Pourquoi les antiautoritaires ne se bornent-ils pas à s’élever contre l’autorité politique, contre l’Etat ? Tous les socialistes sont d’accord que l’Etat politique et, avec lui, l’autorité politique disparaîtront en conséquence de la prochaine révolution sociale, à savoir que les fonctions publiques perdront leur caractère politique et se transformeront en simples fonctions administratives protégeant les véritables intérêts sociaux. Mais les antiautoritaires demandent que l’Etat politique autoritaire soit aboli d’un coup, avant même qu’on ait détruit les conditions sociales qui l’ont fait naître. Ils demandent que le premier acte de la révolution sociale soit l’abolition de l’autorité.
Ont-ils jamais vu une révolution, ces messieurs ? Une révolution est certainement la chose la plus autoritaire qui soit ; c’est l’acte par lequel une partie de la population impose sa volonté à l’autre au moyen de fusils, de baïonnettes et de canons, moyens autoritaires s’il en est ; et le parti victorieux, s’il ne veut pas avoir combattu en vain, doit maintenir son pouvoir par la peur que ses armes inspirent aux réactionnaires. La Commune de Paris aurait-elle duré un seul jour, si elle ne s’était pas servie de cette autorité du peuple armé face aux bourgeois ? Ne peut-on, au contraire, lui reprocher de ne pas s’en être servi assez largement ? Donc, de deux choses l’une : ou les antiautoritaires ne savent pas ce qu’ils disent, et, dans ce cas, ils ne sèment que la confusion ; ou bien, ils le savent et, dans ce cas, ils trahissent le mouvement du prolétariat. Dans un cas comme dans l’autre, ils servent la réaction." (p.39)
Dans ce passage sont abordées des questions qu’il convient d’examiner en connexion avec le problème des rapports entre la politique et l’économie lors de l’extinction de l’Etat (ce thème sera traité dans le chapitre suivant). Telle la question de la transformation des fonctions publiques, de politiques qu’elles étaient, en simples fonctions administratives ; telle la question de "l’Etat politique". Cette dernière expression, particulièrement susceptible de soulever des malentendus, est une allusion au processus d’extinction de l’Etat : il arrive un moment où l’Etat en voie d’extinction peut être appelé un Etat non politique.
Ce qu’il y a de plus remarquable dans ce passage d’Engels, c’est encore la façon dont il pose la question contre les anarchistes. Les social-démocrates qui veulent être les disciples d’Engels ont polémiqué des millions de fois avec les anarchistes depuis 1873, mais le fait est qu’ils n’ont pas discuté comme les marxistes peuvent et doivent le faire. L’idée de l’abolition de l’Etat est, chez les anarchistes, confuse et non révolutionnaire : voilà comment Engels posait la question. C’est précisément la révolution que les anarchistes se refusent à voir, sa naissance et son développement, ses tâches spécifiques en ce qui concerne la violence, l’autorité, le pouvoir et l’Etat.
La critique de l’anarchisme se réduit habituellement, pour les social-démocrates actuels, à cette pure banalité petite-bourgeoise : "Nous admettons l’Etat, les anarchistes non !" Naturellement, une telle banalité ne peut manquer de répugner à des ouvriers tant soit peu réfléchis et révolutionnaires. Engels dit autre chose : il souligne que tous les socialistes reconnaissent la disparition de l’Etat comme une conséquence de la révolution socialiste. Il pose ensuite la question concrète de la révolution, question que les social-démocrates laissent habituellement de côté par opportunisme, abandonnant pour ainsi dire aux seuls anarchistes le soin de "l’étudier". Et, en posant cette question, Engels prend le taureau par les cornes : la Commune n’aurait-elle pas dû se servir davantage du pouvoir révolutionnaire de l’Etat, c’est-à-dire du prolétariat armé, organisé en classe dominante ?
La social-démocratie officielle, qui donnait le ton, éludait généralement la question des tâches concrètes du prolétariat dans la révolution, soit tout simplement par un sarcasme de philistin, soit, dans le meilleur des cas, par ce sophisme évasif : "On verra plus tard". Et les anarchistes étaient en droit de dire de cette social-démocratie qu’elle manquait à son devoir, qui est de faire l’éducation révolutionnaire des ouvriers. Engels met à profit l’expérience de la dernière révolution prolétarienne justement pour étudier de la façon la plus concrète ce que le prolétariat doit faire en ce qui concerne à la fois les banques et l’Etat, et comment il doit s’y prendre.
3. LETTRE A BEBEL
Une des réflexions les plus remarquables, sinon la plus remarquable, que nous trouvons dans les oeuvres de Marx et d’Engels relatives à l’Etat, est le passage suivant de la lettre d’Engels à Bebel, datée du 18-28 mars 1875. Cette lettre, notons-le entre parenthèses, a été reproduite pour la première fois, à notre connaissance, dans le tome II des Mémoires de Bebel (Souvenirs de ma Vie), paru en 1911 ; c’est-à-dire qu’elle fut publiée trente-six ans après sa rédaction et son envoi.
Engels écrivait à Bebel pour critiquer le projet de programme de Gotha (que Marx a également critiqué dans sa fameuse lettre à Bracke). Parlant spécialement de la question de l’Etat, Engels disait ceci :
"L’Etat populaire libre est devenu un Etat libre. D’après le sens grammatical de ces termes, un Etat libre est un Etat qui est libre à l’égard de ses citoyens, c’est-à-dire un Etat à gouvernement despotique. Il conviendrait d’abandonner tout ce bavardage sur l’Etat, surtout après la Commune, qui n’était plus un Etat, au sens propre. Les anarchistes nous ont assez jeté à la tête l’Etat populaire, bien que déjà le livre de Marx contre Proudhon, et puis le Manifeste Communiste, disent explicitement qu’avec l’instauration du régime social socialiste l’Etat se dissout de lui-même (sich auflöst) et disparaît. L’Etat n’étant qu’une institution temporaire dont on est obligé de se servir dans la lutte, dans la révolution, pour réprimer par la force ses adversaires, il est parfaitement absurde de parler d’un Etat populaire libre : tant que le prolétariat a encore besoin de l’Etat, ce n’est point pour la liberté, mais pour réprimer ses adversaires. Et le jour où il devient possible de parler de liberté, l’Etat cesse d’exister comme tel. Aussi proposerions-nous de mettre partout à la place du mot Etat le mot "communauté" (Gemeinwesen), excellent vieux mot allemand, répondant au mot français "commune"" (pp. 321-322 de l’original allemand)[17].
Il ne faut pas perdre de vue que cette lettre a trait au programme du parti, critiqué par Marx dans une lettre écrite quelques semaines seulement après celle-ci (la lettre de Marx est du 5 mai 1875), et qu’à l’époque Engels vivait à Londres avec Marx. Aussi, en disant "nous" dans la dernière phrase, c’est sans aucun doute en son nom propre et au nom de Marx qu’Engels propose au chef du parti ouvrier allemand de supprimer dans le programme le mot "Etat" et de le remplacer par le mot "communauté".
Comme on les entendrait hurler à "l’anarchisme", les chefs du "marxisme" moderne accommodé au goût des opportunistes, si on leur proposait un semblable amendement au programme !
Qu’ils hurlent. La bourgeoisie les en louera.
Quant à nous, nous poursuivrons notre oeuvre. En révisant le programme de notre Parti, nous devrons absolument tenir compte du conseil d’Engels et de Marx, pour être plus près de la vérité, pour rétablir le marxisme en l’expurgeant de toute déformation, pour mieux orienter la classe ouvrière dans sa lutte libératrice. Il est certain que le conseil d’Engels et de Marx ne trouvera pas d’adversaires parmi les bolchéviks. Il n’y aura de difficulté, croyons-nous, que pour le terme à employer. En allemand, il existe deux mots signifiant "communauté", et Engels a choisi celui qui désigne non pas une communauté à part, mais un ensemble, un système de communautés. Ce mot n’existe pas en russe, et il faudra peut-être choisir le mot français "commune" bien que cela présente aussi des inconvénients.
"La Commune n’était plus un Etat, au sens propre", telle est l’affirmation d’Engels, capitale au point de vue théorique. Après l’exposé qui précède, cette affirmation est parfaitement compréhensible. La Commune cessait d’être un Etat dans la mesure où il lui fallait opprimer non plus la majorité de la population, mais une minorité (les exploiteurs) ; elle avait brisé la machine d’Etat bourgeoise ; au lieu d’un pouvoir spécial d’oppression, c’est la population elle-même qui entrait en scène. Autant de dérogations à ce qu’est l’Etat au sens propre du mot. Et si la Commune s’était affermie, les vestiges de l’Etat qui subsistaient en elle se seraient "éteints" d’eux-mêmes ; elle n’aurait pas eu besoin "d’abolir" ses institutions : celles-ci auraient cessé de fonctionner au fur et à mesure qu’elles n’auraient plus rien eu à faire.
"Les anarchistes nous jettent à la tête "l’Etat populaire"". Ce disant, Engels songe surtout à Bakounine et à ses attaques contre les social-démocrates allemands. Engels admet que ces attaques sont justes pour autant que "l’Etat populaire" est un non-sens, une dérogation au socialisme, au même titre que "l’Etat populaire libre". Il s’efforce de corriger la lutte des social-démocrates allemands contre les anarchistes, d’en faire une lutte juste dans ses principes, de la débarrasser des préjugés opportunistes sur "l’Etat". Hélas ! la lettre d’Engels est restée pendant trente-six ans enfouie dans un tiroir. Nous verrons plus loin que, même après la publication de cette lettre, Kautsky s’obstine à répéter, au fond, les erreurs qui avaient déjà motivé la mise en garde d’Engels.
Bebel répond à Engels, le 21 septembre 1875, par une lettre dans laquelle il déclare, entre autre, qu’il "partage entièrement" son point de vue sur le projet de programme, et qu’il a reproché à Liebknecht de se montrer trop conciliant (Mémoires de Bebel, édit. allemande, tome II, p. 334). Mais si nous prenons la brochure de Bebel intitulée Nos buts, nous y trouverons, sur l’Etat, des réflexions absolument fausses :
"L’Etat fondé sur la domination d’une classe doit être transformé en Etat populaire" (Unsere Ziele, édit. allemande, 1886, p.14)
Voilà ce qui est imprimé dans la neuvième (la neuvième !) édition de la brochure de Bebel ! Rien d’étonnant si la social-démocratie allemande s’est pénétrée de ces conceptions opportunistes sur l’Etat si obstinément répétées, d’autant plus que les éclaircissements révolutionnaires d’Engels étaient enfouis dans un tiroir et que la vie elle-même "déshabituait" pour longtemps de la révolution.
4. CRITIQUE DU PROJET DE PROGRAMME D’ERFURT
Lorsqu’on analyse la doctrine marxiste de l’Etat, on ne peut passer sous silence la critique du projet de programme d’Erfurt[18] adressée par Engels à Kautsky le 29 juin 1891, - et qui ne fut publiée que dix ans plus tard dans la Neue Zeit, - car elle est consacrée surtout à la critique des conceptions opportunistes de la social-démocratie dans les problèmes relatifs à l’organisation de l’Etat.
Remarquons en passant que, sur les questions économiques, Engels fournit également une indication des plus précieuses, qui montre avec quelle attention et quelle profondeur de pensée il a suivi les transformations du capitalisme moderne, et comment il a su pressentir ainsi, dans une certaine mesure, les problèmes de notre époque impérialiste. Voici cette indication : au sujet des mots "absence de plan" (Planlosigkeit), employés dans le projet de programme pour caractériser le capitalisme, Engels écrit :
"... si nous passons des sociétés par actions aux trusts qui se soumettent et monopolisent des branches entières de l’industrie, alors ce n’est pas seulement la fin de la production privée, mais encore la cessation de l’absence de plan" (Neue Zeit, 20e année, 1901-1902, tome I, p. 8).
Nous avons là ce qu’il y a de plus essentiel dans l’appréciation théorique du capitalisme moderne, c’est-à-dire de l’impérialisme, à savoir que le capitalisme se transforme en capitalisme monopoliste. Ceci est à souligner, car l’erreur la plus répandue est l’affirmation réformiste bourgeoise prétendant que le capitalisme monopoliste ou le capitalisme monopoliste d’Etat n’est déjà plus du capitalisme, qu’il peut dès lors être qualifié de "socialisme d’Etat", etc. Naturellement, les trusts n’ont jamais donné, ne donnent pas jusqu’à présent, ni ne peuvent donner une planification intégrale. Ils introduisent pourtant une planification ; les magnats du Capital escomptent par avance le volume de la production à l’échelle nationale ou même internationale et règlent cette production d’après un plan, mais nous restons cependant en régime capitaliste, dans une nouvelle phase, certes, mais indéniablement en régime capitaliste. Le fait que ce capitalisme est "proche" du socialisme doit constituer, pour des représentants véritables du prolétariat, un argument en faveur de la proximité, de la facilité, de la possibilité, de l’urgence de la révolution socialiste, et non point un argument pour tolérer la négation de cette révolution et les tentatives de farder le capitalisme, à quoi s’emploient tous les réformistes.
Mais revenons à la question de l’Etat. Engels donne ici trois indications particulièrement précieuses : 1. sur la question de la république ; 2. sur le lien qui existe entre la question nationale et l’organisation de l’Etat ; 3. sur l’autonomie administrative locale.
Pour ce qui est de la république, Engels a fait de cette question le pivot de sa critique du projet du programme d’Erfurt. Et si nous nous rappelons l’importance acquise par le programme d’Erfurt dans toute la social-démocratie internationale, et qu’il a servi de modèle à l’ensemble de la IIe Internationale, on pourra dire, sans exagération, qu’Engels critique ici l’opportunisme de la IIe Internationale tout entière.
"Les revendications politiques du projet, écrit Engels, ont un grand défaut. Ce que justement il eût fallu dire ne s’y trouve pas."
Il montre ensuite que la Constitution allemande est, à proprement parler, une réplique de la Constitution ultra-réactionnaire de 1850 ; que le Reichstag n’est, suivant l’expression de Wilhelm Liebknecht, que la "feuille de vigne de l’absolutisme", et que vouloir réaliser, - sur la base d’une Constitution consacrant l’existence de petits Etats et d’une confédération de petits Etats allemands, - la "transformation des moyens de travail en propriété commune" est "manifestement absurde".
"Y toucher [à ce sujet] serait dangereux", ajoute Engels, sachant parfaitement qu’en Allemagne on ne peut légalement inscrire au programme la revendication de la République. Toutefois, Engels ne s’accommode pas purement et simplement de cette considération évidente, dont "tous" se contentent. Il poursuit : "Mais, de toute façon, les choses doivent être poussées en avant. Combien cela est nécessaire, c’est ce que prouve précisément aujourd’hui l’opportunisme qui commence à se propager [einreissende] dans une grande partie de la presse social-démocrate. Dans la crainte d’un renouvellement de la loi contre les socialistes ou se souvenant de certaines opinions émises prématurément du temps où cette loi était en vigueur, on veut maintenant que le Parti reconnaisse l’ordre légal actuel en Allemagne comme pouvant suffire à faire réaliser toutes ses revendications par la voie pacifique."
Que les social-démocrates allemands aient agi par crainte d’un renouvellement de la loi d’exception, c’est là un fait essentiel qu’Engels met au premier plan et qu’il taxe, sans hésiter, d’opportunisme. Il déclare que, précisément parce qu’il n’y a ni république ni liberté en Allemagne, il est absolument insensé de rêver d’une voie "pacifique". Engels est assez prudent pour ne pas se lier les mains. Il reconnaît que, dans les pays de république ou de très grande liberté, "on peut concevoir" (seulement "concevoir" !) une évolution pacifique vers le socialisme. Mais en Allemagne, répète-t-il,
"... en Allemagne, où le gouvernement est presque tout-puissant, où le Reichstag et les autres corps représentatifs sont sans pouvoir effectif, proclamer de telles choses en Allemagne, et encore sans nécessité, c’est enlever sa feuille de vigne à l’absolutisme et en couvrir la nudité par son propre corps."
Ceux qui couvrirent l’absolutisme, ce sont en effet, dans leur immense majorité, les chefs officiels du Parti social-démocrate allemand, lequel avait mis ces indications "sous le boisseau".
"Une pareille politique ne peut, à la longue, qu’entraîner le Parti dans une voie fausse. On met au premier plan des questions politiques générales, abstraites, et l’on cache par là les questions concrètes pressantes, qui, aux premiers événements importants, à la première crise politique, viennent d’elles-mêmes s’inscrire à l’ordre du jour. Que peut-il en résulter, sinon ceci que, tout à coup, au moment décisif, le Parti sera pris au dépourvu et que sur les points décisifs, il régnera la confusion et l’absence d’unité, parce que ces questions n’auront jamais été discutées ?...
Cet oubli des grandes considérations essentielles devant les intérêts passagers du jour, cette course aux succès éphémères et la lutte qui se livre tout autour, sans se préoccuper des conséquences ultérieures, cet abandon de l’avenir du mouvement que l’on sacrifie au présent, tout cela a peut-être des mobiles honnêtes. Mais cela est et reste de l’opportunisme. Or, l’opportunisme "honnête" est peut-être le plus dangereux de tous...
Une chose absolument certaine, c’est que notre Parti et la classe ouvrière ne peuvent arriver à la domination que sous la forme de la République démocratique. Cette dernière est même la forme spécifique de la dictature du prolétariat, comme l’a déjà montré la grande Révolution française."
Engels reprend ici, en la mettant particulièrement en relief, cette idée fondamentale qui marque comme d’un trait rouge toutes les oeuvres de Marx, à savoir que la république démocratique est le chemin le plus court conduisant à la dictature du prolétariat. Car une telle république, bien qu’elle ne supprime nullement la domination du Capital, ni par conséquent l’oppression des masses et la lutte des classes conduit inévitablement à une extension, à un développement, à un rebondissement, à une aggravation de la lutte tels qu’une fois apparue la possibilité de satisfaire les intérêts vitaux des masses opprimées, cette possibilité se réalise inéluctablement et uniquement dans la dictature du prolétariat, dans la direction de ces masses par le prolétariat. Pour la IIe Internationale tout entière, ce sont là encore des "paroles oubliées" du marxisme, et cet oubli est apparu avec beaucoup de relief dans l’histoire du parti menchévik durant les six premiers mois de la révolution russe de 1917.
Traitant de la république fédérative en rapport avec la composition nationale de la population, Engels écrit :
"Que faut-il mettre à la place de l’Allemagne actuelle ? [avec sa Constitution monarchique réactionnaire, et subdivision, non moins réactionnaire, en petits Etats, subdivision qui perpétue les particularités de "prussianisme" au lieu de les dissoudre dans une Allemagne formant un tout]. A mon avis, le prolétariat ne peut utiliser que la forme de la République une et indivisible. En somme, sur le territoire immense des Etats-Unis, la République fédérative est aujourd’hui encore une nécessité, bien qu’elle commence d’ores et déjà à être un obstacle dans l’Est. Elle constituerait un progrès en Angleterre, où dans deux îles habitent quatre nations et où, malgré un parlement unique, existent côte à côte, encore aujourd’hui, trois législations différentes. Dans la petite Suisse, il y a longtemps qu’elle constitue un obstacle tolérable seulement parce que la Suisse se contente d’être un membre purement passif dans le système d’Etats européen. Pour l’Allemagne, une organisation fédéraliste à la manière suisse serait un recul considérable. Deux points distinguent un Etat fédéral d’un Etat unitaire ; c’est d’abord que chaque Etat fédéré, chaque canton possède sa propre législation civile et pénale, sa propre organisation judiciaire ; c’est ensuite qu’à côté de la Chambre du peuple, il y a une Chambre des représentants des Etats, où chaque canton, petit ou grand, vote comme tel." En Allemagne, l’Etat fédéral forme la transition vers un Etat pleinement unitaire, et il ne faut pas faire rétrograder "la révolution d’en haut", accomplie en 1866 et 1870, mais au contraire la compléter par un "mouvement d’en bas".
Loin de se désintéresser des formes de l’Etat, Engels s’attache au contraire à analyser avec le plus grand soin précisément les formes transitoires, afin de déterminer dans chaque cas donné, selon ses particularités historiques concrètes, le point de départ et le point d’aboutissement de la forme transitoire considérée.
Engels, de même que Marx, défend, du point de vue du prolétariat et de la révolution prolétarienne, le centralisme démocratique, la république une et indivisible. Il considère la république fédérative soit comme une exception et un obstacle au développement, soit comme une transition de la monarchie à la république centralisée, comme un "progrès" dans certaines conditions particulières. Et, parmi ces conditions particulières, il met au premier plan la question nationale.
Chez Engels comme chez Marx, bien qu’ils aient impitoyablement critiqué l’essence réactionnaire des petits Etats et l’utilisation, dans certains cas concrets, de la question nationale pour dissimuler cette essence réactionnaire, on ne trouve nulle part, fût-ce l’ombre du désir d’éluder la question nationale, ce par quoi pèchent souvent les marxistes hollandais et polonais, en partant de la lutte absolument légitime contre le nationalisme étroitement philistin de "leurs" petits Etats.
Même en Angleterre, où les conditions géographiques, la communauté de langue et une histoire plusieurs fois séculaire auraient dû, semble-t-il, "avoir mis fin" à la question nationale en ce qui concerne les petites subdivisions du pays, même ici Engels tient compte du fait évident que la question nationale n’est pas encore réglée, et c’est pourquoi il considère la république fédérative comme un "progrès". Bien entendu, il n’y a pas là l’ombre d’une renonciation à la critique des défauts de la république fédérative, ni à la propagande et à la lutte les plus décidées en faveur de la république unitaire, démocratique et centralisée.
Mais ce centralisme démocratique, Engels ne l’entend nullement au sens bureaucratique que lui donnent les idéologues bourgeois et petits-bourgeois, dont, parmi ces derniers, les anarchistes. Le centralisme, pour Engels, n’exclut pas du tout une large autonomie administrative locale qui, à condition que les "communes" et les régions défendent de leur plein gré l’unité de l’Etat, supprime incontestablement tout bureaucratisme et tout "commandement" par en haut.
"Ainsi donc, République unitaire", écrit Engels en développant les vues sur l’Etat qui doivent être à la base d’un programme marxiste. "Mais pas dans le sens de la République française d’aujourd’hui, qui n’est pas autre chose que l’Empire sans empereur fondé en 1798. De 1792 à 1798, chaque département français, chaque commune (Gemeinde) eut sa complète autonomie administrative, sur le modèle américain, et c’est ce qu’il nous faut avoir de même. Comment organiser cette autonomie et comment on peut se passer de la bureaucratie, c’est ce que nous ont montré l’Amérique et la première République française ; et c’est ce que nous montrent encore aujourd’hui l’Australie, le Canada et les autres colonies anglaises. Une semblable autonomie provinciale et communale est beaucoup plus libre que le fédéralisme suisse, par exemple, où le canton est, il est vrai, très indépendant à l’égard du Bund" (c’est-à-dire de l’Etat confédéral dans son ensemble), "mais où il l’est également à l’égard du district (Bezirk) et de la commune. Les gouvernements cantonaux nomment des gouverneurs de district (Bezirksstatthalter) et des préfets, dont on ne sait rien dans les pays de langue anglaise et dont, à l’avenir, nous devons nous débarrasser aussi résolument que des Landrat et Regierungsrat prussiens" (commissaires, chefs de police de district, gouverneurs et, en général, fonctionnaires nommés d’en haut). Aussi Engels propose-t-il de formuler comme suit l’article du programme relatif à l’autonomie : "Administration autonome complète dans la province, le district et la commune par des fonctionnaires élus au suffrage universel. Suppression de toutes les autorités locales et provinciales nommées par l’Etat."
Dans la Pravda (n° 68 du 28 mai 1917) [Voir V. Lénine : "Une Question de principe", Oeuvres, tome 24 - Note du traducteur.] interdite par le gouvernement de Kérenski et des autres ministres "socialistes", j’ai déjà eu l’occasion de faire remarquer que sur ce point, - qui n’est évidemment pas le seul, tant s’en faut, - nos représentants pseudo-socialistes d’une pseudo-démocratie pseudo-révolutionnaire s’écartent de façon criante du démocratisme. On conçoit que des hommes, liés par leur "coalition" avec la bourgeoisie impérialiste, soient restés sourds à ces remarques.
Il importe éminemment de noter qu’Engels, faits en main, réfute, par un exemple d’une parfaite précision, le préjugé fort répandu, surtout parmi la démocratie petite-bourgeoise, selon lequel une république fédérative implique forcément plus de liberté qu’une république centralisée. Cela est faux. Les faits cités par Engels, relatifs à la république française centralisée de 1792-1798 et à la république fédérative suisse, réfutent cette assertion. La république centralisée vraiment démocratique offrait plus de liberté que la république fédérative. Autrement dit : le maximum de liberté locale, régionale et autre qu’ait connue l’histoire a été assuré par la république centralisée et non par la république fédérative.
A ce fait, comme à tout le problème de la république fédérative et centralisée, ainsi que de l’autonomie administrative locale, notre Parti n’a consacré et ne consacre qu’une attention insuffisante dans sa propagande et son agitation.
5. L’INTRODUCTION DE 1891 A LA GUERRE CIVILE EN FRANCE DE MARX
Dans son introduction à la troisième édition de La Guerre Civile en France, - introduction datée du 18 mars 1891 et imprimée pour la première fois dans la Neue Zeit, - Engels, à côté de réflexions incidentes du plus haut intérêt sur l’attitude à l’égard de l’Etat, résume avec un relief remarquable les enseignements de la Commune[19]. Ce résumé, enrichi de toute l’expérience de la période de vingt années qui sépare son auteur de la Commune, est spécialement dirigé contre la "foi superstitieuse en l’Etat", fort répandue en Allemagne, et peut à juste titre être considéré comme le dernier mot du marxisme sur la question.
En France, après chaque révolution, remarque Engels, les ouvriers étaient armés ; "pour les bourgeois qui se trouvaient au pouvoir, le désarmement des ouvriers était donc le premier devoir... Aussi après chaque révolution, acquise au prix du sang des ouvriers, éclate une nouvelle lutte, qui se termine par la défaite de ceux-ci".
Le bilan de l’expérience des révolutions bourgeoises est aussi succinct qu’expressif. Le fond du problème-comme d’ailleurs dans la question de l’Etat (La classe opprimée possède-t-elle des armes ?) - est admirablement saisi. C’est ce fond que passent le plus souvent sous silence les professeurs influencés par l’idéologie bourgeoise, ainsi que les démocrates petits-bourgeois. Dans la révolution russe de 1917, c’est au "menchévik" Tsérétéli, "marxiste-lui-aussi", qu’est échu l’honneur (l’honneur d’un Cavaignac) de livrer incidemment ce secret des révolutions bourgeoises. Dans son discours "historique" du 11 juin, Tsérétéli a eu l’imprudence d’annoncer que la bourgeoisie était décidée à désarmer les ouvriers de Petrograd, décision qu’il présentait évidemment comme étant aussi la sienne et, plus généralement, comme une nécessité "d’Etat" !
Le discours historique prononcé le 1l juin par Tsérétéli sera certainement, pour tout historien de la révolution de 1917, une des meilleures illustrations de la façon dont le bloc des socialistes-révolutionnaires et des menchéviks, dirigé par le sieur Tsérétéli, a embrassé la cause de la bourgeoisie contre le prolétariat révolutionnaire.
Une autre réflexion incidente d’Engels, liée elle aussi à la question de l’Etat, concerne la religion. On sait que la social-démocratie allemande, au fur et à mesure que la gangrène la gagnait et qu’elle devenait de plus en plus opportuniste, se laissait aller de plus en plus souvent à une interprétation erronée et philistine de la célèbre formule : "La religion est une affaire privée." Savoir : cette formule était interprétée comme si, pour le parti du prolétariat révolutionnaire également, la religion était une affaire privée !! C’est contre cette trahison absolue du programme révolutionnaire du prolétariat que s’éleva Engels qui, en 1891, ne pouvant encore observer que de très faibles germes d’opportunisme dans son parti, s’exprimait avec une extrême prudence :
"Dans la Commune ne siégeaient presque que des ouvriers ou des représentants reconnus des ouvriers ; ses décisions portaient de même un caractère nettement prolétarien. Ou bien elle décrétait des réformes que la bourgeoisie républicaine avait négligée par pure lâcheté, mais qui constituaient pour la libre action de la classe ouvrière une base indispensable, comme la réalisation de ce principe que, par rapport à l’Etat, la religion n’est qu’une affaire privée ; ou bien elle promulguait des décisions prises directement dans l’intérêt de la classe ouvrière, et qui, pour une part, faisaient de profondes entailles dans le vieil ordre social."
C’est à dessein qu’Engels a souligné les mots "par rapport à l’Etat" ; ce faisant, il portait un coup direct à l’opportunisme allemand, qui déclarait la religion affaire privée par rapport au parti et ravalait ainsi le parti du prolétariat révolutionnaire au niveau du plus vulgaire petit bourgeois "libre penseur", qui veut bien admettre qu’on ne soit d’aucune religion, mais abdique la tâche du parti : combattre l’opium religieux qui abêtit le peuple.
Le futur historien de la social-démocratie allemande, approfondissant les causes de la honteuse banqueroute de ce parti en 1914, trouvera sur cette question une nombreuse et intéressante documentation, depuis les déclarations évasives contenues dans les articles du chef idéologique de ce parti, Kautsky, déclarations qui ouvrent toute grande la porte à l’opportunisme, jusqu’à l’attitude du parti à l’égard du Losvon-Kirche-Bewegung (mouvement pour la séparation d’avec l’Eglise) en 1913.
Mais voyons comment, vingt ans après la Commune, Engels résumait les enseignements qu’elle fournit au prolétariat en lutte.
Voici ceux qu’il mettait au premier plan :
"Quant à la force répressive du gouvernement naguère centralisé : l’armée, la police politique, la bureaucratie, créées par Napoléon en 1798, reprises, depuis, avec reconnaissance, par chaque nouveau gouvernement et utilisées par lui contre ses adversaires, c’est justement cette force qui devait partout être renversée, comme elle l’avait été déjà à Paris. La Commune dut reconnaître d’emblée que la classe ouvrière, une fois au pouvoir, ne pouvait continuer à administrer avec la vieille machine d’Etat ; pour ne pas perdre à nouveau sa propre domination qu’elle venait à peine de conquérir, cette classe ouvrière devait, d’une part, éliminer la vieille machine d’oppression jusqu’alors employée contre elle-même, mais, d’autre part, prendre des assurances contre ses propres mandataires et fonctionnaires en les proclamant, en tout temps et sans exception, révocables."
Engels souligne encore et toujours que non seulement sous le régime de la monarchie, mais aussi en république démocratique, l’Etat reste l’Etat, c’est-à-dire qu’il garde son principal caractère distinctif, qui est de transformer les fonctionnaires, "serviteurs de la société" et ses organes, en maîtres de celle-ci.
"Pour éviter cette transformation, inévitable dans tous les régimes antérieurs, de l’Etat et des organes de l’Etat, à l’origine serviteurs de la société, en maîtres de celle-ci, la Commune employa deux moyens infaillibles. Premièrement, elle soumit toutes les places, de l’administration, de la justice et de l’enseignement, au choix des intéressés par élection au suffrage universel, et, bien entendu, à la révocation à tout moment par ces mêmes intéressés. Et, deuxièmement, elle ne rétribua tous les services, des plus bas aux plus élevés, que par le salaire que recevaient les autres ouvriers. Le plus haut traitement qu’elle payât dans l’ensemble était de 6000 francs [Ce qui fait environ 2400 roubles au cours nominal et près de 6000 roubles au cours actuel. Les bolchéviks qui proposent, par exemple, dans les municipalités, des traitements de 9000 roubles, au lieu de proposer pour l’ensemble de l’Etat un maximum de 6000 roubles - somme suffisante - commettent une erreur impardonnable.]. Ainsi, on mettait le holà à la chasse aux places et à l’arrivisme, sans en appeler aux mandats impératifs des délégués aux corps représentatifs qui leur étaient encore adjoints par surcroît."
Engels en arrive ici à cette intéressante limite où la démocratie conséquente, d’une part, se transforme en socialisme et, d’autre part, réclame le socialisme. En effet, pour supprimer l’Etat, il est nécessaire que les fonctions des services d’Etat se transforment en opérations de contrôle et d’enregistrement si simples qu’elles soient à la portée de l’immense majorité, puis de la totalité, de la population. Et, pour supprimer complètement l’arrivisme, il faut que les fonctions "honorifiques", bien que non lucratives, au service de l’Etat, ne puissent pas servir de tremplin pour atteindre des postes hautement lucratifs dans les banques et les sociétés anonymes, comme il advient constamment dans tous les pays capitalistes même les plus libres.
Mais Engels ne verse pas dans l’erreur que commettent, par exemple, certains marxistes à propos du droit des nations à disposer d’elles-mêmes : en régime capitaliste, disent-ils, ce droit est irréalisable ; en régime socialiste, il devient superflu. Ce raisonnement, soi-disant spirituel, mais en fait erroné, pourrait s’appliquer à toute institution démocratique, et aussi au modeste traitement des fonctionnaires, car un démocratisme rigoureusement conséquent est irréalisable en régime capitaliste, et en régime socialiste toute démocratie finira par s’éteindre.
Sophisme qui ressemble à cette vieille plaisanterie : l’homme devient-il chauve s’il perd un de ses cheveux ?
Développer la démocratie jusqu’au bout, rechercher les formes de ce développement, les mettre à l’épreuve de la pratique etc., telle est une des tâches essentielles de la lutte pour la révolution sociale. Pris à part, aucun démocratisme, quel qu’il soit, ne donnera le socialisme ; mais, dans la vie, le démocratisme ne sera jamais "pris à part", il sera "pris dans l’ensemble" ; il exercera aussi une influence sur l’économie dont il stimulera la transformation ; il subira l’influence du développement économique, etc. Telle est la dialectique de l’histoire vivante.
Engels poursuit :
"Cette destruction [Sprengung] de la puissance de l’Etat tel qu’il était jusqu’ici et son remplacement par un pouvoir nouveau, vraiment démocratique, sont dépeints en détail dans la troisième partie de La Guerre civile. Mais il était nécessaire de revenir ici brièvement sur quelques-uns de ses traits, parce que, en Allemagne précisément, la superstition de l’Etat a passé de la philosophie dans la conscience commune de la bourgeoisie et même dans celle de beaucoup d’ouvriers. Dans la conception des philosophes, l’Etat est "la réalisation de l’Idée" ou le règne de Dieu sur terre traduit en langage philosophique, le domaine où la vérité et la justice éternelles se réalisent ou doivent se réaliser. De là cette vénération superstitieuse de l’Etat et de tout ce qui y touche, vénération qui s’installe d’autant plus facilement qu’on est, depuis le berceau, habitué à s’imaginer que toutes les affaires et tous les intérêts communs de la société entière ne sauraient être réglés que comme ils ont été réglés jusqu’ici, c’est-à-dire par l’Etat et ses autorités dûment établies. Et l’on croit déjà avoir fait un pas prodigieusement hardi quand on s’est affranchi de la foi en la monarchie héréditaire et qu’on jure par la République démocratique. Mais, en réalité, l’Etat n’est rien d’autre qu’une machine pour l’oppression d’une classe par une autre, et cela, tout autant dans la République démocratique que dans la monarchie ; le moins qu’on puisse en dire, c’est qu’il est un mal dont hérite le prolétariat vainqueur dans la lutte pour la domination de classe et dont, tout comme la Commune, il ne pourra s’empêcher de rogner aussitôt au maximum les côtés les plus nuisibles, jusqu’à ce qu’une génération grandie dans des conditions sociales nouvelles et libres soit en état de se défaire de tout ce bric-à-brac de l’Etat."
Engels met en garde les Allemands pour qu’ils n’oublient pas, lors du remplacement de la monarchie par la république, les principes du socialisme dans la question de l’Etat en général. Ses avertissements apparaissent aujourd’hui comme une leçon adressée directement aux sieurs Tsérétéli et Tchernov qui ont révélé, dans leur pratique de la "coalition", leur foi superstitieuse en l’Etat, leur vénération superstitieuse à son égard.
Deux remarques encore : 1. Lorsque Engels dit que, dans une république démocratique "tout autant" que dans une monarchie, l’Etat n’est pas autre chose qu’une "machine pour l’oppression d’une classe par une autre", il n’entend pas du tout par là que la forme d’oppression doive être indifférente au prolétariat, comme "l’enseignent" certains anarchistes. Une forme plus large, plus libre, plus franche de lutte des classes et d’oppression de classes facilite considérablement la lutte du prolétariat pour la suppression des classes en général.
2. Pourquoi seule une nouvelle génération pourra-t-elle se défaire complètement de tout ce bric-à-brac de l’Etat ? Cette question se rattache à celle du dépassement de la démocratie, dont nous allons parler.
6. ENGELS ET LE DEPASSEMENT DE LA DEMOCRATIE
Engels eut à se prononcer sur ce point en traitant de l’inexactitude scientifique de la dénomination "social-démocrate".
Dans la préface au recueil de ses articles des années 1870-1880, consacrés à divers thèmes, principalement "internationaux" (Internationales aus dem Volkstaat)["Sujets d’ordre international traités dans L’Etat populaire"-Note du traducteur], préface datée du 3 janvier 1894, c’est-à-dire rédigée un an et demi avant sa mort, il écrit que dans tous ses articles il emploie le mot "communiste", parce qu’à cette époque les proudhonniens en France et les lassaliens en Allemagne s’intitulaient social-démocrates.
"Pour Marx comme pour moi, poursuit Engels, il y avait donc impossibilité absolue d’employer, pour exprimer notre point de vue propre, une expression aussi élastique. Aujourd’hui, il en va autrement, et ce mot ("social-démocrate") peut à la rigueur passer [mag passieren] bien qu’il reste impropre [unpassend] pour un parti dont le programme économique n’est pas simplement socialiste en général, mais expressément communiste, pour un parti dont le but politique final est la suppression de tout l’Etat et, par conséquent, de la démocratie. Au reste, les partis politiques véritables (souligné par Engels) n’ont jamais une dénomination qui leur convienne parfaitement, le parti se développe, la dénomination reste"[20].
Le dialecticien Engels, au déclin de ses jours, demeure fidèle à la dialectique. Marx et moi, dit-il, nous avions pour le parti un nom excellent, scientifiquement exact, mais il n’existait pas alors de parti prolétarien véritable, c’est-à-dire de parti prolétarien de masse. Maintenant (fin du XIXe siècle), il existe un véritable parti, mais sa dénomination est scientifiquement inexacte. N’importe, elle peut "passer" pourvu que le parti se développe, pourvu que l’inexactitude scientifique de sa dénomination ne lui échappe pas et ne l’empêche pas de se développer dans la bonne direction !
Quelque plaisantin pourrait peut-être venir nous consoler à notre tour, nous autres bolchéviks, à la façon d’Engels : nous avons un parti véritable ; il se développe admirablement ; donc, ce nom absurde et barbare de "bolchévik" peut "passer", bien qu’il n’exprime absolument rien, sinon ce fait purement accidentel qu’au congrès de Bruxelles-Londres, en 1903, nous eûmes la majorité... Peut-être maintenant que les persécutions dont notre Parti a été l’objet en juillet-août 1917, de la part des républicains et de la démocratie petite-bourgeoise "révolutionnaire", ont rendu le mot "bolchévik" si honorable aux yeux du peuple : maintenant qu’elles ont en outre marqué l’immense progrès historique accompli par notre Parti dans son développement réel, peut-être hésiterais-je moi-même à proposer, comme je l’ai fait en avril, de changer la dénomination de notre Parti. Peut-être proposerais-je aux camarades un "compromis" : celui de nous appeler Parti communiste, tout en gardant, entre parenthèses, le mot "bolchéviks".
Mais la question de la dénomination du parti est infiniment moins importante que celle de l’attitude du prolétariat révolutionnaire envers l’Etat.
Dans les considérations habituelles sur l’Etat, on commet constamment l’erreur contre laquelle Engels met ici en garde et que nous avons signalée plus haut en passant ; on oublie constamment que la suppression de l’Etat est aussi la suppression de la démocratie, que l’extinction de l’Etat est l’extinction de la démocratie.
Une telle assertion paraît, à première vue, des plus étranges et inintelligibles ; peut-être même certains craindront-ils que nous souhaitions l’avènement d’un ordre social où ne serait pas observé le principe de la soumission de la minorité à la majorité ; car, enfin, la démocratie n’est-elle pas la reconnaissance de ce principe ?
Non. La démocratie et la soumission de la minorité à la majorité ne sont pas des choses identiques. La démocratie, c’est un Etat reconnaissant la soumission de la minorité à la majorité ; autrement dit, c’est une organisation destinée à assurer l’exercice systématique de la violence par une classe contre une autre, par une partie de la population contre l’autre partie.
Nous nous assignons comme but final la suppression de l’Etat, c’est-à-dire de toute violence organisée et systématique, de toute violence exercée sur les hommes, en général. Nous n’attendons pas l’avènement d’un ordre social où le principe de la soumission de la minorité à la majorité ne serait pas observé. Mais, aspirant au socialisme, nous sommes convaincus que dans son évolution il aboutira au communisme et que, par suite, disparaîtra toute nécessité de recourir en général à la violence contre les hommes, toute nécessité de la soumission d’un homme à un autre, d’une partie de la population à une autre ; car les hommes s’habitueront à observer les conditions élémentaires de la vie en société, sans violence et sans soumission.
C’est pour souligner cet élément d’accoutumance qu’Engels parle de la nouvelle génération "grandie dans des conditions sociales nouvelles et libres" et qui sera "en état de se défaire de tout ce bric-à-brac de l’Etat", de tout Etat, y compris celui de la république démocratique.
Pour élucider ce point, il est nécessaire d’analyser les bases économiques de l’extinction de l’Etat.
CHAPITRE V
LES BASES ECONOMIQUES DE L’EXTINCTION DE L’ETAT
L’étude la plus poussée de cette question est celle qu’en a faite Marx dans sa Critique du programme de Gotha (lettre à Bracke, du 5 mai 1875, imprimée seulement en 1891 dans la Neue Zeit, IX, 1, et dont il a paru une édition russe). La partie polémique de cette oeuvre remarquable, qui constitue une critique du lassallianisme, a pour ainsi dire rejeté dans l’ombre la partie positive de l’ouvrage, à savoir : l’analyse de la corrélation entre le développement du communisme et l’extinction de l’Etat.
1. COMMENT MARX POSE LA QUESTION
Si l’on compare superficiellement la lettre de Marx à Bracke, du 5 mai 1875, et la lettre d’Engels à Bebel, du 28 mars 1875, examinée plus haut, il peut sembler que Marx soit beaucoup plus "étatiste" qu’Engels, et que la différence soit très marquée entre les conceptions de ces deux auteurs sur l’Etat.
Engels invite Bebel à cesser tout bavardage sur l’Etat, à bannir complètement du programme le mot Etat, pour le remplacer par celui de "communauté" ; il va jusqu’à déclarer que la Commune n’était plus un Etat au sens propre. Cependant que Marx va jusqu’à parler de "l’Etat [Staatswesen-en allemand] futur de la société communiste", c’est-à-dire qu’il semble admettre la nécessité de l’Etat même en régime communiste.
Mais cette façon de voir serait foncièrement erronée. Un examen plus attentif montre que les idées de Marx et d’Engels sur l’Etat et son extinction concordent parfaitement, et que l’expression citée de Marx s’applique précisément à l’Etat en voie d’extinction.
Il est certain qu’il ne saurait être question de déterminer le moment de cette "extinction" future, d’autant plus qu’elle constituera nécessairement un processus de longue durée. La différence apparente entre Marx et Engels s’explique par la différence des sujets traités et des buts poursuivis par chacun d’eux. Engels se proposait de démontrer à Bebel d’une façon frappante, incisive, à grands traits, toute l’absurdité des préjugés courants (partagés dans une notable mesure par Lassalle) sur l’Etat. Cette question, Marx n’a fait que l’effleurer, car un autre sujet retenait son attention : l’évolution de la société communiste.
Toute la théorie de Marx est une application au capitalisme contemporain de la théorie de l’évolution sous sa forme la plus conséquente, la plus complète, la plus réfléchie et la plus substantielle. On conçoit donc que Marx ait eu à envisager le problème de l’application de cette théorie à la faillite prochaine du capitalisme comme à l’évolution future du Communisme futur.
A partir de quelles données peut-on poser la question de l’évolution future du communisme futur ?
A partir du fait que le communisme procède du capitalisme, se développe historiquement à partir du capitalisme, résulte de l’action d’une force sociale engendrée par le capitalisme On ne trouve pas chez Marx l’ombre d’une tentative d’inventer des utopies, d’échafauder de vaines conjectures sur ce que l’on ne peut pas savoir. Marx pose la question du communisme comme un naturaliste poserait, par exemple, celle de l’évolution d’une nouvelle variété biologique, une fois connue son origine et déterminée la direction où l’engagent ses modifications.
Tout d’abord, Marx écarte la confusion apportée par le programme de Gotha dans la question des rapports entre l’Etat et la société.
"La "société actuelle", écrit-il, c’est la société capitaliste qui existe dans tous les pays civilisés, plus ou moins expurgée d’éléments moyenâgeux, plus ou moins modifiée par l’évolution historique particulière à chaque pays, plus ou moins développée. "L’Etat actuel", au contraire, change avec la frontière. Il est dans l’Empire prusso-allemand autre qu’en Suisse, en Angleterre autre qu’aux Etats-Unis. "L’Etat actuel" est donc une fiction.
Cependant, les divers Etats des divers pays civilisés nonobstant la multiple diversité de leurs formes, ont tous ceci de commun qu’ils reposent sur le terrain de la société bourgeoise moderne, plus ou moins développée au point de vue capitaliste. C’est ce qui fait que certains caractères essentiels leur sont communs. En ce sens, on peut parler "d’Etat actuel", pris comme expression générique, par contraste avec l’avenir où la société bourgeoise, qui lui sert à présent de racine, aura cessé d’exister.
Dès lors, la question se pose : quelle transformation subira l’Etat dans une société communiste ? Autrement dit : quelles fonctions sociales s’y maintiendront analogues aux fonctions actuelles de l’Etat ? Seule la science peut répondre à cette question ; et ce n’est pas en accouplant de mille manières le mot Peuple avec le mot Etat qu’on fera avancer le problème d’un saut de puce[21]."
Après avoir tourné ainsi en ridicule tous les bavardages sur "l’Etat populaire", Marx montre comment il faut poser la question et formule, en quelque sorte, une mise en garde en indiquant que l’on ne peut y donner une réponse scientifique qu’en se basant sur des données scientifiques solidement établies.
Le premier point très exactement établi par toute la théorie de l’évolution, par la science en général,-point qu’oubliaient les utopistes et qu’oublient aujourd’hui les opportunistes qui craignent la révolution socialiste, - c’est qu’historiquement il doit sans aucun doute exister un stade particulier ou une étape particulière de transition du capitalisme au communisme.
2. LA TRANSITION DU CAPITALISME AU COMMUNISME
"Entre la société capitaliste et la société communiste, poursuit Marx, se place la période de transformation révolutionnaire de celle-là en celle-ci. A quoi correspond une période de transition politique où l’Etat ne saurait être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat."
Cette conclusion repose, chez Marx, sur l’analyse du rôle que joue le prolétariat dans la société capitaliste actuelle, sur les données relatives au développement de cette société et à l’inconciliabilité des intérêts opposés du prolétariat et de la bourgeoisie.
Autrefois, la question se posait ainsi : le prolétariat doit, pour obtenir son affranchissement, renverser la bourgeoisie, conquérir le pouvoir politique, établir sa dictature révolutionnaire.
Maintenant, la question se pose un peu autrement : le passage de la société capitaliste, qui évolue vers le communisme, à la société communiste est impossible sans une "période de transition politique" ; et l’Etat de cette période ne peut être que la dictature révolutionnaire du prolétariat.
Quels sont donc les rapports entre cette dictature et la démocratie ?
Nous avons vu que le Manifeste Communiste rapproche simplement l’une de l’autre ces deux notions : "transformation du prolétariat en classe dominante" et "conquête de la démocratie". Tout ce qui précède permet de déterminer plus exactement les modifications que subit la démocratie lors de la transition du capitalisme au communisme.
La société capitaliste, considérée dans ses conditions de développement les plus favorables, nous offre une démocratie plus ou moins complète en république démocratique. Mais cette démocratie est toujours confinée dans le cadre étroit de l’exploitation capitaliste et, de ce fait, elle reste toujours, quant au fond, une démocratie pour la minorité, uniquement pour les classes possédantes, uniquement pour les riches. La liberté, en société capitaliste, reste toujours à peu près ce qu’elle fut dans les républiques de la Grèce antique : une liberté pour les propriétaires d’esclaves. Par suite de l’exploitation capitaliste, les esclaves salariés d’aujourd’hui demeurent si accablés par le besoin et la misère qu’ils se "désintéressent de la démocratie", "se désintéressent de la politique" et que, dans le cours ordinaire, pacifique, des événements, la majorité de la population se trouve écartée de la vie politique et sociale.
La justesse de cette affirmation est peut-être le mieux illustrée par l’Allemagne, parce que c’est dans ce pays précisément que la légalité constitutionnelle s’est maintenue avec une constance et une durée étonnantes pendant près d’un demi-siècle (1871-1914), et parce que la social-démocratie a su, durant cette période, faire beaucoup plus que dans d’autres pays pour "mettre à profit la légalité" et organiser les ouvriers en un parti politique dans une proportion plus considérable que nulle part au monde.
Quelle est donc cette proportion - la plus élevée que l’on observe dans la société capitaliste - des esclaves salariés politiquement conscients et actifs ? Un million de membres du parti social-démocrate sur 15 millions d’ouvriers salariés ! Trois millions de syndiqués, sur 15 millions !
Démocratie pour une infime minorité, démocratie pour les riches, tel est le démocratisme de la société capitaliste. Si l’on considère de plus près le mécanisme de la démocratie capitaliste, on verra partout, dans les "menus" (les prétendus menus) détails de la législation électorale (conditions de résidence, exclusion des femmes, etc.), dans le fonctionnement des institutions représentatives, dans les obstacles effectifs au droit de réunion (les édifices publics ne sont pas pour les "miséreux" !), dans l’organisation purement capitaliste de la presse quotidienne, etc., etc., - on verra restriction sur restriction au démocratisme. Ces restrictions, éliminations, exclusions, obstacles pour les pauvres paraissent menus, surtout aux yeux de ceux qui n’ont jamais connu eux-mêmes le besoin et n’ont jamais approché les classes opprimées ni la vie des masses qui les composent (et c’est le cas des neuf dixièmes, sinon des quatre-vingt-dix neuf centièmes des publicistes et hommes politiques bourgeois), - mais, totalisées, ces restrictions excluent, éliminent les pauvres de la politique, de la participation active à la démocratie.
Marx a parfaitement saisi ce trait essentiel de la démocratie capitaliste quand il a dit dans son analyse de l’expérience de la Commune : on autorise les opprimés à décider périodiquement, pour un certain nombre d’années, quel sera, parmi les représentants de la classe des oppresseurs, celui qui les représentera et les foulera aux pieds au Parlement !
Mais la marche en avant, à partir de cette démocratie capitaliste, - inévitablement étriquée, refoulant sournoisement les pauvres, et par suite foncièrement hypocrite et mensongère, - ne mène pas simplement, directement et sans heurts "à une démocratie de plus en plus parfaite", comme le prétendent les professeurs libéraux et les opportunistes petits-bourgeois. Non. La marche en avant, c’est-à-dire vers le communisme, se fait en passant par la dictature du prolétariat ; et elle ne peut se faire autrement, car il n’est point d’autres classes ni d’autres moyens qui puissent briser la résistance des capitalistes exploiteurs.
Or, la dictature du prolétariat, c’est-à-dire l’organisation de l’avant-garde des opprimés en classe dominante pour mater les oppresseurs, ne peut se borner à un simple élargissement de la démocratie. En même temps qu’un élargissement considérable de la démocratie, devenue pour la première fois démocratie pour les pauvres, démocratie pour le peuple et non pour les riches, la dictature du prolétariat apporte une série de restrictions à la liberté pour les oppresseurs, les exploiteurs, les capitalistes. Ceux-là, nous devons les mater afin de libérer l’humanité de l’esclavage salarié ; il faut briser leur résistance par la force ; et il est évident que, là où il y a répression, il y a violence, il n’y a pas de liberté, il n’y a pas de démocratie.
Cela, Engels l’a admirablement exprimé dans sa lettre à Bebel, où il disait, comme le lecteur s’en souvient : "... tant que le prolétariat a encore besoin de l’Etat, ce n’est point pour la liberté, mais pour réprimer ses adversaires. Et le jour où il devient possible de parler de liberté, l’Etat cesse d’exister comme tel."
Démocratie pour l’immense majorité du peuple et répression par la force, c’est-à-dire exclusion de la démocratie pour les exploiteurs, les oppresseurs du peuple ; telle est la modification que subit la démocratie lors de la transition du capitalisme au communisme.
C’est seulement dans la société communiste, lorsque la résistance des capitalistes est définitivement brisée, que les capitalistes ont disparu et qu’il n’y a plus de classes (c’est-à-dire plus de distinctions entre les membres de la société quant à leurs rapports avec les moyens sociaux de production), c’est alors seulement que "l’Etat cesse d’exister et qu’il devient possible de parler de liberté". Alors seulement deviendra possible et sera appliquée une démocratie vraiment complète, vraiment sans aucune exception. Alors seulement la démocratie commencera à s’éteindre pour cette simple raison que, délivrés de l’esclavage capitaliste, des horreurs, des sauvageries, des absurdités, des ignominies sans nombre de l’exploitation capitaliste, les hommes s’habitueront graduellement à respecter les règles élémentaires de la vie en société connues depuis des siècles, rebattues durant des millénaires dans toutes les prescriptions morales, à les respecter sans violence, sans contrainte, sans soumission, sans cet appareil spécial de coercition qui a nom : l’Etat.
L’expression "l’Etat s’éteint" est très heureuse, car elle exprime à la fois la gradation du processus et sa spontanéité. Seule l’habitude peut produire un tel effet et elle le produira certainement, car nous constatons mille et mille fois autour de nous avec quelle facilité les hommes s’habituent à observer les règles nécessaires à la vie en société quand il n’y a pas d’exploitation, quand il n’y a rien qui excite l’indignation, qui suscite la protestation et la révolte, qui nécessite la répression.
Ainsi donc, en société capitaliste, nous n’avons qu’une démocratie tronquée, misérable, falsifiée, une démocratie uniquement pour les riches, pour la minorité. La dictature du prolétariat, période de transition au communisme, établira pour la première fois une démocratie pour le peuple, pour la majorité, parallèlement à la répression nécessaire d’une minorité d’exploiteurs. Seul le communisme est capable de réaliser une démocratie réellement complète ; et plus elle sera complète, plus vite elle deviendra superflue et s’éteindra d’elle-même.
En d’autres termes : nous avons, en régime capitaliste, l’Etat au sens propre du mot, une machine spéciale d’oppression d’une classe par une autre, de la majorité par la minorité. On conçoit que pour être menée à bien, la répression systématique exercée contre une majorité d’exploités par une minorité d’exploiteurs exige une cruauté, une férocité extrêmes dans la répression, des mers de sang à travers lesquelles l’humanité poursuit sa route sous le régime de l’esclavage, du servage et du salariat.
Ensuite, dans la période de transition du capitalisme au communisme, la répression est encore nécessaire, mais elle est déjà exercée sur une minorité d’exploiteurs par une majorité d’exploités. L’appareil spécial, la machine spéciale de répression, "l’Etat", est encore nécessaire, mais c’est déjà un Etat transitoire, ce n’est plus l’Etat proprement dit, car la répression exercée sur une minorité d’exploiteurs par la majorité des esclaves salariés d’hier est chose relativement si facile, si simple et si naturelle qu’elle coûtera beaucoup moins de sang que la répression des révoltes d’esclaves, de serfs et d’ouvriers salariés, qu’elle coûtera beaucoup moins cher à l’humanité. Elle est compatible avec l’extension de la démocratie à une si grande majorité de la population que la nécessité d’une machine spéciale de répression commence à disparaître. Les exploiteurs ne sont naturellement pas en mesure de mater le peuple sans une machine très compliquée, destinée à remplir cette tâche ; tandis que le peuple peut mater les exploiteurs même avec une "machine" très simple, presque sans "machine", sans appareil spécial, par la simple organisation des masses armées (comme, dirons-nous par anticipation, les Soviets des députés ouvriers et soldats).
Enfin, seul le communisme rend l’Etat absolument superflu, car il n’y a alors personne à mater, "personne" dans le sens d’aucune classe ; il n’y a plus lutte systématique contre une partie déterminée de la population. Nous ne sommes pas des utopistes et nous ne nions pas du tout que des excès individuels soient possibles et inévitables ; nous ne nions pas davantage qu’il soit nécessaire de réprimer ces excès. Mais, tout d’abord, point n’est besoin pour cela d’une machine spéciale, d’un appareil spécial de répression ; le peuple armé se chargera lui-même de cette besogne aussi simplement, aussi facilement qu’une foule quelconque d’hommes civilisés même dans la société actuelle sépare des gens qui se battent ou ne permet pas qu’on rudoie une femme. Ensuite, nous savons que la cause sociale profonde des excès qui constituent une violation des règles de la vie en société, c’est l’exploitation des masses, vouées au besoin, à la misère. Cette principale cause une fois écartée, les excès commenceront infailliblement à "s’éteindre". Avec quelle rapidité et quelle gradation, nous l’ignorons ; mais nous savons qu’ils s’éteindront. Et, avec eux, l’Etat s’éteindra à son tour.
Sans se lancer dans l’utopie, Marx a défini plus en détail ce qu’on peut définir maintenant de cet avenir, à savoir : la différence entre la phase (le degré, l’étape) inférieure et la phase supérieure de la société communiste.
3. PREMIERE PHASE DE LA SOCIETE COMMUNISTE
Dans la Critique du programme de Gotha, Marx réfute minutieusement l’idée de Lassalle selon laquelle l’ouvrier, en régime socialiste, recevra le produit "non amputé" ou "le produit intégral de son travail". Il montre que de la totalité du produit social il faut défalquer : un fonds de réserve, un fonds destiné à accroître la production, un fonds destiné au remplacement des machines "usagées", etc. Puis, des objets de consommation, il faut encore défalquer : un fonds pour les frais d’administration, les écoles, les hôpitaux, les hospices de vieillards, etc.
Au lieu de la formule nébuleuse, obscure et générale de Lassalle ("à l’ouvrier le produit intégral de son travail"), Marx établit avec lucidité comment la société socialiste sera tenue de gérer les affaires. Marx entreprend l’analyse concrète des conditions de vie dans une société où le capitalisme n’existera pas, et il s’exprime ainsi :
"Ce à quoi nous avons affaire ici [à l’examen du programme du parti ouvrier], c’est à une société communiste non pas telle qu’elle s’est développée sur les bases qui lui sont propres, mais au contraire telle qu’elle vient de sortir de la société capitaliste ; une société par conséquent, qui, sous tous les rapport, économique, moral, intellectuel, porte encore les stigmates de l’ancienne société des flancs de laquelle elle est issue."
C’est cette société communiste qui vient de sortir des flancs du capitalisme et porte dans tous les domaines les stigmates de la vieille société que Marx appelle la phase "première" ou phase inférieure de la société communiste.
Les moyens de production ne sont déjà plus la propriété privée d’individus. Ils appartiennent à la société tout entière. Chaque membre de la société, accomplissant une certaine part du travail socialement nécessaire, reçoit de la société un certificat constatant la quantité de travail qu’il a fournie. Avec ce certificat, il reçoit dans les magasins publics d’objets de consommation une quantité correspondante de produits. Par conséquent, défalcation faite de la quantité de travail versée au fonds social, chaque ouvrier reçoit de la société autant qu’il lui a donné.
Règne de "l’égalité", dirait-on.
Mais lorsque, parlant de cet ordre social (que l’on appelle habituellement socialisme et que Marx nomme la première phase du communisme), Lassalle dit qu’il y a là "partage équitable", "droit égal de chacun au produit égal du travail", il se trompe et Marx explique pourquoi.
Le "droit égal", dit Marx, nous l’avons ici, en effet, mais c’est encore le "droit bourgeois" qui, comme tout droit présuppose l’inégalité. Tout droit consiste dans l’application d’une règle unique à des gens différents, à des gens qui, en fait, ne sont ni identiques, ni égaux. Aussi le "droit égal" équivaut-il à une violation de l’égalité, à une injustice. En effet, chacun reçoit, pour une part égale de travail social fourni par lui, une part égale du produit social (avec les défalcations indiquées plus haut).
Or, les individus ne sont pas égaux : l’un est plus fort l’autre plus faible ; l’un est marié, l’autre non ; l’un a plus d’enfants, l’autre en a moins, etc.
..."A égalité de travail, conclut Marx, et, par conséquent, à égalité de participation au fond social de consommation, l’un reçoit donc effectivement plus que l’autre, l’un est plus riche que l’autre, etc. Pour éviter tous ces inconvénients, le droit devrait être non pas égal, mais inégal."
La justice et l’égalité, la première phase du communisme ne peut donc pas encore les réaliser ; des différences subsisteront quant à la richesse, et des différences injustes, mais l’exploitation de l’homme par l’homme sera impossible, car on ne pourra s’emparer, à titre de propriété privée, des moyens de production, fabriques, machines, terre, etc. En réfutant la formule confuse et petite-bourgeoise de Lassalle sur "l’égalité" et la "justice" en général, Marx montre le cours du développement de la société communiste, obligée de commencer par détruire uniquement cette "injustice" qu’est l’appropriation des moyens de production par des individus, mais incapable de détruire d’emblée l’autre injustice : la répartition des objets de consommation "selon le travail" (et non selon les besoins).
Les économistes vulgaires, et parmi eux les professeurs bourgeois, "notre" Tougan y compris, font constamment aux socialistes le reproche d’oublier l’inégalité des hommes et d’en "rêver" la suppression. Ce reproche, on le voit, prouve simplement l’ignorance extrême de messieurs les idéologues bourgeois.
Marx tient rigoureusement compte non seulement de l’inévitable inégalité des hommes entre eux, mais aussi du fait que la transformation des moyens de production en propriété commune de la société entière (le "socialisme" au sens habituel du mot) ne supprime pas à elle seule les défauts de la répartition et l’inégalité du "droit bourgeois", qui continue de régner, puisque les produits sont répartis "selon le travail".
"Mais, poursuit Marx, ces défauts sont inévitables dans la première phase de la société communiste, telle qu’elle vient de sortir de la société capitaliste, après un long et douloureux enfantement. Le droit ne peut jamais être plus élevé que l’état économique de la société et que le degré de civilisation qui y correspond."
Ainsi, dans la première phase de la société communiste (que l’on appelle ordinairement socialisme), le "droit bourgeois" est aboli non pas complètement, mais seulement en partie, seulement dans la mesure où la révolution économique a été faite, c’est-à-dire seulement en ce qui concerne les moyens de production. Le "droit bourgeois" en reconnaît la propriété privée aux individus. Le socialisme en fait une propriété commune. C’est dans cette mesure, mais dans cette mesure seulement, que le "droit bourgeois" se trouve aboli.
Il subsiste cependant dans son autre partie, en qualité de régulateur de la répartition des produits et de la répartition du travail entre les membres de la société. "Qui ne travaille pas ne doit pas manger" : ce principe socialiste est déjà réalisé ; "à quantité égale de travail, quantité égale de produits" : cet autre principe socialiste est déjà réalisé, lui aussi. Pourtant, ce n’est pas encore le communisme et cela n’élimine pas encore le "droit bourgeois" qui, à des hommes inégaux et pour une quantité inégale (inégale en fait) de travail, attribue une quantité égale de produits.
C’est là un "inconvénient", dit Marx ; mais il est inévitable dans la première phase du communisme, car on ne peut, sans verser dans l’utopie, penser qu’après avoir renversé le capitalisme les hommes apprennent d’emblée à travailler pour la société sans normes juridiques d’aucune sorte ; au reste, l’abolition du capitalisme ne donne pas d’emblée les prémisses économiques d’un tel changement.
Or, il n’y a d’autres normes que celles du "droit bourgeois". C’est pourquoi subsiste la nécessité d’un Etat chargé, tout en protégeant la propriété commune des moyens de production, de protéger l’égalité du travail et l’égalité dans la répartition des produits.
L’Etat s’éteint, pour autant qu’il n’y a plus de capitalistes, plus de classes et que, par conséquent, il n’y a pas de classe à mater.
Mais l’Etat n’a pas encore entièrement disparu puisque l’on continue à protéger le "droit bourgeois" qui consacre l’inégalité de fait. Pour que l’Etat s’éteigne complètement, il faut l’avènement du communisme intégral.
4. PHASE SUPERIEURE DE LA SOCIETE COMMUNISTE
Marx poursuit :
"Dans une phase supérieure de la société communiste, quand auront disparu l’asservissante subordination des individus à la division du travail et, avec elle, l’opposition entre le travail intellectuel et le travail manuel ; quand le travail ne sera pas seulement un moyen de vivre, mais deviendra lui-même le premier besoin vital ; quand, avec le développement multiple des individus, les forces productives se seront accrues elles aussi et que toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance, alors seulement l’horizon borné du droit bourgeois pourra être définitivement dépassé et la société pourra écrire sur ses drapeaux : "De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins"."
Maintenant seulement nous pouvons apprécier toute la justesse des remarques d’Engels, accablant de ses sarcasmes impitoyables cet absurde accouplement des mots "liberté" et "Etat". Tant que l’Etat existe, il n’y a pas de liberté. Quand il y aura la liberté, il n’y aura plus d’Etat.
La base économique de l’extinction totale de l’Etat, c’est le communisme arrivé à un si haut degré de développement que toute opposition disparaît entre le travail intellectuel et le travail manuel et que, par conséquent, disparaît l’une des principales sources de l’inégalité sociale contemporaine, source que la seule socialisation des moyens de production, la seule expropriation des capitalistes ne peut en aucune façon tarir d’emblée.
Cette expropriation rendra possible un essor gigantesque des forces productives. Et voyant comment le capitalisme, dès maintenant, entrave incroyablement cet essor, et combien de progrès l’on pourrait réaliser grâce à la technique moderne déjà acquise, nous sommes en droit d’affirmer, avec une certitude absolue, que l’expropriation des capitalistes entraînera nécessairement un développement prodigieux des forces productives de la société humaine. Mais quelle sera la rapidité de ce développement, quand aboutira-t-il à une rupture avec la division du travail, à la suppression de l’opposition entre le travail intellectuel et le travail manuel, à la transformation du travail en "premier besoin vital", c’est ce que nous ne savons ni ne pouvons savoir.
Aussi n’avons-nous le droit de parler que de l’extinction inévitable de l’Etat, en soulignant la durée de ce processus, sa dépendance de la rapidité avec laquelle se développera la phase supérieure du communisme, et en laissant complètement en suspens la question des délais ou des formes concrètes de cette extinction. Car les données qui nous permettraient de trancher de tels problèmes n’existent pas.
L’Etat pourra s’éteindre complètement quand la société aura réalisé le principe : "De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins", c’est-à-dire quand les hommes se seront si bien habitués à respecter les règles fondamentales de la vie en société et que leur travail sera devenu si productif qu’ils travailleront volontairement selon leurs capacités. "L’horizon borné du doit bourgeois" qui oblige à calculer avec l’âpreté d’un Shylock : "N’aurais-je pas travaillé un demi-heure de plus que le voisin ? N’aurais-je pas touché un salaire inférieur au sien ?" - cet horizon borné sera alors dépassé. La répartition des produits n’exigera plus alors le rationnement par la société des produits délivrés à chacun ; chacun puisera librement "selon ses besoins".
Du point de vue bourgeois, il est aisé de traiter un semblable régime social de "pure utopie", et de railler les socialistes qui promettent à chaque citoyen le droit de recevoir de la société, sans aucun contrôle de son travail, autant qu’il voudra de truffes, d’automobiles, de pianos, etc. C’est à des railleries de cette nature que se bornent aujourd’hui encore la plupart des "savants" bourgeois, qui révèlent ainsi leur ignorance et leur mentalité de défenseurs intéressés du capitalisme.
Leur ignorance, car il n’est venu à l’esprit d’aucun socialiste de "promettre" l’avènement de la phase supérieure du communisme ; quant à la prévision de son avènement par les grands socialistes, elle suppose une productivité du travail différente de celle d’aujourd’hui, et la disparition de l’homme moyen d’aujourd’hui capable, comme les séminaristes de Pomialovski, de gaspiller "à plaisir" les richesses publiques et d’exiger l’impossible.
En attendant l’avènement de la phase "supérieure"" du communisme, les socialistes réclament de la société et de l’Etat qu’ils exercent le contrôle le plus rigoureux, sur la mesure de travail et la mesure de consommation ; mais ce contrôle doit commencer par l’expropriation des capitalistes, par le contrôle des ouvriers sur les capitalistes, et il doit être exercé non par l’Etat des fonctionnaires, mais par l’Etat des ouvriers armés.
La défense intéressée du capitalisme par les idéologues bourgeois (et leurs caudataires tels que les Tsérétéli, les Tchernov et cie) consiste précisément à escamoter, par des discussions et des phrases sur un avenir lointain, la question d’actualité brûlante de la politique d’aujourd’hui : l’expropriation des capitalistes, la transformation de tous les citoyens en travailleurs et employés d’un grand "syndicat" unique, à savoir : l’Etat tout entier, et la subordination absolue de tout le travail de tout ce syndicat à un Etat vraiment démocratique, à l’Etat des Soviets des députés ouvriers et soldats.
Au fond, lorsqu’un savant professeur, et après lui le philistin, et après lui les Tsérétéli et les Tchernov parlent des utopies insensées, des promesses démagogiques des bolchéviks, de l’impossibilité "d’instaurer" le socialisme, ils songent précisément à ce stade ou à cette phase supérieure du communisme, que personne n’a jamais promis ni même eu le dessein "d’instaurer", car, d’une façon générale, il est impossible de "l’instaurer".
Nous abordons ici la question de la distinction scientifique entre socialisme et communisme, effleurée par Engels dans le passage précédemment cité sur l’impropriété de l’appellation de "social-démocrate". Au point de vue politique la différence entre la première phase ou phase inférieure et la phase supérieure du communisme sera certainement considérable avec le temps ; mais aujourd’hui, en régime capitaliste, il serait ridicule d’en faire cas, et seuls peut-être quelques anarchistes pourraient la mettre au premier plan (si tant est qu’il subsiste encore parmi les anarchistes des gens qui n’aient rien appris à la suite de la métamorphose "plékhanovienne" des Kropotkine, des Grave, des Cornélissen et autres "étoiles" de l’anarchisme en social-chauvins ou en anarchistes-des-tranchées, suivant l’expression de Gay, un des rares anarchistes qui aient gardé honneur et conscience).
Mais la différence scientifique entre socialisme et communisme est claire. Ce qu’on appelle communément socialisme, Marx l’a appelé la "première" phase ou phase inférieure de la société communiste. Dans la mesure où les moyens de production deviennent propriété commune, le mot "communiste" peut s’appliquer également ici, à condition de ne pas oublier que ce n’est pas le communisme intégral. Le grand mérite des explications de Marx est d’appliquer, là encore, de façon conséquente, la dialectique matérialiste, la théorie de l’évolution, et de considérer le communisme comme quelque chose qui se développe à partir du capitalisme. Au lieu de s’en tenir à des définitions "imaginées", scolastiques et artificielles, à de stériles querelles de mots (qu’est-ce que le socialisme ? qu’est-ce que le communisme ?), Marx analyse ce qu’on pourrait appeler les degrés de la maturité économique du communisme.
Dans sa première phase, à son premier degré, le communisme ne peut pas encore, au point de vue économique, être complètement mûr, complètement affranchi des traditions ou des vestiges du capitalisme. De là, ce phénomène intéressant qu’est le maintien de "l’horizon borné du droit bourgeois", en régime communiste, dans la première phase de celui-ci. Certes, le droit bourgeois, en ce qui concerne la répartition des objets de consommation, suppose nécessairement un Etat bourgeois, car le droit n’est rien sans un appareil capable de contraindre à l’observation de ses normes.
Il s’ensuit qu’en régime communiste subsistent pendant un certain temps non seulement le droit bourgeois, mais aussi l’Etat bourgeois - sans bourgeoisie !
Cela peut sembler un paradoxe ou simplement un jeu dialectique de l’esprit, ce que reprochent souvent au marxisme ceux qui n’ont jamais pris la peine d’en étudier, si peu que ce soit, la substance éminemment profonde.
En réalité, la vie nous montre à chaque pas, dans la nature et dans la société, des vestiges du passé subsistant dans le présent. Et ce n’est point d’une façon arbitraire que Marx a inséré dans le communisme une parcelle du droit "bourgeois" ; il n’a fait que constater ce qui, économiquement et politiquement, est inévitable dans une société issue des flancs du capitalisme.
La démocratie a une importance énorme dans la lutte que la classe ouvrière mène contre les capitalistes pour son affranchissement. Mais la démocratie n’est nullement une limite que l’on ne saurait franchir ; elle n’est qu’une étape sur la route de la féodalité au capitalisme et du capitalisme au communisme.
Démocratie veut dire égalité. On conçoit la portée immense qui s’attache à la lutte du prolétariat pour l’égalité et au mot d’ordre d’égalité, à condition de comprendre ce dernier exactement, dans le sens de la suppression des classes. Mais démocratie signifie seulement égalité formelle. Et, dès que sera réalisée l’égalité de tous les membres de la société par rapport à la possession des moyens de production, c’est-à-dire l’égalité du travail, l’égalité du salaire, on verra se dresser inévitablement devant l’humanité la question d’un nouveau progrès à accomplir pour passer de l’égalité formelle à l’égalité réelle, c’est-à-dire à la réalisation du principe : "De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins." Par quelles étapes, par quelles mesures pratiques l’humanité s’acheminera-t-elle vers ce but suprême, nous ne le savons ni ne pouvons le savoir. Mais ce qui importe, c’est de voir l’immense mensonge contenu dans l’idée bourgeoise courante suivant laquelle le socialisme est quelque chose de mort, de figé, de donné une fois pour toutes, alors qu’en réalité c’est seulement avec le socialisme que commencera dans tous les domaines de la vie sociale et privée un mouvement de progression rapide, effectif, ayant véritablement un caractère de masse et auquel participera d’abord la majorité, puis la totalité de la population.
La démocratie est une forme de l’Etat, une de ses variétés. Elle est donc, comme tout Etat, l’application organisée, systématique, de la contrainte aux hommes. Ceci, d’une part. Mais, d’autre part, elle signifie la reconnaissance officielle de l’égalité entre les citoyens, du droit égal pour tous de déterminer la forme de l’Etat et de l’administrer. Il s’ensuit donc qu’à un certain degré de son développement, la démocratie, tout d’abord, unit le prolétariat, la classe révolutionnaire anticapitaliste, et lui permet de briser, de réduire en miettes, de faire disparaître de la surface de la terre la machine d’Etat bourgeoise, fût-elle bourgeoise républicaine, l’armée permanente, la police, la bureaucratie, et de les remplacer par une machine d’Etat plus démocratique, mais qui n’en reste pas moins une machine d’Etat, sous la forme des masses ouvrières armées, puis, progressivement, du peuple entier participant à la milice.
Ici, "la quantité se change en qualité" : parvenu à ce degré, le démocratisme sort du cadre de la société bourgeoise et commence à évoluer vers le socialisme. Si tous participent réellement à la gestion de l’Etat, le capitalisme ne peut plus se maintenir. Et le développement du capitalisme crée, à son tour, les prémisses nécessaires pour que "tous" puissent réellement participer à la gestion de l’Etat. Ces prémisses sont, entre autres, l’instruction générale déjà réalisée par plusieurs des pays capitalistes les plus avancés, puis "l’éducation et la formation à la discipline" de millions d’ouvriers par l’appareil socialisé, énorme et complexe, de la poste, des chemins de fer, des grandes usines, du gros commerce, des banques, etc., etc.
Avec de telles prémisses économiques, on peut fort bien, après avoir renversé les capitalistes et les fonctionnaires, les remplacer aussitôt, du jour au lendemain, pour le contrôle de la production et de la répartition, pour l’enregistrement du travail et des produits, par les ouvriers armés, par le peuple armé tout entier. (Il ne faut pas confondre la question du contrôle et de l’enregistrement avec celle du personnel possédant une formation scientifique, qui comprend les ingénieurs, les agronomes, etc. : ces messieurs, qui travaillent aujourd’hui sous les ordres des capitalistes, travailleront mieux encore demain sous les ordres des ouvriers armés.)
Enregistrement et contrôle, tel est l’essentiel, et pour la "mise en route" et pour le fonctionnement régulier de la société communiste dans sa première phase. Ici, tous les citoyens se transforment en employés salariés de l’Etat constitué par les ouvriers armés. Tous les citoyens deviennent les employés et les ouvriers d’un seul "cartel" du peuple entier, de l’Etat. Le tout est d’obtenir qu’ils fournissent un effort égal, observent exactement la mesure de travail et reçoivent un salaire égal. L’enregistrement et le contrôle dans ce domaine ont été simplifiés à l’extrême par le capitalisme, qui les a réduits aux opérations les plus simples de surveillance et d’inscription et à la délivrance de reçus correspondants, toutes choses à la portée de quiconque sait lire et écrire et connaît les quatre règles d’arithmétique [Quand l’Etat réduit ses fonctions essentielles à un semblable enregistrement et à un contrôle de ce genre effectués par les ouvriers eux-mêmes, il cesse d’être un "Etat politique" ; les "fonctions publiques perdent leur caractère politique et se transforment en de simples fonctions administratives" (voir plus haut, chapitre IV, §2 : "La polémique d’Engels avec les anarchistes").].
Quand la majorité du peuple procédera par elle-même et partout à cet enregistrement, à ce contrôle des capitalistes (transformés désormais en employés) et de messieurs les intellectuels qui auront conservé leurs pratiques capitalistes, alors ce contrôle sera vraiment universel, général, national et nul ne pourra s’y soustraire, de quelque manière que ce soit, "il n’y aura plus rien à faire".
La société tout entière ne sera plus qu’un seul bureau et un seul atelier, avec égalité de travail et égalité de salaire.
Mais cette discipline "d’atelier" que le prolétariat, après avoir vaincu les capitalistes et renversé les exploiteurs, étendra à toute la société n’est nullement notre idéal ni notre but final ; c’est seulement un échelon nécessaire pour débarrasser radicalement la société des vilenies et des ignominies de l’exploitation capitaliste, et assurer la marche continue en avant.
Dès l’instant où tous les membres de la société, ou du moins leur immense majorité, ont appris à gérer eux-mêmes l’Etat, ont pris eux-mêmes l’affaire en main, "organisé" le contrôle sur l’infime minorité de capitalistes, sur les petits messieurs désireux de conserver leurs pratiques capitalistes et sur les ouvriers profondément corrompus par le capitalisme - dès cet instant, la nécessité de toute administration en général commence à disparaître. Plus la démocratie est complète, et plus proche est le moment où elle deviendra superflue. Plus démocratique est "l’Etat" constitué par les ouvriers armés et qui "n’est plus un Etat au sens propre", et plus vite commence à s’éteindre tout Etat.
En effet, quand tous auront appris à administrer et administreront effectivement eux-mêmes la production sociale, quand tous procéderont eux-mêmes à l’enregistrement et au contrôle des parasites, des fils à papa, des filous et autres "gardiens des traditions du capitalisme", - se soustraire à cet enregistrement et à ce contrôle exercé par le peuple entier sera à coup sûr d’une difficulté si incroyable et d’une si exceptionnelle rareté, cela entraînera vraisemblablement un châtiment si prompt et si rude (les ouvriers armés ont un sens pratique de la vie ; ils ne sont pas de petits intellectuels sentimentaux et ne permettront sûrement pas qu’on plaisante avec eux) que la nécessité d’observer les règles, simples mais essentielles, de toute société humaine deviendra très vite une habitude.
Alors s’ouvrira toute grande la porte qui permettra de passer de la première phase de la société communiste à sa phase supérieure et, par suite, à l’extinction complète de l’Etat.
CHAPITRE VI
L’AVILISSEMENT DU MARXISME PAR LES OPPORTUNISTES
La question de l’attitude de l’Etat envers la révolution sociale et de la révolution sociale envers l’Etat a très peu préoccupé les théoriciens et les publicistes les plus en vue de la IIe Internationale (1889-1914), comme du reste le problème de la révolution en général. Mais le plus caractéristique dans le développement graduel de l’opportunisme, qui a abouti à la faillite de la IIe Internationale en 1914, c’est que même quand ce problème se posait de front, on s’appliquait à le tourner ou on l’ignorait totalement.
D’une façon générale, on peut dire que la tendance à éluder la question de l’attitude de la révolution prolétarienne envers l’Etat, tendance avantageuse pour l’opportunisme qu’elle alimentait, a conduit à la déformation du marxisme et à son total avilissement.
Pour caractériser, ne fût-ce que brièvement, ce triste processus, considérons les théoriciens les plus en vue du marxisme : Plékhanov et Kautsky.
1. POLEMIQUE DE PLEKHANOV AVEC LES ANARCHISTES
Plékhanov a consacré à l’attitude de l’anarchisme envers le socialisme une brochure spéciale : Anarchisme et socialisme, parue en allemand en 1894.
Plékhanov a réussi le tour de force de traiter ce thème en éludant complètement la question la plus actuelle, la plus brûlante et, politiquement, la plus essentielle dans la lutte contre l’anarchisme, à savoir : l’attitude de la révolution envers l’Etat, et la question de l’Etat en général ! Sa brochure comprend deux parties : une partie historico-littéraire, renfermant une précieuse documentation sur l’évolution des idées de Stirner, de Proudhon, etc., l’autre, toute philistine, renferme des raisonnements du plus mauvais goût sur l’impossibilité de distinguer un anarchiste d’un bandit.
Cette combinaison de thèmes est archi-plaisante et archi-caractéristique de toute l’activité de Plékhanov à la veille de la révolution et pendant la période révolutionnaire en Russie. C’est bien ainsi que Plékhanov est apparu de 1905 à 1917 : mi-doctrinaire, mi-philistin, se traînant en politique à la remorque de la bourgeoisie.
On a vu que Marx et Engels, polémisant avec les anarchistes, ont mis surtout en relief, avec le plus grand soin, leurs propres vues sur l’attitude de la révolution à l’égard de l’Etat. Lorsqu’il publia en 1891 la Critique du programme de Gotha de Marx, Engels écrivit : "... nous (c’est-à-dire Engels et Marx) étions à ce moment, deux ans à peine après le Congrès de La Haye de l’Internationale[22] [la première], en plein bataille avec Bakounine et ses anarchistes".
Les anarchistes ont essayé de présenter précisément la Commune de Paris comme une chose, pour ainsi dire, "à eux", qui confirmait leur doctrine. Mais ils n’ont rien compris aux enseignements de la Commune, ni à l’analyse que Marx en a faite. Sur les questions politiques concrètes : faut-il briser la vieille machine d’Etat ? et par quoi la remplacer ? l’anarchisme n’a rien donné qui se rapproche, fût-ce approximativement, de la vérité.
Mais traiter du thème "anarchisme et socialisme" en éludant totalement la question de l’Etat, sans remarquer tout le développement du marxisme avant et après la Commune, c’était verser inévitablement dans l’opportunisme. Car ce qu’il faut surtout à l’opportunisme, c’est précisément que les deux questions que nous venons d’indiquer ne soient pas posées du tout. C’est déjà une victoire pour l’opportunisme.
2. POLEMIQUE DE KAUTSKY AVEC LES OPPORTUNISTES
La littérature russe possède sans aucun doute infiniment plus de traductions des oeuvres de Kautsky qu’aucune autre langue. Ce n’est pas sans raison que certains social-démocrates allemands disent en plaisantant que Kautsky est lu en Russie plus qu’en Allemagne (soit dit entre parenthèses, il y a, dans cette boutade, une vérité historique autrement plus profonde que ne le soupçonnent ceux qui l’ont lancée, savoir : ayant commandé en 1905 une quantité extrêmement élevée, sans précédent, des meilleures oeuvres de la meilleure littérature social-démocrate du monde, et ayant reçu un nombre inusité dans les autres pays de traductions et d’éditions de ces oeuvres, les ouvriers russes ont, pour ainsi dire, transplanté de la sorte à un rythme accéléré, sur le jeune sol de notre mouvement prolétarien, l’expérience considérable d’un pays voisin plus avancé).
Kautsky est connu chez nous par son exposé populaire du marxisme, et surtout pour sa polémique contre les opportunistes, Bernstein en tête. Il est cependant un fait à peu près ignoré, mais que l’on ne saurait passer sous silence si l’on s’assigne pour tâche d’analyser la façon dont Kautsky a pu glisser vers cette confusion d’idées incroyablement honteuse et vers la défense du social-chauvinisme au cours de la grande crise de 1914-1915. Ce fait, c’est qu’avant de s’élever contre les représentants les plus en vue de l’opportunisme en France (Millerand et Jaurès) et en Allemagne (Bernstein), Kautsky avait manifesté de très grands flottements. Le journal marxiste Zaria[23], qui parut de 1901 à 1902 à Stuttgart et qui défendait les idées prolétariennes révolutionnaires, avait du polémiquer avec Kautsky et traiter de "résolution-caoutchouc" la résolution bâtarde évasive et conciliatrice à l’égard des opportunistes qu’il avait proposée au Congrès socialiste international de Paris en 1900[24]. On a publié en Allemagne des lettres de Kautsky attestant de non moindres flottements avant son entrée en campagne contre Bernstein.
Chose infiniment plus grave encore : jusque dans sa polémique avec les opportunistes, dans sa manière de poser et de traiter le problème, nous constatons maintenant, en étudiant l’histoire de la récente trahison de Kautsky envers le marxisme, une déviation constante vers l’opportunisme, précisément dans la question de l’Etat.
Prenons le premier ouvrage important de Kautsky contre l’opportunisme, son livre Bernstein et le programme social-démocrate. Kautsky réfute minutieusement Bernstein. Mais voici qui est caractéristique.
Dans ses Prémisses du socialisme, oeuvre qui l’a rendu célèbre à la manière d’Erostrate, Bernstein accuse le marxisme de "blanquisme" (accusation mille fois reprise depuis lors par les opportunistes et les bourgeois libéraux de Russie contre les représentants du marxisme révolutionnaire, les bolchéviks). Ici, Bernstein s’arrête spécialement sur La Guerre Civile en France de Marx ; il tente, sans y réussir aucunement, comme on l’a vu, d’identifier le point de vue de Marx sur les enseignements de la Commune avec celui de Proudhon. Ce qui attire surtout l’attention de Bernstein, c’est la conclusion que Marx a soulignée dans la préface de 1872 au Manifeste Communiste, et où il est dit que "la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre la machine de l’Etat toute prête et de la faire fonctionner pour son propre compte".
Cette formule "plaît" tellement à Bernstein qu’il la répète au moins trois fois dans son livre, en l’interprétant dans un sens tout à fait déformé, opportuniste.
Comme on l’a vu, Marx veut dire que la classe ouvrière doit briser, démolir, faire sauter (Sprengung, explosion,- l’expression est d’Engels) toute la machine d’Etat. Or, d’après Bernstein, Marx aurait par ces mots mis en garde la classe ouvrière contre une ardeur trop révolutionnaire lors de la prise du pouvoir.
On ne saurait imaginer déformation plus grossière, plus scandaleuse, de la pensée de Marx.
Et comment Kautsky a-t-il procédé dans sa réfutation si minutieuse de cette "bernsteiniade" ?
Il s’est bien gardé d’analyser dans toute sa profondeur la déformation infligée sur ce point au marxisme par les opportunistes. Il a reproduit le passage cité plus haut de la préface d’Engels à La Guerre civile de Marx en affirmant que, d’après Marx, la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre la machine de l’Etat toute prête, mais qu’en général elle peut s’en emparer, et il n’a rien dit de plus. Que Bernstein ait attribué à Marx juste le contraire de sa pensée véritable, et que dès 1852 Marx ait assigné à la révolution prolétarienne la tâche de "briser" la machine d’Etat-de tout cela Kautsky ne souffle mot.
Il en résulte que ce qui distingue foncièrement le marxisme de l’opportunisme dans la question des tâches de la révolution prolétarienne se trouve escamoté par Kautsky !
"Nous pouvons en toute tranquillité, écrit Kautsky "contre" Bernstein, laisser à l’avenir le soin de résoudre le problème de la dictature du prolétariat" (p. 172 de l’édit. allemande).
Ce n’est pas là une polémique contre Bernstein ; c’est, au fond, une concession à ce dernier, une capitulation devant l’opportunisme ; car, pour le moment, les opportunistes ne demandent rien d’autre que de "laisser en toute tranquillité à l’avenir" les questions capitales relatives aux tâches de la révolution prolétarienne.
De 1852 à 1891, durant quarante années, Marx et Engels ont enseigné au prolétariat qu’il doit briser la machine d’Etat. Et Kautsky, en 1899, devant la trahison totale du marxisme par les opportunistes sur ce point, escamote la question de savoir s’il faut briser cette machine, en lui substituant celle des formes concrètes de cette démolition ; il se retranche derrière cette "incontestable" (et stérile) vérité philistine, que nous ne pouvons connaître à l’avance ces formes concrètes !
Un abîme sépare Marx et Kautsky dans leur attitude envers la tâche du parti prolétarien, qui est de préparer la classe ouvrière à la révolution. Prenons l’ouvrage suivant, plus mûri, de Kautsky, également consacré dans une notable mesure à la réfutation des erreurs de l’opportunisme. C’est sa brochure sur La Révolution sociale. L’auteur y a pris spécialement comme sujet les problèmes de la "révolution prolétarienne" et du "régime prolétarien". Il apporte quantité d’idées très précieuses, mais il omet justement le problème de l’Etat. Dans cette brochure, il est partout question de la conquête du pouvoir d’Etat, sans plus ; c’est-à-dire que l’auteur a choisi une formule qui est une concession aux opportunistes, puisqu’elle admet la conquête du pouvoir sans la destruction de la machine d’Etat. Kautsky ressuscite en 1902 précisément ce qu’en 1872 Marx déclarait "périmé" dans le programme du Manifeste Communiste.
La brochure consacre un chapitre particulier aux "formes et aux armes de la révolution sociale". On y traite et de la grève politique de masse, et de la guerre civile, et des "instruments de domination d’un grand Etat moderne, tels que la bureaucratie et l’armée" ; mais pas un mot sur les enseignements que la Commune a déjà fourni aux ouvriers. Ce n’est certes pas par hasard qu’Engels mettait en garde les socialistes allemands, plus que quiconque, contre la "vénération superstitieuse" de l’Etat.
Kautsky présente la chose ainsi : le prolétariat victorieux "réalisera le programme démocratique" ; suit l’exposé des articles de ce programme. Quant à ce que 1871 a donné de nouveau touchant le remplacement de la démocratie bourgeoise par la démocratie prolétarienne, pas un mot. Kautsky se réfugie dans des banalités d’apparence "sérieuse", comme celle-ci :
"Il va de soi que nous n’arriverons pas au pouvoir dans les conditions du régime actuel. La révolution elle-même suppose des luttes de longue haleine, d’une grande profondeur, qui auront eu le temps de modifier notre structure politique et sociale actuelle."
Cela "va de soi" assurément, et comme il est vrai aussi que les chevaux mangent de l’avoine et que la Volga se jette dans la mer Caspienne. Il est seulement à regretter qu’à l’aide d’une phrase creuse et ronflante sur la lutte "d’une grande profondeur", on élude une question vitale pour le prolétariat révolutionnaire, celle de savoir en quoi consiste la "profondeur" de sa révolution par rapport à l’Etat et à la démocratie, à la différence des révolutions antérieures non prolétariennes.
En éludant cette question, Kautsky fait en réalité sur ce point capital une concession à l’opportunisme, il lui déclare une guerre redoutable en paroles, souligne l’importance de "l’idée de révolution" (mais que peut bien valoir cette "idée" lorsqu’on a peur de propager parmi les ouvriers les enseignements concrets de la révolution ?), ou bien il dit : "L’idéalisme révolutionnaire avant tout", ou bien il proclame qu’aujourd’hui les ouvriers anglais ne sont "guère plus que des petits bourgeois".
"Dans la société socialiste, écrit Kautsky, peuvent coexister... les formes les plus variées d’entreprises : bureaucratiques(??), trade-unionistes, coopératives, individuelles... il y a, par exemple, des entreprises qui ne peuvent pas se passer d’une organisation bureaucratique(??), tels les chemins de fer. Ici, l’organisation démocratique peut revêtir l’aspect suivant : les ouvriers éliraient des délégués, qui formeraient une sorte de Parlement ayant pour mission d’établir le régime de travail et de surveiller le fonctionnement de l’appareil bureaucratique. D’autres exploitations peuvent être confiées aux syndicats ouvriers ; d’autres encore peuvent être fondées sur le principe de la coopération" (pp. 148 et 115 de la trad. russe, publiée à Genève en 1903).
Cette façon de voir est erronée ; elle marque un recul par rapport aux éclaircissements que Marx et Engels donnaient entre 1870 et 1880, en s’inspirant des enseignements de la Commune.
En ce qui concerne la nécessité d’une organisation prétendument "bureaucratique", les chemins de fer ne se distinguent rigoureusement en rien de toutes les entreprises de la grande industrie mécanisée en général, de n’importe quelle usine, d’un grand magasin, d’une grande exploitation agricole capitaliste. Dans toutes ces entreprises, la technique prescrit une discipline absolument rigoureuse, la plus grande ponctualité dans l’accomplissement de la part de travail assignée à chacun, sous peine d’arrêt de toute l’entreprise ou de détérioration des mécanismes, du produit fabriqué. Dans toutes ces entreprises, évidemment, les ouvriers "éliront des délégués qui formeront une sorte de Parlement".
Mais le grand point ici, c’est que cette "sorte de Parlement" ne sera pas un parlement dans le sens des institutions parlementaires bourgeoises. Le grand point ici, c’est que cette "sorte de Parlement" ne se contentera pas "d’établir le régime de travail et de surveiller le fonctionnement de l’appareil bureaucratique", comme se l’imagine Kautsky dont la pensée ne dépasse pas le cadre du parlementarisme bourgeois. Il est certain qu’en société socialiste une "sorte de Parlement" composé de députés ouvriers "déterminera le régime de travail et surveillera le fonctionnement" de "l’appareil", mais cet appareil-là ne sera pas "bureaucratique". Les ouvriers, après avoir conquis le pouvoir politique, briseront le vieil appareil bureaucratique, le démoliront jusqu’en ses fondements, n’en laisseront pas pierre sur pierre et le remplaceront par un nouvel appareil comprenant ces mêmes ouvriers et employés. Pour empêcher ceux-ci de devenir des bureaucrates, on prendra aussitôt des mesures minutieusement étudiées par Marx et Engels : 1. électivité, mais aussi révocabilité à tout moment ; 2. un salaire qui ne sera pas supérieur à celui d’un ouvrier ; 3. adoption immédiate de mesures afin que tous remplissent des fonctions de contrôle et de surveillance, que tous deviennent pour un temps "bureaucrates" et que, de ce fait, personne ne puisse devenir "bureaucrate".
Kautsky n’a pas du tout réfléchi au sens de ces mots de Marx : "La Commune était non pas un organisme parlementaire, mais un corps agissant, exécutif et législatif à la fois."
Kautsky n’a absolument pas compris la différence entre le parlementarisme bourgeois - qui unit la démocratie (pas pour le peuple) à la bureaucratie (contre le peuple) - et le démocratisme prolétarien, qui prendra immédiatement des mesures pour couper le bureaucratisme à la racine et qui sera à même de les appliquer jusqu’au bout, jusqu’à la destruction complète du bureaucratisme, jusqu’à l’établissement complet d’une démocratie pour le peuple.
Kautsky a fait preuve ici, comme tant d’autres, d’un "respect superstitieux" envers l’Etat, d’une "vénération superstitieuse" du bureaucratisme.
Passons au dernier et meilleur ouvrage de Kautsky contre les opportunistes, à sa brochure Le Chemin du pouvoir (il semble qu’elle n’ait pas été éditée en russe, car elle parut en 1909, au plus fort de la réaction en Russie). Cette brochure marque un grand progrès, puisqu’elle ne traite ni du programme révolutionnaire en général, comme la brochure de 1899 dirigée contre Bernstein, ni des tâches de la révolution sociale indépendamment de l’époque de son avènement, comme la brochure La Révolution sociale de 1902, mais des conditions concrètes qui nous obligent à reconnaître que "l’ère des révolutions" commence.
L’auteur parle explicitement de l’aggravation des contradictions de classe en général et de l’impérialisme, lequel joue à cet égard un rôle particulièrement important. Après la "période révolutionnaire de 1789 à 1871" pour l’Europe occidentale, l’année 1905 inaugure une période analogue pour l’Est. La guerre mondiale approche avec une rapidité redoutable. "Il ne saurait plus être question, pour le prolétariat, d’une révolution prématurée." "Nous sommes entrés dans la période révolutionnaire." "L’ère révolutionnaire commence".
Déclarations parfaitement claires. Cette brochure de Kautsky permet de comparer ce que la social-démocratie allemande promettait d’être avant la guerre impérialiste et jusqu’où elle est tombée (et Kautsky avec elle) après que la guerre eut éclaté. "La situation actuelle, écrivait Kautsky dans la brochure analysée, comporte un danger : c’est qu’on peut aisément nous prendre (nous, social-démocrates allemands) pour plus modérés que nous ne sommes en réalité." Il est apparu que le Parti social-démocrate allemand était en réalité infiniment plus modéré et plus opportuniste qu’il ne le paraissait !
Il est d’autant plus caractéristique qu’après avoir proclamé si catégoriquement que l’ère des révolutions était ouverte, Kautsky, dans une brochure pourtant spécialement consacrée, comme il le dit lui-même à l’analyse du problème de la "révolution politique", laisse de nouveau complètement de côté la question de l’Etat.
Toutes ces tentatives pour tourner la question, tous ces silences et réticences ont eu pour résultat inévitable ce ralliement complet à l’opportunisme dont nous allons parler ci-après.
La social-démocratie allemande semblait proclamer par la bouche de Kautsky : je garde mes conceptions révolutionnaires (1899) ; je reconnais notamment que la révolution sociale du prolétariat est inévitable (1902), je reconnais qu’une nouvelle ère de révolutions s’est ouverte (1909). Mais dès l’instant où se pose la question des tâches de la révolution prolétarienne à l’égard de l’Etat, j’opère un recul par rapport à ce que Marx disait déjà en 1852 (1912).
C’est ainsi que la question s’est posée de front lors de la polémique de Kautsky avec Pannekoek.
3. POLEMIQUE DE KAUTSKY AVEC PANNEKOEK
Pannekoek, adversaire de Kautsky, était l’un des représentants de la tendance "radicale de gauche", qui comptait dans ses rangs Rosa Luxembourg, Karl Radek, d’autres encore. Préconisant la tactique révolutionnaire, ils s’accordaient à reconnaître que Kautsky adoptait une position "centriste", dénuée de principes, et oscillait entre le marxisme et l’opportunisme. La justesse de cette appréciation a été pleinement démontrée par la guerre, lorsque la tendance dite "du centre" (appelée à tort marxiste) ou "kautskiste" s’est révélée dans toute sa hideuse indigence.
Dans son article "L’action de masse et la révolution" (Neue Zeit, 1912, XXX, 2), qui traite, entre autres, du problème de l’Etat, Pannekoek définissait la position de Kautsky comme un "radicalisme passif", comme une "théorie de l’attente inactive". "Kautsky ne veut pas voir le processus de la révolution" (p. 616). En posant ainsi la question, Pannekoek a abordé le sujet qui nous intéresse : les tâches de la révolution prolétarienne à l’égard de l’Etat.
"La lutte du prolétariat, écrivait-il, n’est pas simplement une lutte contre la bourgeoisie pour le pouvoir d’Etat ; c’est aussi une lutte contre le pouvoir d’Etat... La révolution prolétarienne consiste à anéantir les instruments de la force de l’Etat et à les éliminer (Auflösung, littéralement : dissoudre) par les instruments de la force du prolétariat... La lutte ne cesse qu’au moment où le résultat final est atteint, au moment où l’organisation d’Etat est complètement détruite. L’organisation de la majorité prouve sa supériorité en anéantissant l’organisation de la minorité dominante" (p. 548).
La formule dont Pannekoek a revêtu sa pensée souffre de très graves défauts. Néanmoins, l’idée est claire, et il est intéressant de voir comment Kautsky a cherché à la réfuter.
"Jusqu’ici, a-t-il écrit, l’opposition entre les social-démocrates et les anarchistes consistait en ce que les premiers voulaient conquérir le pouvoir d’Etat, et les seconds le détruire. Pannekoek veut l’un et l’autre" (p. 724).
L’exposé de Pannekoek manque de clarté et de précision (sans compter les autres défauts de son article, qui ne se rapportent pas au sujet traité) ; mais Kautsky a pris la question de principe soulevée par Pannekoek et, dans cette question de principe capitale, il abandonne tout à fait les positions du marxisme pour passer entièrement à l’opportunisme. La distinction qu’il établit entre social-démocrates et anarchistes est complètement erronée ; le marxisme est définitivement dénaturé et avili.
Voici ce qui distingue les marxistes des anarchistes : 1° Les premiers, tout en se proposant de supprimer complètement l’Etat, ne croient la chose réalisable qu’après la suppression des classes par la révolution socialiste, comme résultat de l’instauration du socialisme qui mène à la disparition de l’Etat, les seconds veulent la suppression complète de l’Etat du jour au lendemain, sans comprendre les conditions qui la rendent possible. 2° Les premiers proclament la nécessité pour le prolétariat, après qu’il aura conquis le pouvoir politique, de détruire entièrement la vieille machine d’Etat et de la remplacer par une nouvelle, qui consiste dans l’organisation des ouvriers armés, sur le modèle de la Commune ; les seconds, tout en plaidant pour la destruction de la machine d’Etat, ne se représentent que très confusément par quoi le prolétariat la remplacera et comment il usera du pouvoir révolutionnaire ; les anarchistes vont jusqu’à repousser l’utilisation du pouvoir d’Etat par le prolétariat révolutionnaire, jusqu’à repousser la dictature révolutionnaire. 3° Les premiers veulent que le prolétariat se prépare à la révolution en utilisant l’Etat moderne ; les anarchistes sont contre cette façon de faire.
Dans cette discussion, c’est Pannekoek qui représente le marxisme contre Kautsky, car Marx a précisément enseigné que le prolétariat ne peut pas se contenter de conquérir le pouvoir d’Etat (en ce sens que le vieil appareil d’Etat ne doit pas passer simplement en d’autres mains), mais qu’il doit briser, démolir cet appareil et le remplacer par un nouveau.
Kautsky abandonne le marxisme pour l’opportunisme, car il escamote tout à fait précisément cette destruction de la machine d’Etat, absolument inacceptable pour les opportunistes, et laisse ainsi à ces derniers une échappatoire qui leur permet d’interpréter la "conquête" comme une simple acquisition de la majorité.
Afin de dissimuler cette déformation du marxisme, Kautsky agit en bon glossateur : il y va d’une "citation" de Marx lui-même. Marx affirmait en 1850 la nécessité d’une "centralisation résolue de la force entre les mains de l’Etat". Et Kautsky de triompher : Pannekoek ne voudrait-il pas détruire le "centralisme" ?
Simple tour de passe-passe, qui rappelle celui de Bernstein identifiant le marxisme et le proudhonisme dans leurs vues sur la fédération considérée comme préférable au centralisme.
La "citation" de Kautsky vient comme un cheveux sur la soupe. Le centralisme est possible avec la vieille machine d’Etat comme avec la nouvelle. Si les ouvriers unissent librement leurs forces armées, ce sera du centralisme, mais celui-ci reposera sur la "destruction complète" de l’appareil d’Etat centraliste, de l’armée permanente, de la police, de la bureaucratie. Kautsky agit d’une façon tout à fait malhonnête en éludant les considérations bien connues de Marx et d’Engels sur la Commune pour aller déterrer une citation qui n’a rien à voir avec la question.
"Peut-être Pannekoek voudra-t-il supprimer les fonctions publiques des fonctionnaires ? poursuit Kautsky. Mais nous ne nous passons de fonctionnaires ni dans l’organisation du parti ni dans celle des syndicats, sans parler des administrations de l’Etat. Notre programme demande non pas la suppression des fonctionnaires de l’Etat, mais leur élection par le peuple... Il s’agit maintenant chez nous non de savoir quelle forme revetira l’appareil administratif dans "l’Etat futur", mais de savoir si notre lutte politique détruira (auflöst, littéralement : dissoudra) le pouvoir de l’Etat avant que nous l’ayons conquis [souligné par Kautsky]. Quel est le ministère avec ses fonctionnaires qui pourrait être détruit ?" Il énumère les ministères de l’Instruction publique, de la Justice, des Finances, de la Guerre. "Non, pas un des ministères actuels ne sera supprimé par notre lutte politique contre le gouvernement... Je le répète, pour éviter les malentendus : il ne s’agit pas de savoir quelle forme la social-démocratie victorieuse donnera à "l’Etat futur", il s’agit de savoir comment notre opposition transformera l’Etat actuel" (p. 725)
C’est là un véritable escamotage. Pannekoek posait le problème précis de la révolution. Le titre de son article et les passages cités le disent clairement. En sautant à la question de "l’opposition", Kautsky ne fait que substituer au point de vue révolutionnaire le point de vue opportuniste. Son raisonnement se ramène à ceci : maintenant, opposition ; après la conquête du pouvoir, on avisera. La révolution disparaît ! C’est exactement ce que demandaient les opportunistes.
Il ne s’agit ni de l’opposition, ni de la lutte politique en général, mais précisément de la Révolution. La révolution consiste en ceci : le prolétariat détruit "l’appareil administratif" et l’appareil d’Etat tout entier pour le remplacer par un nouveau, qui est constitué par les ouvriers armés. Kautsky montre une "vénération superstitieuse" pour les "ministères" ; mais pourquoi ne pourraient-ils pas être remplacés, mettons par des commissions de spécialistes auprès des Soviet souverains et tout-puissants de députés ouvriers et soldats ?
L’essentiel n’est point de savoir si les "ministères" subsisteront ou s’ils seront remplacés par des "commissions de spécialistes", ou par d’autres organismes : cela n’a absolument aucune importance. L’essentiel est de savoir si la vieille machine d’Etat (liée à la bourgeoisie par des milliers d’attaches et toute pénétrée de routine et de conservatisme) sera maintenue ou si elle sera détruite et remplacée par une nouvelle. La révolution ne doit pas aboutir à ce que la classe nouvelle commande et gouverne à l’aide de la vieille machine d’Etat, mais à ceci, qu’après l’avoir brisée, elle commande à l’aide d’une machine nouvelle : c’est cette idée fondamentale du marxisme que Kautsky escamote ou qu’il n’a absolument pas comprise.
Sa question relative aux fonctionnaires montre de toute évidence qu’il n’a compris ni les enseignements de la Commune ni la doctrine de Marx. "Nous ne nous passons de fonctionnaires ni dans l’organisation du parti, ni dans celle des syndicats"...
Nous ne nous passons pas de fonctionnaires en régime capitaliste, sous la domination de la bourgeoisie. Le prolétariat est opprimé, les masses laborieuses sont asservies par le capitalisme. En régime capitaliste, la démocratie est rétrécie, comprimée, tronquée, mutilée par cette ambiance que créent l’esclavage salarié, le besoin et la misère des masses.
C’est pour cette raison, et seulement pour cette raison, que dans nos organisations politiques et syndicales les fonctionnaires sont corrompus (ou plus exactement ont tendance à l’être) par l’ambiance capitaliste et manifestent une tendance à se transformer en bureaucrates, c’est-à-dire en personnages privilégiés, coupés des masses et placés au-dessus d’elles.
Là est l’essence du bureaucratisme. Et tant que les capitalistes n’auront pas été expropriés, tant que la bourgeoisie n’aura pas été renversée, une certaine "bureaucratisation" des fonctionnaires du prolétariat eux-mêmes est inévitable.
Kautsky dit en somme ceci : puisqu’il subsistera des employés publics élus, il y aura donc aussi en régime socialiste des fonctionnaires et une bureaucratie ! C’est précisément ce qui est faux. Précisément par l’exemple de la Commune, Marx a montré que les titulaires des fonctions publiques cessent, en régime socialiste, d’être des "bureaucrates", "fonctionnaires" au fur et à mesure que, sans parler de leur électivité, on établit en outre leur révocabilité à tout moment, qu’on réduit en outre leur traitement à un salaire moyen d’ouvrier, et qu’en plus on remplace les organismes parlementaires par des corps "agissants", "exécutifs et législatifs à la fois".
Au fond, toute l’argumentation de Kautsky contre Pannekoek, et surtout cet argument admirable que dans les organisations syndicales, pas plus que dans celles du parti, nous ne pouvons nous passer de fonctionnaires, attestent que Kautsky reprend les vieux "arguments" de Bernstein contre le marxisme en général. Dans son livre de renégat Les Prémisses du socialisme, Bernstein part en guerre contre l’idée de démocratie "primitive", contre ce qu’il appelle le "démocratisme doctrinaire" : mandats impératifs, fonctionnaires non rétribués, représentation centrale sans pouvoir, etc. Afin de prouver la carence de cette démocratie "primitive", Bernstein invoque l’expérience des trade-unions anglaises, interprétée par les époux Webb. Au cours des soixante-dix années de leur développement, les trade-unions, qui auraient soi-disant évolué "en pleine liberté" (p. 137 de l’édit. allemande), se seraient convaincues de l’inefficacité de la démocratie primitive et l’auraient remplacée par l’habituel parlementarisme allié au bureaucratisme.
En fait, les trade-unions n’ont pas évolué "en pleine liberté" mais en plein esclavage capitaliste, où, certes, l’on "ne saurait éviter" les concessions au mal régnant, à la violence, au mensonge, à l’élimination des pauvres de l’administration "supérieure". En régime socialiste, bien des aspects de la démocratie "primitive" revivront nécessairement, car, pour la première fois dans l’histoire des sociétés civilisées, la masse de la population se haussera à une participation autonome, non seulement aux votes et aux élections, mais encore à l’administration journalière. En régime socialiste, tout le monde gouvernera à tour de rôle et s’habituera vite à ce que personne ne gouverne.
Avec son génial esprit d’analyse et de critique, Marx a vu dans les mesures pratiques de la Commune ce tournant que craignent tant et ne veulent pas reconnaître les opportunistes, par lâcheté et parce qu’ils se refusent à rompre définitivement avec la bourgeoisie ; que ne veulent pas voir les anarchistes, soit qu’ils se hâtent trop, soit qu’en général ils ne comprennent pas les conditions dans lesquelles s’opèrent les grandes transformations sociales. "Il ne faut même pas songer à détruire la vieille machine d’Etat : comment pourrions-nous nous passer des ministères et des fonctionnaires ?" raisonne l’opportuniste imbu de philistinisme et qui au fond, loin de croire à la révolution et à sa puissance créatrice, en a une peur mortelle (comme en ont peur nos menchéviks et nos socialistes-révolutionnaires).
"Il faut penser uniquement à la destruction de la vieille machine d’Etat ; inutile d’approfondir les enseignements concrets des révolutions prolétariennes antérieures, et d’analyser par quoi et comment remplacer ce que l’on détruit", raisonne l’anarchiste (le meilleur des anarchistes, naturellement, et non celui qui, à la suite des Kropotkine et consorts, se traîne derrière la bourgeoisie) ; c’est pourquoi l’anarchiste en arrive à la tactique du désespoir, et non à une activité révolutionnaire concrète, intrépide, inexorable, mais qui tient compte en même temps des conditions pratiques du mouvement des masses.
Marx nous apprend à éviter ces deux erreurs : il nous apprend à faire preuve de la plus grande audace dans la destruction totale de la vieille machine d’Etat ; il nous enseigne d’autre part à poser le problème d’une façon concrète : la Commune a pu, en quelques semaines, commencer à construire une machine d’Etat nouvelle, prolétarienne, procédant de telle et telle façon, en prenant les mesures précitées tendant à assurer une plus grande démocratie et à extirper le bureaucratisme. Apprenons donc des communards l’audace révolutionnaire, tâchons de voir dans leurs mesures pratiques une esquisse des mesures pratiquement urgentes et immédiatement réalisables ; c’est ainsi que nous parviendrons, en suivant cette voie, à détruire complètement le bureaucratisme.
Ce qui garantit la possibilité de cette destruction, c’est que le socialisme réduira la journée de travail, élèvera les masses à une vie nouvelle, placera la majeure partie de la population dans des conditions permettant à tous, sans exception, de remplir les "fonctions publiques". Et c’est ce qui conduira à l’extinction complète de tout Etat en général.
"Le rôle de la grève de masse, poursuit Kautsky, ne peut jamais être de détruire le pouvoir d’Etat, mais seulement d’amener le gouvernement à des concessions sur une question donnée, ou de remplacer un gouvernement hostile au prolétariat par un gouvernement allant au-devant (entgegenkommende) des besoins du prolétariat... Mais jamais et en aucun cas, cela [c’est-à-dire la victoire du prolétariat sur le gouvernement hostile] ne peut mener à la destruction du pouvoir d’Etat ; il ne peut en résulter qu’un qu’un certain déplacement (Verschiebung) du rapport des forces à l’intérieur du pouvoir d’Etat... le but de notre lutte politique reste donc, comme par le passé, la conquête du pouvoir d’Etat par l’acquisition de la majorité au Parlement et la transformation de ce dernier en maître du gouvernement" (pp. 726, 727, 732).
Voilà bien l’opportunisme le plus pur et le plus plat ; c’est renoncer en fait à la révolution tout en la reconnaissant en paroles. La pensée de Kautsky ne va pas au-delà d’un "gouvernement allant au-devant des besoins du prolétariat", c’est un pas en arrière vers le philistinisme par rapport à 1847, quand le Manifeste Communiste proclamait "l’organisation du prolétariat en classe dominante".
Kautsky en sera réduit à réaliser "l’unité" qu’il chérit avec les Scheidemann, les Plékhanov, les Vandervelde, tous unanimes à lutter pour un gouvernement "allant au-devant des besoins du prolétariat".
Quant à nous, nous romprons avec ces renégats du socialisme et lutterons pour la destruction de toute la vieille machine d’Etat, afin que le prolétariat armé devienne lui-même le gouvernement. Ce sont "deux grandes différences".
Kautsky restera dans l’agréable compagnie des Legien et des David, des Plékhanov, des Potressov, des Tsérétéli et des Tchernov, qui ne demandent pas mieux que de lutter pour un "déplacement du rapport de forces à l’intérieur du pouvoir d’Etat", pour "l’acquisition de la majorité au Parlement et la transformation de ce dernier en maître du gouvernement", but des plus nobles où tout peut être accepté par les opportunistes, où rien ne sort du cadre de la république bourgeoise parlementaire.
Quant à nous, nous romprons avec les opportunistes ; et le prolétariat conscient sera tout entier avec nous dans la lutte, non pour un "déplacement du rapport de forces", mais pour le renversement de la bourgeoisie, pour la destruction du parlementarisme bourgeois, pour une république démocratique du type de la Commune ou une République des Soviets des députés ouvriers et soldats, pour la dictature révolutionnaire du prolétariat.
Le socialisme international comprend des courants qui se situent plus à droite que celui de Kautsky : les Cabiers socialistes mensuels[25] en Allemagne (Legien, David, Kolbe et bien d’autres, y compris les Scandinaves Stauning et Branting) ; les jauressistes et Vandervelde en France et en Belgique ; Turati, Trèves et les autres représentants de l’aile droite du parti italien ; les fabiens et les "indépendants" ("l’Independant Labour Party" qui, en réalité, fut toujours sous la dépendance des libéraux) en Angleterre[26], etc... Tous ces messieurs, qui jouent un rôle considérable et très souvent prépondérant dans l’activité parlementaire et dans les publications du parti, rejettent ouvertement la dictature du prolétariat et pratiquent un opportunisme non déguisé. Pour ces messieurs, la "dictature" du prolétariat "contredit" la démocratie !! Au fond, rien de sérieux ne les différencie des démocrates petits-bourgeois.
Dès lors, nous sommes en droit de conclure que la IIe Internationale, dans l’immense majorité de ses représentants officiels, a entièrement versé dans l’opportunisme. L’expérience de la Commune a été non seulement oubliée, mais dénaturée. Loin d’inculquer aux masses ouvrières la conviction que le moment approche où il leur faudra agir et briser la vieille machine d’Etat en la remplaçant par une nouvelle et en faisant ainsi de leur domination politique la base de la transformation socialiste de la société,-on leur suggérait tout le contraire, et la "conquête du pouvoir" était présentée de telle façon que mille brèches restaient ouvertes à l’opportunisme.
La déformation et la conjuration du silence autour du problème de l’attitude de la révolution prolétarienne envers l’Etat ne pouvaient manquer de jouer un rôle considérable au moment où les Etats, pourvus d’un appareil militaire renforcé par suite de la compétition impérialiste, sont devenus des monstres belliqueux exterminant des millions d’hommes afin de décider qui, de l’Angleterre ou de l’Allemagne, du capital financier anglais ou du capital financier allemand, régnera sur le monde.
CHAPITRE VII
L’EXPERIENCE DES REVOLUTIONS RUSSES DE 1905 ET DE 1917
Le sujet indiqué dans le titre de ce chapitre est si vaste qu’on pourrait et devrait lui consacrer des volumes. Dans la présente brochure il nous faudra naturellement nous borner aux leçons les plus importantes de l’expérience acquise, qui concernent directement les tâches du prolétariat à l’égard du pouvoir d’Etat au cours de la révolution." (Ici s’arrête le manuscrit - Note de la rédaction.)
POSTFACE DE LA PREMIERE EDITION
La présente brochure a été rédigée en août et en septembre 1917. J’avais déjà arrêté le plan du chapitre suivant, le VIIe : "L’expérience des révolutions russes de 1905 et 1917". Mais, en dehors du titre, je n’ai pas eu le temps d’écrire une seule ligne de ce chapitre, "empêché" que je fus par la crise politique qui a marqué la veille de la Révolution d’Octobre 1917. On ne peut que se réjouir d’un tel "empêchement". Mais le second fascicule de cette brochure (consacrée à L’expérience des révolutions russes de 1905 et 1917) devra sans doute être remis à beaucoup plus tard ; il est plus agréable et plus utile de faire "l’expérience d’une révolution" que d’écrire à son sujet.
L’auteur, Pétrograd, 30 novembre 1917.
Ecrit en août-septembre 1917. Paru en brochure en 1918 aux Editions "Jizn i Znanié". Conforme au texte de la brochure parue aux Editions "Kommunist" en 1919, confronté avec le manuscrit et l’édition de 1918.