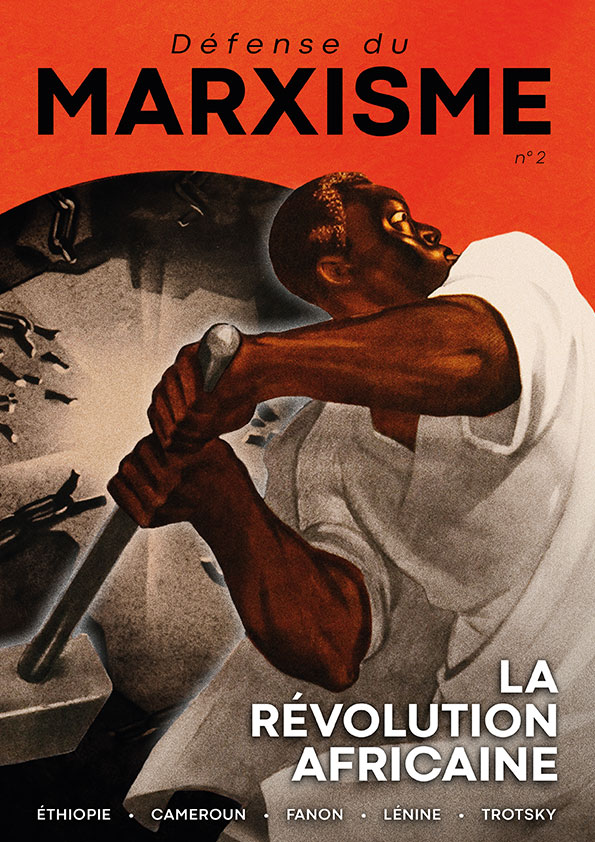Bucarest, mai 1915. Mon cher Camarade et Ami,
Des circonstances indépendantes de ma volonté ont retardé ma réponse. Cette fois encore, en commençant ma lettre, j’ai failli l’interrompre pour attendre votre brochure sur les conditions de la paix future, dont les agences allemandes annoncent, en même temps que l’apparition, la critique faite par le Vorwärts. Seule la crainte de voir survenir de nouveaux événements, qui interrompraient définitivement les communications déjà si difficiles entre la France et la Roumanie, m’a déterminé à le faire sans plus tarder.
En laissant pour la fin de ma réponse les questions de fait, comme celle de notre prétendu germanophilisme, je tiens, dès le commencement, à vider le différend théorique qui existe entre nous. Vous le reconnaissez vous-même quand vous déclarez explicitement que ce qui nous sépare actuellement ce n’est pas l’appréciation différente de tel ou tel événement, mais une conception différente de notre tactique socialiste.
Différences de théorie et de tactique Dans mon interview, publiée dans l’Humanité du 17 mars, où j’affirme que « les raisons d’ordre socialiste restent déterminantes pour l’attitude des socialistes des pays neutres », vous avez vu, et avec raison, un reproche adressé aux socialistes des pays belligérants - donc aussi à vous socialistes français - de ne plus obéir aux mêmes principes que nous.
Saisissant cette critique dans toute sa gravité, vous essayez, au commencement même de votre lettre, de la rejeter. Vous écrivez : « Il ne m’en apparaît pas moins qu’entre votre conception et la nôtre il y a des différences essentielles et d’autant plus graves que vous basez votre neutralité sur les principes et que nous, socialistes français, qui avons la certitude de n’avoir, dans cette tourmente, ni perdu la tête, ni abdiqué quoi que ce soit de nos principes, nous avons la prétention justement d’avoir basé notre attitude sur ces mêmes principes et sur l’intérêt socialiste. »
Je remarque ici même que ce n’est pas sans une certaine inquiétude que je vois apparaître sous votre plume ce terme nouveau dans le langage de nos discussions l’intérêt socialiste.
Jusqu’à présent, l’intérêt socialiste se confondant avec l’application des principes socialistes, il n’était pas nécessaire qu’on lui fit les honneurs d’une citation spéciale. Ce n’est que le jour où les socialistes des pays belligérants ont trouvé que les principes seuls ne constituent pas un guide sûr, mais sont plutôt un guide gênant, qu’ils ont appelé à leur secours l’intérêt socialiste, différent des principes socialistes, et même en contradiction avec ces principes.
Nous allons discuter plus loin les motifs que vous invoquez pour votre justification et dont je reconnais d’avance toute la gravité ; nous allons voir aussi si votre tactique, en sacrifiant les principes, peut au moins se flatter d’être profitable à la classe ouvrière en France et à la cause du socialisme - nous allons discuter tout cela, mais au prés. Table je tiens à établir que vous employez une tactique nouvelle en contradiction évidente avec celle que vous avez suivie jusqu’à présent.
En ce qui concerne les socialistes allemands - dans leur majorité, tout au moins - vous constatez vous-même ce fait en leur adressant un juste reproche ; je ne discuterai pas cette question, étant d’accord avec vous.
Mais vous aussi, vous avez violé les règles établies par notre Internationale socialiste dans ses successifs Congrès nationaux et internationaux.
Ne dites-vous pas vous-même, dans votre lettre, que vous étiez avec nous hier, que vous serez avec nous demain, mais qu’aujourd’hui vous n’êtes pas avec nous ? Or nous, c’est l’Internationale socialiste, telle qu’elle se manifestait dans ses résolutions. Nous, c’est-à-dire les partis socialistes des pays neutres, nous sommes, aujourd’hui, sur le même terrain sur lequel nous nous trouvions hier et que nous conserverons demain, même si nos pays étaient entraînés dans la guerre.
Je puis admettre qu’en faisant ce que l’Humanité a appelé la trêve des classes et ce que les socialistes allemands ont appelé, chez eux, la paix civile, vous avez eu les meilleures intentions socialistes, et que vous avez cru défendre les vrais intérêts du socialisme, mais il n’en reste pas moins vrai qu’aujourd’hui, comme à un ballottage quand le candidat socialiste, ayant obtenu moins de voix s’efface devant le candidat de la fraction bourgeoise la plus avancée, le parti socialiste français s’est effacé devant l’impérialisme français aux prises avec l’impérialisme allemand.
Voilà le fait incontestable.
La question qui se pose est de savoir si cette tactique nouvelle est vraiment profitable aux luttes du prolétariat.
Doit-on admettre comme inévitable et utile cette éclipse volontaire et complète du socialisme, devant les nuages de la guerre ?
Doit-on considérer cet événement grave qu’est la guerre comme un incident électoral, pendant lequel le socialisme doit rester passif ?
Comment ! Au moment même où la responsabilité des classes dominantes éclate dans toute sa grandeur sinistre ; au moment où leurs fautes et leurs crimes accumulés aboutissent au fait le plus monstrueux, le plus antisocialiste et antiouvrier, devons-nous plier drapeau et renoncer à notre tâche, d’organisateurs de la lutte des classes ?
Oui, je comprends bien que dans l’accomplissement de cette tâche nous devrons mettre toute notre perspicacité, pour ne pas servir l’ennemi extérieur du socialisme ; je comprends que nous devrons prendre nos précautions, faire nos réserves, mais d’ici à abdiquer notre volonté socialiste il y a une distance énorme.
Or, dans l’entrée des deux camarades socialistes dans le ministère Viviani nous voyons précisément cette abdication du parti socialiste en France.
L’entrée des socialistes dans le ministère. - Résolution de Kautsky. - Résolution de Stuttgart Je sais que vous pouvez vous prévaloir de la résolution du Congrès international de Paris de 1900, résolution dite de Kautsky qui autorisait, dans des circonstances exceptionnelles, l’entrée des socialistes dans un ministère bourgeois. Comme Kautsky l’a expliqué lui-même, plus tard, à Amsterdam, sous le terme de « circonstances exceptionnelles », il entendait justement « l’hypothèse d’une guerre d’invasion ».
Mais, voulez-vous vraiment invoquer cette résolution ? Il faut vous rappeler alors que la résolution de Kautsky fut votée contre la volonté de l’unité socialiste révolutionnaire de France, dont les citoyens Guesde et Vaillant étaient les inspirateurs les plus écoutés.
Il faut vous rappeler également que la résolution de Kautsky était une concession faite au ministérialisme socialiste qui avait, en ce moment, un défenseur redoutable en la personne de Jaurès, dont l’autorité personnelle, déjà grande avant l’Affaire, était devenue immense après elle. Par son prestige personnel et par l’éloquence de sa parole ardente, Jaurès a désarmé l’Internationale, mais sans la convaincre. Ceux qui condamnaient ses idées sentaient leurs langues se paralyser quand il était question de le critiquer.
Je n’oublierai jamais une scène intéressante qui se passa à la Commission des résolutions.
Au lendemain du vote de la résolution de Kautsky, Jaurès s’était empressé de triompher dans la Petite République et ceci malgré la consigne formelle qui interdisait aux socialistes français de se servir de la résolution de Kautsky comme d’une arme, dans leurs luttes intestines. D’après le texte même de la résolution, celle-ci ne pouvait pas être interprétée comme la justification d’une tactique quelconque. C’est pourquoi, après l’apparition de l’article de Jaurès dans la Petite République, quelques délégués, parmi lesquels Kautsky lui-même, Plékhanov , Rosa Luxembourg, Clara Zetkin, etc.., ont demandé la convocation, en séance extraordinaire, de la Commission des résolutions, pour remettre les choses au point. C’est Plékhanov qui en prenant le premier la parole, a demandé, au nom de ses camarades, que la Commission votât un ordre du jour exprimant son regret de l’usage que Jaurès avait fait de cette résolution. Mais sur la seule déclaration de celui-ci, qu’il n’entendait pas se considérer lié par des consignes et qu’il revendiquait la liberté d’interprétation, les initiateurs de la réunion renoncèrent à leur projet. Une autre proposition tendant au vote d’un ordre du jour faisant mention de l’objet pour lequel la commission avait été convoquée, n’a même pas été mise au vote par le citoyen Vandervelde, qui présidait la séance.
Je rappelle ces faits, que Guesde certainement connaît, quoiqu’il n’ait pas assisté à cette séance de la Commission, pour vous montrer que vous ne pourriez pas invoquer cette résolution que vous aviez, avec raison, désapprouvée.
D’ailleurs Jaurès, qui n’entendait pas que la participation au gouvernement bourgeois fût limitée au cas de la défense du territoire, relevait, plus tard et non sans ironie, le caractère légèrement nationaliste de l’interprétation que Kautsky donnait à sa résolution.
« Lorsque j’ai entendu le citoyen Kautsky - disait Jaurès à Amsterdam - répéter qu’il acceptait la possibilité de la participation des socialistes dans le gouvernement central en cas de péril national, je me demandais si le ministérialisme devenait orthodoxe, à condition d’être compliqué de nationalisme et s’il était excusable pour un prolétaire de sacrifier la lutte des classes pour collaborer à la défense de cette même patrie, qui était administrée et surtout exploitée par la classe bourgeoise. Je me demandais si la liberté politique, la liberté individuelle, la possibilité d’organiser le prolétariat n’était pas pour le prolétaire d’un intérêt tout aussi essentiel que la Patrie. Et je sens que, dans certaines circonstances, je ne pourrais pas suivre jusqu’au bout le ministérialisme nationaliste de notre camarade. »
Mais l’Internationale, elle non plus, ne partagea pas le point de vue de Kautsky pour des motifs différents de ceux de Jaurès. Quand la question de notre attitude en cas de guerre est venue devant les Congrès de Stuttgart (1907), de Copenhague (1910) et de Bâle en 1912, les résolutions, votées à l’unanimité et soutenues vigoureusement par Jaurès lui-même, nous imposaient non pas l’abdication de notre volonté socialiste, non pas la passivité, mais bien au contraire, une activité socialiste intense.
« Si une guerre menace d’éclater, dit la résolution de Stuttgart - reproduite textuellement dans le manifeste de Bâle - il est du devoir de la classe ouvrière dans les pays concernés, il est du devoir de ses représentants dans les parlements... de déployer tout leurs efforts pour empêcher la guerre, par tous les moyens qui leur paraîtront les mieux appropriés et qui varient, naturellement, selon l’acuité de la lutte des classes et l’état de la politique générale. Au cas où la guerre éclaterait néanmoins, c’est leur devoir de s’entremettre pour la faire cesser promptement et d’utiliser de toutes leurs forces la crise économique et politique, créée par la guerre pour agiter les couches populaires les plus profondes et précipiter ainsi la fin de la domination capitaliste [1]. »
Il est inutile de dire que l’Internationale, en votant cette résolution, n’a pas entendu imposer au parti socialiste des pays belligérants ni la grève générale, ni la désertion, ni aucun des moyens de sabotage de la défense nationale. On ne songea par un seul instant que cette résolution nous conseillait de faire du « tolstoïsme » devant l’ennemi menaçant notre sol. Ce que la résolution de Stuttgart-Copenhague-Bâle imposait, mais d’une façon impérieuse, aux socialistes des pays en guerre, c’est de ne pas aliéner ce qui leur reste de liberté de pensée et d’action, tout en faisant leur devoir comme soldats. La résolution imposait aux socialistes de ne pas oublier qu’à part l’ennemi de l’extérieur il y a celui de l’intérieur, dont on doit faire cesser la domination. C’est dans l’Almanach même du Parti Ouvrier Français, dont vous, cher ami, deviez être plus tard un des militants, qu’Engels écrivait en 1891 - après les fêtes de Cronstadt - que dans l’intérêt même de la Révolution les social-démocrates allemands étaient obligés de défendre, en cas de guerre, tout ce qu’ils avaient conquis jusqu’à présent, sans s’incliner devant l’ennemi du dehors, ni devant celui de l’intérieur.
C’est là la bonne et saine tradition socialiste. Pourquoi ne l’avez-vous pas suivie ?
Pour quels motifs, vous, les membres de l’ancien Parti Ouvrier Français, vous les « guesdistes », les défenseurs écoutés et admirés à tous les Congrès socialistes internationaux et nationaux, de la lutte des classes irréductible, avez-vous préconisé et fait de l’abdication de classe ?
Est-ce parce que le sol de la France est piétiné par un agresseur insolent et arrogant ? Mais nos résolutions ont compté avec une telle éventualité. Elles ont prévu que même dans ce cas, nous ne pouvons pas oublier que nos ennemis sont deux et que si c’est un grand malheur pour le prolétariat de tomber sous un joug étranger, le malheur devient une véritable catastrophe si le prolétariat recule des positions qu’il a conquises sur la bourgeoisie, après une lutte continue d’un demi-siècle.
Les origines de la guerre. Les responsabilités Je sais que pour justifier votre attitude, vous, les socialistes français - comme d’ailleurs les socialistes allemands, vous avez créé une littérature d’exégèse sur les origines de la guerre. Vous tenez beaucoup à vous placer dans le cas de légitime défense.
« Ce n’est pas la France, mais l’Allemagne qui a voulu la guerre ! »
Les socialistes allemands répondent : « Ce n’est pas l’Allemagne, mais la Russie et ses alliées qui ont voulu la guerre ! »
Hildebrand et, avec lui, ses autres collègues du Reichstag, assurent que, « à la veille de la guerre, le gouvernement a fait tout pour en empêcher l’explosion. »
Avant la guerre, les socialistes de chaque pays considéraient de leur strict devoir de rechercher la responsabilité, aussi petite qu’elle soit, de leur propre gouvernement, de leurs propres classes dominantes.
Maintenant, pendant la guerre, les rôles ont été intervertis : les socialistes de France cherchent et insistent sur la responsabilité du gouvernement allemand ; ceux de l’Allemagne recherchent les responsabilités en Russie et chez les alliées de ce pays.
Je ne puis pas m’empêcher de relever ce que ce procédé a de nouveau et d’inquiétant.
Je ne pense pas un seul instant à vous reprocher la tendance de fixer les responsabilités immédiates de la guerre. Loin de moi cette pensée. Ce que nous ne pouvons admettre, ce qu’aucun socialiste ne doit admettre, c’est l’usage que vous voulez faire des graves responsabilités qui tombent sur l’Allemagne. Ce que nous croyons contraire à la cause du prolétariat français et du socialisme international, c’est ce désir de diminuer ou même de masquer la responsabilité du gouvernement français en mettant en relief et même en exagérant celle du gouvernement allemand
C’est un point de vue qui n’est pas socialiste.
Mais, puisque vous, cher ami, vous soulevez la question des responsabilités, permettez-moi, après discussion faite des intentions qui l’ont soulevée, de l’examiner à fond.
A quoi tenait la paix en Europe ? A l’équilibre des forces de la triple et de la double alliance.. On savait depuis longtemps que la rupture de cet équilibre rendait la guerre possible et même probable. C’est de là que provenait sinon la sympathie, au moins la tolérance, que certains de nos militants, au courant de la politique extérieure, manifestaient pour le système des alliances. Parlant à l’enterrement de Pressensé du grand attachement de celui-ci pour la paix, Jaurès rappelait l’importance que de Pressensé attribuait au système des alliances actuelles. « Qui dit alliance, dit un commencement de classement, un commencement d’ordre. »
Vous vous rappelez sans doute les protestations hypocrites du Temps et des autres organes de la presse revancharde française quand, après la mort d’Andrea Costa, on a su qu’à la question posée par celui-ci à Jaurès, s’il était de l’intérêt de la paix que l’Italie continue à rester dans la Triple Alliance, Jaurès aurait répondu. affirmativement ?
Pourtant, c’était très naturel et très logique. Jaurès craignait que la sortie de l’Italie de la triplice pourrait pousser l’Allemagne, par peur d’être encerclée, à faire la guerre préventive.
Pour le même motif, il cherchait à éloigner tout ce qui dans l’entente avec l’Angleterre aurait pu provoquer les susceptibilités et susciter les craintes de l’Allemagne. La dernière fois que je l’ai entendu parler, au meeting de Londres, à la veille de Noël 1913, lors de la réunion du Bureau socialiste international, il protestait contre les jingoes anglais, qui mettaient comme condition de l’entente avec la France - au moins la presse nationaliste française l’affirmait - le vote de la loi du service de trois ans et de nouveaux crédits pour l’armée. Jaurès protestait contre cette condition qui pourrait conduire à la guerre. C’est lui également qui dans l’Humanité, conseillait souvent au gouvernement de la République de ne pas trop s’engager dans la voie de la politique russe en Orient, car la Russie n’avait pas renoncé à la conquête des Détroits. N’est-ce pas Guesde, avant lui, qui, au Congrès d’Amsterdam, dénonçait l’alliance franco-russe en disant, dans son langage imagé, qu’elle est grosse de guerre ?
Mais cela c’est de l’histoire connue. Ce qui est moins connu chez vous et ce que nous, les socialistes des Balkans, connaissons parfaitement bien, c’est le concours actif, continu que votre diplomatie donnait à celle de la Russie, dans ses intrigues ténébreuses dans les Balkans pour créer ici le premier et le second bloc balkaniques avec la pointe dirigée contre l’Autriche et l’Allemagne.
D’ailleurs, la responsabilité directe et immédiate de la Russie dans cette guerre et, en quelque sorte son dessein même de la provoquer a été soupçonné par Jaurès, comme le démontre le citoyen Pressemane dans un article paru le jour même de l’assassinat de Jaurès - et avant que son auteur ait connu la terrible nouvelle - dans le Petit Limousin.
Et, en effet, quand est-ce que la Russie aurait pu trouver une occasion plus favorable pour faire la guerre et avoir de son côté la France et l’Angleterre et presque toute la démocratie européenne ?
Je soupçonne que la diplomatie anglaise n’est pas non plus à l’abri de tout reproche, comme d’ailleurs nous le démontre la campagne courageuse menée par nos camarades de l’Independent Labour Party. L’antagonisme entre l’Allemagne et l’Angleterre est trop ancien, trop connu ; l’alarme contre les progrès effrayants de l’industrie allemande, au détriment de l’industrie anglaise, l’intention attribuée à l’Allemagne de ravir l’empire colonial de l’Angleterre - sont des choses trop souvent agitées dans la presse anglaise pour que la diplomatie anglaise, quand le moment favorable se présenta, c’est-à-dire quand l’Allemagne, par son arrogance agressive, soulevait l’Europe contre elle, n’eût cherché à en tirer profit. Elle multiplia doucement et dans l’obscurité des chancelleries les probabilités de guerre et donna même un petit coup d’épaule au militarisme, déjà prêt à jeter l’Europe dans l’abîme.
Je le répète et, par les temps qui courent, trop de précautions ne nuisent pas, j’espère que personne ne verra dans cette courte analyse de la politique des Etats de la Triple-Entente le désir d’alléger l’immense part de responsabilité qui revient, dans l’œuvre d’extermination qui se poursuit, à l’Allemagne et à l’Autriche. Mais la responsabilité ne se limite pas aux seules grandes puissances. Je trouve même que c’est un faux procédé et une mauvaise tactique qui nous font un tort énorme à nous, socialistes des pays balkaniques, que de chercher dans la presse socialiste étrangère à présenter les gouvernements des petits Etats, et en particulier des Etats balkaniques, comme autant de troupeaux d’agneaux innocents, de la naïveté, de la bonté et du patriotisme desquels abusent les ogres de la diplomatie européenne. Nous savons trop bien ce que vaut la ménagerie balkanique ; nous savons qu’il n’y a pas un seul gouvernement en Europe qui pourrait dire : ma conscience est tranquille. Tous ont contribué à l’incendie qui a embrasé monts et océans, les uns en y apportant des bûches, les autres du sarment. Quand nous tenons à ne pas exagérer les responsabilités individuelles, pour ne pas diminuer celles qui reviennent au régime capitaliste - vous-mêmes, vous dites qu’il est générateur de guerres, - ce n’est pas, faut-il le dire, par dilettantisme de sophiste, mais par obéissance à la plus impérieuse nécessité socialiste. Nous devrons charger le capitalisme de tous les péchés, parce qu’ainsi nous pourrons soulever contre lui les tempêtes de la révolution prolétarienne. Et quant à la place de cette tactique de guerre des classes, on nous recommande de faire l’exégèse de la guerre, on enlève à notre parti la plus redoutable de ses armes de lutte.
Le premier agresseur et le système des alliances Je ne crois pas d’un intérêt essentiel de discuter la question : qui fut le premier à attaquer, qui fut l’agresseur dans la guerre actuelle.
Au début de la guerre, quand le conflit était localisé entre la Serbie et l’Autriche, et que les lignes de démarcation étaient encore distinctes, à ce moment-là on pouvait parler d’un agresseur. Quoique nous connaissions la légèreté criminelle avec laquelle la Narodna Odbrana, cette carbonaria d’officiers ambitieux, qui sont, depuis plusieurs années, et surtout depuis la guerre balkanique, les vrais maîtres de la Serbie et qui commandent à la presse, au. ministres, au parlement et à la diplomatie - sans parler du roi - quoique nous connaissions, dis-je, l’inconscience avec laquelle ces messieurs provoquaient l’Autriche, il n’en est pas moins vrai que l’assassinat de Sarajevo n’a été qu’un prétexte à cette dernière puissance et que la crainte qu’elle disait éprouver à l’égard de la Serbie ne pouvait pas être réelle ; son ultimatum et son attaque furent donc prémédités depuis le jour où l’Autriche avait vu se fermer pour elle la route de Salonique.
Mais une fois la guerre entre l’Autriche et la Serbie éclatée, la guerre générale est venue toute seule par le simple jeu des alliances. Pouvez-vous admettre que si l’Allemagne n’avait pas attaqué la France, le contraire ne serait pas arrivé ? Dans un article de Renaudel, paru dans l’Humanité, le lendemain même de l’assassinat de Jaurès, on laissait entendre que le parti socialiste français, dans ses efforts nobles et désespérés du dernier moment, en vue d’empêcher la catastrophe, a demandé au gouvernement français, non pas de tenir ses obligations envers la Russie, mais de les respecter seulement après avoir épuisé tous les efforts tendant à maintenir la paix.
Je sais que maintenant, le militarisme arrogant allemand fouille le sol de la France, qu’il brutalise, à force de lois et de règlement rigide la nation qui a fait le plus pour la liberté de l’humanité. Et moi, traité toute ma vie de conquis, auquel les conquérants refusèrent même un jour le droit de cité - comme vous faîtes allusion dans votre lettre, - plus que tout autre je suis en état de vous comprendre. Tout dernièrement, en feuilletant la revue illustrée allemande Die Jugend, je suis tombé sur un tableau représentant une illumination en l’honneur du Kaiser à... Lille. Des flots de lumière éclatante inondaient la place devant l’Hôtel de Ville, pavoisé aux aigles allemands. Devant ce défi insolent que le conquérant jette à la douleur de la population meurtrie, on s’indigne à juste raison.
Et je me suis senti patriote français. Mais c’est encore vous, les Français, qui, ayant subi vous-mêmes et avant fait subir aux autres les injustices de la guerre, c’est encore vous qui avez fait le proverbe : à la guerre comme à la guerre ! Aujourd’hui les Allemands sont à Lille : vous serez peut-être demain en Allemagne et votre armée fouillera le sol allemand ; vos lois et vos règlements militaires brutaliseront la nation allemande et les tours du Dôme de Cologne seront illuminées en l’honneur de Nicolas, George et Poincaré.
Non, la question : Qui a attaqué le premier n’a pas l’importance que vous voulez lui donner.
Je m’élève d’avance contre toute interprétation unilatérale de ma pensée. J’avoue que la responsabilité n’est pas répartie d’une façon égale. Le fait même que l’Allemagne est un pays à organisation encore féodale et militaire, et que la volonté des masses, pacifistes, ne compte pas trop pour le gouvernement de ce pays, nous permet de supposer, a priori, que le gouvernement allemand peut proclamer la guerre beaucoup plus facilement que le gouvernement d’une République ou même celui d’une monarchie parlementaire. Je ne conteste pas que le devoir qui incombait et incombe, actuellement, aux socialistes de l’Allemagne, est plus grave que celui qui incombait aux socialistes de la France. Puisque c’est l’Allemagne qui a formellement déclaré la guerre, il était du devoir des socialistes allemands de donner l’exemple d’une opposition courageuse. De même qu’aujourd’hui, dans la phase actuelle de la guerre, quand les armées allemandes sont partout sur des territoires étrangers et que l’intégrité de l’Allemagne n’est en rien menacée, le devoir des socialistes allemands est supérieur à celui des socialistes français dans la campagne à mener en vue de la conclusion de la paix.
Socialistes allemands et socialistes français Mais ceci à titre de réciprocité, c’est-à-dire à condition que vous reconnaissiez que le devoir des socialistes allemands était double : de combattre leur gouvernement et de se défendre en même temps contre les gouvernements étrangers, c’est-à-dire de ne pas méconnaître l’existence de l’ennemi extérieur.
C’est encore Engels qui écrivait dans l’article déjà cité, qu’en cas d’une guerre avec la Russie et ses alliés, l’Allemagne socialiste a un devoir envers elle-même : de se défendre. Le triomphe de la Russie signifierait la défaite de l’Allemagne socialiste . « Si la République française - écrivait Engels - se mettait au service de Sa Majesté l’autocrate de toutes les Russies, les soldats allemands seraient forcés de lutter contre elle aussi. Vis-à-vis de l’empire allemand, la République française peut représenter la Révolution bourgeoise. Mais, vis-à-vis de la République de Constant, Rouvier et même de Clemenceau et surtout vis-à-vis de la République qui travaille pour le tzar russe, le socialisme allemand représente la Révolution prolétarienne. »
Incontestablement, le socialisme français peut tenir, avec plus de raison encore, un langage analogue. « En face de la social-démocratie allemande, la République de M. Poincaré peut représenter l’alliée de la Russie, mais le féodalisme allemand, en face du socialisme français, représente la contre-révolution. »
Tant que la bourgeoisie détient le pouvoir et peut déclencher cet appareil formidable, qui s’appelle la mobilisation et la guerre, elle possède la faculté de mettre le prolétariat entre deux feux, entre deux dangers, entre deux pièges : s’unir à l’ennemi intérieur contre celui du dehors et abdiquer ainsi son indépendance de classe et aliéner sa liberté d’action, ou refuser de marcher à la guerre et devenir ainsi le complice indirect de l’ennemi extérieur.
Dans leurs délibérations, nos congrès nationaux et internationaux ont envisagé le problème sous ses deux aspects et en rejetant tous les moyens qui pouvaient jeter le prolétariat dans une extrémité - en rejetant par exemple la grève générale, quand elle ne peut pas être proclamée dans tous les pays belligérants, - ils ont laissé à l’appréciation du parti socialiste, dans chaque pays, le choix de la meilleure tactique, pour tenir le prolétariat à la même distance des deux pièges, des deux dangers ; une tactique qui constituerait le dosage le plus juste entre les deux nécessités la défense du socialisme contre l’ennemi extérieur et sa défense contre l’ennemi intérieur.
Je vous avoue qu’au début de la guerre, aussi bien dans le vote des crédits en Allemagne que dans le vote des crédits en France, je n’ai pas vu une déviation radicale à l’ancienne tactique socialiste. Certains mêmes d’entre nous ont cru à la présence d’un de ces résultats paradoxaux du mécanisme parlementaire qui a amené, plus d’une fois, les socialistes à des votes en apparence contradictoires avec leurs principes. Nous avons cru à une faute, mais pas à une déviation.
Je me rappelle les circonstances qui amenaient le parti socialiste français, sous le ministère de Léon Bourgeois, à voter contre l’urgence de la suppression des lois scélérates - urgence demandée par les réactionnaires dans l’espoir de renverser ledit ministère. Plus tard, sous Waldeck-Rousseau, certains socialistes durent voter l’ordre du jour Magniaudé condamnant les idées collectivistes.
En ce qui concerne plus particulièrement l’attitude des socialistes allemands le jour du 4 août, avant même que nous ayons reçu les journaux, les bruits qui nous étaient parvenus disaient qu’ils avaient voté les crédits parce qu’ils englobaient également une somme de trois milliards destinée aux familles des mobilisés.
Plus tard, nous avons compris la véritable signification de ces actes.
Quand nous avons appris que les socialistes allemands, tout en connaissant la violation de la neutralité de la Belgique, n’ont pas protesté, par respect pour le protocole parlementaire et pour « l’Union nationale » ; quand nous avons pris connaissance des articles chauvins du Hamburger Echo et d’autres journaux socialistes allemands, et que nous avons connu l’intimité qui commençait à exister entre les socialistes et les partis au pouvoir ; quand nous avons lu le discours de Hildebrand qui cherchait à mettre à la charge du « jugement sain et pratique » ce que vous mettez à la charge de « l’intérêt du socialisme » ; quand nous avons lu surtout l’inconcevable discours de Heine qui proclame Guillaume II infaillible et invitait le prolétariat allemand à se fier au Syllabus de ce nouveau Pie IX ; quand nous avons appris comment Scheidemann, sommé par les partis de l’ordre, a désavoué Ledebour pour sa courageuse protestation contre la mesure barbare du général Hindenburg ; quand nous avons appris enfin que la démocratie socialiste allemande commençait à escompter la régénération du pays par la collaboration des classes, nous nous sommes dit : le 4 août n’est pas un incident, mais le triomphe d’une tactique nouvelle. D’ailleurs, les révisionnistes des Sozialistische Monatshefte le déclaraient eux-mêmes avec orgueil : le 4 août est la date d’une nouvelle orientation du socialisme allemand.
En ce qui concerne l’attitude des socialistes français, elle ne nous est apparue sous son vrai jour que plus tard, quand nous les avons vus entrer dans le ministère et faire leur campagne pour entraîner les socialistes des pays neutres à la guerre, en les taxant de « germanophiles », s’ils manifestaient leur volonté de rester fidèles à la véritable tactique socialiste ; quand nous avons appris les commentaires qu’ils faisaient aux résolutions de la Conférence de Londres, ainsi que leur silence à la Chambre au moment où Viviani dénaturait leur pensée ; quand nous avons appris enfin l’opposition qu’ils mettaient à toute tentative d’entente et de rapprochement avec les socialistes allemands et lu le discours de Sembat à Marseille, qui ressemble énormément à ceux que prononçait Millerand au temps de l’Exposition de 1900 ; quand nous avons su, entendu et appris tout cela, nous nous sommes dit : le « ministérialisme » ressuscite en France et, ce qui est grave, il triomphe maintenant avec le concours de ceux qui, à Amsterdam, étaient ses plus irréductibles adversaires.
Le coupable : c’est l’opportunisme socialiste Le cinquantième anniversaire de l’internationale a fourni au monde la preuve que l’internationalisme n’était pas encore devenu un sentiment réel, qu’il n’était qu’un mot, dont le contenu était encore à attendre. La conscience socialiste et internationale s’est montrée, sous certains rapports, plus faible même que la conscience catholique, car tandis que les cardinaux catholiques de l’Allemagne et de la France, de l’Angleterre et de l’Autriche ont pu se réunir à Rome pour élire ensemble un nouveau pape, notre Bureau Socialiste International n’a pu se réunir une seule fois depuis le commencement de la guerre, malgré toutes les démarches et toutes les instances des socialistes des pays neutres.
Cette désagrégation de l’Internationale, ce désastre moral de notre parti n’est pas le résultat d’une erreur passagère, d’un simple incident parlementaire. Il a pour cause une altération profonde de la conscience socialiste de l’Europe, empoisonnée par le révisionnisme et l’opportunisme socialistes.
Je rejette la justification banale des partis socialistes des pays belligérants prétextant que les nécessités de la défense nationale priment toutes les autres. Hildebrand est d’opinion que si les socialistes allemands n’avaient pas voté les crédits il se serait produit un tel découragement dans les rangs des soldats que l’Allemagne aurait été battue. Que d’exagérations puériles !
La vraie tactique socialiste n’aurait pas compromis la défense nationale.
D’ailleurs, ceci m’a été confirmé par un camarade allemand qui, à ma question de savoir si le prolétariat allemand n’aurait pas fait son devoir comme soldats si les socialistes refusaient de voter les crédits nécessaires, se prononçait sans difficulté pour l’affirmative.
Je suis certain que la même remarque peut être faite pour la France. Dans notre propagande nous avions déjà préparé le prolétariat pour une pareille tactique : être contre la guerre, mais aussi contre le sabotage de la défense nationale. Le vote des crédits qui rompait brutalement la continuité et l’unité d’action du socialisme international et qui a créé dans la conscience du parti une fissure par laquelle s’est introduite peu à peu toute une mentalité antisocialiste, n’était pas un acte d’intérêt socialiste ou national. La meilleure preuve c’est qu’en Allemagne, nous le tenons d’une source certaine, le chancelier lui-même admettait, quelques jours avant la convocation du Reichstag, dans une conversation avec Haase, que les socialistes ne voteraient pas les crédits et que leur conduite logique était de s’abstenir. Pourquoi donc tant de zèle nationaliste ? Quels en sont les motifs ?
Il doit en exister de bien sérieux ; il en existe, sûrement, mais ils sont d’une nature bien opportuniste. Ce n’est pas la peur de l’ennemi extérieur, mais la peur de perdre des électeurs, dont la mentalité était façonnée par la presse jaune, la peur - je parle ici de l’Allemagne - de voir les organisations matées, les caisses confisquées, les journaux suspendus, la vie du mouvement syndical et du mouvement politique paralysée, qui créa ce malheureux courant guerrier. Toute la campagne du révisionnisme allemand désirant la collaboration des classes, servit à préparer le terrain.
A cela il faut ajouter, pour l’Allemagne toujours, ce qu’on a appelé le caporalisme, sentiment opposé à une véritable démocratie. Le parti social-démocrate allemand, malgré un travail de géant d’un demi-siècle, ne pouvait remplacer ce que l’histoire faisait, ailleurs, par ses révolutions. Le peuple allemand reste, dans le fond de son âme, encore imbibé du culte de la force.
Le zèle nationaliste du socialisme français s’explique par d’autres raisons, et surtout par son organisation relativement faible, si on la considère en rapport avec son influence politique. Cette dernière étant due surtout à la forme républicaine du gouvernement, les socialistes français sont très sensibles à tout ce qui menace la République, à tout ce qui peut diminuer la distance qui sépare le parti du pouvoir. D’autre part, le socialisme en France est, par tradition, nationaliste. La conviction d’autrefois et qui correspondait alors à un réel état de choses, qu’en dehors de la France il n’y a pas de socialisme et que le triomphe du socialisme français signifie son triomphe dans l’Europe entière, survit encore aujourd’hui et fait que les socialistes français traitent avec un égoïsme caractéristique les partis socialistes des autres pays.
Les socialistes français comprennent admirablement bien que si les autres pays étaient en guerre ou menacés d’invasion, rien ne les obligerait à demander l’intervention armée de la France. Ce serait une absurdité. Si la France est en guerre, les choses changent : ils nous demandent, ils exigent même de nous faire les apôtres de la guerre et d’envoyer le prolétariat de nos pays à la boucherie.
Illusions dangereuses La guerre actuelle nous apporte de nouvelles guerres Il est vrai que vous, socialistes français, vous considérez la guerre actuelle de la France et de ses alliés comme une guerre d’une nature exceptionnelle qui se distingue des guerres ordinaires, non seulement par l’étendue de son théâtre, par le perfectionnement des engins, par l’immensité des masses en action, par le manque absolu de tout scrupule dans les rapports d’Etat à Etat, mais encore par son but même. Le triomphe de la France et de ses alliés est présenté comme un bond énorme vers le progrès et la civilisation.
Vous dites :
« Quant aux nationalités opprimées, nous les libérerons ; quand au militarisme, nous le renverserons ; quant à l’impérialisme et au droit que peut puiser dans la prétendue supériorité de sa culture un peuple à dominer les autres, c’est une idée que nous rayerons de la pensée européenne. »
Empruntant à Hervé son « thermocautère », vous fouillez toutes les plaies de l’Europe en croyant les guérir. Vous traversez la Méditerranée en proclamant la liberté de races, dites inférieures.
Mais si la guerre peut apporter à l’humanité tous ces bienfaits que nous, les anciens « guesdistes », nous croyions irréalisables tant que les producteurs ne seront pas maîtres des moyens de production, pourquoi avons-nous été et sommes-nous encore les adversaires de la guerre ?
Si la guerre, faite par des capitalistes contre des capitalistes, peut amener la liberté de l’humanité entière, ce n’est pas : « A bas la guerre ! » mais bien : « Vive la guerre ! » qu’il fallait crier. Au lieu de combattre la guerre, il faudrait, au contraire, nous proclamer ses plus zélés champions.
Comment vous y prenez-vous pour opérer cette réhabilitation de la guerre ? Quelles sont vos raisons pour en faire l’apologie ?
Je comprendrais votre optimisme si vous, socialistes français, pouviez être maîtres de la future conférence de la paix.
Mais, dans le ministère actuel, les socialistes n’ont que deux représentants. Etes-vous sûrs qu’à la fin de la guerre, quand la présence des socialistes ne sera plus nécessaire pour donner à la bourgeoisie l’autorité sur le prolétariat, la presse bourgeoise ou un M. Chaumet ne provoqueront pas un incident, machiné d’avance, pour débarquer ces gêneurs ?
Etes-vous certains qu’au cas où votre programme serait embrassé par le gouvernement français, il sera également admis par celui d’Angleterre ? Et de la Russie, qu’en pensez vous ? Va-t-elle souscrire à votre programme de libération des peuples, de suppression du militarisme, de renversement de l’impérialisme et d’extirpation de la conscience européenne de la prétendue supériorité des races ?
En tout cas, ce que nous voyons nous rend très sceptiques.
Nous assistons à une soumission de volontés, mais elle s’exerce dans un sens contraire à vos désirs.
Ce n’est pas la majorité bourgeoise du ministère qui cède et qui se rétracte devant la minorité socialiste, mais bien au contraire ; ce n’est pas la France qui impose son idéal démocratique à l’Angleterre, mais c’est l’Angleterre qui obtient le’ concours de la France, pour maintenir sa domination sur des centaines de millions d’habitants appartenant à des races inférieures. Enfin, ce n’est pas la Russie qui se soumet à la volonté de ses alliées occidentales, mais ce sont celles-ci qui abdiquent devant le tzarisme.
La preuve n’est pas loin à chercher. La diplomatie franco-anglaise a capitulé devant la Russie dans la question de Constantinople et des Détroits. Hervé lui-même a capitulé et il ne reste plus de défenseur en France, pour la neutralisation des Détroits, qu’une partie des socialistes. L’Humanité, qui publiait dans les numéros des 19 et 20 mars, les deux articles successifs de Moutet et de Renaudel protestant contre l’aplatissement devant la Russie, nous fournit la preuve indirecte de la capitulation que je dénonce.
Le principe des nationalités a essuyé un autre échec dans la question de l’Adriatique, dont la côte de l’Istrie et de la Dalmatie, peuplée par dés Serbes et des Croates, a été cédée, parait-il, par la Triple-Entente à l’Italie. Un million de Slaves, peut-être même un million deux cent mille, qui jouissent encore aujourd’hui, en Autriche, d’une large autonomie, devront faire connaissance avec le nationalisme intolérant des Italiens qui se flattent d’être les meilleurs assimilateurs en Europe.
* En vingt-cinq ans, il ne restera pas de Slaves, me disait un professeur de l’Université de Rome, collaborateur du Corriere della Sera, quand je lui expliquais les dangers que présentait l’irredenta serbe au cas d’une annexion de l’Istrie et dé la Dalmatie.
* Les Slaves sont dés agriculteurs paisibles, dont nous ferons vite des Italiens, à l’aide de nos écoles ; quant à la Serbie, elle sera trop absorbée par la digestion (sic) des nouveaux territoires annexés pour qu’elle puisse songer à nous faire des difficultés.
* Un langage analogue tenait à Bucarest, eu 1913, à la signature du traité de paix, le ministre de la Serbie, M. Pachitch.
![]() Nous ne craignons pas les Bulgares en Macédoine. Ce sont des agriculteurs et des pâtres qui ne demandent qu’une chose : qu’on les laisse vaquer en paix à leurs travaux. En chassant les prêtres et les maîtres d’école bulgares et en les remplaçant par des Serbes, nous ferons qu’en dix ans il ne reste plus un Bulgare en Macédoine.
Nous ne craignons pas les Bulgares en Macédoine. Ce sont des agriculteurs et des pâtres qui ne demandent qu’une chose : qu’on les laisse vaquer en paix à leurs travaux. En chassant les prêtres et les maîtres d’école bulgares et en les remplaçant par des Serbes, nous ferons qu’en dix ans il ne reste plus un Bulgare en Macédoine.
Le même langage et la même politique suivent Bulgares, Roumains et Grecs, par rapport aux éléments d’autres races qui ont eu le malheur de tomber dans les territoires qui leur furent concédés.
« Le principe des nationalités » ne peut pas figurer dans un programme socialiste. Son application est impossible dans les cadres de l’Etat national d’aujourd’hui. En Orient, surtout, où les éléments sont excessivement mêlés, où les frontières ethnographiques n’existent même pas, le principe des nationalités ne sert qu’à masquer une politique de conquête territoriale.
Aussi, nous avons de la peine à croire que, même vainqueurs, vous serez maîtres de décider les conditions de la paix future et nous apporter autre chose que des guerres futures.
Inutile de dire que nous ne partageons pas et nous n’avons jamais partagé cette autre illusion, confessée par certains socialistes allemands, que le triomphe de l’Allemagne signifierait la défaite du tzarisme russe et le triomphe de la démocratie. Nous nous sommes toujours refusés à admettre que la guerre que l’Allemagne fait à la Russie soit à un degré quelconque une guerre de libération. Et, quand un lecteur allemand nous envoya, pour être publiée, la lettre que le député progressiste Haase avait adressée à Marcel Sembat et dans laquelle il reprochait à la France de collaborer avec la Russie, nous n’avons pas voulu lui donner place dans notre journal, considérant comme prétextes hypocrites de la part de l’impérialisme allemand le danger de la réaction russe. A cette occasion, motivant notre refus, nous avons émis l’hypothèse, qui n’est certainement pas encore exclue, que les événements pourraient finir par conduire à une réconciliation russo-allemande et à. la résurrection de la fameuse Sainte-Alliance. L’Allemagne a tout intérêt à ménager la Russie, pour s’en servir, plus tard, contre l’Angleterre. Mais nous avons le droit de nous étonner davantage quand vous, socialistes français, tombez dans l’extrême opposé à celui des révisionnistes et des progressistes allemands en voulant présenter comme « libératrice et démocratique » la plus capitaliste et la plus impérialiste des guerres et en vous proclamant lés apôtres des alliances dont les seuls mobiles sont l’avidité de territoires et des richesses et dont les procédés de réalisation sont le marchandage avec l’indépendance des petites nations et des « races inférieures », la perfidie, la ruse et la violence.
Je ne doute pas que le jour où le parti socialiste français sera forcé, par les inévitables conflits entre le travail et le capital, de revenir à la saine doctrine de la lutte des classes, il avouera lui-même avoir été la victime de la plus funeste des illusions, avoir été dupe de la bourgeoisie qui a réussi en France, aussi bien qu’en Allemagne, à mobiliser comme l’a si bien dit Liebknecht, pour ses fins impérialistes, les sentiments démocratiques du prolétariat. Mais en ce moment-ci, vous ne pouvez pas vous prévaloir de l’idéal socialiste.
Ceci ressort également de la solution que vous avez cru donner â la question de l’Alsace-Lorraine.
Le question de l’Alsace-Lorraine Vous proclamez, comme un but à atteindre, la réannexion à la France de ses deux anciennes provinces. Mais ce serait un acte de violence comme il le fut en 1871, mais en direction opposée. Les Français subissaient alors la violence dés Allemands vainqueurs ; aujourd’hui ce seront les centaines de mille d’Allemands, immigrés en Alsace, qui subiront de ce fait la violence du vainqueur français.
Pour les socialistes il n’y a qu’une solution juste et en même temps pratique : l’autonomie complète des deux provinces devant constituer à l’avenir un Etat tampon entre l’Allemagne et la France.
Je sais que vous, socialistes français, vous proposez la consultation préalable de la population, à l’aide d’un référendum.
Or il existe des questions dont la solution est imposée par une sérié de circonstances et qui ne doivent pas être soumises aux surprises d’un plébiscite dont la sincérité serait contestée, en tout cas.
Dans une question pareille, ce n’est pas seulement l’opinion de la majorité, plus ou moins accidentelle, qu’on doit prendre en considération, mais aussi celle de la minorité et l’on doit envisager également la répercussion, que l’une ou l’autre de ces solutions aurait en Allemagne ou en France. Il ne s’agit pas de satisfaire momentanément tel ou tel vœu, mais dé prévenir des conflits futurs.
C’est pourquoi je considère la solution, que vous mettez à tort sous le patronage de Liebknecht et de Bebel, comme une solution nationaliste et funeste à la paix future de l’Europe et aux rapports futurs du socialisme allemand et français.
Le plébiscite dont parlent les socialistes français sera d’ailleurs une formalité superflue si, d’après l’avis d’Hervé, on doit exclure les Allemands immigrés depuis 1871 et dont le chiffre, d’après certains camarades français, monterait aujourd’hui à 400.000 hommes et comprendre, au contraire, tous les émigrés qui ont quitté, en 1871 et postérieurement, les deux anciennes provinces françaises.
Je ne crois pas, d’autre part, que vous soyez pour les Alsaciens-Lorrains d’origine allemande plus tolérants que les Allemands ne l’ont été pour ceux d’origine française. La France, comme l’Allemagne, comme l’Italie, est un Etat national, homogène, et ne peut pas, de ce fait, tolérer des éléments d’autre nationalité. Je n’oublierai jamais que sous le ministère Combes on avait dénoncé comme un véritable crime contre l’Unité nationale française le fait qu’en Bretagne le catéchisme était lu en langue bretonne. Combes s’empressa même de l’interdire d’une façon expresse. Ce fait, extraordinaire si on le considère au point de vue de la liberté individuelle, apparaît naturel si l’on prend en considération le caractère profondément unitaire et centraliste de l’Etat français.
Je puis dire, sans crainte d’exagération, qu’après la guerre, si le plan de la « libération des nationalités » tel que la triple - maintenant quadruple - entente le conçoit, triomphe, il y aura en Europe une plus forte oppression nationale, comme il y en a eu davantage dons les Balkans après les deux guerres balkaniques. Il ne faut pas être, par exemple, grand prophète pour prédire que les Serbes et les Croates qui passeront sous le joug de l’Italie n’auront, même pas en partie, l’autonomie dont ils jouissent à l’heure actuelle, sous la domination autrichienne.
Sympathies et antipathies socialistes Vous pouvez pourtant objecter : admettons que le triomphe de la Triple-Entente n’apporte pas à l’humanité tout ce que nous en attendons, ne concédez-vous pas qu’il est tout de même plus profitable pour le progrès de l’Europe, que le triomphe des puissances centrales ?
Avant de répondre à cette question je dois faire quelque réserve. Manifester des sympathies pour tel ou tel des groupements en guerre n’implique pas nécessairement une obligation de participer à la guerre à ses côtés. Pendant les guerres balkaniques, les socialistes français étaient partagés dans leurs sympathies. Dans les articles sur la politique extérieure de l’Humanité il y avait à remarquer trois courants divers : De Pressensé était bulgarophile, Jaurès turcophile, Veillard grécophile et serbophile. D’autre part, Guesde préférait le triomphe du bloc balkanique sur la Turquie et prophétisait - probablement se le rappelle-t-il encore - qu’il verrait peut-être aussi la désagrégation de l’Autriche-Hongrie.
Est-ce que ces sympathies différentes et même contradictoires impliquaient pour leurs auteurs l’obligation de demander à la France d’entrer en guerre à côté de tel ou tel belligérant ?
Nous, les socialistes des Balkans, nous n’avons pas failli pendant les guerres dans lesquelles étaient engagés nos pays, à notre devoir socialiste ; nous n’avons pas cessé un seul instant de condamner nos gouvernements, mais si nous étions tombés dans le zèle nationaliste de nos camarades d’Occident, et si nous nous étions adressés à eux pour demander qu’ils renoncent à leur tactique et qu’ils entraînent leurs pays dans la guerre, ne nous aurait-on pas traités d’égarés du socialisme ? Les petits pays s’exposent pourtant davantage, en participant à une guerre.
La France, battue, n’en continuera pas moins d’exister. L’Italie de même. Celle-ci a eu cette rare chance de ressortir même après ses défaites militaires avec une augmentation de territoire. La situation est toute autre pour les petits Etats balkaniques. Ils risquent, en cas de défaite, leur propres territoires, comme ce fut le cas pour la Roumanie, qui contribuait à la victoire russe de Plevna, et se voyait dépouillée, à la fin de la guerre, de la Bessarabie.
Nous aurions donc pu demander votre intervention en notre faveur avec plus de raisons que vous n’en avez pour demander la nôtre. Vous ne nous objecterez pas, je suppose, que nos peuples sont petits et qu’ils doivent se sacrifier pour les grands. Ce serait introduire par la porte du socialisme la théorie impérialiste des races supérieures et des races inférieures, que vous voulez, précisément et avec raison, écarter de la conscience européenne.
Nous aurions pu invoquer également l’intérêt du progrès général, car il est rare que deux Etats en lutte soient en situation identique et que le triomphe de l’un ne soit plus profitable au progrès de l’Europe que le triomphe de l’autre.
Ceci dit, je puis affirmer, étant complètement sûr que mon avis est partagé par la totalité des socialistes de la Roumanie, de la Bulgarie et, je crois même, par la totalité des socialistes des pays neutres que, si la guerre était limitée entre la France, la Belgique et l’Angleterre d’un côté, et l’Allemagne et l’Autriche de l’autre, les sympathies, sans la moindre hésitation, se porteraient sur le premier de ces groupements.
Mais la guerre a aussi un autre théâtre, celui d’Orient, où les puissances centrales luttent contre la Russie.
La haine du tzarisme Or, la haine du tzarisme russe est une tradition dans l’Internationale. Nous, particulièrement, les socialistes des Balkans, nous avons été élevés dons cette haine. Nos maîtres socialistes n’ont jamais cessé de nous dire :
Chez vous, en Orient, il y a une rude et difficile tâche à accomplir. Dans l’intérêt de l’Internationale, vous devez lutter contre la politique de conquête de la Russie. « Vous avez un écueil grave à éviter à tout prix : en faisant du socialisme, tâchez de ne pas faire le jeu de la Russie, » - m’écrivait en 1896 le vieux Liebknecht, celui qui, pour son attachement à la France, avait été appelé « le Français ». Les camarades russes nous disaient la même chose. En s’adressant en 1894 aux socialistes des Balkans, Plékhanov leur disait : « Vis-à-vis de la Russie tzariste le socialisme international a un seul et unique devoir : de la tenir dans l’isolement le plus complet. En proclamant au Congrès de Marseille que la Russie est l’échine de la réaction en Europe. Guesde ne nous invitait-il pas à la lutte sans merci contre le tzarisme russe.
Pourtant, et nous demandons qu’on nous rende cette justice, s’il y a eu des social-démocrates qui ont insisté sur ce que l’Internationale ne s’égare pas sur cette seule piste pour oublier que la menace de la paix de l’Europe orientale réside en Autriche également, ce sont les socialistes des Balkans. Les camarades qui étaient à la Conférence du Bureau Socialiste International de Bruxelles, en octobre 1912, savent combien nous avons tenu à ce que chaque impérialisme ait sa part de blâme et combien nous avons insisté en vue de présenter le danger pour l’universalisation de la guerre, alors localisée entre la Turquie et le bloc balkanique, comme venant du côté de l’Autriche. Nos arguments ont probablement produit une certaine impression, car l’année suivante, au mois de décembre, à Londres, le citoyen Vaillant me déclarait s’être rappelé plus d’une fois nos avertissements, que les événements venaient de confirmer et qu’ils confirment actuellement encore davantage. Il ne faut pas qu’à présent nous nous égarions de nouveau, cette fois, sur la piste autrichienne et allemande et que nous perdions de vue les conquêtes que la Russie prépare au sud, avec le concours de ses alliés. Les Russes à Constantinople, c’est sûrement l’anéantissement de l’indépendance des États balkaniques. Leur territoire se réduirait alors au hinterland nécessaire à la défense de Constantinople et des Détroits.
Tant que la sécurité de l’actuelle capitale des Turcs était menacée au Nord, par la Russie, les Balkans et le Danube étaient ses lignes de défense naturelle. Mais si Constantinople devient russe, il ne sera plus menacé du nord-est mais du nord-ouest, du côté de l’Allemagne. Dans ce cas, la ligne naturelle de défense n’est plus formée par les Balkans et le Danube, mais bien par les Carpathes ; une loi stratégique impose que toute extension de la Russie vers le sud soit accompagnée d’une extension correspondante vers l’ouest.
Pouvons-nous avoir, dans ce cas, des sympathies pour la Russie ? Pouvons-nous lui souhaiter des succès ?
Vous reconnaissez d’ailleurs vous-même le danger russe. Seulement, vous nourrissez l’espoir de le tenir en frein avec le concours de l’Angleterre et des futures Républiques qui s’élèveront à la place de l’Allemagne et de l’Autriche vaincues. Mais ne croyez-vous pas que le tzarisme russe, qui a précisément prouvé ne pas méconnaître ses vrais intérêts, déjouera vos combinaisons ? Ne pensez-vous pas qu’au premier danger menaçant son pouvoir, Nicolas Il s’empressera de conclure la paix avec ses bons et anciens amis Guillaume II et François-Joseph.
Ce que nous voulons c’est que personne ne triomphe ; ce que nous désirons c’est que l’Allemagne soit rejetée du Nord de la France et de la Belgique et que l’ours du Nord soit forcé de rentrer dans sa tanière.
Mais ces sympathies et antipathies n’engagent nullement notre action déterminée par les seuls intérêts de la classe ouvrière, distincts de ceux de la bourgeoisie. Si nous admettions la théorie du moindre mal, si nous nous étions déclarés prêts à chaque conflit à entrer en guerre, pour celui des adversaires en lutte, dont le triomphe nous paraissait le moins nuisible, notre parti serait devenu l’annexe des partis bourgeois. Vous savez bien que pour déterminer notre attitude vis-à-vis de bourgeois en lutte ou en guerre, ce qui doit nous préoccuper ce ne sont pas les différences qui les séparent, mais bien celles, beaucoup plus grandes, qui nous séparent d’eux.
Notre « germanophilisme » et l’hypocrisie des « francophiles » Mais il paraît que notre lutte pour la neutralité stricte et loyale est présentéecomme une preuve de germanophilisme et cela, parce que notre neutralité profiterait actuellement à l’Allemagne.
Ce n’est pas sérieux.
Qu’auriez-vous dit si quelqu’un vous faisait remarquer à vous socialistes français que vous devriez cesser vos protestations contre l’expédition au Maroc, parce que votre neutralité profiterait indirectement au Sultan ?
Au début de la guerre, notre lutte pour le maintien de la neutralité vous a profité, à vous également, car à ce moment-là, l’entrée de la Roumanie en action ne se serait faite qu’au profit de l’Allemagne - à laquelle nous lie un traité d’alliance.
Maintenant, une grande partie de nos réactionnaires sont francophiles, mais c’est parce qu’ils espèrent obtenir de la France une plus grande part de la proie future. Si la balance de la victoire fléchit de nouveau et sensiblement, du côté des Allemands, vos alliés en Roumanie changeront de sentiments en moins de vingt-quatre heures. Et alors nous, les socialistes roumains, nous, qui avons déclaré, dès le début, que nous ne pouvons être ni pour l’impérialisme allemand, brutal et arrogant, ni pour le tzarisme russe, nous qui considérons de notre honneur d’être toujours avec le socialisme et avec les vaincus, serons alors les seuls défenseurs de la France républicaine, comme au début de la guerre, quand nos « francophiles » trouvaient à la République tous les torts et accusaient les socialistes français, et Jaurès en particulier, d’avoir préparé le désastre de leur pays.
Pour votre édification personnelle, je vous traduirai un article intitulé Les réactionnaires attaquent la démocratie française et paru dans notre journal du 7/20 septembre, dans lequel nous prenions la défense de la République française contre ses détracteurs roumains.
Nous parlons de la France démocratique qui depuis quelques jours est devenue l’objet des attaques de la presse conservatrice, libérale ou indépendante.
Du chœur des détracteurs ne pouvait pas être absente la voix criarde des « socialistes sans muselière ». Eux tous, ils accusent la démocratie française et entre autres le ministère Combes, les socialistes et Jaurès en première ligne, d’avoir préparé la défaite de la France.
Avant même qu’ils aient attendu les résultats décisifs de la guerre, Epoca proclame la défaite de la France et ceci à cause des socialistes, qui votaient contre les budgets de guerre et faisaient de la propagande antimilitariste.
Cependant il est un fait connu que ses plus grandes défaites, la France les a connues sous le régime de la monarchie et de l’Empire. Sous Napoléon III, la France fut dans un mois à Sedan, tandis qu’actuellement, après un mois et demi de guerre, ses armées paraissent encore entières, intactes, et, même capables de reprendre l’offensive.
La vérité est toute différente des affirmations de la presse réactionnaire.
Les socialistes ont combattu et vont combattre dans l’avenir, non pas les institutions militaires en elles-mêmes, qui subsisteront tant que le capitalisme existera - mais ils ont combattu leur forme actuelle, qui loin de garantir la sécurité des pays, les expose aux invasions étrangères.
Les armées permanentes sont un danger pour l’existence des petits Etats.
C’est aujourd’hui qu’on voit, d’autre part, combien prévoyant se montrait Jaurès quand il accusait l’état-major général français d’avoir compromis la défense de la France par l’absence d’une conception démocratique de la question militaire.
Plus loin, l’auteur développe les idées de Jaurès sur l’Armée nouvelle.
Déjà ce commencement d’article vous montre que nous les « germanophiles » nous prenions la défense de la France, tandis que les « francophiles » d’aujourd’hui cherchaient, par une manœuvre contre la démocratie française et en répandant le bruit que la France est irrémédiablement perdue, à faciliter l’entrée en action de la Roumanie à côté de l’Allemagne.
Le parti interventionniste en Roumanie De l’article cité plus haut, vous avez pu constater encore comment les classes dominantes de la Roumanie cherchent à tirer des enseignements die la guerre, des arguments pour rendre la vie aux courants que les luttes du prolétariat avaient déjà refoulés.
Les progrès faits, dans cette direction, par la bourgeoisie roumaine depuis le commencement de la guerre sont assez remarquables. A la suite de la confusion que la guerre a provoquée et grâce à une campagne de presse sans scrupule, sans la moindre bonne foi, mais méthodiquement et savamment conduite, tout ce que nous avions de plus rétrograde, de plus taré, de plus compromis, est revenu à la surface, s’est réhabilité et a grandi à vue d’œil jusqu’à jouer un rôle décisif dans la vie de ce pays. Les maîtres chanteurs de la presse jaune, les organisateurs des pogromes de l’antisémitisme roumain, les fusilleurs de paysans, les briseurs de grèves, communient tous, maintenant, dans le même « idéal national ».
A la tête du parti guerrier de la Roumanie se trouvent deux personnages dont les noms symbolisent, dans notre pays, la corruption et la réaction.
L’un c’est M. Take Ionesco - l’espoir de la Triple - maintenant la Quadruple-Entente, - l’homme qui a travaillé le plus pour corrompre les mœurs politiques de ce pays en faisant de la vénalité un principe politique - son arrivée au département des Finances a toujours été comparée au déversement du Nil, - l’homme aux ambitions vulgaires et d’une vanité démesurée, le politicien sans foi, sans convictions qui considère les programmes politiques comme autant de causes à plaider. Avide du pouvoir, il a cherché à être, en toutes occasions, du côté des vainqueurs, à courtiser les hommes du jour et à se donner ensuite pour leur ami, leur confident et leur inspirateur. Ses partisans sont fiers de son intimité avec Poincaré, qu’il tutoie, avec Sir Grey, auquel il donne des tapes amicales entre deux conseils sur la politique que doit suivre l’Angleterre. Jusqu’hier M. Take Ionesco était l’homme qui ne cessait de faire cas de ses amitiés allemandes, qui énumérait à chaque occasion, avec complaisance, le nombre des déjeuners qu’il avait pris avec Kiderlen-Wachter, d’Aehrental et autres. Escomptant la victoire des alliés, M. Take Ionesco est devenu maintenant leur homme et trouvant difficile un retour à ses anciennes sympathies, il menace, en cas d’échec de la Russie, de s’expatrier en Amérique, le peuple roumain perdant, pour ce « patriote », tout intérêt le jour où il n’aura plus l’espoir de revenir au pouvoir. Mais ce Tartarin, doublé de Bompard, qui songe déjà à sa retraite solennelle, possède aussi le sens pratique des deux célèbres méridionaux. De tous les hommes politiques roumains c’est lui qui a compris l’importance de la grande presse et il a réussi, en se servant d’un ancien socialiste, C. Mille, à mettre la main sur deux journaux politiques des plus répandus qui, sous le masque d’indépendance, ne font que la réclame et la politique de Take Ionesco. Il a pu compenser ainsi la faiblesse de son parti, en hommes et en idées, par la corruption de la presse.
L’autre chef du parti guerrier c’est M. N. Filipesco, boyard de vieille souche, aux traditions de famille russophiles, l’homme aux idées les plus arriérées, détracteur de la démocratie - Epoca, dont j’ai parlé plus haut, est son organe personnel, - monteur de pogromes antisémites, organisateur de coups de force, amateur de jurons et de pugilat. Un véritable bonapartiste, un Morny qui n’a pas encore trouvé le Louis-Bonaparte pour décembriser la Roumanie. Les sympathies de M. Filipesco sont pour la Russie et pour... l’Allemagne. Pour la République française, il a l’aversion du hobereau.
Voilà, cher ami, les hommes avec lesquels vous voulez qu’on fasse triompher la démocratie, la probité et le socialisme !
Mais le « francophilisme » est également exploité, en Roumanie, par les renégats du socialisme - lesquels chassés par la grande porte du socialisme international, cherchent à revenir par l’escalier de service, à se créer des attaches avec le parti socialiste français, pour l’exploiter encore, dans leurs seuls intérêts d’arrivistes. Ce sont eux, je suppose, qui sont venus chez vous, à Paris, pour vous parler du « germanophilisme » des socialistes roumains.
Ce seul fait suffirait pour faire voir le recul sensible qu’a subi le socialisme dans les pays belligérants pendant les dix derniers mois. Si un de ces transfuges était venu chez vous avant la guerre, vous n’auriez prêté aucune attention à ses insanités.
Il n’aurait même pas osé aborder un pareil sujet.
Guerre et réaction La campagne pour la guerre, chez nous, a eu encore d’autres résultats. Je ne parlerai pas des conséquences désastreuses de la politique équivoque de notre gouvernement pour les ouvriers et pour les paysans, je ne relèverai que des mesures du gouvernement. La guerre a facilité le vote de plusieurs lois dirigées contre la classe ouvrière. Comme exemples : la loi sur le contrôle des étrangers, qui fait de l’espionnage une institution d’Etat et de la dénonciation un devoir de citoyen ; la loi sur l’assistance des mobilisés qui, après avoir fixé un secours ridicule de 20 francs par mois pour les ouvriers de la ville et de 15 francs pour ceux de la campagne, a imposé à la classe ouvrière, pour recueillir les fonds nécessaires, des taxes qui n’ont pas d’analogues même dans les pays belligérants. Les cartes postales sont taxées par un timbre supplémentaire de cinq centimes ; les notes des restaurants dépassant un franc paient un impôt de dix centimes et celles au-dessus de deux francs - la progression s’arrête ici - de vingt centimes.
Mais il y a pire encore.
Vous savez que nous avons, en Roumanie, le régime électoral le plus arriéré et que, d’autre part, nos paysans vivent dans les conditions agraires existant en France à la veille de la Révolution. Après la dernière révolte des paysans, nos gouvernants ont trouvé impossible le maintien de cet état de choses et durent penser à accorder un nouveau régime électoral et à donner de la terre aux paysans. Les événements de la guerre apparaissent aux hobereaux roumains comme un moyen propice pour s’arrêter dans la voie des réformes. M. N. Filipesco a déclaré, avec sa brutalité habituelle, à la réunion du Comité exécutif du Parti conservateur : « Le parti conservateur doit se mettre à la tête du mouvement pour l’unité nationale, pour pouvoir ensuite combattre avec plus d’autorité la réforme électorale et la réforme agraire ! » Le peuple roumain doit donc faire la guerre, car c’est le plus sûr moyen d’enterrer les réformes I
Et vous voulez que nous soyons pour la guerre ? Je comprends que dans certaines circonstances on soit forcé - comme c’est le cas chez vous - de subir le voisinage et la collaboration des Drumont, des Barrès, des Meyer, des Maurras, mais quelle aberration que d’aller chercher et de provoquer cette collaboration ?
Deux socialismes Non, nous ne sommes pas d’accord avec vous et vous ne pouvez pas nous convaincre de faire de bonne grâce, chez nous, ce que vous êtes forcés de subir chez vous.
Nous sommes et nous restons les partisans de la bonne et vieille tactique de la lutte des classes et nous répudions de toutes nos forces celle de la collaboration des classes.
Je prévois votre observation : vous direz que, vous aussi, vous ne renoncez pas à la lutte des classes, et que c’est l’intérêt socialiste qui vous force à faire cette déviation passagère.
Mais ne voyez-vous pas, mon cher ami, le coup que vous portez au passé glorieux de ce socialisme français dont vous faites partie ?
Les possibilistes ne disaient-ils pas eux-mêmes qu’ils sont pour la socialisation des moyens de travail, mais que la réalisation de ce but ne pourra se faire que progressivement ?
Le ministérialisme socialiste français ne jurait-il pas qu’il resterait fidèle au principe de la lutte des classes ? De quel droit avez-vous combattu l’un et l’autre ?
C’est parce que vous vous rendiez bien compte qu’on ne peut pas faire certaines concessions sans compromettre l’avenir même du socialisme.
Non, il n’est pas exact de dire que maintenant encore nous professons le même principe de la lutte des classes, mais que nous différons seulement dans son application, les conditions n’étant pas identiques dans tous les pays.
Le Parti Ouvrier Indépendant suit en Angleterre une tactique toute différente de celle du Parti socialiste anglais, quoique les deux partis travaillent sous le coup des mêmes événements et dans le même milieu.
La preuve c’est que les partis socialistes des deux pays belligérants, alliés, suivent deux tactiques différentes. C’est ainsi que les députés socialistes serbes et les députés socialistes russes ont refusé de voter les crédits de guerre, et que le contraire est arrivé en France.
Entre leur tactique et la vôtre il y a plus de différence qu’entre la vôtre et celle des socialistes allemands. Donc, nous ne sommes pas en présence de deux tactiques, mais en présence de deux socialismes.
Voilà la vérité.
Nous, les socialistes roumains, nous voulons rester avec le socialisme révolutionnaire, qui fut hier la source de votre force, et nous voulons continuer à l’avenir la lutte contre la guerre et contre l’opportunisme.
Avec salutations amicales,
Christian Rakovski, Délégué de la Roumanie au Bureau Socialiste International.
[1] Nous avons eu la chance rare de publier dans la Lupla du I" mai de cette année une épreuve de cette résolution, texte français, corrigée par la main de Jaurès.