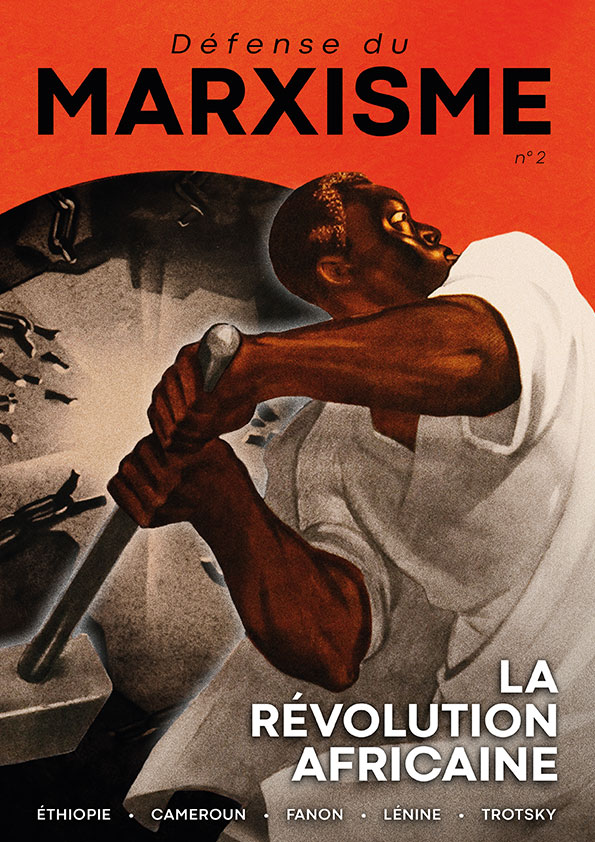Cet article traite des conditions de vie – et de mort – des soldats de l’armée française, pendant la première guerre mondiale, et notamment des mutineries qui éclatèrent en mai et juin 1917. Ces événements sont trop peu connus, en France, alors qu’ils font partie, eux aussi, de notre histoire révolutionnaire. Notre principale source est le livre remarquable de l’historien américain Richard M. Watt : Trahison ? (Presses de la Cité, 1964).
A la fin de l’année 1916, après deux ans et demi de carnage, l’armée française était saignée à blanc. Le nombre total de soldats français tués au champ de bataille, morts des suites de leurs blessures, prisonniers ou portés disparus s’élevait à 1 300 000. Selon l’Etat-major de 1914, la guerre devait être une guerre de mouvement, rapidement conclue grâce à la « théorie de l’offensive ». Les premières attaques avaient ressemblé à celles du siècle précédent. Sur fond de musique militaire, drapeaux au vent, baïonnettes fixées, les soldats sont menés par des officiers gantés de blanc contre le feu dévastateur des mitrailleuses allemandes. « Dès que l’infanterie française avance, écrivait un officier britannique, elle est arrosée de shrapnels, et les malheureux fantassins sont abattus comme des lapins. Ils sont très braves et ne cessent de revenir à la charge à travers un feu d’enfer, mais sans succès. Leurs officiers sont splendides ; ils précèdent leurs troupes d’une vingtaine de mètres, aussi calmes qu’à la parade. Mais jusqu’à présent, je n’en ai pas vu un seul parcourir plus de cinquante mètres sans être abattu. »
Effervescence
La bataille de la Marne, en septembre 1914, arrête enfin l’avance allemande. Mais alors commence l’enlisement dans l’horreur indescriptible de la guerre des tranchées. Au cours de l’année 1915, toutes les tentatives d’ouvrir une brèche dans les lignes adverses, ou de gagner du terrain à une échelle militairement significative, se soldent par un échec. L’année suivante, ni l’hécatombe de Verdun, en février, ni l’offensive de la Somme, en avril, ne débouchent sur une percée. Le général Nivelles, qui remplace Joffre, avait obstinément refusé d’abandonner son « plan » pour l’offensive de la Somme, et ce bien que les Allemands, au courant de ses moindres détails, aient ordonné un repli stratégique qui le rendait caduc. Le résultat fut une nouvelle débâcle. Le seul élément du plan qui s’est déroulé conformément aux prévisions, c’est le courage et l’élan des « poilus ». Agonisant dans des trous d’obus et dans les barbelés, trop d’hommes meurent pour rien, une fois de plus. Trois ans de combats, de terribles souffrances et de massacres n’ont abouti qu’à une nouvelle saignée de masse, pour quelques collines de l’Aisne. Dans le vaste désordre qui règne, le long du Chemin des Dames, les soldats, trahis par l’incompétence et le cynisme réactionnaire de leurs chefs, savent que les soldats russes ne veulent plus de la guerre impérialiste, que la révolution a éclaté, en Russie, et que le Tsar a été renversé. Dans l’armée française, aussi, la mutinerie est désormais dans l’air.
La première division d’infanterie coloniale avait la réputation d’être solide et obéissante. Elle avait souvent été à la pointe des assauts. Revenant du front, dans la nuit du 21 au 22 avril 1917, ce sont pourtant ces troupes qui s’écrient : « A bas la guerre ! On nous a fait assassiner ! » Averti des « symptômes d’effervescence » de ce genre, Nivelles ne veut rien entendre. Soucieux de sauver ce qui lui reste de sa crédibilité, il ordonne de nouveaux assauts futiles.
Une mutinerie éclate finalement le 29 avril, dans le 2e bataillon du 18e régiment d’infanterie. Lors de l’offensive ordonnée par Nivelles, à peine 200 des 600 membres du bataillon ont survécu. Cantonnés près de Soissons, ils ne parviennent pas à se remettre de cette expérience. Ils espèrent un transfert sur le front d’Alsace, un secteur relativement calme. Mais le 29, moins de deux semaines après le massacre, de nouveaux officiers qu’ils ne connaissaient et ne respectaient pas les informent qu’ils vont remonter en ligne. Ils se révoltent, scandent des mots d’ordre contre la guerre. On appelle alors une section de gendarmes, qui réussit à les mettre en ligne, et, à deux heures du matin, ils sont en route pour le front. En chemin, les gendarmes arrêtent plus ou moins arbitrairement une vingtaine de soldats, qu’ils considèrent comme des meneurs de la révolte. Une douzaine d’entre eux sont incarcérés. Un « conseil de guerre » composé d’officiers est mis en place. Il leur faut des condamnations « pour l’exemple ». Les prisonniers sont déportés en Guinée française, à l’exception du caporal Moulia et des soldats Cordonnier, Didier, Garrel et La Placette, qui sont condamnés à mort.
Les exécutions ont lieu quelques jours plus tard. Seul Moulia a survécu. Le 12 juin, alors qu’on le menait au peloton d’exécution, un tir de barrage déclenché par l’artillerie allemande s’abat sur le secteur. Profitant de la confusion, Moulia parvient à se cacher dans les bois. Vingt ans plus tard, sa présence sera signalée en Amérique du Sud.
« A bas la guerre ! Mort aux responsables ! »
La mutinerie du 2e bataillon du 18e régiment a donc été réprimée rapidement et sévèrement. Mais elle n’était que la première d’une longue série de révoltes d’une bien plus grande ampleur. La mutinerie suivante éclata dans la 2e division coloniale, elle aussi cantonnée à Soissons, cinq jours à peine après celle du 2e bataillon. La 2e coloniale venait de mener trois attaques ruineuses. Pourtant, le 3 mai, elle reçoit l’ordre de se rassembler dans les quartiers dévastés, au nord de la ville, pour remonter au front, une fois de plus. Le camp de la division est inondé de tracts condamnant la guerre et appelant au renversement du système qui en est responsable.
Après tant de désastres, tant de morts, les troupes ne sont pas pressées de se mettre en rang. Sentant l’humeur récalcitrante des hommes, les officiers doivent adopter un ton circonspect, plus persuasif que directif. De nombreux soldats se présentent sans fusil. « Que se passe-t-il, les gars ? Où sont vos armes ? » D’abord une voix solitaire, au fond de la masse : « On ne marche pas, mon lieutenant ! » D’autres voix se lèvent. « A bas la guerre ! Mort aux responsables ! » Ils gardent une attitude respectueuse envers les officiers, obéissent aux ordres, mais refusent de monter au front, quoi qu’il arrive. La révolte éclate. Pratiquement tous les régiments de la division y participent. 200 soldats envahissent le quartier général du commandant divisionnaire, en criant « On ne marchera pas ! » Les officiers tentent en vain de reprendre le contrôle de la troupe. Mais partout, ils rencontrent la même situation. Les soldats sont prêts à défendre les tranchées, mais ne veulent pas participer à de nouvelles attaques, aussi futiles que meurtrières.
Finalement, dans la soirée, les régiments se forment et partent prendre place dans les tranchées, convaincus qu’ils ne doivent pas laisser les troupes en première ligne mourir sous le feu ou d’épuisement, faute de relève. En apparence, cette deuxième mutinerie, comme celle du 18e régiment, a été maîtrisée assez facilement. Mais comme l’écrit Richard M. Watt, l’auteur de Trahison ?, il y a une différence importante, entre les deux événements : « Il y avait [cette fois-ci] trop d’hommes à punir. Pour cette raison, les soldats comprirent – avec une intense satisfaction – que, désormais, ils pourraient tenir tête à leurs officiers, défier la froide et inexorable discipline plus ou moins impunément, et pourraient même refuser d’attaquer. Bref, les troupes elles-mêmes décideraient de leur vie ou de leur mort. Tout étonnés de cette simple vérité qu’ils avaient jusqu’alors ignorée, nos poilus allèrent de l’avant pour la partager avec toute l’armée. »
Les mutineries de mai 1917 avaient comme trait commun de s’être produites, presque sans exception, dans des divisions d’infanterie. Cela s’explique sans doute par le fait que l’infanterie avait souffert dans des proportions infiniment plus grandes que les divisions d’artillerie ou de cavalerie, aussi bien lors de la débâcle de l’offensive du général Nivelles que dans les autres épisodes du carnage impérialiste. A partir de juin, cependant, les révoltes prennent une ampleur sans précédent et s’étendent rapidement à pratiquement tous les corps de l’armée. Dès les premiers jours du mois, les trois régiments de la 9e division se soulèvent. « Nous ne monterons pas en ligne », disent les soldats. Ils menacent ouvertement de tirer sur les officiers qui s’aviseraient de les arrêter. « On veut bien garder les tranchées, mais on n’attaquera plus. C’est trop bête de marcher vers des mitrailleuses intactes. On en a assez de se faire tuer sur des barbelés. »
Les soldats commencent à tirer des conclusions politiques. Les « papillons » et autres feuilles de propagande semés dans les casernes et les tranchées, dont l’impact semblait jusqu’alors relativement limité, sont lus et commentés. « Si nous marchons quelque part, ce sera contre la Chambre des Députés ! » Nivelles s’inquiétait de cette politisation, comme l’indique, entre autres, un mémorandum adressé au Ministre de Guerre, Hubert Lyautey :
« Les tracts. – Depuis plus d’un an, des tracts, brochures, journaux pacifistes parviennent aux armées. On en découvre davantage en quinze jours qu’on n’en saisissait en trois mois, en 1916… Ils sèment le doute quant à la justice de la cause pour laquelle les soldats se battent. Ils font l’apologie de l’Allemagne, affirment l’impossibilité de la victoire, et prétendent que la paix seule résoudra les problèmes du charbon et de la vie chère. D’aucuns renferment les plus dangereuses indications et les pires conseils… Ces factums entament l’esprit d’offensive des combattants, les énervent, les découragent.
« Les réunions de permissionnaires. – Pendant leur permission, un certain nombre de soldats assistent à des réunions où, sous prétexte de traiter des questions corporatives, les chefs syndicalistes et anarchistes exposent des théories pacifistes. De retour aux tranchées, ils répètent à leurs camarades les arguments qu’ils ont entendus.
« Militaires en relations avec les meneurs. – Certains soldats restent en correspondance suivie avec les individus qui semblent conduire la propagande. Les lettres qu’ils leur adressent accusent réception de journaux, tracts, feuilles volantes qu’ils avouent avoir communiqués ou répandus…
« Propositions. – Il y aurait lieu de saisir les tracts dans les imprimeries qui les tirent, d’interdire les réunions où les discussions ne se limitent pas à des questions strictement professionnelles, de supprimer le journal révolutionnaire russe Natchalo, d’empêcher les menées de Sébastien Faure, Merrheim, Hubert et de la douzaine d’agitateurs qui les appuient, de briser la propagande pacifiste et d’exiger un travail normal dans les usines de guerre et les arsenaux. »
En effet, entre Paris et le front, le Ministère de la guerre considérait qu’il ne restait plus que deux divisions sur lesquelles l’Etat-major pouvait absolument compter. A Paris, des mouvements de grève rajoutaient à la panique qui s’installait dans les milieux gouvernementaux. Poincaré fut saisi d’horreur à la vue d’une manifestation d’ouvrières des fabriques de munitions, qui ont bruyamment terminé leur marche devant les fenêtres du Palais de l’Elysée.
A Dormans, des soldats se soulèvent en scandant : « A bas la guerre et vive la révolution russe ! »
Incapables de comprendre leur propre responsabilité dans l’effondrement de l’armée, les généraux ne veulent y voir que l’œuvre de quelques « conspirateurs ». S’adressant au député Henri Gallichet, qui venait de témoigner d’une mutinerie à Soissons, le général Franchet D’Esperey assure qu’il existe « un véritable complot organisé qui tend à dissoudre toute discipline… Les meneurs étaient en relation à Paris avec des agents louches de désordre. L’enquête a démontré que les promoteurs de la rébellion projetaient de s’emparer d’une gare et de se faire transporter par chemin de fer à Paris pour y soulever la population contre la guerre. La révolution russe doit servir de modèle… Les troupes sont tenues en état de surexcitation continuelle par les journaux remplis de détails sur les évènements de Russie, par les relations d’incidents parlementaires hostiles aux généraux, par les exagérations pessimistes… Pourquoi ferme-t-on les yeux ? Pourquoi ne réprime-t-on pas ? Cela cessera ou nous n’aurons plus d’armée, et l’ennemi, en cinq jours, pourrait être devant Paris ! »
Le nombre de désertions augmente en flèche. Alors qu’à peine 509 désertions avaient été signalées, en 1914, puis 2 433 en 1915 et 8 924 en 1916, leur nombre s’élevait déjà aux alentours de 15 000 sur les six premiers mois de 1917.
L’une des mutineries les plus importantes a lieu à proximité de Cœuvres, à quelques kilomètres de Soissons, le 2 juin, dans le 310e régiment d’infanterie. Le 30 mai, un autre régiment est passé par Cœuvres – en route, semblait-il, pour le front. Mais il était évident que les soldats n’avaient pas l’intention de s’y rendre. Ils sont passés devant les hommes du 310e, en criant : « A bas la guerre ! Faites comme nous et la guerre s’arrêtera ! La liberté ou la mort ! » Finalement, le régiment en rébellion est chassé de Cœuvres par une troupe de cavalerie et de mitrailleurs. Mais l’incident laisse sa marque sur les hommes du 310e, désormais en ébullition. Ici et là, ils entonnent L’Internationale.
Le lendemain, ils reçoivent l’ordre de quitter Cœuvres. Mais ils refusent. Ils élisent des délégués chargés de maintenir une « discipline révolutionnaire » dans le régiment – suivant en cela, comme bien d’autres régiments français, l’exemple des « soviets de députés des soldats » élus dans les régiments russes. Ils tiennent ainsi pendant quatre jours, avant de se rendre. Les deux-tiers des hommes sont incarcérés près de Soissons. Une quinzaine d’entre eux est condamnée aux travaux forcés. Seize hommes sont condamnés à mort. Mais cela n’a pas mis fin à la révolte dans l’armée française. Dans la deuxième semaine de juin, le 298e régiment d’infanterie lance une insurrection, prend le contrôle du village de Missy-aux-Bois et y établit son propre « gouvernement révolutionnaire ».
Dans ses mémoires, Poincaré relate que les insurgés ont écrit des lettres collectives à leurs officiers. Ils y disent qu’ils ne remonteront plus au front et exigent la conclusion d’une « paix immédiate et honorable ». Lorsque les officiers rejettent leur démarche, les soldats les expulsent de Missy-aux-Bois. Des barricades sont érigées autour de la ville. La « discipline révolutionnaire » s’impose à tous. Le commandant élu par les insurgés publie une déclaration pour expliquer à la population locale que les soldats « ne sont ni des voleurs, ni des assassins ». Il interdit toute forme de pillage ou de vol.
L’Etat-major ne peut pas tolérer cette insurrection. Dans le contexte de juin 1917, elle risque de déclencher une insurrection générale des poilus. Les autorités militaires décident donc de la réprimer dans le sang, si nécessaire. Une division de cavalerie encercle les insurgés et les prive de nourriture. Au bout de trois jours, isolés et affamés, ils se rendent. Plusieurs soldats, considérés à tort ou à raison comme les « meneurs », seront sommairement exécutés.