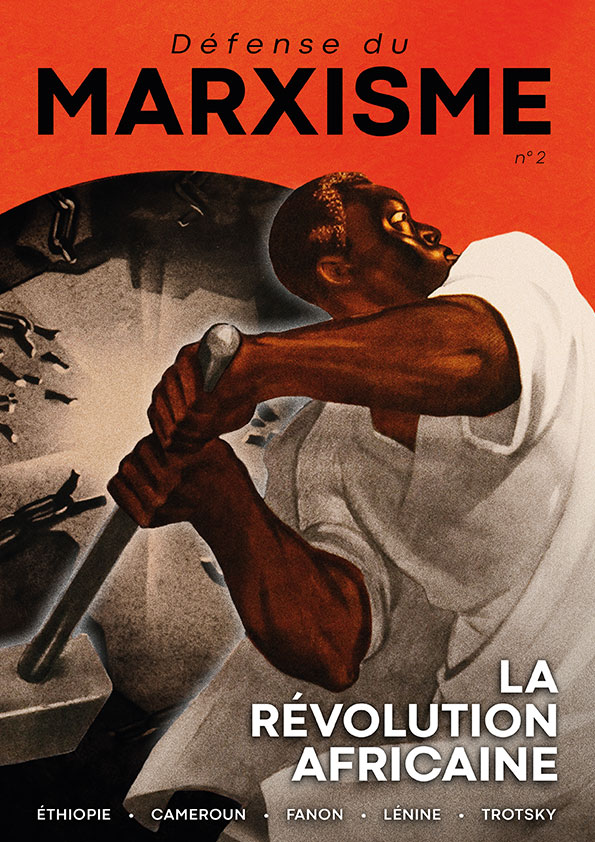Les récentes élections européennes ont envoyé une onde de choc dans le paysage politique du continent. Des partis de droite soi-disant « anti-système » ont fait des scores importants dans des pays comme la France, la Grèce et la Grande-Bretagne, au grand dam des partis traditionnels. Mais l’idée que cette élection représente un brusque mouvement vers la droite – voire vers le fascisme – est complètement fausse.
En Grèce, en Espagne et au Portugal, il y a eu un mouvement vers la gauche, parfois très net. En Espagne, l’irruption de Podemos (« Nous pouvons ») est un séisme politique. De fait, les résultats électoraux à travers l’Europe illustrent une polarisation vers la droite et vers la gauche – ainsi qu’un déclin du « Centre ». Seuls Merkel (CDU) et Renzi (PD), en Allemagne et en Italie, font de bons résultats. Mais ce sont les deux seuls pays où, pour différentes raisons, les électeurs n’ont pas encore complètement tourné le dos à l’UE et aux partis du « Centre ». Dans le reste de l’UE, les partis traditionnels de droite et de gauche ont été victimes de ce que les grands médias décrivent confusément comment une « protestation populiste ». Quelle est la signification de ce phénomène ?
Le lien avec situation objective est évident. L’effondrement économique de 2008 était un tournant brutal dans la situation. Le vieil équilibre économique était détruit. A l’époque, nous expliquions qu’en essayant de restaurer l’équilibre économique, les capitalistes allaient détruire l’équilibre politique et social. Ces élections le montrent clairement. L’équilibre politique en Europe a été brisé – et il ne sera pas facilement restauré.
Les idées politiques des peuples ont été profondément affectées par cinq années de crise économique, de chômage de masse, de plans de rigueur et de recul des niveaux de vie. Les partis et gouvernements responsables des politiques d’austérité ont vu leur soutien s’effondrer. Dans certains cas, comme celui du Pasok grec, ils sont même menacés de disparaître de la scène. C’est ce qui était arrivé au Parti Socialiste italien, il y a 20 ans.
L’instabilité politique reflète un profond courant de mécontentement. Les brusques mouvements d’opinion ne sont pas accidentels. Ils montrent que les masses cherchent désespérément une issue à la crise. Les résultats des élections du 25 mai ne sont qu’une manifestation – certes partielle et confuse – de cette tendance fondamentale.
La France
Le chœur des plaintes sur la prétendue menace fasciste atteint son apogée en France, où le parti de Marine Le Pen a recueilli 25 % des voix, loin devant le PS et l’UMP.
Si Jean-Marie Le Pen n’est pas un fasciste, il n’en est pas loin. Le mois dernier, il a déclaré que« Monseigneur Ebola » – du nom du virus qui décime l’Afrique noire – pourrait « régler en trois mois [...] l’explosion démographique ». Mais sa fille a réalisé depuis longtemps que les liens publics avec le fascisme n’allaient pas l’aider dans sa carrière parlementaire. Elle a travaillé dur pour rendre le FN « respectable » – jusqu’à censurer son père. En se concentrant sur la démagogie anti-UE, anti-immigration et « anti-système », elle est arrivée à ses fins.
Le Front National n’était jamais arrivé en tête d’une élection nationale. Il enverra 24 des 74 députés européens représentant la France à Bruxelles. Ce résultat a choqué la classe politique et les « observateurs ». Or il était assez prévisible. N’oublions pas que le rôle de la social-démocratie est précisément de trahir le peuple qui l’a élue, de faire le sale boulot des banquiers et des capitalistes – et donc de décevoir les masses, en particulier les classes moyennes, ouvrant la voie à la droite la plus réactionnaire. La France de ces deux dernières années est une parfaite illustration de cette loi universelle.
Il y a deux ans à peine, François Hollande et le PS ont remporté une nette victoire aux élections présidentielles et législatives. C’était un mandat clair pour le changement. Lors de la campagne électorale, Hollande s’était donné une image de gauche, promettant d’en finir avec l’austérité, de taxer les plus riches (à hauteur de 75 %), de revenir sur les contre-réformes des retraites et, de créer 60 000 emplois dans l’Education nationale.
Hollande n’a pas mis longtemps à renier ses promesses. Sous la pression des grands capitalistes, il a adopté une politique de rigueur. Le sentiment domine que les dirigeants socialistes ont trahi le peuple et que la classe politique en général est déconnectée de la réalité. Les gens se disent : « En quoi monte vote change-t-il quoi que ce soit ? Aucun de ces politiciens ne me représente. » Cette conclusion parfaitement rationnelle n’est pas limitée à la France. Les gens y parviennent dans pratiquement tous les pays d’Europe, comme ces élections l’ont clairement révélé.
Quant à la « relation spéciale » de la France avec l’Allemagne (le « couple franco-allemand »), c’est unbluff pathétique. En réalité, c’est Merkel qui détient le véritable pouvoir. Elle décide de tout, Hollande de rien. La haine du « système » s’est donc étendue aux bureaucrates sans visage de Bruxelles, qui semblent encore plus éloignés des vrais problèmes que les politiciens. Dans un électorat déjà désenchanté, la propagande anti-UE de Marine Le Pen a, sans surprise, rencontré un écho favorable.
Hollande est désormais le président le plus impopulaire depuis 1958. Mais était-il inévitable que le mécontentement à l’égard de François Hollande bénéficie à Marine Le Pen ? Non, ce n’était pas inévitable. Il y a deux ans, le Front de Gauche réalisait un très bon résultat à l’élection présidentielle, dans la foulée de meetings et rassemblements massifs. Mélenchon parlait de « révolution », défendait un programme radical – et rencontrait un écho enthousiaste. Si Mélenchon et le PCF avaient maintenu une ligne d’opposition de gauche claire au gouvernement, ils auraient beaucoup progressé.
Mais ils n’ont rien fait de tel. Les élections municipales ont vu le PCF s’allier au PS, dès le premier tour – et les dirigeants du PG vanter leurs alliances avec les Verts (qui étaient alors au gouvernement). Beaucoup d’électeurs de Mélenchon à la présidentielle en furent écœurés. Comme le disait le duc d’Enghien au sujet de sa propre exécution : « c’est pire qu’un crime ; c’est une faute ». Ensemble, les dirigeants du PCF et du PG sont parvenus à gravement affaiblir le Front de Gauche. Et comme la nature ne tolère pas le vide, le résultat prévisible de cette situation fut la montée du FN. Il n’y a absolument rien d’étonnant à cela.
Hollande est sans doute parvenu à la conclusion qu’il n’a plus rien à perdre et peut poursuivre sa course vers la droite. Bien sûr, c’est suicidaire à la fois pour lui et pour le PS. Mais comme les vieux Samouraïs, les dirigeants socio-démocrates préfèrent se tuer avec leur propre épée que de se livrer au déshonneur d’abandonner le système capitaliste à son propre sort. Le seul à en tirer profit est le Front National.
L’Espagne
L’Espagne a connu l’une des récessions les plus profondes en Europe. Le gouvernement de droite de Rajoy (PP) a appliqué une politique brutale d’austérité et de coupes budgétaires, qui a mis au chômage la moitié de la jeunesse. Cela a provoqué des mouvements de protestation massifs et l’occupation des places dans plus de 50 villes, il y a trois ans. Ce mouvement s’est éteint sans avoir apparemment rien accompli. Mais le mécontentement du peuple a maintenant trouvé une expression politique. Le gouvernement de Rajoy est détesté. Le vote pour le PP s’est effondré.
Le Parti socialiste (PSOE) n’a pas bénéficié de l’effondrement électoral du PP. Au contraire, le PSOE a réalisé sa plus mauvaise performance électorale depuis la chute de la dictature, en 1977-78. Les gens se souviennent que les dirigeants du PSOE ont engagé la politique d’austérité quand ils étaient au gouvernement. En conséquence, ils sont considérés comme co-responsables des souffrances du peuple espagnol.
En 2009, le PP et le PSOE recueillaient ensemble 81 % des voix, contre seulement 49 % cette fois-ci. Le PP s’effondre de 42 à 26 %, le PSOE de 38,8 à 23 %. Ces partis faisaient ensemble 12,8 millions de votes en 2009, contre 7,7 millions cette fois-ci, soit un recul de 5 millions de voix. C’est un niveau historiquement bas pour les deux partis sur lesquels la démocratie bourgeoise s’est basée, en Espagne, depuis la fin de la dictature de Franco (si l’on considère que le PP est le successeur de l’UCD de Suarez).
Ces élections marquent un tournant vers la gauche en Espagne. Izquierda Unida (IU), qui comprend le Parti communiste, a progressé significativement, de 3,7 % et 588 000 voix en 2009 à 10 % et 1,58 million de voix aujourd’hui. C’est aussi une progression par rapport aux 6,9 % des élections générales de 2011.
Cependant, l’élément le plus intéressant de cette élection, en Espagne, est l’émergence soudaine et inattendue de « Podemos », une nouvelle formation qui a surpris en obtenant 8 % des voix. Il fait même un meilleur score qu’IU dans une plusieurs de régions importantes, comme les Asturies et Madrid (à la fois dans la ville et dans la région).
Cette formation a attiré les voix des couches radicalisées de la société qui voulaient protester contre le système tout entier. Ces voix ne sont pas allées à IU, considéré comme trop modéré et trop lié au système existant. C’est particulièrement le cas à Madrid, où la fédération d’IU est dominée par son aile droite et entachée de scandales de corruption. Il y a trois mois, Podemos n’existait même pas. Tous les sondages réalisés avant le vote suggéraient qu’il aurait du mal à remporter plus d’un siège. Ce parti âgé de trois mois, avec un budget d’à peine 100 000 euros, se hisse finalement à la quatrième place, avec 1,25 million de voix et cinq sièges au Parlement européen. Dans certaines régions – Madrid inclus –, Podemos (« Nous pouvons ») émerge comme la troisième force politique derrière le PP et le PSOE.
L’émergence soudaine de Podemos a choqué la classe politique. La presse a publié des éditoriaux stupéfaits expliquant que ce mouvement « vient de nulle part », ce qui signifie en réalité que les « observateurs » n’ont rien vu venir. Car Podemos ne vient pas de « nulle part ». C’est l’expression politique du mouvement de masse de la jeunesse et des travailleurs espagnols qui, ces trois dernières années, ont manifesté contre l’austérité et la dictature des banquiers. Si le mouvement était invisible pour les « experts » politiques, c’est parce qu’ils ont la tête enfoncée dans un lieu inavouable où le soleil ne brille jamais.
« Si les gens ne font pas de politique eux-mêmes, elle se fait sans eux, et c’est alors qu’ils [les politiciens] volent vos droits démocratiques en même temps que votre porte-monnaie », expliquait dans une interview Pablo Iglesias, la figure dirigeante de Podemos. Cela représente un grand pas un avant dans la conscience de mouvement de protestation espagnol. Au lieu du rejet confus et semi-anarchiste de la politique, nous avons là une tentative de donner à ce mouvement une expression politique organisée.
Presque sans argent, ce parti embryonnaire montre que la combinaison d’une politique anti-capitaliste militante et d’une organisation active enracinée peuvent défier les puissantes machines des partis bureaucratiques soutenus par les millions des banquiers et des capitalistes. Podemos a constitué un réseau de 300 « cercles » à travers le pays. Les idées de Podemos sont vagues et confuses, mais sa propagande est clairement anti-capitaliste.
Bien que Podemos évite de s’identifier à la « droite » ou à la « gauche » et préfère se référer aux « citoyens » qu’aux travailleurs, le message qu’il a transmis était clairement : « ceux d’en bas » contre « ceux d’en haut ». Alors que les « populistes » de droite se confinent à un rejet étroitement nationaliste de l’UE, Pablo Iglesias donne un contenu de classe à son opposition à la politique de la Troïka.
Donnant une expression au rejet de l’establishment et de l’UE capitalistes, le jeune dirigeant de Podemos a écrit sur son blog que le principal objectif de la Troïka est de « sécuriser les profits des banques, des grandes compagnies et des spéculateurs ». C’est tout à fait correct. Il ajoute : « L’Europe ne doit pas être un instrument pour asphyxier les pays du sud, et l’Espagne ne doit pas être un pays pour les corrompus, les fraudeurs et les spéculateurs immobiliers. »
L’émergence de Podemos a déjà eu un impact sur les partis traditionnels. Elle a provoqué la chute d’Alfredo Perez Rubalcalba, le secrétaire général du PSOE. On peut douter que Podemos parvienne à supplanter IU sur la gauche du PSOE, mais il peut agir comme un puissant catalyseur pour radicaliser la gauche, l’arracher à sa léthargie réformiste ossifiée. Ce serait très positif.
La Grèce
Les médias bourgeois et les sectes gauchistes sont obsédés par Aube Dorée. Il est vrai que c’est un parti fasciste qui a progressé, cela qui reflète le même processus social et politique de polarisation que nous avons mentionné plus haut. Dans ces élections, il est arrivé en troisième position, devant le Pasok, qui paye le prix de sa participation au gouvernement dirigé par le parti de droite Nouvelle Démocratie.
Les chefs d’Aube Dorée avaient des rêves de grandeur : ils s’imaginaient pouvoir prendre le pouvoir. Mais la classe dirigeante a compris que face à une classe ouvrière radicalisée, toute tentative de se tourner vers le fascisme serait extrêmement risquée. Par conséquent, les capitalises grecs ont été obligés de prendre certaines mesures pour retenir les chiens enragés d’Aube Dorée, même s’ils n’avaient évidemment aucune intention d’interdire ce parti, car ils en auront besoin à l’avenir.
Pour paraître plus respectable, Aube Dorée a troqué ses bottes contre des costumes à la veille des élections. Ils ont gagné ainsi leurs premiers sièges au Parlement européen. Cependant, ce succès a un caractère relatif. En effet, le premier vainqueur de ces élections n’est pas Aube Dorée, mais Syriza, qui a battu Nouvelle Démocratie et remporte ainsi sa première victoire électorale nationale. Le leader de Syriza, Alexis Tsipras, a déclaré que c’était une victoire « historique » pour son parti. C’est une déclaration raisonnable. Mais contrairement à ce qu’on entend parfois, Syriza n’est pas vraiment un nouveau parti. Son noyau est constitué de membres de Synaspismos, qui est une scission du Parti communiste grec (KKE). Il compte beaucoup d’anciens militants communistes et socio-démocrates, y compris d’éminents transfuges du Pasok.
L’ascension fulgurante de Syriza reflète la colère des électeurs vis-à-vis des programmes d’austérité successifs mis en oeuvre par la classe dirigeante. Et leur frustration est en train de se développer à cause de cette même classe dirigeante qui a conduit la Grèce à l’effondrement économique. Avec 26,4 %, Syriza est arrivé devant Nouvelle Démocratie (23,2 %). L’Aube Dorée est à 9,3 %, devant la coalition de l’Olivier (Elia) – une alliance de centre-gauche dirigée par le Pasok et qui a recueilli 8,1% des voix. Syriza a également remporté une victoire importante dans l’élection du gouverneur de la région de l’Attique, qui entoure la capitale et compte environ un tiers de la population du pays.
Pourtant la victoire de Syriza ne conduira pas immédiatement à la chute du gouvernement d’Antonis Samaras. Comme les deux partenaires de la coalition ont capté ensemble une part plus importante des votes que Syriza, ils s’accrochent désespérément au pouvoir, comme un homme qui se noie s’accroche à un morceau de bois qui flotte. Mais la houle emportera Samaras vers le large, où il finira par disparaître sans laisser de traces. Les jours de ce gouvernement sont comptés. Tôt ou tard, Samaras devra organiser de nouvelles élections ; et tout indique que Syriza les gagnera.
Tsipras a déclaré que sa victoire électorale signifiait que le gouvernement n’a plus le droit de négocier avec les créanciers internationaux sur les questions clés comme la restructuration de la dette publique, ou d’imposer de nouvelles mesures d’austérité. S’il arrive au pouvoir, il a promis de déchirer l’accord barbare de « sauvetage » de la Grèce – une perspective qui a suscité les espoirs de millions de Grecs. En même temps, il a dit que la Grèce resterait dans l’UE et dans la zone euro, ce qui, sur la base du capitalisme, signifierait qu’il serait toujours à la merci de Bruxelles et de Berlin. La façon dont cette contradiction sera résolue déterminera l’avenir de Syriza et de la Grèce.
L’Italie
Le fait majeur du résultat électoral en Italie, c’est le niveau historique de l’abstention. Cela reflète une frustration croissante et un rejet à la fois du système politique et des politiques d’austérité. 57,2 % des électeurs italiens ont pris la peine de voter, contre 66,5 % en 2009 et 75,2 % lors des législatives de 2013.
Le premier ministre italien, Matteo Renzi, a réussi à marginaliser l’aile gauche du Parti Démocrate (PD) et le contrôle désormais complètement. Il poursuit un cours droitier : nouvelle contre-réforme du Code du travail, refus de négocier avec les syndicats, etc. Les médias bourgeois s’enthousiasment du résultat du vote en faveur de Renzi. Ils le soutiennent parce qu’il est un politicien purement bourgeois, alors que les dirigeants précédents du PD venaient de l’ancien Parti Communiste italien. Cependant, compte tenu de l’abstention, Renzi n’a rallié que 25 % de l’électorat.
Contrairement à ce qu’affirme la presse bourgeoise italienne, Renzi n’a pas réalisé le meilleur résultat de l’histoire du PD. En 2008, le PD de Veltroni avait recueilli davantage de voix que Renzi. De même, il n’est pas vrai que Renzi a fait mieux que le PCI de Berlinguer en 1976. A l’époque, le PCI avait recueilli 12,6 millions de voix, soit 1,3 million de plus que Renzi. En outre, le PD a fait 12 millions de voix en 2008, puis 8,6 millions en 2013 et 11 millions en 2014. Ces oscillations illustrent l’extrême volatilité de l’électorat.
Et le « Mouvement des 5 étoiles » de Beppe Grillo, dont la presse a tant parlé par le passé ? Ses cinq étoiles ont illuminé le ciel pendant un bref moment. Mais comme c’est souvent le cas des mouvements de masse petit-bourgeois, il s’est rapidement essoufflé. Ces partis sont intrinsèquement instables et peuvent disparaître aussi rapidement qu’ils sont apparus.
Le Mouvement de Grillo a tout de même recueilli 5,8 millions de voix (21,1 % des suffrages). Mais il a perdu 3 millions de voix par rapport à 2013. Le fait est que partout où des responsables de ce parti ont été élus, au plan local, ils ont déçu. Il est probable que le mouvement de Grillo entrera en crise et connaitra de violentes oscillations vers la droite et vers la gauche.
Le vote pour Grillo était clairement un vote contre l’austérité et les politiques imposées par l’UE en général. Si on ajoute à cela les 22 millions d’électeurs qui se sont abstenus, cela fait 28 millions d’Italiens qui ont perdu toute confiance dans les grands partis de centre-droit et de centre-gauche.
Ce qu’il reste des vieux partis de la gauche italien, y compris le PRC et SEL (une scission de droite du PRC menée par Nichi Vendola), a soutenu une liste intitulée « L’autre Europe avec Tsipras). Ils espéraient bénéficier du succès de Syriza en Grèce et sont parvenus à passer le seuil d’éligibilité de quelques milliers de voix. Mais ils n’ont réalisé que 4,03 % des voix. Ils ont recueilli 1,1 million de voix, contre 1,8 million l’an passé avec la liste Ingroia. Leur euphorie surréaliste est sans doute déterminée par le fait qu’ils semblent avoir réussi à enrayer leur déclin électoral. Mais cela ne durera pas longtemps.
Le bloc traditionnel de la droite constituée autour de Berlusconi – qui n’avait pas le droit de voter – est dans sa phase de crise terminale. Il est divisé. Avec 16,8 % des voix, Forza Italia (4,6 millions de suffrages) perd 6 millions de voix par rapport à 2009 et 2,5 millions par rapport à 2013. Il est peu probable que ce parti regagne du terrain rapidement.
La Ligue du Nord a un peu progressé sur la base d’une démagogie anti-UE. Enfin, il faut mentionner Mario Monti, l’économiste bourgeois qui fut le premier ministre « technocratique » de l’Italie entre 2011 et 2013, bien qu’il n’ait jamais été élu par personne. Son parti, « Scelta Europa », a perdu 2,5 millions de voix en un an. Il a recueilli 0,72 % des suffrages.
Encouragé par ces résultats électoraux, la bourgeoisie mettra la pression sur le gouvernement de Renzi pour qu’il approfondisse et accélère l’agenda des politiques d’austérité. Renzi se sentira conforté pour attaquer le monde du travail et engager d’autres mesures impopulaires. Les dirigeants syndicaux sont sur la défensive et chercheront un compromis. Mais aucun compromis n’est possible. Ils reculeront et capituleront autant qu’ils le peuvent, mais tous ces compromis ne suffiront pas à satisfaire la bourgeoisie italienne, qui se trouve dans une position de plus en plus désespérée face à ses plus puissants rivaux européens.
Toute la situation s’oriente vers une explosion de la lutte des classes. Dans les mois à venir, il faut s’attendre à l’éclatement de luttes extrêmement radicales, que les dirigeants syndicaux s’efforceront de déconnecter les unes des autres, comme on l’a vu lors des cinq jours de grève des chauffeurs de bus de Gênes en novembre 2013. Compte tenu des traditions des travailleurs italiens, de telles luttes peuvent se développer et se transformer en un vaste mouvement de protestation anti-gouvernemental.
Tôt ou tard, les syndicats seront obligés de s’engager dans une semi-opposition, d’abord, puis dans une opposition ouverte au gouvernement Renzi. Cela peut provoquer une scission dans le Parti Démocrate suivant des lignes de classe, ouvrant la voie à une recomposition de la gauche italienne.
La Grande-Bretagne
La presse voit un « séisme politique » dans la victoire de l’UKIP aux élections européennes, en Grande-Bretagne. Le parti d’extrême-droite a fait 27,5 % des voix et décroche 24 sièges. Nigel Farage, son dirigeant, aime poser en homme du peuple qui boit de grandes quantités de bière anglaise dans son pub local et conspue les bureaucrates étrangers qui nous empêchent de fumer dans les lieux publics. Or en réalité, cet « homme du peuple » est un ancien banquier et un homme riche. Il représente les intérêts, non du peuple, mais de la City de Londres. C’est une des raisons qui expliquent tout le temps que les médias lui accordé. Cela marque un changement d’attitude d’une section de la classe dirigeante britannique à l’égard de l’UE.
La période fiévreuse de croissance et de spéculation, pendant laquelle les banquiers vivaient dans une orgie de profits, a coïncidé avec une période de relations relativement bonnes entre l’Europe et la Grande-Bretagne. La City de Londres faisait un feu de joie de toutes les restrictions sur les activités bancaires. Cela a mené directement à l’effondrement catastrophique de 2008. La fête est terminée et ses protagonistes ont une terrible gueule de bois.
La note est présentée aux masses sous la forme de coupes drastiques dans leurs niveaux de vie. Récemment, même des gens comme Christine Lagarde (FMI) et le chef de la Banque d’Angleterre ont commencé à critiquer les énormes bonus des banquiers. Ils s’inquiètent à juste titre des conséquences politiques des inégalités croissantes dans la société. Nulle part ces inégalités sont plus flagrantes qu’en Grande-Bretagne. Londres est la plus grande concentration de millionnaires en Europe.
La City de Londres récolte les fruits d’une croissance qui repose largement sur une bulle du marché immobilier. Or comme on l’a vu en 2008, les bulles ont tendance éclater – avec de très fâcheuses conséquences. Cette situation illustre le caractère complètement dégénéré et parasitaire de la classe dirigeante britannique. En outre, les privilèges de la City de Londres suscitent la jalousie des banquiers du reste de l’Europe. L’UE a fait environ 40 propositions de réécriture des réglementations du secteur bancaire européen, ce qui a suscité la fureur des banquiers britanniques contre les « lourdes régulations de l’UE ». C’est ce conflit entre gangs rivaux de capitalistes, et non les sentiments nationaux offensés auxquels en appelle le démagogue Farage, qui est la véritable cause des relations empoisonnées entre Londres et Bruxelles.
C’est l’incapacité des dirigeants du Parti Travailliste à exprimer la colère et la frustration des masses britanniques qui explique la progression de l’UKIP. Ed Miliband offre l’image d’une faiblesse abjecte et qui ne suscite aucun enthousiasme. En conséquence, un certain nombre d’électeurs travaillistes, en province, se sont tournés cette fois-ci vers l’UKIP
La presse britannique a systématiquement promu l’UKIP et Farage, ces derniers temps. La classe dirigeante comprend que la coalition actuelle entre Conservateurs et Lib-Dems court à la défaite aux prochaines élections législatives, dans un an. Malgré sa direction droitière, le Parti Travailliste s’en est sorti raisonnablement bien aux élections locales et européennes. Mais malgré l’extrême modération de Miliband et ses tentatives de montrer à la bourgeoisie qu’il est « prêt à gouverner », la classe dirigeante ne fait pas confiance au Parti Travailliste et à ses dirigeants. Dans un contexte de crise et de polarisation croissante, elle voit une menace dans les liens qui perdurent entre le Parti Travailliste et les syndicats.
En conséquence, la bourgeoisie voit dans l’UKIP un moyen de siphonner le Parti Travailliste, tout en mettant la pression aux Conservateurs pour qu’ils aillent encore plus vers la droite. Mais c’est une stratégie très dangereuse. Premièrement, rien ne prouve que les résultats des élections européennes se prolongeront aux élections législatives. Le haut niveau de l’abstention aux élections européennes (66 %) montre que la plupart des gens les considèrent comme inutiles (ce qui est bien compréhensible). Beaucoup se sont abstenus, d’autres ont choisi l’option d’un vote de protestation pour l’UKIP.
Farage déclare ses ambitions pour les prochaines élections. Cependant, il faut noter que sont parti n’a pas réussi à remporter une seule mairie dans tout le pays, lors des récentes élections locales. Il est très peu probable qu’il remporte beaucoup de sièges aux élections législatives. Et comme nombre des voix qu’il recueillera viendront d’électeurs qui jusqu’alors votaient pour les Conservateurs, cela pourrait même profiter au Parti Travailliste.
L’Allemagne
En Allemagne, la désillusion d’une partie de la population vis-à-vis des partis traditionnels qui ont dominés l’Allemagne d’après-guerre s’est exprimée par l’émergence du parti anti-euro « Alternative für Deutschland » (AfD). Cela représente une protestation contre l’élite politique pro-UE et sa gestion de la crise de l’euro. Comme dans les autres pays européens, il y a en Allemagne un désenchantement croissant à l’égard de « l’idéal européen ». La participation aux élections européennes y est passée de 65 % en 1979 à 43 % en 2014.
La classe dirigeante allemande a tiré d’immenses profits de l’UE et de l’euro, mais elle est réticente lorsqu’ il s’agit de payer les factures. Angela Merkel, la vraie dirigeante de l’Europe, prêche les vertus de l’austérité et de la discipline à une Europe de plus en plus irritée par la domination allemande et de plus en plus révoltée par les politiques d’austérité. Ces élections révèlent la ligne de faille qui, à l’avenir, pourrait conduire à l’effondrement de l’euro et même à l’éclatement de l’UE elle-même.
Comme dans les autres pays européens, les démagogues de droite allemands profitent de la crise de l’euro pour gagner du soutien en ravivant le nationalisme allemand. Le professeur d’économie Bernd Lucke, qui dirige l’AfD, dit vouloir une Europe d’Etats-nations, non une Europe fédérale, et promet de faire la guerre à la bureaucratie de Bruxelles. Un de ses opposants politiques l’à récemment qualifié de « fasciste de salon déguisé ». Dans un pays encore hanté par le souvenir du régime nazi, l’AfD suscite de fortes émotions. Les moustaches d’Adolf Hitler ont été taguées sur les affiches de Lucke.
Cette forme allemande de mouvement réactionnaire a quelques traits spécifiques. Alors que tous les autres partis de la droite nationaliste, en Europe, s’opposent d’une manière ou d’une autre à l’immigration, l’AfD défend la liberté de circulation dans l’UE (complétée par une répression des « abus d’aides sociales »). La raison en est très claire : la puissance économique allemande s’est construite dans une large mesure par l’exploitation des travailleurs immigrés. Pour les capitalistes allemands, stopper l’immigration reviendrait à tuer la poule aux œufs d’or.
L’obsession de l’AfD n’est donc pas l’immigration, mais l’euro. Lucke dénonce constamment le fait que l’Allemagne verse des milliards dans les plans de « sauvetage » de la Grèce et d’autres pays endettés de la zone euro. Cette campagne anti-euro « respectable » permet à l’AfD d’attirer un large électorat dans un pays où les partis ouvertement nazis se heurtent aux souvenirs des horreurs du régime d’Hitler.
Tandis que le minuscule parti néo-nazi allemand se base sur les éléments déclassés de la société, l’AfD trouve un écho parmi les mécontents des classes moyennes, des entrepreneurs et des enseignants. Dans les élections parlementaires allemandes de l’année dernière, quand l’AfD se présentait pour la première fois, il a échoué de peu à recueillir les 5 % nécessaires pour entrer dans le Bundestag. L’AfD a pris des voix surtout au parti libéral, le FDP, un parti classique de la classe moyenne.
L’AfD n’est pas un parti fasciste, mais il pourrait être un stimulateur du fascisme à l’avenir. Il compte des éléments fascistes dans ses rangs, notamment dans son organisation de jeunesse, « Junge Alternativ ». Le masque de modération de Lucke est tombé lors de la campagne pour les élections parlementaires, l’année dernière, lorsqu’il a qualifié les immigrés pauvres de « lie de la société ». Mais dans la campagne des élections européennes, le masque est resté fermement en place. Par exemple, Lucke a rejeté la perspective de constituer un groupe avec le Front National français ou l’UKIP britannique, qu’il qualifie de trop extrémistes. Il a tenté de se rapprocher des Conservateurs britanniques, mais ces derniers, craignant de provoquer l’ire de Merkel, on rejeté ses avances, pour le moment.
Quelques autres exemples
Au Portugal, la coalition gouvernementale de droite (PSD-CSD-PP) a été lourdement battue, passant de 40 % (1,4 million de voix) en 2009 à 27,7 % aujourd’hui (900 000 voix). Le Parti Socialiste en sort vainqueur, passant de 26 % à 31 % des voix. Cependant, en nombre de voix, la progression est très modeste (+ 90 000).
A la gauche du PS, le principal bénéficiaire est le Parti Communiste, qui est perçu comme le parti de gauche anti-austérité et anti-UE le plus consistant. Il pas de 10 % en 2009 (380 000 voix) à 12,6 % (416 000 voix). A l’inverse, le Bloc de Gauche a perdu environ 50 % de ses voix, plongeant de 10 % à 4,5%. Si on additionne toutes les voix de gauche, le total est de 48 % des suffrages, contre 46 % en 2009.
La plus grande surprise vient de Belgique, où les électeurs ne votaient pas seulement pour le parlement européen, mais aussi pour les parlements régionaux et fédéraux du pays. Un des éléments les plus importantes de ces élections fut la percée du Parti des Travailleurs de Belgique (PVDA/PTB), une organisation ex-maoïste qui se réclame toujours ouvertement du marxisme, bien que son programme soit désormais essentiellement réformiste de gauche.
Ce parti a obtenu ses meilleurs résultats (9,04 %) à Anvers, la deuxième plus grande ville de Belgique. Cela fait de lui le 4e parti de la ville, devant les Chrétiens-Démocrates, les Libéraux et le parti d’extrême droite Vlaams Belang, lequel était encore récemment cité en exemple de la prétendue « menace fasciste » imminente.
Dans le sud du pays (zone francophone), le PTB a fait de très bons résultats. A Charleroi (ville très ouvrière), il a obtenu 8,81% des voix. A Liège, la plus grande ville du sud, il arrivé en deuxième position dans la ceinture rouge, avec des scores allant de 10 à 20 %, juste derrière le Parti Socialiste.
En conséquence, le PTB, qui est le seul parti de gauche national et bilingue en Belgique, a huit députés dans les différents parlements, dont deux au parlement fédéral (national). C’est la première fois depuis 1985 que des candidats à la gauche du Parti Socialiste son élus députés en Belgique. Ce résultat reflète un changement d’humeur et un mouvement clair vers la gauche dans les quartiers ouvriers, dans les syndicats, notamment le syndicat socialiste (ABVV/FGTB) et dans la société en général. C’est encore un mouvement minoritaire, mais il est significatif.
En Irlande également, la coalition gouvernementale (Labour Party et Fine Gael) a été lourdement battue. Le LP a été particulièrement puni par les électeurs pour sa participation une coalition avec le parti bourgeois Fine Gael, qui a mené toutes les coupes budgétaires exigées par Bruxelles (ce qui a provoqué la démission d’Eamon Gilmore). Le Fine Gael a subi une sévère défaite. Et la victoire électorale revient au Sinn Fein. Il y avait aussi des élections locales, en Irlande, où ces résultats on étés confirmés de façon encore plus nette en termes de conseillers perdus ou gagnés.
Au Danemark, le parti du « Peuple Danois » (extrême-droite) a fait près de 27 % des voix, doublant son nombre de députés européens. Là encore, cela représente un vote de contestation contre le parti Social-démocrate au pouvoir, qui a mené un programme de coupes budgétaires : il a reculé de 20 % par rapport à 2009. Dans le même temps, les principaux partis bourgeois ont aussi enregistré des lourdes pertes et sont dans une crise profonde.
En Finlande, le Parti Finnois (anti-immigration) a gagné deux députés supplémentaires, mais il a reculé en pourcentage depuis les dernières élections nationales. L’Alliance de Gauche retourne au parlement européen avec un député et 9,3 % des voix.
En Suède, le processus n’est pas allé aussi loin que dans les pays voisin, mais le parti d’extrême droite des Démocrates Suédois a remporté deux siège avec 9,7 % des voix. Cette progression découle entièrement du déclin des partis gouvernementaux de droite. Un parti bourgeois traditionnel, les Modérés, a été relégué en troisième position, avec 13,4 % des voix, derrière les Verts et les Sociaux-démocrates. Selon un récent sondage, le gouvernement de coalition n’a plus que 36 % d’opinion favorable.
En Autriche, Parti de la Liberté (FPO, extrême-droite) a beaucoup progressé, recueillant près d’une voix sur cinq. Il passe de deux à quatre députés européens et s’est déclaré prêt à s’unir au Front National français. Parti d’opposition, le FPO s’est concentré sur une démagogie liant les problèmes de l’Autriche aux immigrés et à l’UE. Selon l’Institut Autrichien de Recherches Economiques, le revenu net des travailleurs à diminué tous les ans depuis 2008, excepté en 2009, et est actuellement plus bas qu’à l’époque du lancement de l’euro, en 1999. Malgré cela, les capitalistes sont inquiets du manque de compétitivité de l’Autriche vis-à-vis de ses concurrents.
L’Europe de l’Est
Il est difficile de se faire une idée claire des résultats en Europe de l’Est. Bien que les informations disponibles soient très partielles, certaines tendances sont clairement observables. La première chose, et la plus frappante dans les tendances générales, c’est la très forte abstention dans tous ces pays, même comparée aux taux de participation déjà très faible dans le reste de l’Europe.
La participation moyenne dans les 28 Etats membres de l’UE (le dernier pays entrant étant la Croatie) est de 43,1 % (sensiblement égal à 2009 : 43 %). Mais le taux global de participation en Europe de l’Est est à peine de 28 % : moins d’un électeur sur trois a pris la peine de voter. Cela révèle un profond désintérêt vis-à-vis de l’UE, ainsi qu’une désillusion.
La Slovaquie a été le pays où le taux de participation a été le plus bas : 13 %. Mais même en Pologne, qui semblait être le pays ayant le plus « bénéficié » de son entrée dans l’UE, la participation n’était que de 23 %. « Ceci ne peut qu’être qualifié de catastrophe », a résumé le politologue Martin Klus à TASR newswire.
Il est évident que la colère couve en Europe de l’Est, en réaction à la crise générale du capitalisme et à ses contradictions sociales explosives, qui se sont révélées le plus clairement lors de récents troubles en Bulgarie. Dans la dernière période, les illusions sur le capitalisme ont été définitivement minées, dans un pays après l’autre. Cependant, dans la plupart des pays d’Europe, cette colère n’a pas trouvé d’expression politique.
Avec un taux de participation aussi bas, il est difficile de d’analyser la signification de ces résultats. Toutefois, la tendance générale qui en ressort est la défaite, ou tout au moins l’affaiblissement, des partis de gouvernement. C’est le cas partout, quelle que soit la couleur politique des gouvernements en question. Si on combine ce fait au faible taux de participation, cela indique clairement un accroissement du mécontentement à l’encontre des élites dirigeantes, rapaces et corrompues, qui ont pris le pouvoir après la chute du stalinisme.
Conclusion
Les résultats des élections européennes de 2014 pourraient constituer un tournant historique. Dans des conditions de crise, toutes les contradictions et tous les antagonismes nationaux remontent à la surface. Le processus d’intégration européenne, déjà en difficulté du fait de la crise de l’euro, va s’embourber. Les tensions entre la France et l’Allemagne vont croître ; le fossé entre le Sud et le Nord de l’Europe va se creuser. Une nouvelle récession, inévitable à un certain stade, pourrait mener à la dislocation de l’UE, sous l’impact de tendances protectionnistes.
Au fond, le problème de la bourgeoisie européenne, c’est que la classe ouvrière n’est plus disposée à accepter une politique permanente d’austérité. Les élections européennes de 2014 illustrent, à leur manière, le profond malaise de la société, dont les symptômes se multiplient. Sous la surface, un profond courant de mécontentement, de frustration et de colère cherche une issue. Le problème est qu’aucun parti traditionnel de masse ne donne une expression adéquate à cette colère.
Graduellement, douloureusement, lentement, les masses commencent à comprendre la situation. Elles cherchent une voix, un drapeau et un programme auxquels croire. Mais elles ont tendance à penser qu’elles ne peuvent croire en personne. Les gens, les partis et les institutions qui leur inspiraient le respect, autrefois, ne suscitent plus que leur dégoût. Politiciens, banquiers, juges, police, Eglise, pesse : aucune de ces institutions n’est épargnée par le déclin moral et la corruption. Et comment pourrait-il en être autrement, dans une société elle-même pourrie jusqu’à la moelle ?
Le parti qui a remporté ces élections à une très large majorité est : « Aucun d’entre eux ». Les « experts » des médias et dirigeants des grands partis se plaignent de l’abstention. Mais faut-il s’en étonner – ou s’étonner du fait que de nombreux électeurs aient exprimé leur colère en votant pour des démagogues « anti-système » ? Non. L’abstention massive n’est pas une expression d’apathie, mais au contraire d’une frustration et d’un mécontentement profonds.
Les observateurs superficiels – de droite comme de « gauche » – ne regardent que la surface. Ils prennent les apparences extérieures pour un fait établi et ne voient pas plus loin. Marx était beaucoup plus profond lorsqu’il comparait la révolution à une taupe qui creuse patiemment sous la surface et n’est visible que lorsqu’elle émerge en pleine lumière, à un moment et en un lieu inattendus.
La période actuelle est une période de transition, une période de préparation : la classe ouvrière commence lentement, mais sûrement, à tirer des conclusions de son expérience. La faillite du système capitaliste fait graduellement son chemin dans l’esprit de millions d’hommes et de femmes. La faillite du réformisme également. Il n’y a plus de certitudes et d’idées figées. Les dirigeants ouvriers dont l’autorité était immense, par le passé, sont soumis à un examen scrupuleux. On compare les mots et les actes. Le doute se transforme en malaise, le malaise en mécontentement, le mécontentement en indignation.
Les partis, dirigeants et programmes politiques sont éprouvés et rejetés les uns après les autres. Des partis qui ont dominé la scène pendant de décennies, parfois des générations, se retrouvent balayés du pouvoir et jetés dans la poubelle de l’histoire. Les grandes organisations connaîtront sans cesse des crises, des scissions, des fusions et de nouvelles scissions, dont sortiront de nouvelles formations. Le pendule oscillera vers la droite et vers la gauche ; les dirigeants les plus radicaux remplaceront systématiquement les plus modérés.
Nous sommes entrés dans une période extrêmement instable, une période de révolution et de contre-révolution à l’échelle mondiale. Ces élections montrent l’avenir de l’Europe, mais d’une façon confuse et embryonnaire. Dans la période à venir, ces tendances confuses deviendront plus claires. Seule la faiblesse chronique de la tendance marxiste les empêche de prendre dès à présent une forme cohérente et organisée. C’est notre tâche de dépasser cette faiblesse, de renforcer la tendance marxiste et d’armer le mouvement de seules idées et du seul programme qui peuvent mener à la victoire.
le 29 mai 2014