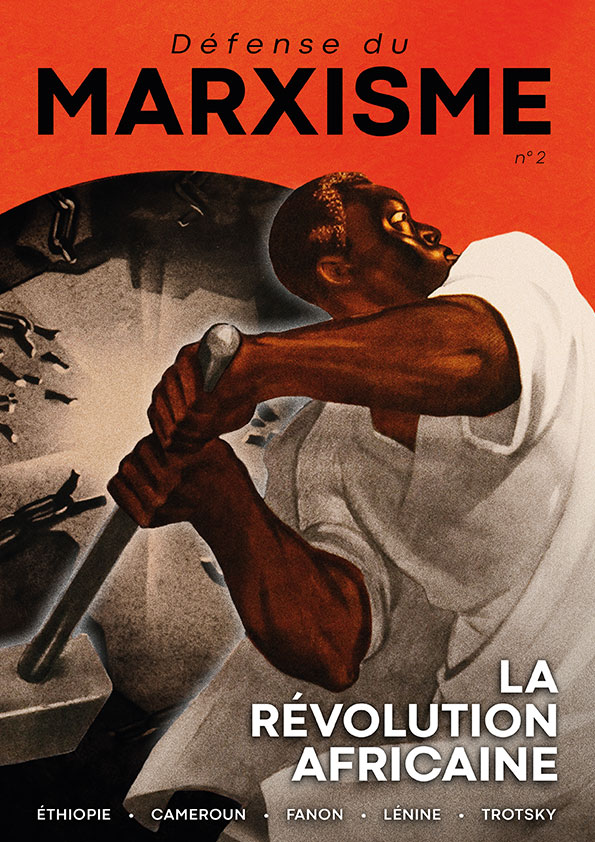Ce texte est la préface à l’édition espagnole de "Où va la France ?" de Trotsky
Les travailleurs français ont de grandes traditions révolutionnaires. Au cours de l’histoire, ils ont tenté à maintes reprises, avec l’élan et l’audace extraordinaires dont ils sont capables, d’en finir avec l’exploitation capitaliste. Il en fut ainsi lors de la Commune de Paris, en 1871, puis en 1936, en 1944-47 et en 1968. Les enseignements de ces événements sont d’une importance cruciale pour tous ceux qui, aujourd’hui, s’engagent dans la lutte contre le capitalisme. Car aujourd’hui encore, des luttes de grande ampleur, en France, attirent régulièrement l’attention des travailleurs du monde. La courbe ascendante des mobilisations de la jeunesse et du mouvement ouvrier français – depuis 1995, mais surtout depuis 2002 – montre que le pays va bientôt connaître une nouvelle confrontation majeure entre les classes, ou plus exactement toute une série de confrontations, au cours desquelles le renversement du capitalisme sera placé à l’ordre du jour comme la tâche pratique immédiate du mouvement syndical, socialiste et communiste.
Le mouvement révolutionnaire dont le point culminant fut la grève générale de mai-juin 1936 a commencé en réaction au soulèvement anti-parlementaire des ligues fascistes, le 6 février 1934. Où va la France ?, et les autres textes de Trotsky concernant cette période, constituent une analyse marxiste de ces événements d’une richesse et d’une clarté exceptionnelles. Une opportunité historique de renverser le capitalisme français – et de porter, par la même occasion, un coup dévastateur au fascisme en Allemagne, en Italie et en Espagne – a été perdue par les dirigeants socialistes et communistes de l’époque, avec des conséquences tragiques pour les travailleurs de France et de toute l’Europe.
La crise économique mondiale annoncée par l’effondrement de la Bourse de Wall Street, en octobre 1929, s’est propagée quasi-immédiatement à la plupart des pays européens. La France en a été relativement épargnée jusqu’à l’automne de 1931. Mais entre 1931 et 1932, la production industrielle a brusquement chuté de 22%, pour stagner durablement à ce même niveau jusqu’en 1940 et au delà.
La crise industrielle frappa la classe ouvrière de plein fouet. Le nombre de chômeurs dépassa les 350 000 en 1932, pour atteindre 826 000 en 1936. Le pouvoir d’achat s’effondrait. Dans les villes comme dans les campagnes, la misère s’étendait. Les classes moyennes (petits paysans, petits propriétaires, boutiquiers, etc.), ruinées ou menacées de l’être, se détournaient massivement du Parti Radical – le principal parti du capitalisme français, à l’époque –, tandis que les organisations fascistes, profitant de l’impuissance du régime parlementaire de la Troisième République, menaient une vive agitation pour son renversement.
La SFIO dans la tourmente
Au Congrès de la SFIO qui avait eut lieu en décembre 1920, à Tours, l’aile droite du parti avait été mise en minorité. Sur les 180 000 adhérents du parti, au moment du congrès, plus de 90 000 l’avaient rejoint depuis 1918. Les nouveaux enrôlés étaient jeunes, révoltés par l’horreur de la guerre qui venait de s’achever, et animés d’une hostilité implacable à l’égard des « socialistes » qui avaient cautionné le carnage au nom de l’« Union Sacrée ». Ils étaient remplis d’enthousiasme pour la révolution russe et l’Internationale Communiste, et encouragés par la puissante vague de grèves et d’agitation sociale qui avait secoué la France au lendemain de la guerre. La scission de Tours a privé l’aile droite du parti des trois-quarts des adhérents, de ses moyens financiers et de son journal, L’Humanité, qui devint l’organe du Parti Communiste naissant. La SFIO conservait 55 des 68 députés élus à l’Assemblée Nationale en 1919, ainsi que presque tous les maires, conseillers municipaux et chefs des fédérations. Ce sont essentiellement les bureaucrates réformistes, soucieux de conserver leurs positions, qui restèrent dans la « vieille maison », soutenus par une fraction minoritaire et largement démoralisée des militants.
Même après la scission, la SFIO connut une longue série de crises internes. Elle était divisée entre son aile gauche, hostile à toute entente avec le Parti Radical, et son aile droite, favorable à un gouvernement de coalition avec les Radicaux. En 1924, le dirigeant radical Edouard Herriot proposa d’inclure la SFIO dans une coalition gouvernementale. Les négociations entre les deux partis échouèrent, mais la direction de la SFIO, autour de Léon Blum, s’engagea néanmoins à soutenir sans réserve le gouvernement Radical. « Nous étions convaincus, écrira-t-il plus tard, que nous apporterions une aide plus forte au Parti Radical en le soutenant de l’extérieur et unanimement, qu’en collaborant avec lui au nom d’un parti incertain et divisé. »
Suite à la prise du pouvoir de Hitler, en Allemagne, les « néo-socialistes » dans la SFIO, autour de Marcel Déat et Adrien Marquet, prônèrent une politique « d’ordre et d’autorité », car ces mots d’ordre, disaient-ils, expliquaient le succès des fascistes. Plus tard, ils deviendront eux-mêmes des fascistes notoires, offrant leurs services aux nazis lors de l’occupation allemande, en 1940 : Marquet comme Ministre de la Justice et Déat comme Ministre du Travail. Les « néo-socialistes » – 22 députés, 7 sénateurs et quelques 20 000 adhérents – rompirent avec la SFIO en octobre 1933. Quelques mois plus tard, le « fouet de la contre-révolution » du 6 février 1934 projetait brusquement la classe ouvrière française sur l’avant-scène de l’histoire.
Le PCF et la « troisième période »
Un an à peine après l’accession au pouvoir des nazis, en Allemagne, la manifestation des fascistes français, armés et de plus en plus nombreux, a envoyé une onde de choc à travers la classe ouvrière française. En Allemagne, la victoire des fascistes avait été grandement facilitée par la division de la classe ouvrière. La politique de la soi-disant « Troisième période » – celle du prétendu « effondrement définitif de l’ordre capitaliste » –, décrétée par les dirigeants staliniens de l’Internationale Communiste, signifiait dans la pratique que les dirigeants communistes allemands excluaient toute action commune entre travailleurs communistes et sociaux-démocrates, ces derniers étant désormais qualifiés de « sociaux-fascistes ». Les chefs de l’Internationale Communiste repoussaient toute possibilité d’accord de combat entre organisations ouvrières.
En France, le PCF suivit une politique analogue jusqu’en 1934. Depuis 1924, la politique du parti se caractérisait par une série de zigzags, et la politique de la « troisième période » ne pouvait qu’aggraver la désorientation des militants. En 1929, Trotsky résumait ainsi la situation : « Les premiers pas du parti avaient été pleins de promesse. La direction de l’Internationale Communiste unissait alors la perspicacité révolutionnaire et l’audace à l’attention la plus profonde aux particularités concrètes de chaque pays. C’est seulement sur cette voie que le succès était possible. Les changements de direction en URSS […] se sont répercutés pernicieusement sur la vie de toute l’Internationale Communiste, le parti français compris. La continuité du développement et de l’expérience fut automatiquement rompue. Ceux qui dirigeaient à l’époque de Lénine le PCF furent non seulement écartés de la direction, mais exclus du parti. On n’admit plus à la direction que ceux qui montraient assez d’empressement à reproduire tous les zigzags de la direction de Moscou. »
En conséquence, de 1925 à 1929, les effectifs du PCF chutèrent de 83 000 à 35 000. La mystification politique sur le thème de la « Troisième période » et l’assimilation des travailleurs socialistes à des « sociaux-fascistes » isolaient de plus en plus le parti de la masse des travailleurs. En 1931-1932, il ne lui restait qu’environ 10 000 adhérents. Le parti risquait de devenir une secte impuissante. Dans un article publié dans La Vérité, le 17 novembre 1933, Trotsky expliquait comment la théorie du « social-fascisme » minait la crédibilité du mouvement communiste aux yeux des travailleurs : « La formule " fascisme ou communisme " est absolument juste, mais seulement en dernière analyse. La politique fatale de l’Internationale Communiste, soutenue par l’autorité de l’Etat ouvrier, n’a pas seulement compromis les méthodes révolutionnaires : elle a donné à la social-démocratie, souillée de crimes et de trahisons, la possibilité de lever de nouveau au-dessus de la classe ouvrière le drapeau de la démocratie bourgeoise comme drapeau du salut.
« Des dizaines de millions de travailleurs sont alarmés jusqu’au tréfonds de leur conscience par le danger du fascisme. Hitler leur a montré de nouveau ce que signifie l’écrasement des organisations ouvrières et des droits démocratiques élémentaires. Les staliniens affirmaient au cours des dernières années qu’entre le fascisme et la démocratie bourgeoise, il n’y avait pas de différence, que le fascisme et la social-démocratie étaient jumeaux. Les ouvriers du monde entier se sont convaincus par la tragique expérience allemande de la criminelle absurdité de tels discours. »
A partir de février 1934, les dirigeants du PCF opèrent un brusque changement d’orientation. Face à la menace mortelle du fascisme, la classe ouvrière française aspirait instinctivement à l’unité dans l’action. Lors des manifestations anti-fascistes du 12 février, à Paris, le cortège des communistes se mêla dans l’enthousiasme, et aux cris d’« unité ! unité ! », à celui des socialistes – que la « ligne » officielle du PCF qualifiait encore de sociaux-fascistes. Les dirigeants du parti ne pouvaient rien faire pour empêcher cette union à la base. La théorie du « social-fascisme », rejetée par la base du mouvement communiste, ne pouvait plus être maintenue.
Cependant, la politique sectaire du PCF a été remplacée, non par le programme d’un front unique révolutionnaire des organisations des travailleurs, mais par une politique de collaboration de classe dictée par Moscou, et dont les conséquences allaient s’avérer désastreuses pour la classe ouvrière française. Maurice Thorez et la direction du PCF prônaient une nouvelle « union sacrée » – rebaptisée « Front Populaire » pour l’occasion. Le Front Populaire incluait non seulement les sociaux-démocrates, mais aussi la classe capitaliste, incarnée par le Parti Radical. Ainsi, les « sociaux-fascistes » et « radicaux-fascistes » d’hier devenaient désormais des alliés de première importance dans la luttecontre le fascisme.
Mais l’abandon de la théorie du « social-fascisme » répondait aussi aux exigences d’un nouveau tournant dans la politique étrangère de l’URSS, qui s’enracinait dans la dégénérescence bureaucratique de la révolution russe. A partir de 1924, l’arrivée au pouvoir de Staline et l’évolution de la politique de l’Etat soviétique, à travers tous ses zigzags, furent la conséquence de l’affirmation progressive du pouvoir de la caste bureaucratique conservatrice, dans le contexte de l’épuisement et l’isolement de la révolution dans un pays arriéré. La théorie du « socialisme dans un seul pays », évoquée par Staline pour la première fois en 1924, puis entérinée comme doctrine officielle de l’Internationale Communiste en 1928, signifiait l’abandon de l’internationalisme révolutionnaire au profit d’une politique au service des intérêts diplomatiques de la bureaucratie soviétique. Trotsky prédisait alors que l’adoption de cette « théorie » par l’Internationale Communiste mènerait inéluctablement à la dégénérescence réformiste et nationaliste de ses sections nationales. Le cours ultérieur des événements, en France comme ailleurs, devait confirmer ce pronostic d’une façon éclatante.
Menacé par l’arrivée au pouvoir de Hitler et le réarmement de l’Allemagne, l’Etat soviétique cherchait le soutien diplomatique de pays européens, dont la Grande-Bretagne et la France. Staline tendait la main aux partis capitalistes partisans de la « sécurité collective ». En mai 1935, le président du Conseil, Pierre Laval, se rendait à Moscou et signait un pacte d’assistance franco-soviétique. Staline déclara alors qu’il approuvait la politique de défense de la France. Immédiatement, le PCF cessa toute activité et propagande anti-militariste, adoptant le drapeau tricolore et La Marseillaise.
Un mois plus tard, la direction du PCF se déclara prête à soutenir un gouvernement capitaliste dirigé par le Parti Radical, « pourvu qu’il remédie à la crise économique et qu’il défende les libertés démocratiques. » Cette déclaration coïncidait avec un appel aux Radicaux de la part de Blum, qui les invita à former « un grand mouvement populaire […] contre les effets économiques, politiques et sociaux de la crise capitaliste ». Le Parti Radical, dévoué corps et âme aux intérêts des capitalistes, devait donc lutter contre les « 200 familles » ! L’alliance avec les Radicaux impliquait la limitation du programme du Front Populaire à des réformes superficielles, ne remettant nullement en cause les intérêts fondamentaux des capitalistes. Le PCF, plus encore que la SFIO, refusait obstinément d’intégrer dans le programme du Front Populaire des mesures susceptibles d’« aliéner les Radicaux ». Thorez insistait sur le fait que la propriété capitaliste de l’industrie et des banques devait être scrupuleusement respectée. L’alliance avec les Radicaux fut consacrée le 14 juillet 1935, au terme d’un défilé « patriotique » dans les rues de Paris. Blum et Thorez marchaient aux côtés du radical Daladier. Fait significatif : à cette date, le Parti Radical faisait encore partie du gouvernement réactionnaire de Pierre Laval, qu’il n’a quitté qu’en janvier 1936. Laval allait, lui aussi – comme Déat et Marquet – participer au régime de Pétain. Il sera fusillé en 1945.
Des élections à la grève générale
Le Front Populaire remporte les élections des 26 avril et 3 mai 1936. Avec 1 955 000 voix – soit un recul de 400 000 voix – les Radicaux sont les grands perdants du scrutin. Mais leur déroute est limitée, au deuxième tour, par les désistements socialistes et communistes en leur faveur, ce qui en fait les arbitres de la Chambre des Députés : aucune majorité n’est possible sans eux. Les Communistes, par contre, récoltent 1 469 000 voix, soit 700 000 de plus qu’au scrutin précédent. La rupture avec les « néo-socialistes » coûte à peine 34 000 voix à la SFIO, qui en totalise 1 977 000, dépassant les Radicaux de 20 000 voix. Avec 146 sièges, la SFIO devient, pour la première fois dans l’histoire du pays, le groupe le plus important à la Chambre. Quant aux Radicaux, ils obtiennent 116 sièges, contre 159 précédemment. Le PCF passe de 10 à 77 sièges.
La Constitution de la Troisième République prévoyait un délai d’un mois entre les élections et la mise en place du nouveau gouvernement. Cette période était généralement consacrée à la paisible attribution des portefeuilles, et autres formalités administratives. Mais en 1936, elle marqua le début du plus grand mouvement révolutionnaire qu’ait connu la France depuis la Commune de Paris. Pendant que Blum, avec l’appui de Thorez et des dirigeants du PCF, s’apprêtait à veiller sur les intérêts du capitalisme en collaboration avec le principal parti capitaliste du pays, la classe ouvrière passait à l’action.
Le 14 mai, les ouvriers métallurgistes de l’usine Bloch se mettent en grève. Ils occupent l’usine nuit et jour. Les gens du voisinage leur apportent vivres et encouragements. La direction de l’usine cède dès le lendemain, accordant aux grévistes une augmentation de salaire et des congés payés. Dans les jours qui suivent, d’autres mouvements de grève se produisent dans le pays, et obtiennent, eux aussi, gain de cause. Ces premières victoires captent l’attention de l’ensemble de la classe ouvrière. Blum, qui s’efforce de rassurer les milieux capitalistes quant à la « modération » de ses intentions, est effrayé par l’ampleur que prend le mouvement. Il appelle les travailleurs à la patience, c’est-à-dire à l’inaction. En vain. Le 26 mai, toutes les usines du secteur automobile – dont les 35 000 ouvriers de l’usine Renault – et de l’aviation du département de la Seine se mettent en grève. La direction de la CGT, réunifiée depuis le mois de mars, sous la direction de Léon Jouhaux, n’est pour rien dans le déclenchement du mouvement, qui s’étend rapidement aux autres industries, y compris aux ouvriers du bâtiment qui travaillent sur les chantiers de l’Exposition Internationale. Jouhaux incite les travailleurs à reprendre le travail, mais ne parvient pas à empêcher l’extension du mouvement. Au-delà des travailleurs industriels, le mouvement de grève gagne des couches de la classe ouvrière jusqu’alors inorganisées et inertes, mais souvent très durement exploitées.
Les signes du réveil révolutionnaire de la classe ouvrière se multiplient. Le 24 mai, lors de la manifestation traditionnelle de commémoration de la Commune de Paris, au Père Lachaise, le nombre de manifestants – qui ne dépassait pas, ordinairement, quelques centaines – avoisine les 600 000 ! Des militaires venus d’une caserne de Versailles portaient une banderole où était écrit : « La soldatesque versaillaise de 1871 assassina la Commune. Les soldats de Versailles de 1936 la vengeront ! »
Les travailleurs réclament des garanties de salaire minimum, la semaine de 40 heures (au lieu de 48), la majoration des heures supplémentaires et des congés payés. Nuit et jour, ils occupent les lieux du travail, tiennent des piquets de grève, créent des comités veillant à l’application des décisions collectives et à la protection de l’outil de travail contre des actes de sabotage ou de malveillance. Le 31 mai, Le Temps, porte-parole de la classe capitaliste, constate avec horreur « l’ordre qui règne dans les usines ». Les travailleurs se comportent, dit le journal, « comme si les usines leur appartenaient déjà ». Le 4 juin, à la veille de l’entrée en fonction du nouveau gouvernement, les grèves s’étendent à pratiquement toutes les industries, et commencent à paralyser l’économie nationale.
Une grève générale illimitée comme celle de 1936 porte la lutte des classes à un niveau qui pose directement la question du pouvoir. Comme le disait Trotsky : « C’est clairement l’union des opprimés contre leurs oppresseurs ». Par sa nature même, la grève générale oblige la classe ouvrière à instaurer son contrôle direct des moyens de production et à assumer progressivement les fonctions de l’Etat. Par l’action vigoureuse des travailleurs, une situation révolutionnaire se crée dans laquelle prend corps – sous une forme embryonnaire – le futur Etat socialiste. Cette menace contre l’existence même du capitalisme était en contradiction complète avec la collaboration de classe incarnée par le Front Populaire. La grève générale effrayait non seulement la classe capitaliste et ses représentants à la tête du Parti Radical, mais aussi les architectes « socialistes » et « communistes » du Front Populaire. Thorez avait insisté pour qu’aucune atteinte ne soit pas portée à la propriété capitaliste – et voilà que les ouvriers s’emparaient directement de cette propriété !
Les appels au calme, à la modération et à la reprise du travail, de la part des dirigeants de la CGT, de Blum et de Thorez, restent d’abord sans effet. Thorez insiste sur le fait que la situation « n’est pas révolutionnaire », et met les travailleurs en garde contre le danger de « jouer le jeu du fascisme ». Mais les travailleurs ne tiennent pas compte des consignes de leurs « dirigeants ». Lorsque Blum envoie le dirigeant syndical communiste Henri Reynaud, accompagné de Jules Moch (secrétaire général du gouvernement), pour obtenir des grévistes une livraison de mazout nécessaire aux boulangers de la capitale, ils reviennent les mains vides, les ouvriers n’ayant même pas voulu leur ouvrir la porte.
Le 6 juin, le nombre de grévistes s’élève à plus de 500 000. Le 7 juin, il s’approche du million. Le patronat craint que la poursuite du mouvement de grève n’aboutisse à une révolution et à la fin de la propriété capitaliste. Pris de panique, et pour aider les dirigeants de la CGT à mettre un terme au mouvement, le gouvernement Blum organise des négociations à l’Hôtel Matignon, le 7 juin. Quand ils sont sous la menace de tout perdre, les capitalistes font toujours de concessions, quitte à les reprendre plus tard, lorsque la menace est écartée. C’est dans cet état d’esprit que le patronat, représenté par la CGPF, aborde les négociations de Matignon. Blum tente de limiter les concessions faites en matière salariale, qui sont finalement de l’ordre de 7 à 12% dans le secteur privé. Le patronat concède également la semaine de 40 heures et 2 semaines de congés payés, ainsi que le principe des accords collectifs et de nouveaux droits syndicaux.
Dans son discours à la Chambre des Députés, Blum se dit « fier » des accords de Matignon, mais souligne ce que tout le monde sait déjà : « La crise n’est pas terminée ». Il faut rapidement promulguer les lois concernant les réformes promises. « Nous sommes, vous le savez, Messieurs, dans des circonstances où chaque heure compte. » En effet, les accords de Matignon ne mettent pas fin au mouvement de grève, et ne permettent pas de rétablir l’autorité des dirigeants socialistes, communistes et syndicaux. Bien au contraire, les grèves redoublent d’intensité. La CGT a vu le nombre de ses adhérents s’accroître dans des proportions inédites : elle passe d’un million à 5 300 000. Les métallurgistes de la région parisienne refusent les accords et votent la poursuite de la grève. Le nombre de grévistes augmente non seulement dans l’industrie et le commerce, mais aussi en milieu rural, où des milliers d’ouvriers agricoles occupent les grandes fermes. A Paris et dans de nombreuses villes de province, des cafés, des hôtels et des restaurants sont occupés par les salariés. Ici et là commencent à émerger des organisations comparables aux soviets de la révolution russe. Par exemple, le 8 juin, dans l’usine Hotchkiss, à Levallois, dans la banlieue nord-ouest de Paris, une assemblée regroupant les délégués de 33 usines des environs vote une résolution demandant l’élection d’un « comité central de grève » Le 11 juin, toutes les principales industries de Paris et du département de la Seine sont en grève, et une nouvelle assemblée de 587 délégués représentant 243 usines de la région parisienne se tient dans la capitale. Le nombre total de grévistes, même selon les chiffres du gouvernement, s’approche de 1 200 000. Blum met des troupes et des gardes mobiles en alerte, prêts à marcher sur Paris pour réprimer la grève, et ne cesse de répéter que son gouvernement fera respecter « l’ordre ».
Les travailleurs se heurtent sans cesse aux directions de leurs propres organisations, qui veulent toutes défendre la propriété privée et faire en sorte que cesse le mouvement de grève. Le 11 juin, Thorez s’adresse aux métallurgistes. Il les met en garde contre le risque, selon lui, d’effrayer la petite bourgeoisie et de briser le Front Populaire, en « aggravant le désordre ». « Il faut savoir consentir aux transactions, il faut savoir terminer une grève », dit-il, car « l’heure de la révolution n’est pas venue. » De nouveaux secteurs de la classe ouvrière, comme par exemple les employées des grands magasins de Paris, se lancent dans la lutte au lendemain de l’intervention de Thorez qui, pourtant, cherchait à y mettre un terme. Cependant, au cours des deux semaines suivantes, du fait du comportement traître des dirigeants des organisations syndicales et politiques des travailleurs, le mouvement de grève finit par s’épuiser.
Le gouvernement du Front Populaire ne dura que douze mois, jusqu’en juin 1937. Le capitalisme français lui doit sa survie. Plus tard, Blum évoquera son rôle en 1936 dans les termes suivants : « A cette époque-là, parmi la bourgeoisie et particulièrement dans les milieux patronaux, on comptait sur moi et on mettait son espoir en moi comme dans un sauveur. La situation était si angoissante et le pays si près de la guerre civile qu’on ne pouvait plus espérer qu’en une intervention providentielle : la venue d’un homme à qui l’on attribuait assez de pouvoir de persuasion et d’influence sur la classe ouvrière pour lui faire entendre la voix de la raison afin qu’elle n’use ni abuse de sa force. » Dans les faits, Blum n’aurait jamais pu sauver le capitalisme français, en 1936, sans le comportement tout aussi traître de Maurice Thorez.
Léon Trotsky est arrivée en France en juillet 1933, après avoir quitté son lieu d’exil sur l’île de Prinkipo, au large d’Istanbul. Expulsé de France pour la deuxième fois en juin 1935 – il l’avait déjà été en 1916, du fait de son activité d’opposition internationaliste à la guerre – il se rend d’abord en Norvège, puis au Mexique. En France, la réaction a relevé la tête. Les concessions obtenues en juin 1936 sont annulées les unes après les autres. Blum a abandonné les travailleurs espagnols à leur sort, et ses successeurs ne cachent pas leur soutien aux forces franquistes. En France, grévistes et manifestants sont violemment réprimés par la police et les bandes réactionnaires. Les banques et les grands industriels finançaient et armaient des organisations fascistes, dont notamment le PPF dirigé par l’ex-communiste Jacques Doriot. En juin 1940, le régime dictatorial de Pétain couronne le triomphe de la contre-révolution. Quelques semaines plus tard, Trotsky est assassiné, au Mexique, par un agent de Staline. Dans un texte inachevé publié après sa mort, on trouve les lignes suivantes sur la situation en France :
« En France, il n’y a pas de fascisme au sens véritable du terme. Le régime du sénile Maréchal Pétain représente une forme sénile du bonapartisme à l’époque du déclin de l’impérialisme. Mais ce régime lui-même ne fut rendu possible qu’après que la radicalisation prolongée de la classe ouvrière qui aboutit à l’explosion de juin 1936 ait échoué à trouver une issue révolutionnaire. Les IIe et IIIe internationales, et le charlatanisme réactionnaire du " Front Populaire ", ont déçu et démoralisé la classe ouvrière. Après cinq ans de propagande en faveur d’une alliance des démocraties et de la sécurité collective, après le passage soudain de Staline dans le camp de Hitler, la classe ouvrière française se trouva prise au dépourvu. La guerre provoqua une désorientation terrible et un état d’esprit de défaitisme passif ou, pour s’exprimer plus justement, d’indifférence devant une impasse. De ce tissu de circonstances surgirent d’abord une catastrophe militaire sans précédent, puis le méprisable régime de Pétain. Précisément parce que le régime du Pétain est du bonapartisme sénile, il ne contient aucun élément de stabilisation et peut être renversé par un soulèvement révolutionnaire bien plus vite qu’un régime fasciste. » Le soulèvement auquel Trotsky s’attendait eut lieu en août 1944.
70 ans plus tard
Le développement industriel de la France depuis la deuxième guerre mondiale a entraîné une modification profonde dans les rapports entre la classe capitaliste et le salariat, qui constitue aujourd’hui 86% de la population active. Ces sont les salariés qui assurent toutes les fonctions essentielles de la société. Jamais, dans l’histoire de la France, le salariat n’a été aussi puissant, y compris sur le plan numérique. L’accroissement de la technologie dans le processus productif et l’évolution de la division du travail correspondant font que les différentes formes d’activité économique et sociale ont atteint un degré d’interdépendance sans précédent, de sorte que le lancement d’une grève dans un secteur donné – même s’il n’emploie qu’un nombre relativement faible de salariés – peut très rapidement mener à la paralysie de pans entiers de l’économie. La concentration des moyens de production et la division du travail qui accompagnent le développement du capitalisme se traduisent par un accroissement du poids social et économique du salariat, et donc de son pouvoir potentiel, au détriment de toutes les autres classes sociales.
Dans les années 1930, la population urbaine ne constituait toujours que la moitié de la population totale. Aujourd’hui, la population « rurale » proprement dite ne représente pas plus de 6% de la population totale – et parmi les actifs de cette petite minorité, 85% sont des salariés. L’érosion des couches intermédiaires de la société signifie que la forme la plus extrême de la réaction capitaliste – l’instauration d’un régime fasciste – est désormais impossible en France. La base sociale nécessaire au développement d’un mouvement fasciste de masse n’existe plus.
Marx disait que la lutte des classes est toujours menée jusqu’à son terme, en France. A son époque, la place encore prépondérante de la paysannerie dans l’économie et dans l’armée signifiait qu’un mouvement révolutionnaire urbain qui ne parvenait pas à s’attirer rapidement le soutien des couches inférieures de la petite bourgeoisie était inévitablement écrasé. Les événements de février-juin 1848 et l’expérience de la Commune de 1871 illustrent bien cette tragique réalité. A partir de juin 1936, il n’a fallut que 12 mois pour que le rapport de force s’inverse radicalement en faveur de la classe capitaliste. Dans les conditions de notre époque, cependant, le poids social écrasant du salariat fait que, dès lors que le processus révolutionnaire sera sérieusement engagé, le salariat aura non pas une, mais toute une série d’opportunités pour prendre le pouvoir – sans que, dans les temps de reflux, la classe capitaliste puisse inverser de manière décisive la situation en sa faveur. La révolution de 1968, comme celle de 1936, a été avortée par la direction défaillante du PCF. Mais déjà, le cours des événements qui suivirent la défaite de 1968 illustrait les limites imposées à la réaction par le nouveau rapport de force entre les classes. Ces limites sont encore plus étroites aujourd’hui.
Ainsi, de nos jours, le mouvement ouvrier français affronte le capitalisme dans un contexte national et international infiniment plus favorable que celui des années 30. Les prémisses fondamentales de la prochaine révolution française résident dans l’incapacité du capitalisme à développer l’économie, dans son déclin en tant que puissance mondiale et dans la régression sociale permanente qu’il impose à la masse de la population. La grève générale des transports, en 1995, la défaite de la droite aux élections législatives de 1997, la vague de grèves pour la mise en application de la semaine des 35 heures, les grèves dans l’Education nationale, les manifestations colossales contre le Front National lors des élections présidentielles, en 2002, ou encore les mobilisations contre la réforme de retraites, contre la Constitution Européenne et le « Contrat Première Embauche » (CPE) en 2003, 2005 et 2006, sont autant de signes précurseurs de l’immense confrontation entre les classes qui se prépare.
La révolution qui approche sera « nationale » uniquement dans le sens où sa tâche immédiate sera de mettre fin à l’emprise de la classe capitaliste française sur l’économie, sur l’administration, sur les forces armées et la police, et sur tous les autres instruments de son pouvoir. Mais elle sera, dès le premier jour, un événement international, dans ses causes fondamentales comme dans ses conséquences à court terme. Elle secouera l’ordre capitaliste et soulèvera un enthousiasme massif à travers l’Europe et le monde entier.
L’étude des leçons de 1936 n’a rien d’un exercice académique. Elle doit servir à préparer la nouvelle génération de révolutionnaires aux épreuves qui les attendent dans un proche avenir. Car la victoire n’est pas garantie d’avance. Tout comme une armée a besoin de généraux, de théoriciens et de stratèges ayant assimilé les leçons des guerres passées, les travailleurs auront eux aussi besoin, dans la confrontation décisive entre les classes qui s’annonce, de dirigeants qui incarnent l’expérience historique du mouvement ouvrier international, pourvus d’un tempérament révolutionnaire intransigeant et d’une confiance inébranlable dans la capacité de la classe ouvrière à s’emparer du pouvoir, à organiser la société sur de nouvelles bases et à ouvrir une nouvelle ère dans l’histoire de l’humanité – celle du socialisme international.