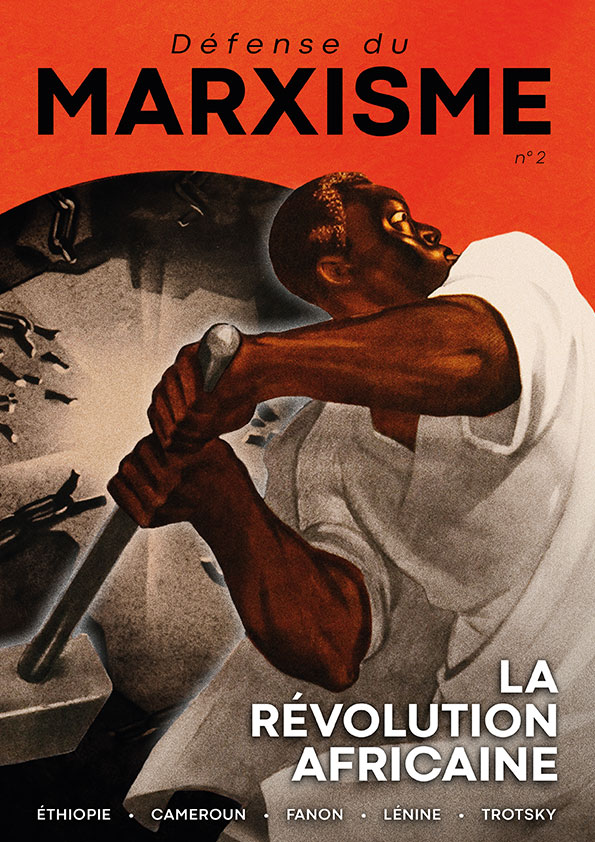Voici un véritable programme politique et économique, rédigé à la veille de la révolution d’Octobre. Lénine l’écrivit mi-septembre, de son exil en Finlande. Il fut publié en octobre sous forme de brochure.
Dans ce classique du marxisme, Lénine décrit d’abord la grave crise économique qui frappait la Russie, résultat de l’activité prédatrice de la bourgeoise, de la complète inactivité des partis réformistes et de la poursuite de la guerre impérialiste. Le pays était menacé d’un écroulement économique complet. La bourgeoisie sabotait délibérément la production avec l’espoir que le chaos économique et la famine détruiraient la révolution.
Dans ce contexte, Lénine formula des revendications transitoires correspondant à l’urgence de la situation. Il lança un appel à la nationalisation des banques et des autres grandes entreprises capitalistes, à l’intervention des travailleurs dans la gestion et le contrôle de la production, à la levée du secret commercial et à la confiscation des terres des grands propriétaires fonciers. Il conclut : seule une révolution socialiste, menée par la classe ouvrière avec le soutien de la paysannerie pauvre, pourra éviter la catastrophe : « Périr ou s’élancer en avant à toute vapeur. C’est ainsi que l’histoire pose la question. »
La famine approche
La Russie est menacée d’une catastrophe certaine. Les transports ferroviaires sont incroyablement désorganisés, et cette désorganisation s’aggrave. Les chemins de fer vont s’arrêter. Les arrivages de matières premières et de charbon pour les usines cesseront. De même, les arrivages de céréales. Sciemment, sans relâche, les capitalistes sabotent (gâchent, arrêtent, sapent, freinent) la production dans l’espoir que cette catastrophe sans précédent entraînera la faillite de la République et de la démocratie, des Soviets, et, en général, des associations prolétariennes et paysannes, en facilitant le retour à la monarchie et la restauration de la toute-puissance de la bourgeoisie et des grands propriétaires fonciers.
Une catastrophe d’une ampleur inouïe et la famine nous menacent inéluctablement. Tous les journaux l’ont dit et mille fois. Un nombre incroyable de résolutions ont été adoptées par les différents partis et par les Soviets des députés ouvriers, soldats et paysans ; ces résolutions reconnaissent que la catastrophe est certaine, qu’elle est imminente, qu’il faut la combattre énergiquement, que le peuple doit faire des « efforts héroïques » pour conjurer le désastre, etc.
Tout le monde le dit. Tout le monde le reconnaît. Tout le monde l’affirme. Et l’on ne fait rien.
Six mois de révolution ont passé. La catastrophe s’est encore rapprochée. Un chômage massif pèse sur nous. Songez un peu : le pays souffre d’une pénurie de marchandises, le pays se meurt par manque de denrées alimentaires, par manque de main-d’œuvre alors qu’il y a en suffisance du blé et des matières premières ; et c’est dans un tel pays, dans un moment aussi critique, que le chômage est devenu massif ! Quelle preuve faut‑il encore pour démontrer qu’en six mois de révolution (une révolution que d’aucuns appellent grande, mais que pour l’instant il serait peut-être plus juste d’appeler une révolution pourrie), alors que nous sommes en république démocratique, alors que foisonnent les associations, organisations et institutions qui s’intitulent fièrement « démocratiques révolutionnaires », rien, absolument rien de sérieux n’a été fait pratiquement contre la catastrophe, contre la famine ? Nous courons de plus en plus vite à la faillite, car la guerre n’attend pas et la désorganisation qu’elle entraîne dans toutes les branches de la vie nationale s’aggrave sans cesse.
Or, il suffit d’un minimum d’attention et de réflexion pour se convaincre qu’il existe des moyens de combattre la catastrophe et la famine, que les mesures à prendre sont tout à fait claires, simples, parfaitement réalisables, pleinement à la mesure des forces du peuple, et que si ces mesures ne sont pas prises, c’est uniquement, exclusivement parce que leur application porterait atteinte aux profits exorbitants d’une poignée de grands propriétaires fonciers et de capitalistes.
C’est un fait. On peut affirmer en toute certitude que vous ne trouverez pas un seul discours, un seul article de journal de quelque tendance qu’il soit, une seule résolution d’une assemblée ou d’une institution quelconque, qui ne reconnaisse en termes parfaitement clairs et précis la nécessité de la mesure de lutte fondamentale, essentielle, propre à conjurer la catastrophe et la famine. Cette mesure, c’est le contrôle, la surveillance, le recensement, la réglementation par l’État ; la répartition rationnelle de la main-d’œuvre dans la production et la distribution des produits, l’économie des forces populaires, la suppression de tout gaspillage de ces forces, qu’il faut ménager. Le contrôle, la surveillance, le recensement, voilà le premier mot de la lutte contre la catastrophe et la famine. Personne ne le conteste, tout le monde en convient. Mais c’est justement ce qu’on ne fait pas, de crainte d’attenter à la toute-puissance des grands propriétaires fonciers et des capitalistes, aux profits démesurés, inouïs, scandaleux qu’ils réalisent sur la vie chère et les fournitures de guerre (et presque tous « travaillent » aujourd’hui, directement ou indirectement, pour la guerre) profits que tout le monde connaît, que tout le monde peut constater et au sujet desquels tout le monde pousse des « oh ! » et des « ah ! ».
Et l’État ne fait absolument rien pour établir un contrôle, une surveillance et un recensement tant soit peu sérieux.
Inaction totale du gouvernement
Partout c’est le sabotage systématique, incessant, de tout contrôle, de toute surveillance et de tout recensement, de toute tentative faite par l’État pour organiser ce travail. Et il faut être incroyablement naïf pour ne pas comprendre – ou profondément hypocrite pour feindre de ne pas comprendre – d’où vient ce sabotage, par quels moyens il est perpétré. Car ce sabotage exercé par les banquiers et les capitalistes, ce torpillage par eux de tout contrôle, de toute surveillance, et de tout recensement, s’adapte aux formes d’État de la République démocratique, à l’existence des institutions « démocratiques révolutionnaires ». Messieurs les capitalistes se sont merveilleusement assimilé une vérité que reconnaissent en paroles tous les partisans du socialisme scientifique, mais que les mencheviks et les socialistes‑révolutionnaires se sont efforcés d’oublier dès que leurs amis ont reçu des sinécures de ministres, de sous‑secrétaires d’État, etc. À savoir que la nature économique de l’exploitation capitaliste n’est aucunement affectée par la substitution de formes de gouvernement démocratiques républicaines aux formes monarchistes ; et que, par conséquent et inversement, il suffit de modifier la forme de la lutte en faveur de l’intangibilité du sacro‑saint profit capitaliste pour le sauvegarder en régime de république démocratique avec le même succès que sous la monarchie autocratique.
Le sabotage sous sa forme moderne, la plus récente, le sabotage démocratique républicain de tout contrôle, de tout recensement, de toute surveillance, consiste en ceci : les capitalistes (de même, bien entendu, que tous les mencheviks et socialistes‑révolutionnaires) reconnaissent « avec ardeur », en paroles, le « principe » du contrôle et sa nécessité, mais ils insistent sur son application « graduelle », méthodique, « réglée par l’État ». Or, pratiquement, ces belles paroles masquent le torpillage du contrôle qui est réduit à rien, à une fiction, à une comédie ; toutes les mesures sérieuses et pratiques sont indéfiniment différées ; on crée des appareils de contrôle extraordinairement compliqués, lourds, bureaucratiques et inertes, qui dépendent entièrement des capitalistes, ne font absolument rien et ne peuvent absolument rien faire.
Pour ne pas avancer d’affirmations gratuites, nous invoquerons le témoignage des mencheviks et des socialistes-révolutionnaires, c’est-à-dire précisément de ceux qui ont eu la majorité dans les Soviets pendant le premier semestre de la révolution, qui ont participé au « gouvernement de coalition » et qui, par suite, sont politiquement responsables, devant les ouvriers et les paysans russes, des complaisances envers les capitalistes, du torpillage de tout contrôle par ces derniers.
L’organe officiel le plus haut placé de tous les organes dits « habilités » (ne riez pas !) de la démocratie « révolutionnaire » – les Izvestia du C.E.C. (c’est-à-dire du Comité exécutif central du Congrès des Soviets des députés ouvriers, soldats et paysans de Russie) – publie dans son n°164, daté du 7 septembre 1917, une décision émanant d’une institution spéciale, créée aux fins de contrôle par ces mêmes mencheviks et socialistes‑révolutionnaires et qui se trouve entièrement entre leurs mains. Cette institution spéciale, c’est la « Section économique » du Comité exécutif central. La décision reconnaît officiellement, comme un fait acquis, « l’inaction totale des organismes centraux constitués auprès du gouvernement et chargés de réglementer la vie économique ».
En vérité, peut‑on imaginer témoignage plus éloquent, signé de la main des mencheviks et des socialistes‑révolutionnaires eux-mêmes, attestant la faillite de leur politique ?
Même sous le tsarisme on avait reconnu la nécessité de réglementer la vie économique, et plusieurs institutions avaient été créées à cet effet. Mais, sous le tsarisme, la désorganisation n’avait cessé de croître, atteignant des proportions fantastiques. Il fut reconnu d’emblée que la tâche du gouvernement républicain, révolutionnaire, était de prendre des mesures sérieuses, énergiques, pour mettre fin au marasme économique. Lorsque se forma le gouvernement de « coalition », auquel participaient mencheviks et socialistes‑révolutionnaires, il prit l’engagement, dans la déclaration solennelle qu’il adressa au peuple en date du 6 mai, d’instituer le contrôle et la réglementation de la vie économique par l’État. Les Tseretelli et les Tchernov, de même que tous les autres dirigeants mencheviks et socialistes‑révolutionnaires, jurèrent leurs grands dieux que non seulement ils répondaient du gouvernement, mais que les « organismes habilités de la démocratie révolutionnaire », qui se trouvaient entre leurs mains, surveillaient et contrôlaient effectivement l’activité du gouvernement.
Quatre mois se sont écoulés depuis le 6 mai, quatre longs mois pendant lesquels la Russie a sacrifié des centaines de milliers de ses soldats dans une absurde « offensive » impérialiste, pendant lesquels la ruine économique et la catastrophe se sont rapprochées à pas de géant, alors que la saison d’été permettait de tirer largement parti des transports par eau, de l’agriculture, des prospections géologiques, etc., etc., et au bout de ces quatre mois, les mencheviks et les socialistes‑révolutionnaires se voient obligés de reconnaître officiellement l’« inaction totale » des organismes de contrôle formés auprès du gouvernement !!
Et ces mencheviks et socialistes‑révolutionnaires prétendent maintenant, avec un air sérieux d’hommes d’État (nous écrivons ces lignes juste à la veille de la Conférence démocratique du 12 septembre[1]), qu’il est possible de remédier la situation en remplaçant la coalition avec les cadets, par une coalition avec les gros bonnets de l’industrie et du commerce, les Kit Kitytch[2], les Riabouchinski, les Boublikov, les Terechtchenko et Cie !
On se demande : comment expliquer cet aveuglement stupéfiant des mencheviks et des socialistes‑révolutionnaires ? Faut‑il les considérer comme des nouveau-nés en politique qui, par candeur et déraison extrêmes, ne savent ce qu’ils font et se trompent de bonne foi ? Ou l’abondance des sinécures de ministres, de sous‑secrétaires d’État, de gouverneurs généraux, de commissaires, etc., aurait‑elle la propriété d’engendrer une cécité particulière, « politique » ?
Les mesures de contrôle sont universellement connues et faciles à réaliser
Mais, pourra‑t‑on se demander, les moyens et mesures de contrôle ne sont‑ils pas une chose extrêmement compliquée, difficile, encore non expérimentée, voire inconnue ? Les atermoiements ne s’expliquent‑ils pas par le fait que les hommes d’État du parti cadet, de la classe industrielle et commerçante, des partis socialistes-révolutionnaire et menchévique, ont beau peiner depuis six mois, à la sueur de leur front, sur la recherche, l’étude, la découverte des mesures et moyens de contrôle, le problème se révèle incroyablement difficile et n’est toujours pas résolu ?
Hélas ! C’est sous cet aspect qu’on s’efforce de présenter les choses, en « faisant marcher » le moujik inculte, ignorant et abêti, et le philistin qui croit tout et n’approfondit rien. Mais en réalité, même le tsarisme, même l’« ancien régime », lorsqu’il créa les comités des industries de guerre[3], connaissait la mesure essentielle, le principal procédé et moyen d’exercer le contrôle, qui consiste à associer la population par professions, par objectifs de travail, par branches d’activité, etc. Mais le tsarisme redoutait l’association de la population ; c’est pourquoi il restreignait de toutes les manières et entravait artificiellement l’emploi de ce procédé et moyen de contrôle universellement connu, éminemment facile et parfaitement applicable.
Accablés par les charges extrêmes et les calamités de la guerre, souffrant dans une plus ou moins grande mesure du marasme économique et de la famine, tous les États belligérants ont depuis longtemps établi, défini, appliqué, essayé toute une série de mesures de contrôle, qui, presque toujours, reviennent à associer la population, à créer ou encourager des associations de toute sorte, surveillées par l’État, auxquelles participent ses représentants, etc. Toutes ces mesures de contrôle sont universellement connues, on en a beaucoup parlé et on a beaucoup écrit à leur sujet ; les lois sur le contrôle, édictées par les puissances belligérantes avancées, ont été traduites en russe ou exposées en détail dans la presse russe.
Si notre gouvernement voulait réellement appliquer le contrôle de façon sérieuse et pratique, si ses institutions ne s’étaient pas condamnées, par leur servilité envers les capitalistes, à une « inaction totale », l’État n’aurait qu’à puiser des deux mains dans l’abondante réserve des mesures de contrôle déjà connues, déjà appliquées. Le seul empêchement à cela, empêchement que les cadets, les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks dissimulent aux yeux du peuple, a été et reste que le contrôle mettrait en évidence les profits fabuleux des capitalistes et leur porterait atteinte.
Pour mieux faire comprendre cette question capitale (qui est en somme la question du programme de tout gouvernement vraiment révolutionnaire, désireux de sauver la Russie de la guerre et de la famine), nous allons énumérer ces principales mesures de contrôle et les examiner l’une après l’autre.
Nous verrons qu’il aurait suffi à un gouvernement intitulé démocratique révolutionnaire autrement que par dérision de décréter (d’ordonner, de prescrire), dès la première semaine de son existence, l’application des principales mesures de contrôle, d’établir des sanctions sérieuses, des sanctions d’importance, contre les capitalistes qui essaient de se soustraire frauduleusement à ce contrôle, et d’inviter la population à surveiller elle-même les capitalistes, à veiller à ce qu’ils se conforment scrupuleusement aux décisions sur le contrôle, pour que celui-ci soit depuis longtemps appliqué en Russie.
Ces principales mesures sont :
- La fusion de toutes les banques en une seule dont les opérations seraient contrôlées par l’État, ou la nationalisation des banques.
- La nationalisation des syndicats capitalistes, c’est-à-dire des groupements monopolistes capitalistes les plus importants (syndicats du sucre, du pétrole, de la houille, de la métallurgie, etc.).
- La suppression du secret commercial.
- La cartellisation forcée, c’est-à-dire l’obligation pour tous les industriels, commerçants, patrons en général, de se grouper en cartels ou syndicats.
- Le groupement obligatoire ou l’encouragement au groupement de la population en sociétés de consommation, et un contrôle exercé sur ce groupement.
Voyons maintenant la portée qu’aurait chacune de ces mesures, à la condition d’être appliquée dans un esprit démocratique et révolutionnaire.
Nationalisation des banques
Les banques, on le sait, constituent les foyers de la vie économique moderne, les principaux centres nerveux de tout le système capitaliste d’économie. Parler de la « réglementation de la vie économique » et passer sous silence la nationalisation des banques, c’est ou bien faire preuve de l’ignorance la plus crasse ou bien tromper le « bon peuple » avec des paroles pompeuses et des promesses grandiloquentes, que l’on est décidé par avance à ne point tenir.
Contrôler et réglementer les livraisons de blé ou en général la production et la répartition des produits, sans contrôler, sans réglementer les opérations de banque, est un non-sens. C’est faire la chasse à des « kopecks » problématiques et fermer les yeux sur des millions de roubles. Les banques modernes ont si intimement, si indissolublement fusionné avec le commerce (du blé comme de tout autre produit) et l’industrie que, sans « mettre la main » sur les banques, il est absolument impossible de rien faire de sérieux, qui soit vraiment « démocratique et révolutionnaire ».
Mais peut-être cette « mainmise » de l’État sur les banques est‑elle une opération très difficile et très compliquée ? C’est précisément par des arguments de ce genre que l’on cherche d’ordinaire à faire peur aux philistins. Ce sont, bien entendu, les capitalistes et leurs défenseurs qui s’y emploient, car ils y trouvent leur avantage.
En réalité, la nationalisation des banques, qui n’enlève pas un seul kopeck à aucun « possesseur », ne présente absolument aucune difficulté au point de vue de la technique ou de la culture ; elle est entravée uniquement par la cupidité sordide d’une infinie poignée de richards. Si l’on confond aussi souvent la nationalisation des banques avec la confiscation des biens privés, la faute en est à la presse bourgeoise qui répand cette confusion, son intérêt étant de tromper le public.
La propriété des capitaux concentrés dans les banques et avec lesquels celles‑ci opèrent, est certifiée par des attestations imprimées ou manuscrites, appelées actions, obligations, lettres de change, reçus, etc. Aucune de ces attestations n’est annulée ni modifiée par la nationalisation des banques, c’est-à-dire par leur fusion en une seule banque d’État. L’individu qui avait 15 roubles sur son livret de caisse d’épargne reste possesseur de ces 15 roubles après. la nationalisation des banques, et celui qui possédait 15 millions garde également, après la nationalisation des banques, ces 15 millions sous forme d’actions, d’obligations, de lettres de change, de warrants, etc.
Quelle est donc la portée de la nationalisation des banques ?
C’est qu’aucun contrôle effectif des différentes banques et de leurs opérations n’est possible (même si le secret commercial est supprimé, etc.) ; car on ne peut suivre les procédés extrêmement complexes, embrouillés et subtils employés pour établir les bilans, fonder des entreprises et des filiales fictives, faire intervenir des hommes de paille, etc., etc. Seule la réunion de toutes les banques en une banque unique, sans signifier par elle-même le moindre changement dans les rapports de propriété, sans enlever – répétons-le – un seul kopeck à aucun possesseur, rend possible le contrôle effectif à la condition bien entendu que soient appliquées toutes les autres mesures indiquées plus haut. Seule la nationalisation des banques permet d’obtenir que l’État sache où et comment, de quel côté et à quel moment passent les millions et les milliards. Seul le contrôle exercé sur les banques – ce centre, ce principal pivot et ce mécanisme essentiel du trafic capitaliste – permettrait d’organiser, en fait et non en paroles, le contrôle de toute la vie économique, de la production et de la répartition des principaux produits ; il permettrait d’organiser la « réglementation de la vie économique », qui, sans cela, est infailliblement vouée à n’être qu’une phrase ministérielle destinée à duper le bon peuple. Seul le contrôle des opérations de banque, à la condition qu’elles soient effectuées dans une seule banque d’État, permet d’organiser, grâce à des mesures ultérieures facilement applicables, la perception effective de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit possible de dissimuler les biens et revenus ; car aujourd’hui, cet impôt n’est la plupart du temps qu’une fiction.
Il suffirait de décréter purement et simplement la nationalisation des banques ; les directeurs et les employés la réaliseraient eux-mêmes. Ici, point n’est besoin pour l’État d’aucun appareil spécial, d’aucune préparation spéciale, cette mesure pouvant précisément être réalisée par un seul décret, « d’un seul coup ». Car la possibilité économique d’une telle mesure a été créée justement par le capitalisme qui, dans son développement, en est arrivé aux lettres de change, aux actions, aux obligations, etc. Il ne reste ici qu’à unifier la comptabilité ; et si l’État démocratique révolutionnaire décidait la convocation immédiate – par télégraphe – d’assemblées des directeurs et des employés dans chaque ville et de congrès dans chaque région et dans tout le pays, pour la fusion immédiate de toutes les banques en une seule banque d’État, cette réforme serait accomplie en quelques semaines. Il va de soi que ce sont précisément les directeurs et les cadres supérieurs qui résisteraient, qui s’efforceraient de tromper l’État, de faire traîner les choses en longueur, etc. Car ces messieurs-là perdraient leurs sinécures si lucratives, ils perdraient la possibilité de se livrer à des opérations malhonnêtes particulièrement avantageuses. Tout est là. Mais la fusion des banques ne présente pas la moindre difficulté technique, et si le pouvoir d’État était révolutionnaire autrement qu’en paroles (c’est-à-dire s’il n’avait pas peur de rompre avec l’inertie et la routine), s’il était démocratique autrement qu’en paroles (c’est-à-dire s’il agissait dans l’intérêt de la majorité du peuple, et non d’une poignée de richards), il suffirait de décréter, comme châtiment, la confiscation des biens et la prison pour les directeurs, administrateurs et gros actionnaires qui se seraient rendus coupables de la moindre manœuvre dilatoire et de tentatives de dissimuler des documents et relevés de comptes ; il suffirait, par exemple, de grouper à part les employés pauvres et d’accorder des primes à ceux d’entre eux qui découvriraient des fraudes et manœuvres dilatoires de la part des cadres riches, et la nationalisation des banques se ferait sans heurt ni secousse, en moins de rien.
Les avantages de la nationalisation des banques seraient immenses pour le peuple entier, non pas tant pour les ouvriers (ceux-ci ont rarement affaire aux banques) que pour la masse des paysans et des petits industriels. Il en résulterait une économie colossale de travail et, à supposer que l’État garde l’ancien effectif des employés de banque, cela marquerait un pas considérable vers l’universalisation (la généralisation) de l’usage des banques, vers la multiplication de leurs succursales ; la population serait plus à même de profiter des services des banques, etc., etc. Il deviendrait beaucoup plus facile justement pour les petits patrons, pour les paysans, d’obtenir du crédit. Quant à l’État il aurait, pour la première fois, la possibilité d’abord de connaître toutes les principales opérations financières, sans dissimulation possible, puis de les contrôler, ensuite de réglementer la vie économique, enfin d’obtenir des millions et des milliards pour les grandes opérations d’État, sans avoir à payer, « pour le service rendu », des « commissions » exorbitantes à messieurs les capitalistes. C’est pour cette raison – et seulement pour cette raison – que tous les capitalistes, tous les professeurs bourgeois, toute la bourgeoisie et tous les Plekhanov, les Potressov et Cie qui s’en font les valets sont prêts, l’écume aux lèvres, à partir en guerre contre la nationalisation des banques, à inventer des milliers de prétextes contre cette mesure éminemment facile et urgente alors que, même du point de vue de la « défense » nationale, c’est-à-dire du point de vue militaire, elle comporte d’immenses avantages et soit de nature à accroître énormément la « puissance militaire » du pays.
Mais ici l’on nous opposera peut-être l’objection suivante : comment se fait‑il que des États aussi avancés que l’Allemagne et les États‑Unis d’Amérique procèdent à une admirable « réglementation de la vie économique » sans même songer à nationaliser les banques ?
Parce que, répondrons‑nous, ces États, dont l’un est une monarchie et l’autre une république, sont tous deux non seulement capitalistes, mais encore impérialistes. Comme tels, ils réalisent les réformes qui leur sont nécessaires par la voie bureaucratique réactionnaire. Or, ici, nous parlons de la voie démocratique révolutionnaire.
Cette « petite différence » a une importance capitale. Le plus souvent, on « n’a pas coutume » d’y penser. Les mots « démocratie révolutionnaire » sont devenus chez nous (notamment chez les socialistes‑révolutionnaires et les mencheviks) presque une phrase conventionnelle comme l’expression « Dieu merci », employée par des gens qui ne sont pas ignorants au point de croire en Dieu, ou comme l’expression « honorable citoyen », que l’on emploie parfois même quand on s’adresse aux collaborateurs du Dien[4] ou de l’Edinstvo[5], bien que tout le monde, ou presque, se doute que ces journaux ont été fondés et sont entretenus par des capitalistes, dans l’intérêt des capitalistes, et que, par conséquent, la collaboration de pseudo‑socialistes à ces organes soit fort peu « honorable ».
Si l’on n’emploie le terme de « démocratie révolutionnaire » ni comme un cliché pompeux, ni comme une appellation conventionnelle, mais en réfléchissant à son sens, on verra qu’être démocrate, c’est compter effectivement avec les intérêts de la majorité du peuple, et non de la minorité ; qu’être révolutionnaire, c’est briser de la façon la plus résolue, la plus impitoyable tout ce qui est nuisible et suranné.
En Amérique, non plus qu’en Allemagne, ni les gouvernements ni les classes dirigeantes ne prétendent, que l’on sache, au titre de « démocratie révolutionnaire » : nos socialistes‑révolutionnaires et nos mencheviks y prétendent (et le prostituent).
Il n’existe, en Allemagne, que quatre grandes banques privées, qui ont une importance nationale ; les États-Unis n’en comptent que deux. Il est plus aisé, plus commode, plus avantageux, pour les rois de la finance qui sont à la tête de ces banques, de s’associer sans publicité, en secret, à la manière réactionnaire et non révolutionnaire, bureaucratiquement et non démocratiquement, en corrompant les fonctionnaires de l’État (c’est la règle générale et pour les États‑Unis et pour l’Allemagne), en maintenant le caractère privé des banques justement pour garder le secret des opérations, pour percevoir de ce même État des millions et des millions de « surprofit », pour assurer le succès de frauduleuses combinaisons financières.
L’Amérique comme l’Allemagne « réglementent la vie économique » de façon à créer un bagne militaire pour les ouvriers (et en partie pour les paysans), et un paradis pour les banquiers et les capitalistes. Leur réglementation consiste à « serrer la vis » aux ouvriers jusqu’à la famine et à assurer aux capitalistes (en secret, à la manière bureaucratique réactionnaire) des profits supérieurs à ceux d’avant-guerre.
Cette voie est tout à fait possible également pour la Russie impérialiste républicaine. C’est ce que font, d’ailleurs, non seulement les Milioukov et les Chingarev, mais aussi Kerensky marchant de compagnie avec Terechtchenko, Nékrassov, Bernatski, Prokopovitch et consorts, qui couvrent eux aussi, par des procédés bureaucratiques réactionnaires l’« inviolabilité » des banques et leurs droits sacrés à des profits exorbitants. Ayons donc le courage de dire la vérité : on veut, en Russie républicaine, réglementer la vie économique par des méthodes bureaucratiques réactionnaires, mais on a « souvent » du mal à réaliser la chose du fait de l’existence des « Soviets », que le Kornilov numéro un n’a pas réussi à disperser, ce que tâchera de faire un Kornilov numéro deux...
Voilà la vérité. Et cette vérité simple, bien qu’amère, est plus utile pour éclairer le peuple que les mensonges mielleux sur « notre » « grande » démocratie « révolutionnaire »...
La nationalisation des banques rendrait infiniment plus facile la nationalisation simultanée des assurances, c’est-à-dire la fusion de toutes les compagnies d’assurances en une seule, la centralisation de leur activité et le contrôle de celle-ci par l’État. Les congrès des employés des compagnies d’assurances accompliraient, cette fois encore, la fusion sans délai et sans aucun effort, si l’État démocratique révolutionnaire la décrétait et prescrivait aux directeurs et aux gros actionnaires d’y procéder sans le moindre retard, sous leur entière responsabilité personnelle.
Les capitalistes ont engagé des centaines de millions dans les assurances ; tout le travail y est effectué par les employés. La fusion aurait pour résultat d’abaisser la prime d’assurance, de procurer une foule d’avantages et de commodités à tous les assurés, dont elle permettrait d’augmenter le nombre avec la même dépense d’énergie et de ressources. Aucune, absolument aucune autre raison que l’inertie, la routine et la cupidité d’une poignée de titulaires de sinécures lucratives ne s’oppose à cette réforme qui augmenterait aussi, d’autre part, la « capacité de défense » du pays, économiserait le travail du peuple et ouvrirait de sérieuses possibilités de « réglementation de la vie économique », en fait et non en paroles.
Nationalisation des syndicats patronaux
Ce qui distingue le capitalisme des systèmes économiques anciens, précapitalistes, c’est qu’il a établi une liaison, une interdépendance très étroite entre les différentes branches de l’économie. Sans quoi, disons-le en passant, aucune mesure dans le sens du socialisme ne serait techniquement réalisable. Or, grâce à la domination des banques sur la production, le capitalisme moderne a porté au plus haut point cette interdépendance des diverses branches de l’économie nationale. Les banques et les branches maîtresses de l’industrie et du commerce sont étroitement soudées. Cela signifie, d’une part, que l’on ne saurait se contenter de nationaliser les banques seules, sans prendre des mesures visant à établir le monopole de l’État sur les syndicats de commerce et d’industrie (syndicats du sucre, du charbon, du fer, du pétrole, etc.), sans nationaliser lesdits syndicats. D’autre part, cela signifie que la réglementation de la vie économique, si tant est qu’on veuille la réaliser sérieusement, implique la nationalisation simultanée des banques et des syndicats patronaux.
Prenons à titre d’exemple le syndicat du sucre. Formé sous le tsarisme, il était devenu, à ce moment déjà, un vaste groupement capitaliste de fabriques et d’usines parfaitement outillées. Et ce groupement, bien entendu, était tout pénétré d’un esprit profondément réactionnaire et bureaucratique ; il assurait des profits scandaleux aux capitalistes, réduisait ses employés et ses ouvriers à la condition de véritables esclaves privés de tout droit, humiliés, abêtis. À ce moment déjà, l’État contrôlait et réglementait la production au profit des magnats, des riches.
Ici, il reste seulement à transformer la réglementation bureaucratique réactionnaire en une réglementation démocratique révolutionnaire par simples décrets convoquant un congrès des employés, des ingénieurs, des directeurs, des actionnaires, établissant une comptabilité uniforme, le contrôle par les syndicats ouvriers, etc. C’est la plus simple des choses, et pourtant elle n’est pas encore accomplie ! Sous le régime de la république démocratique, l’industrie du sucre reste en fait soumise à une réglementation bureaucratique réactionnaire ; tout reste comme par le passé : gaspillage du travail du peuple, routine et stagnation, enrichissement des Bobrinski et des Terechtchenko. Faire appel à l’initiative de la démocratie et non de la bureaucratie, des ouvriers et des employés et non des « rois du sucre », voilà ce que l’on pourrait et devrait faire en quelques jours, d’un seul coup, si les socialistes‑révolutionnaires et les mencheviks n’obscurcissaient la conscience du peuple par des plans de « coalition », justement avec ces mêmes rois du sucre, de cette coalition avec les riches, qui, précisément, rend absolument inévitable l’« inaction totale » du gouvernement dans la réglementation de la vie économique[6].
Prenons l’industrie du pétrole. Elle est déjà « socialisée » dans une très vaste proportion par le développement antérieur du capitalisme. Un couple de rois du pétrole brassent, à eux seuls, des millions et des centaines de millions en tondant des coupons, en tirant des profits fabuleux d’une « affaire » déjà organisée en fait techniquement et socialement, à l’échelle nationale, déjà conduite par des centaines et des milliers d’employés, d’ingénieurs, etc. La nationalisation de l’industrie du pétrole est possible d’emblée et obligatoire pour un État démocratique révolutionnaire, surtout quand celui-ci traverse une crise très grave, et qu’il importe à tout prix d’économiser le travail du peuple et d’augmenter la production du combustible. Il est évident qu’ici le contrôle bureaucratique ne donnera rien, ne changera rien, car les « rois du pétrole » auront raison des Terechtchenko, des Kerensky, des Avksentiev et des Skobélev aussi facilement qu’ils ont eu raison des ministres du tsar : par des atermoiements, des prétextes spécieux, des promesses, et aussi par la corruption directe et indirecte de la presse bourgeoise (cela s’appelle l’« opinion publique », et les Kerensky et les Avksentiev « comptent » avec elle), par la corruption des fonctionnaires (que les Kerensky et les Avksentiev maintiennent à leurs postes dans le vieil appareil d’État, demeuré intact).
Pour faire quelque chose de sérieux, il faut passer, et ce, de façon vraiment révolutionnaire, de la bureaucratie à la démocratie, c’est-à-dire déclarer la guerre aux rois et aux actionnaires du pétrole, décréter la confiscation de leurs biens et des peines d’emprisonnement pour entrave à la nationalisation de l’industrie du pétrole, pour dissimulation des revenus ou des comptes, pour sabotage de la production, pour refus de prendre des mesures visant à augmenter la production. Il faut faire appel à l’initiative des ouvriers et des employés, les convoquer immédiatement à des conférences ou congrès, leur attribuer une part déterminée des bénéfices sous condition d’organiser un ample contrôle et d’augmenter la production. Si des mesures démocratiques révolutionnaires de ce genre avaient été prises d’emblée, dès avril 1917, la Russie, qui est un des pays les plus riches du monde par ses réserves de combustible liquide, aurait pu, durant l’été, en utilisant les transports par eau, faire énormément pour livrer à la population les quantités nécessaires de carburant.
Ni le gouvernement bourgeois, ni celui de la coalition des socialistes‑révolutionnaires, des mencheviks et des cadets n’ont absolument rien fait ; ils se sont bornés au petit jeu bureaucratique des réformes. Ils n’ont pas osé prendre une seule mesure démocratique et révolutionnaire. Mêmes rois du pétrole, même stagnation, même haine des ouvriers et des employés contre leurs exploiteurs et, de ce fait, même désorganisation, même gaspillage du travail du peuple, tout comme au temps du tsarisme. Rien de changé, si ce n’est, dans les chancelleries « républicaines », les en-têtes des papiers entrant et sortant !
Dans l’industrie houillère, non moins « prête » à la nationalisation, au point de vue de la technique et de la culture, régie avec non moins de cynisme par les spoliateurs du peuple, les rois du charbon, nous sommes en présence d’une série de faits patents de sabotage avéré, de détérioration manifeste et d’arrêt de la production par les industriels. Jusqu’à la Rabotchaïa Gazéta, organe menchevik ministériel, qui a reconnu ces faits. Eh bien ? On n’a absolument rien fait, à part les vieilles conférences bureaucratiques réactionnaires dites « paritaires », où sont représentés en nombre égal les ouvriers et les forbans du syndicat houiller !! Aucune mesure démocratique révolutionnaire, pas l’ombre d’une tentative pour établir le seul contrôle réel, par en bas, par le syndicat des employés, par les ouvriers, en usant de la terreur à l’égard des industriels houillers qui mènent le pays à sa perte et stoppent la production ! Comment donc ! Ne sommes‑nous pas « tous » pour la « coalition », si ce n’est avec les cadets, du moins avec les milieux industriels et commerciaux ? Or, être pour la coalition, cela veut dire justement laisser le pouvoir aux capitalistes, les laisser impunis, les laisser mettre des bâtons dans les roues, tout rejeter sur les ouvriers, accentuer la débâcle économique et préparer ainsi un nouveau coup de force Kornilov !
Suppression du secret commercial
Sans la suppression du secret commercial, ou bien le contrôle de la production et de la répartition reste une promesse vaine servant uniquement aux cadets à duper les socialistes‑révolutionnaires et les mencheviks, et aux socialistes‑révolutionnaires et mencheviks à duper les classes laborieuses, ou bien il ne peut être réalisé que par des procédés et des mesures bureaucratiques réactionnaires. Quelque évidente que soit cette vérité pour toute personne non prévenue, quelle que soit l’insistance avec laquelle la Pravda a réclamé la suppression du secret commercial (ce qui fut l’un des principaux motifs de son interdiction par le gouvernement Kerensky, serviteur du capital), ni notre gouvernement républicain, ni les « organismes habilités de la démocratie révolutionnaire » n’ont même songé à cette condition première d’un contrôle effectif.
C’est là, précisément, la clef de tout contrôle. C’est là, précisément, le point le plus sensible du capital qui dépouille le peuple et sabote la production. Et c’est bien pourquoi les socialistes‑révolutionnaires et les mencheviks craignent de soulever cette question.
L’argument habituel des capitalistes, repris sans autre réflexion par la petite bourgeoisie, est que, d’une façon générale, l’économie capitaliste n’admet absolument pas la suppression du secret commercial, attendu que la propriété privée des moyens de production et la dépendance des différentes entreprises à l’égard du marché rendent nécessaires la « sacro-sainte inviolabilité » des livres de commerce et le secret des opérations commerciales, y compris naturellement les opérations de banque.
Les gens qui, sous une forme ou sous une autre, répètent cet argument ou d’autres analogues, se laissent tromper et trompent eux-mêmes le peuple en fermant les yeux sur deux faits fondamentaux, essentiels et notoires de la vie économique actuelle. Premier fait : le grand capitalisme, c’est-à-dire la forme particulière de la gestion des banques, des syndicats capitalistes, des grandes usines, etc. Deuxième fait : la guerre.
C’est précisément le grand capitalisme d’aujourd’hui qui, se transformant partout en capitalisme monopoliste, ôte toute ombre de raison d’être au secret commercial ; il en fait une hypocrisie et uniquement un moyen de dissimuler les escroqueries financières et les profits inouïs du grand capital. La grande entreprise capitaliste est, de par sa nature technique, une entreprise socialisée, c’est-à-dire qu’elle travaille pour des millions de gens et associe dans ses opérations, directement et indirectement, des centaines, des milliers et des dizaines de milliers de familles. C’est bien autre chose que l’entreprise du petit artisan ou du paysan moyen, qui ne tiennent en général aucun livre de commerce et que, par conséquent, la suppression du secret commercial ne concerne en rien !
Au reste, dans une grande entreprise, les opérations sont de toute façon connues de centaines de personnes et davantage. La loi qui protège le secret commercial sert ici non pas les besoins de la production ou de l’échange, mais la spéculation et le lucre sous leur forme la plus brutale, l’escroquerie qualifiée qui, on le sait, est spécialement répandue dans les sociétés anonymes, et voilée avec un art particulier par les comptes rendus et les bilans élaborés de façon à tromper le public.
Si le secret commercial est inévitable dans la petite production marchande, c’est-à-dire parmi les petits paysans et artisans, chez qui la production elle-même n’est pas socialisée, mais disséminée, morcelée, par contre, dans la grande entreprise capitaliste, protéger ce secret, c’est protéger les privilèges et les profits d’une poignée, oui, d’une poignée de gens au détriment du peuple entier. Cela a déjà été reconnu même par la loi, pour autant qu’elle prescrit la publication des bilans des sociétés anonymes : mais ce contrôle - déjà réalisé en Russie comme dans tous les pays avancés – est précisément un contrôle bureaucratique réactionnaire ; il n’ouvre pas les yeux au peuple et ne permet pas de connaître toute la vérité sur les opérations des sociétés anonymes.
Pour agir en démocrates révolutionnaires, il faudrait édicter immédiatement une nouvelle loi qui supprimerait le secret commercial, exigerait des grandes entreprises et des riches les comptes rendus les plus complets, conférerait à tout groupe de citoyens atteignant un nombre assez important pour pouvoir exprimer un avis démocratiquement valable (par exemple 1000 ou 10 000 électeurs) le droit de vérifier tous les documents de n’importe quelle grande entreprise. Cette mesure est entièrement et facilement réalisable par simple décret ; elle seule donnerait libre cours à l’initiative populaire, au contrôle par les associations d’employés, d’ouvriers, par tous les partis politiques ; elle seule rendrait ce contrôle efficace et démocratique.
Ajoutez à cela la guerre. L’immense majorité des entreprises industrielles et commerciales ne travaillent plus à présent pour le « marché libre », mais pour l’État, pour la guerre. C’est pourquoi j’ai déjà dit dans la Pravda que ceux qui nous objectent l’impossibilité d’instaurer le socialisme mentent et mentent triplement, car il ne s’agit pas d’instaurer le socialisme maintenant, tout de suite, du jour au lendemain, mais de dévoiler la dilapidation du Trésor public[7].
L’entreprise capitaliste qui travaille « pour la guerre » (c’est-à-dire qui est liée directement ou indirectement aux fournitures de guerre) pille le Trésor public systématiquement et pertinemment ; et messieurs les cadets avec les mencheviks et les socialistes‑révolutionnaires, qui s’opposent à la suppression du secret commercial, ne font que favoriser et couvrir la dilapidation des deniers publics.
Actuellement, la guerre coûte à la Russie 50 millions de roubles par jour. La majeure partie de ces 50 millions va aux fournisseurs de l’armée. Sur ces 50 millions, au moins 5 millions par jour, et plus probablement 10 millions et davantage, représentent les « profits licites » des capitalistes et des fonctionnaires qui, d’une façon ou d’une autre, ont partie liée avec eux. Les firmes les plus importantes et les banques qui avancent des fonds pour les opérations sur les fournitures de guerre, réalisent ainsi des bénéfices fabuleux, précisément par la dilapidation des deniers publics, car on ne saurait qualifier autrement ces manœuvres destinées à mystifier et à écorcher le peuple « à la faveur » des calamités de la guerre, « à la faveur » de la mort de centaines de milliers et de millions d’hommes.
Ces bénéfices scandaleux sur les fournitures, ces « lettres de garantie » dissimulées par les banques, les noms de ceux qui profitent du renchérissement de la vie, « tout le monde » les connaît ; dans la « société », on en parle avec un petit sourire ironique ; même la presse bourgeoise, qui a pour règle de taire les faits « désagréables » et d’éluder les questions « délicates », fournit à ce sujet quantité d’indications précises portant sur tel ou tel point particulier. Tout le monde le sait et tout le monde se tait, en prend son parti, s’accommode d’un gouvernement qui parle éloquemment de « contrôle » et de « réglementation » !!
Les démocrates révolutionnaires, s’ils étaient vraiment des révolutionnaires et des démocrates, édicteraient immédiatement une loi qui supprimerait le secret commercial, obligerait les fournisseurs et les négociants à présenter leurs comptes, leur interdirait d’abandonner leur genre d’activité sans l’autorisation des pouvoirs publics, condamnerait à la confiscation des biens et à la peine de mort[8] pour dissimulation des profits et mystification du peuple, organiserait la vérification et le contrôle par en bas, démocratiquement par le peuple lui-même, par les associations d’employés, d’ouvriers, de consommateurs, etc.
Nos socialistes‑révolutionnaires et nos mencheviks méritent bien le nom de démocrates apeurés, car ils répètent, en l’occurrence, ce que disent tous les petits bourgeois apeurés, à savoir que les capitalistes « fileront » si l’on prend des mesures « trop rigoureuses », que « nous » ne nous tirerons pas d’affaire sans les capitalistes, que les millionnaires anglo-français qui nous « soutiennent » se formaliseront peut-être à leur tour, etc. On pourrait croire que les bolcheviks proposent une chose jamais vue dans l’histoire de l’humanité, jamais expérimentée, « utopique », alors qu’en réalité, il y a 125 ans déjà, en France, des hommes qui étaient de vrais « démocrates révolutionnaires », réellement convaincus du caractère juste et défensif de la guerre qu’ils faisaient, des hommes qui s’appuyaient réellement sur les masses populaires sincèrement convaincues, elles aussi, ont su instituer un contrôle révolutionnaire sur les riches et obtenir des résultats qui forcèrent l’admiration du monde entier. Et, pendant les cinq quarts de siècle écoulés depuis, le développement du capitalisme a créé les banques, les cartels, les chemins de fer, etc., etc., qui ont rendu cent fois plus faciles et plus simples les mesures relatives à un contrôle réellement démocratique exercé par les ouvriers et les paysans sur les exploiteurs, les grands propriétaires fonciers et les capitalistes.
Au fond, toute la question du contrôle se ramène à savoir qui est le contrôleur et qui est le contrôlé, c’est-à-dire quelle classe exerce le contrôle et quelle classe le subit. Chez nous, en Russie républicaine, on reconnaît et on laisse jusqu’à présent aux grands propriétaires fonciers et aux capitalistes le rôle de contrôleurs, qu’ils exercent avec la participation des « organismes habilités » d’une démocratie soi-disant révolutionnaire. Il en résulte inévitablement une spéculation capitaliste effrénée qui soulève l’indignation du peuple entier, et la désorganisation économique artificiellement entretenue par les capitalistes. Il faut passer résolument, sans esprit de retour, sans crainte de rompre avec ce qui est vieux, sans crainte de bâtir hardiment du neuf, au contrôle exercé par les ouvriers et les paysans sur les grands propriétaires fonciers et les capitalistes. Or, c’est ce que nos socialistes‑révolutionnaires et nos mencheviks craignent comme le feu.
Le groupement forcé en cartels
La cartellisation forcée, c’est-à-dire le groupement forcé des industriels, par exemple, en cartels, est déjà pratiquement appliquée par l’Allemagne. Là encore, il n’y a rien de nouveau. Là encore, par la faute des socialistes-révolutionnaires et des mencheviks, nous constatons la stagnation la plus complète dans la Russie républicaine que ces peu honorables partis « amusent » en dansant le quadrille soit avec les cadets, soit avec les Boublikov, soit avec Terechtchenko et Kerensky.
D’une part, la cartellisation forcée constitue en quelque sorte un moyen pour l’État de stimuler le développement du capitalisme, qui mène toujours et partout à l’organisation de la lutte des classes, à l’accroissement du nombre, de la diversité et de l’importance des cartels. D’autre part, cette cartellisation forcée est la condition préliminaire et nécessaire de tout contrôle tant soit peu sérieux et de toute politique tendant à économiser le travail du peuple.
La loi allemande oblige, par exemple, les patrons tanneurs d’une localité donnée ou du pays entier à se grouper en cartel ; un représentant de l’État fait partie de la direction de ce cartel, aux fins de contrôle. Cette loi n’affecte nullement par elle-même les rapports de propriété ; elle ne prive pas du moindre kopeck aucun propriétaire d’entreprise et ne laisse rien préjuger sur le point de savoir si le contrôle sera appliqué dans les formes, le sens, un esprit bureaucratiques et réactionnaires ou démocratiques et révolutionnaires.
On pourrait et l’on devrait, sans perdre une seule semaine d’un temps précieux, promulguer tout de suite chez nous des lois semblables et laisser à la vie sociale le soin de déterminer elle-même les formes plus concrètes d’application de la loi, la rapidité de cette application, les moyens de la surveiller, etc. Pour édicter une telle loi, l’État n’a besoin ni d’un appareil spécial, ni de recherches particulières, ni d’études préliminaires d’aucune sorte ; il faut simplement être résolu à rompre avec certains intérêts privés des capitalistes, qui « ne sont pas accoutumés » à une pareille ingérence dans leurs affaires, qui n’entendent pas perdre les surprofits que leur assure, en plus de l’absence de tout contrôle, la gestion à l’ancienne mode.
Il n’est besoin d’aucun appareil administratif, d’aucune « statistique » (que Tchernov voulait substituer à l’initiative révolutionnaire de la paysannerie), pour promulguer pareille loi, car son application devra incomber aux fabricants ou aux industriels eux-mêmes, à des forces sociales existantes, sous le contrôle des forces sociales (c’est-à-dire non gouvernementales, non bureaucratiques) également existantes, mais qui doivent être obligatoirement celles des couches dites inférieures, c’est-à-dire des classes opprimées, exploitées, toujours infiniment supérieures – l’Histoire l’atteste – aux exploiteurs, par leur aptitude à l’héroïsme, à l’abnégation, à une discipline fraternelle.
Admettons que nous ayons un gouvernement vraiment démocratique révolutionnaire, et qu’il décrète : tous les fabricants et industriels employant, disons, deux ouvriers au moins, sont tenus de se grouper sans délai, par branches de production, en associations de district et de province. La responsabilité de l’exécution scrupuleuse de cette loi incombe en premier lieu aux fabricants, aux directeurs, aux membres des conseils d’administration, aux gros actionnaires (car ce sont eux les vrais chefs de l’industrie moderne, ses véritables maîtres). Au cas où ils se refuseraient à coopérer à l’application immédiate de la loi, ils seraient considérés comme des déserteurs et punis comme tels. Leur responsabilité est solidaire et engage tout leur avoir ; tous répondent pour chacun et chacun pour tous. La responsabilité incombe ensuite à tous les employés également tenus de former un syndicat unique, et à tous les ouvriers groupés dans leur syndicat. La cartellisation a pour but d’établir une comptabilité aussi complète, rigoureuse et détaillée que possible, et surtout de coordonner les opérations ayant trait à l’achat des matières premières, à la vente des produits fabriqués, ainsi qu’à l’économie des ressources et des forces du peuple. Avec le groupement d’entreprises dispersées en un syndicat patronal unique, cette économie atteindrait d’immenses proportions, ainsi que nous l’enseigne la science économique et que nous le montre l’exemple de tous les syndicats, cartels et trusts. Répétons une fois encore que, par elle-même, cette cartellisation ne change pas d’un iota les rapports de propriété, n’ôte pas le moindre kopeck à aucun possesseur. C’est un fait qu’il convient de souligner tout particulièrement, parce que la presse bourgeoise ne cesse d’« effrayer » les petits et moyens patrons en leur disant que les socialistes en général et les bolcheviks en particulier, entendent les « exproprier » ; assertion qui est un mensonge évident, car les socialistes, même dans une révolution intégralement socialiste, ne veulent ni ne peuvent exproprier les petits cultivateurs, et ne le feront point. Or, nous parlons seulement ici des mesures les plus indispensables et les plus urgentes déjà appliquées en Europe occidentale, et qu’une démocratie tant soit peu conséquente devrait appliquer immédiatement chez nous pour conjurer la catastrophe certaine dont nous sommes menacés.
Le groupement des petits et tout petits patrons en associations se heurterait à des difficultés sérieuses au point de vue de la technique et de la culture, en raison du morcellement extrême de leurs entreprises, de leur technique primitive et de l’ignorance ou du manque d’instruction de leurs propriétaires. Mais ces entreprises précisément pourraient être exemptées de l’application de la loi sur la cartellisation forcée (comme nous l’avons déjà indiqué dans l’hypothèse précédente) ; leur non‑association et, à plus forte raison, tout retard dans leur association, ne constituerait pas un obstacle sérieux, car les petites entreprises, bien qu’extrêmement nombreuses, ne jouent qu’un rôle infime dans l’ensemble de la production, dans l’économie nationale en général ; au surplus, elles dépendent souvent, d’une façon ou d’une autre, des grandes entreprises.
Seules les grandes entreprises ont une importance décisive ; là, les forces et les moyens d’ordre technique et culturel de la « cartellisation » existent ; il ne manque que l’initiative du pouvoir révolutionnaire, une initiative ferme, résolue, d’une sévérité impitoyable envers les exploiteurs, pour que ces forces et ces moyens soient mis en œuvre.
Plus le pays est pauvre en forces techniquement instruites, et, d’une façon générale, en forces intellectuelles, plus s’impose la nécessité de décréter, aussi rapidement et aussi résolument que possible, le groupement forcé, et de le réaliser en commençant par les grandes et très grandes entreprises ; car c’est précisément ce groupement qui économisera les forces intellectuelles et permettra de les utiliser pleinement, de les répartir d’une façon plus rationnelle. Si les paysans russes eux-mêmes ont su, dans leurs villages reculés, faire un pas énorme en avant après 1905 en ce qui concerne la création d’associations de toute sorte, sous le gouvernement tsariste, et malgré les milliers d’obstacles que celui-ci leur opposait, il est certain que le groupement des grandes et moyennes entreprises industrielles et commerciales pourrait se faire en quelques mois, si ce n’est plus vite, à condition qu’elles y soient contraintes par un gouvernement véritablement démocratique et révolutionnaire s’appuyant sur la sympathie, la participation, les intérêts, les avantages des « couches inférieures » de la démocratie, employés, des ouvriers, que ce gouvernement appellerait à exercer le contrôle
Réglementation de la consommation
La guerre a obligé tous les États belligérants et bon nombre d’États neutres à réglementer la consommation. La carte de pain est apparue en ce monde ; elle est devenue chose coutumière et a frayé la voie à d’autres cartes. La Russie n’a pas fait exception ; elle a également introduit la carte de pain.
Mais voilà précisément l’exemple qui nous permettra, peut-être, de comparer le mieux les méthodes bureaucratiques réactionnaires de lutte contre la catastrophe, qui tendent à réduire les réformes au minimum, aux méthodes démocratiques révolutionnaires qui, pour mériter leur nom, doivent se proposer nettement comme tâche de rompre par la violence avec les vieilleries périmées et d’accélérer le plus possible la marche en avant.
La carte de pain, ce modèle classique de réglementation de la consommation dans les États capitalistes d’aujourd’hui (dans le meilleur des cas) se propose et réalise une seule tâche : répartir la quantité disponible de pain, de façon que tout le monde en soit pourvu. Le maximum de consommation n’est pas établi pour tous les produits, tant s’en faut, mais seulement pour les principaux produits « d’usage courant ». Et c’est tout. On ne se préoccupe pas d’autre chose. Bureaucratiquement, on fait le compte du pain disponible, on divise le total obtenu par le nombre d’habitants, on fixe une norme de consommation, on la décrète et on s’en tient là. On ne touche pas aux objets de luxe puisque, « de toute façon », il y en a peu et ils sont d’un prix qui n’est pas à la portée du « peuple ». C’est pourquoi, dans tous les pays belligérants, sans exception aucune, même en Allemagne, pays que l’on peut, je crois, sans crainte de contestation, considérer comme le modèle de la réglementation la plus ponctuelle, la plus méticuleuse et la plus stricte de la consommation, même en Allemagne on voit les riches déroger constamment, aux « normes » de consommation, quelles qu’elles soient. Cela aussi, « tout le monde » le sait, « tout le monde » en parle avec un sourire ironique ; on trouve constamment dans la presse socialiste allemande, et parfois même dans la presse bourgeoise, malgré les férocités d’une censure dominée par l’esprit de caserne, des entrefilets et des informations sur le menu des riches. Ceux-ci reçoivent du pain blanc à volonté dans telle ou telle ville d’eaux (laquelle est fréquentée, sous prétexte de maladie, par tous ceux... qui ont beaucoup d’argent) ; ils consomment, au lieu de produits d’usage courant, des denrées de choix, rares et recherchées.
L’État capitaliste réactionnaire, qui craint d’ébranler les fondements du capitalisme, les fondements de l’esclavage salarié, les fondements de la domination économique des riches, craint de développer l’initiative des ouvriers et des travailleurs en général ; il craint d’« attiser » leurs exigences. Un tel État n’a besoin de rien d’autre que de la carte de pain. Un tel État, quoi qu’il fasse, ne perd pas de vue un seul instant son objectif réactionnaire : consolider le capitalisme, ne pas le laisser ébranler, limiter la « réglementation de la vie économique » en général, et de la consommation en particulier, aux mesures absolument indispensables pour assurer la subsistance du peuple, en se gardant bien de réglementer effectivement la consommation par un contrôle sur les riches qui leur imposerait, à eux qui sont mieux placés, privilégiés, rassasiés et gavés en temps de paix, des charges plus grandes en temps de guerre.
La solution bureaucratique réactionnaire du problème posé aux peuples par la guerre se limite à la carte de pain, à la répartition égale des produits « d’usage courant » absolument indispensables à l’alimentation, sans s’écarter en rien de l’orientation bureaucratique et réactionnaire dont l’objectif est le suivant : ne pas éveiller l’initiative des pauvres, du prolétariat, de la masse du peuple (du « demos ») ; ne pas admettre leur contrôle sur les riches, laisser aux riches le maximum d’expédients leur permettant de s’offrir des objets de luxe. Et dans tous les pays, nous le répétons, même en Allemagne – et à plus forte raison en Russie – il est une masse d’expédients : le « bas peuple » souffre de la faim tandis que les riches se rendent dans les villes d’eaux, complétant la maigre ration officielle par des « suppléments » de toute sorte et ne se laissant pas contrôler.
Dans la Russie qui vient de faire la révolution contre le tsarisme au nom de la liberté et de l’égalité, dans la Russie devenue d’emblée une république démocratique de par ses institutions politiques effectives, ce qui frappe surtout le peuple, ce qui suscite particulièrement le mécontentement, l’exaspération, la colère et l’indignation des masses, c’est la facilité – que tout le monde voit – avec laquelle les riches tournent la réglementation introduite par la « carte de pain ». Cette facilité est extrême. « En sous-main » et à des prix particulièrement élevés, surtout quand on a des « relations » (et il n’y a que les riches qui en aient), on se procure de tout et en abondance. C’est le peuple qui a faim. La réglementation de la consommation est confinée dans le cadre le plus étroit, le plus réactionnaire et le plus bureaucratique. Le gouvernement ne manifeste pas la moindre intention, pas le moindre souci d’établir cette réglementation sur des bases véritablement démocratiques et révolutionnaires.
Les files d’attente, « tout le monde » en souffre, mais... mais les riches envoient leurs domestiques faire la queue ; ils entretiennent même à cet effet une domesticité spéciale ! Joli « démocratisme » !
En présence des calamités inouïes qui accablent le pays, une politique démocratique révolutionnaire ne se bornerait pas à établir la carte de pain pour combattre la catastrophe imminente. Elle y ajouterait en premier lieu les sociétés de consommation, car c’est le seul moyen de réaliser intégralement le contrôle de la consommation ; en second lieu, le service de travail pour les riches, qui seraient tenus de remplir gratuitement, dans ces sociétés de consommation, des fonctions de secrétaires ou tout autre emploi analogue ; en troisième lieu, le partage égal parmi la population de la totalité effective des produits de consommation, afin que les charges de la guerre soient réparties d’une façon vraiment égale ; en quatrième lieu, l’organisation du contrôle de façon que les classes pauvres de la population contrôlent la consommation des riches.
L’application d’un démocratisme authentique dans ce domaine et la manifestation d’un véritable esprit révolutionnaire dans l’organisation du contrôle précisément par les classes les plus nécessiteuses du peuple, stimuleraient puissamment la tension de toutes les forces intellectuelles existantes, le développement de l’énergie vraiment révolutionnaire du peuple entier. Car, aujourd’hui, les ministres de la Russie républicaine, démocratique et révolutionnaire, tout comme leurs confrères de tous les autres pays impérialistes, prodiguent des phrases pompeuses sur le « travail commun au profit du peuple », sur la « tension de toutes les forces », mais le peuple voit, sent et perçoit mieux que personne l’hypocrisie de ces paroles.
Il en résulte un piétinement sur place et un accroissement irrésistible de la désorganisation. Et la catastrophe devient imminente, puisque, d’une part, notre gouvernement ne peut instituer un bagne militaire pour les ouvriers à la manière de Kornilov, de Hindenburg, sur le modèle impérialiste en général : les traditions, les souvenirs, les vestiges, les habitudes, les institutions de la révolution sont encore trop vivaces dans le peuple ; et, d’autre part, notre gouvernement ne veut pas s’engager sérieusement dans la voie démocratique révolutionnaire, imprégné qu’il est jusqu’à la moelle et ligoté du sommet à la base par ses rapports de dépendance à l’égard de la bourgeoisie, par sa « coalition » avec elle, par la crainte de toucher à ses privilèges de fait.
Sabotage de l’activité des organisations démocratiques par le gouvernement
Nous avons examiné les différents moyens et méthodes de conjurer la catastrophe et la famine. Partout nous avons vu la contradiction irréductible entre, d’une part, la démocratie, et de l’autre, le gouvernement et le bloc des socialistes‑révolutionnaires et des mencheviks qui le soutient. Pour prouver que ces contradictions existent dans la réalité, et non seulement dans notre exposé, et que leur caractère irréductible est démontré pratiquement par des conflits d’une portée nationale, il suffit de rappeler deux « bilans » particulièrement typiques, deux leçons qui se dégagent de ces six mois de notre révolution.
L’histoire du « règne » de Paltchinski est une de ces leçons. L’autre est l’histoire du « règne » et de la chute de Pechekhonov.
En substance, les mesures de lutte décrites plus haut contre la catastrophe et la famine consistent à encourager de toutes les manières (y compris la contrainte) le groupement en associations de la population et, en premier lieu, de la démocratie, c’est-à-dire de la majorité de la population : donc, avant tout, des classes opprimées, ouvriers et paysans, paysans pauvres surtout. Et c’est dans cette voie que la population s’est engagée d’elle-même, spontanément, pour lutter contre les difficultés, les charges et les calamités inouïes de la guerre.
Le tsarisme entravait par tous les moyens l’association libre et autonome de la population. Mais, après la chute de la monarchie tsariste, les organisations démocratiques apparurent et se développèrent rapidement à travers toute la Russie. La catastrophe fut combattue par les organisations démocratiques nées spontanément, par toutes sortes de comités de ravitaillement et d’approvisionnement en vivres, en combustibles, etc., etc.
Or, ce qu’il y a eu de plus remarquable durant les six mois de notre révolution, sur cette question, c’est qu’un gouvernement qui se prétend républicain et révolutionnaire, un gouvernement soutenu par les mencheviks et les socialistes‑révolutionnaires au nom des « organismes habilités de la démocratie révolutionnaire », a combattu les organisations démocratiques et en a triomphé !!
Paltchinski s’est acquis dans cette lutte la plus triste et la plus large renommée à l’échelle de toute la Russie. Il a agi en se retranchant derrière le gouvernement, sans intervenir ouvertement devant le peuple (tout comme préféraient généralement agir les cadets qui, « pour le peuple », mettaient volontiers en avant Tseretelli, cependant qu’eux-mêmes réglaient en sous-main toutes les affaires d’importance). Paltchinski a freiné et saboté toutes les mesures sérieuses des organisations démocratiques spontanément créées par le peuple, car aucune mesure sérieuse ne pouvait être prise sans qu’il fût « porté atteinte » aux profits démesurés et à l’arbitraire des gros bonnets de l’industrie et du commerce. Or, Paltchinski était précisément leur défenseur et serviteur fidèle. Il en est arrivé – ce fait a été publié dans les journaux – à annuler tout bonnement certaines dispositions de ces organisations démocratiques !!
Toute l’histoire du « règne » de Paltchinski – et il « régna » de longs mois, justement à l’époque où Tseretelli, SkobeIev et Tchernov étaient « ministres » – n’est qu’un incessant, un abominable scandale, le sabotage de la volonté du peuple, des décisions de la démocratie, afin de complaire aux capitalistes et d’assouvir leur sordide cupidité. Les journaux n’ont pu publier, comme bien l’on pense, qu’une infime partie des « exploits » de Paltchinski. Une enquête minutieuse sur les moyens qu’il a employés pour entraver la lutte contre la famine ne pourra être entreprise que par un gouvernement prolétarien, vraiment démocratique, quand il aura conquis le pouvoir et fait juger par le tribunal du peuple, sans en rien cacher, la besogne de Paltchinski et de ses pareils.
On nous objectera peut-être que Paltchinski était quand même une exception et qu’on l’a d’ailleurs écarté... Or, la vérité, justement, c’est que Paltchinski n’est pas une exception, mais la règle ; que la situation ne s’est pas du tout améliorée du fait que Paltchinski a été écarté ; que d’autres Paltchinski, portant d’autres noms, l’ont remplacé ; que toute l’« influence » des capitalistes, toute la politique de sabotage de la lutte contre la famine pratiquée pour leur être agréable, sont demeurées intangibles. Car Kerensky et Cie ne sont qu’un paravent qui masque la défense des intérêts capitalistes.
La preuve la plus éclatante, c’est la démission du ministre du ravitaillement Pechekhonov. On sait que Pechekhonov est un populiste tout ce qu’il y a de plus modéré. Mais il voulait organiser le ravitaillement de façon consciencieuse, en contact avec les organisations démocratiques et en s’appuyant sur elles. L’expérience de l’activité de Pechekhonov et sa démission sont d’autant plus intéressantes que ce populiste des plus modérés, membre du parti « socialiste‑populaire », prêt à tous les compromis avec la bourgeoisie, s’est vu néanmoins obligé de démissionner ! Car, pour plaire aux capitalistes, aux grands propriétaires fonciers et aux koulaks, le gouvernement Kerensky a relevé le prix taxé du blé !
Voici comment, dans la Svobodnaïa Jizn[9] n°1, du 2 septembre, M. Smith apprécie la « mesure » prise et son importance :
« Quelques jours avant que le gouvernement ait décidé l’augmentation du prix taxé, la scène suivante se déroula au sein du Comité national du ravitaillement : le représentant de la droite, Rolovitch, défenseur opiniâtre des intérêts du commerce privé et ennemi implacable du monopole du blé et de l’ingérence de l’État dans la vie économique, déclara haut et clair, avec un sourire satisfait, que d’après ses renseignements, le prix taxé du blé allait sous peu être élevé.
« En réponse, le représentant du Soviet des députés ouvriers et soldats déclara qu’il n’en savait rien, qu’aussi longtemps que durerait la révolution en Russie, pareille chose ne pouvait se produire et que, en tout cas, le gouvernement ne pouvait le faire sans prendre avis des organismes habilités de la démocratie : le Conseil économique et le Comité national du ravitaillement. Le représentant du Soviet des députés paysans s’est associé à cette déclaration.
« Mais, hélas ! les faits devaient apporter dans cette controverse une cruelle mise au point : ce fut le représentant des éléments censitaires, et non les représentants de la démocratie, qui se trouvait avoir raison. Il s’avéra parfaitement informé de l’attentat qui se préparait contre les droits de la démocratie, encore que les représentants de cette dernière eussent repoussé avec indignation l’idée même d’un semblable attentat. »
Ainsi, le représentant des ouvriers comme celui de la paysannerie déclarent tout net leur opinion au nom de l’immense majorité du peuple, mais le gouvernement Kerensky fait le contraire, pour servir les capitalistes !
Le représentant des capitalistes, Rolovitch, était parfaitement informé, à l’insu de la démocratie, de même que nous avons toujours observé et observons encore que les journaux bourgeois, la Retch et la Birjovka, sont les mieux informés de ce qui se passe au sein du gouvernement Kerensky.
Qu’atteste cette remarquable qualité d’information ? Évidemment, que les capitalistes ont leurs « entrées » et qu’ils détiennent en fait le pouvoir. Kerensky est leur homme de paille, qu’ils font marcher quand et comme cela leur est nécessaire. Les intérêts de dizaines de millions d’ouvriers et de paysans sont sacrifiés à seule fin d’assurer les profits d’une poignée de riches.
Comment nos socialistes‑révolutionnaires et nos mencheviks réagissent‑ils devant cette révoltante mystification du peuple ? Peut‑être ont‑ils lancé un appel aux ouvriers et aux paysans pour leur dire qu’après cela, la place de Kerensky et de ses collègues est en prison et non ailleurs ?
A Dieu ne plaise ! Les socialistes‑révolutionnaires et les mencheviks, représentés par leur « section économique », se sont bornés à adopter la résolution comminatoire que nous avons déjà mentionnée ! Ils y déclarent que la hausse du prix du blé décrétée par le gouvernement de Kerensky est une « mesure funeste qui porte un rude coup tant à l’œuvre du ravitaillement qu’à l’ensemble de la vie économique du pays » et que ces mesures funestes ont été appliquées en « violation » flagrante de la loi !!
Voilà les résultats de la politique de conciliation, de la tactique de flirt et de « ménagement » à l’égard de Kerensky.
Le gouvernement viole la loi en adoptant, pour plaire aux riches, aux grands propriétaires fonciers et aux capitalistes, une mesure qui ruine toute l’oeuvre de contrôle, de ravitaillement et d’assainissement des finances on ne peut plus ébranlées ; et les socialistes‑révolutionnaires et les mencheviks continuent à préconiser l’entente avec les milieux industriels et commerciaux, à conférer avec Terechtchenko, à ménager Kerensky. Et ils se bornent à consigner leur protestation dans une résolution de papier que le gouvernement classe le plus tranquillement du monde !!
Voilà où apparaît dans toute son évidence cette vérité que les socialistes‑révolutionnaires et les mencheviks ont trahi le peuple et la révolution, et que ce sont les bolcheviks qui deviennent les vrais chefs des masses, même de celles qui suivent les socialistes‑révolutionnaires et les mencheviks.
Car c’est la conquête du pouvoir par le prolétariat, avec le parti bolchevik à sa tête, qui seule pourrait mettre fin aux infamies perpétrées par Kerensky et consorts, et remettre en marche les organisations démocratiques de ravitaillement, d’approvisionnement, etc., dont Kerensky, et son gouvernement sabotent le fonctionnement.
Les bolcheviks s’affirment – l’exemple cité le montre avec une clarté parfaite – comme les représentants des intérêts du peuple entier, qui luttent pour assurer le ravitaillement et l’approvisionnement, pour satisfaire les besoins les plus immédiats des ouvriers et des paysans, en battant la politique hésitante et irrésolue des socialistes‑révolutionnaires et des mencheviks, qui est une vraie trahison et dont l’application a conduit le pays à cette honte qu’est la hausse du prix du blé !
La faillite financière et les moyens de la conjurer
La hausse du prix taxé du blé a aussi un autre aspect. Elle entraînera une nouvelle augmentation chaotique de l’émission de papier-monnaie, une nouvelle poussée de vie chère, une aggravation de la désorganisation des finances ; elle rapprochera la faillite financière. Tout le monde reconnaît que l’émission de papier monnaie est la pire forme d’emprunt forcé, qu’elle aggrave surtout la situation des ouvriers, de la partie la plus pauvre de la population, qu’elle est le pire aspect du désordre financier.
Et c’est justement à cette mesure que recourt le gouvernement Kerensky soutenu par les socialistes‑révolutionnaires et les mencheviks !
Pour combattre sérieusement la désorganisation des finances et l’effondrement financier inéluctable, il n’est pas d’autre moyen que de rompre révolutionnairement avec les intérêts du capital et d’organiser un contrôle véritablement démocratique, c’est-à-dire « par en bas », un contrôle des ouvriers et des paysans pauvres sur les capitalistes. C’est de ce moyen que nous avons parlé tout au long de notre exposé.
L’émission de papier-monnaie en quantité illimitée encourage la spéculation, permet aux capitalistes de gagner des millions et entrave considérablement l’élargissement, pourtant si nécessaire, de la production, car la cherté des matériaux, des machines, etc., augmente et progresse par bonds. Comment remédier à la situation alors que les richesses acquises par les riches au moyen de la spéculation restent dissimulées ?
On peut établir un impôt progressif sur le revenu, comportant des taxes très élevées sur les gros et très gros revenus. Cet impôt, notre gouvernement l’a établi à la suite des autres gouvernements impérialistes. Mais il est dans une notable mesure une pure fiction et reste lettre morte ; car, premièrement, l’argent se déprécie de plus en plus vite, et, deuxièmement, la dissimulation des revenus est d’autant plus grande qu’ils ont davantage leur source dans la spéculation et que le secret commercial est mieux gardé.
Pour rendre l’impôt réel et non plus fictif, il faut un contrôle réel, qui ne soit pas simplement sur le papier. Or, le contrôle sur les capitalistes est impossible s’il reste bureaucratique, car la bureaucratie est elle-même liée, attachée par des milliers de fils, à la bourgeoisie. C’est pourquoi dans les États impérialistes de l’Europe occidentale – monarchies ou républiques, peu importe – l’assainissement des finances n’est obtenu qu’au prix de l’introduction d’un « service obligatoire du travail », qui équivaut pour les ouvriers à un bagne militaire ou à un esclavage militaire.
Le contrôle bureaucratique réactionnaire, tel est le seul moyen que connaissent les États impérialistes, sans en excepter les républiques démocratiques, la France et les États-Unis, pour faire retomber les charges de la guerre sur le prolétariat et les masses laborieuses.
La contradiction fondamentale de la politique de notre gouvernement, c’est justement qu’il est obligé, pour ne pas se brouiller avec la bourgeoisie, pour ne pas rompre la « coalition » avec elle, de pratiquer un contrôle bureaucratique réactionnaire, qu’il qualifie de « démocratique révolutionnaire », en trompant constamment le peuple, en irritant, en exaspérant les masses qui viennent de renverser le tsarisme.
Or, ce sont précisément les mesures démocratiques révolutionnaires qui, en groupant dans des associations les classes opprimées, les ouvriers et les paysans, c’est-à-dire les masses, permettraient d’établir le contrôle le plus efficace sur les riches et de combattre avec le plus de succès la dissimulation des revenus.
On cherche à encourager l’usage des chèques pour lutter contre l’inflation. Cette mesure n’est d’aucune importance pour les pauvres, car, de toute façon, ils vivent au jour le jour et accomplissent au cours de la semaine leur « cycle économique » en restituant aux capitalistes les maigres sous qu’ils ont réussi à gagner. En ce qui concerne les riches, l’usage de chèques pourrait avoir une importance considérable : il permettrait à l’État, surtout s’il était combiné à des mesures telles que la nationalisation des banques et la suppression du secret commercial, de contrôler effectivement les revenus des capitalistes, de les imposer effectivement, de « démocratiser » (et en même temps de redresser) effectivement le système financier.
Mais l’obstacle, ici, c’est précisément la crainte d’attenter aux privilèges de la bourgeoisie, de rompre la « coalition » avec elle. Car, sans des mesures véritablement révolutionnaires, sans la contrainte la plus sérieuse, les capitalistes ne se soumettront à aucun contrôle, ne dévoileront pas leurs budgets, ne mettront pas leurs réserves de papier-monnaie « sous la coupe » de l’État démocratique.
En nationalisant les banques, en édictant une loi qui rendrait l’usage des chèques obligatoire pour tous les riches, en supprimant le secret commercial, en punissant la dissimulation des revenus par la confiscation des biens, etc., les ouvriers et les paysans, groupés en associations, pourraient avec une extrême facilité rendre effectif et universel le contrôle sur les riches, et ce contrôle restituerait au Trésor le papier-monnaie émis par lui en le reprenant à ceux qui le détiennent, à ceux qui le dissimulent.
Il faut pour cela une dictature révolutionnaire de la démocratie dirigée par le prolétariat révolutionnaire ; autrement dit, la démocratie doit devenir révolutionnaire en fait. Tout est là. Mais c’est précisément ce dont ne veulent pas nos socialistes‑révolutionnaires et nos mencheviks, qui se couvrent du drapeau de la « démocratie révolutionnaire » pour tromper le peuple, et soutiennent en fait la politique bureaucratique réactionnaire de la bourgeoisie, dont la devise est, comme toujours : « Après nous, le déluge[10] ! »
D’ordinaire, nous ne remarquons même pas combien profondément se sont ancrés en nous les habitudes et les préjugés anti-démocratiques au sujet de la « sacro-sainte » propriété bourgeoise. Quand un ingénieur ou un banquier publient des données sur les revenus et les dépenses de l’ouvrier, sur son salaire et sur la productivité de son travail, la chose est considérée comme archilégale et juste. Personne ne songe à y voir une atteinte à la « vie privée » de l’ouvrier, « un acte de mouchardage ou une délation » de la part de l’ingénieur. La société bourgeoise considère le travail et le gain des ouvriers salariés comme un livre ouvert qui lui appartient, que tout bourgeois est en droit de consulter à tout moment, afin de dénoncer le « luxe » des ouvriers, leur prétendue « paresse », etc.
Et le contrôle inverse ? Si les syndicats d’employés, de commis, de domestiques étaient invités par l’État démocratique à contrôler les revenus et les dépenses des capitalistes, à en publier les chiffres, à aider le gouvernement à combattre la dissimulation des revenus ?
Quelles clameurs sauvages la bourgeoisie ne pousserait-elle pas contre le « mouchardage », contre la « délation » ! Quand les « maîtres » contrôlent leurs serviteurs, quand les capitalistes contrôlent les ouvriers, cela est dans l’ordre des choses. La vie privée du travailleur et de l’exploité n’est pas considérée comme inviolable, la bourgeoisie est en droit de demander des comptes à chaque « esclave salarié », elle peut à tout moment révéler au public ses revenus et ses dépenses. Mais que les opprimés essayent de contrôler l’oppresseur, de tirer au clair ses revenus et ses dépenses, de dénoncer son luxe, ne serait‑ce qu’en temps de guerre, lorsque ce luxe est la cause directe de la famine et de la mort des armées au front, oh non ! La bourgeoisie ne tolérera ni « mouchardage » ni « délation » !
La question se ramène toujours à ceci : la domination de la bourgeoisie est inconciliable avec la démocratie authentique, véritablement révolutionnaire. Au XXe siècle, en pays capitaliste, on ne peut être démocrate révolutionnaire si l’on craint de marcher au socialisme.
Peut-on aller de l’avant si l’on craint de marcher au Socialisme ?
Chez le lecteur nourri des idées opportunistes qui ont cours parmi les socialistes‑révolutionnaires et les mencheviks, ce qui précède peut aisément susciter l’objection que voici : au fond, la plupart des mesures décrites ici ne sont pas démocratiques, ce sont déjà des mesures socialistes !
Cette objection courante, habituelle (sous une forme ou sous une autre) dans la presse bourgeoise, socialiste-révolutionnaire et menchévique, est un argument réactionnaire pour défendre un capitalisme arriéré, un argument qui porte la livrée de Strouvé. Nous ne sommes pas encore mûrs, dit‑on, pour le socialisme ; il est trop tôt pour l’« instaurer » ; notre révolution est bourgeoise. C’est pourquoi il faut se faire les valets de la bourgeoisie (bien que les grands révolutionnaires bourgeois de France aient assuré la grandeur de leur révolution, il y a de cela 125 ans, en exerçant la terreur contre tous les oppresseurs, seigneurs terriens aussi bien que capitalistes !).
Les pseudo‑marxistes, auxquels se sont joints les socialistes‑révolutionnaires, qui se font les serviteurs de la bourgeoisie et qui raisonnent ainsi, ne comprennent pas (si l’on considère les bases théoriques de leurs conceptions) ce qu’est l’impérialisme, ce que sont les monopoles capitalistes, ce qu’est l’État, ce qu’est la démocratie révolutionnaire. Car, si on a compris cela, on est obligé de reconnaître que l’on ne saurait aller de l’avant sans marcher au socialisme.
Tout le monde parle de l’impérialisme. Mais l’impérialisme n’est pas autre chose que le capitalisme monopoliste.
Que le capitalisme, en Russie également, soit devenu monopoliste, voilà ce qu’attestent assez le « Prodougol », le « Prodamet », le syndicat du sucre, etc. Ce même syndicat du sucre nous fournit un exemple saisissant de la transformation du capitalisme monopoliste en capitalisme monopoliste d’État.
Or, qu’est-ce que l’État ? C’est l’organisation de la classe dominante ; en Allemagne, par exemple, celle des hobereaux et des capitalistes. Aussi, ce que les Plekhanov allemands (Scheidemann, Lansch et autres) appellent le « socialisme de guerre » n’est‑il en réalité que le capitalisme monopoliste d’État du temps de guerre ou, pour être plus clair et plus simple, un bagne militaire pour les ouvriers en même temps que la protection militaire des profits capitalistes.
Eh bien, essayez un peu de substituer à l’État des capitalistes et des hobereaux, à l’État des capitalistes et des grands propriétaires fonciers, l’État démocratique révolutionnaire, c’est-à-dire un État qui détruise révolutionnairement tous les privilèges quels qu’ils soient, qui ne craigne pas d’appliquer révolutionnairement le démocratisme le plus complet. Et vous verrez que dans un État véritablement démocratique et révolutionnaire, le capitalisme monopoliste d’État signifie inévitablement, infailliblement, un pas, ou des pas en avant vers le socialisme !
Car, si une grande entreprise capitaliste devient monopole, c’est qu’elle dessert le peuple entier. Si elle est devenue monopole d’État, c’est que l’État (c’est-à-dire l’organisation armée de la population et, en premier lieu, des ouvriers et des paysans, si l’on est en régime démocratique révolutionnaire) dirige toute l’entreprise. Dans l’intérêt de qui ?
Ou bien dans l’intérêt des grands propriétaires fonciers et des capitalistes ; et nous avons alors un État non pas démocratique révolutionnaire, mais bureaucratique réactionnaire, une république impérialiste.
Ou bien dans l’intérêt de la démocratie révolutionnaire ; et alors c’est ni plus ni moins un pas vers le socialisme.
Car le socialisme n’est autre chose que l’étape immédiatement consécutive au monopole capitaliste d’État. Ou encore : le socialisme n’est autre chose que le monopole capitaliste d’État mis au service du peuple entier et qui, pour autant, a cessé d’être un monopole capitaliste.
Ici, pas de milieu. Le cours objectif du développement est tel qu’on ne saurait avancer, à partir des monopoles (dont la guerre a décuplé le nombre, le rôle et l’importance), sans marcher au socialisme.
Ou bien l’on est réellement démocrate révolutionnaire. Et alors on ne saurait craindre de s’acheminer vers le socialisme.
Ou bien l’on craint de s’acheminer vers le socialisme et l’on condamne tous les pas faits dans cette direction, sous prétexte, comme disent les Plekhanov, les Dan et les Tchernov, que notre révolution est bourgeoise, qu’on ne peut pas « introduire » le socialisme, etc. Dans ce cas, l’on en arrive fatalement à la politique de Kerensky, Millioukov et Kornilov, c’est-à-dire à la répression bureaucratique réactionnaire des aspirations « démocratiques révolutionnaires » des masses ouvrières et paysannes.
Il n’y a pas de milieu.
Et c’est là la contradiction fondamentale de notre révolution.
Dans l’histoire en général, et surtout en temps de guerre, il est impossible de piétiner sur place. Il faut ou avancer, ou reculer. Il est impossible d’avancer dans la Russie du XXe siècle, qui a conquis la République et la démocratie par la voie révolutionnaire, sans marcher au socialisme, sans progresser vers le socialisme (progression conditionnée et déterminée par le niveau de la technique et de la culture : il est impossible d’« introduire » en grand le machinisme dans les exploitations paysannes comme il est impossible de le supprimer dans la production du sucre).
Et craindre d’avancer équivaut à reculer. C’est ce que font messieurs les Kerensky, aux applaudissements enthousiastes des Milioukov et des Plekhanov, avec la sotte complicité des Tseretelli et des Tchernov.
La dialectique de l’Histoire est précisément telle que la guerre, qui a extraordinairement accéléré la transformation du capitalisme monopoliste en capitalisme monopoliste d’État, a par là même considérablement rapproché l’humanité du socialisme.
La guerre impérialiste marque la veille de la révolution socialiste. Non seulement parce que ses horreurs engendrent l’insurrection prolétarienne – aucune insurrection ne créera le socialisme s’il n’est pas mûr économiquement –, mais encore parce que le capitalisme monopoliste d’État est la préparation matérielle la plus complète du socialisme, l’antichambre du socialisme, l’étape de l’Histoire qu’aucune autre étape intermédiaire ne sépare du socialisme.
Nos socialistes‑révolutionnaires et nos mencheviks envisagent le problème du socialisme en doctrinaires, du point de vue d’une doctrine qu’ils ont apprise par cœur et mal comprise. Ils présentent le socialisme comme un avenir lointain, inconnu, obscur.
Or, aujourd’hui, le socialisme est au bout de toutes les avenues du capitalisme contemporain, le socialisme apparaît directement et pratiquement dans chaque disposition importante constituant un pas en avant sur la base de ce capitalisme moderne.
Qu’est-ce que le service de travail obligatoire ?
C’est un pas en avant, sur la base du capitalisme monopoliste moderne, un pas vers la réglementation de toute la vie économique d’après un certain plan d’ensemble, un pas vers l’économie du travail national afin de prévenir son gaspillage insensé par le capitalisme.
Les junkers (grands propriétaires fonciers) et les capitalistes instituent en Allemagne le service de travail obligatoire, qui devient fatalement un bagne militaire pour les ouvriers.
Mais considérez la même institution et réfléchissez à la portée qu’elle aurait dans un État démocratique révolutionnaire. Le service de travail obligatoire institué, réglé, dirigé par les Soviets des députés ouvriers, soldats et paysans, ce n’est pas encore le socialisme, mais ce n’est déjà plus le capitalisme. C’est un pas immense vers le socialisme, un pas après lequel il est impossible, toujours en démocratie intégrale, de revenir en arrière, de revenir au capitalisme, à moins d’user des pires violences contre les masses.
La guerre et la lutte contre la débâcle économique
La question des mesures à prendre pour conjurer la catastrophe imminente nous amène à élucider une autre question extrêmement importante : la liaison de la politique intérieure avec la politique extérieure, ou encore : le rapport entre la guerre de conquête, impérialiste, et la guerre révolutionnaire, prolétarienne ; entre la guerre criminelle de rapine et la guerre juste, démocratique.
D’une part, toutes les mesures que nous avons décrites, et qui sont destinées à conjurer la catastrophe, accroîtraient considérablement, comme nous l’avons déjà marqué, la capacité de défense du pays, autrement dit sa puissance militaire. D’autre part, il est impossible d’appliquer ces mesures sans transformer la guerre de conquête en une guerre juste, sans transformer la guerre menée par les capitalistes dans l’intérêt des capitalistes en une guerre menée par le prolétariat dans l’intérêt de tous les travailleurs et de tous les exploités.
En effet, la nationalisation des banques et des syndicats patronaux, accompagnée de la suppression du secret commercial et de l’établissement du contrôle ouvrier sur les capitalistes, ne signifierait pas seulement une immense économie du travail national, la possibilité d’économiser des forces et des ressources ; elle signifierait encore une amélioration de la situation des masses laborieuses, c’est-à-dire de la majorité de la population. Tout le monde sait que, dans la guerre moderne, l’organisation économique a une importance décisive. La Russie a suffisamment de blé, de houille, de pétrole, de fer ; à cet égard, notre situation est meilleure que celle de tout autre pays belligérant d’Europe. Et si elle luttait contre la débâcle économique par les moyens indiqués plus haut, en s’appuyant dans cette lutte sur l’initiative des masses, en améliorant leur situation, en nationalisant les banques et les syndicats patronaux, la Russie utiliserait sa révolution et son démocratisme pour porter le pays tout entier à un niveau d’organisation économique infiniment plus élevé.
Si, au lieu de la « coalition » avec la bourgeoisie, qui entrave toute mesure de contrôle et sabote la production, les socialistes‑révolutionnaires et les mencheviks avaient, en avril, fait passer le pouvoir aux Soviets et s’étaient employés, non pas à jouer aux « chassés-croisés ministériels » et à user bureaucratiquement, aux côtés des cadets, le velours des fauteuils de ministres, de sous-secrétaires d’État, etc., etc., mais à diriger les ouvriers et les paysans dans l’exercice de leur contrôle sur les capitalistes, dans leur guerre contre ces derniers, la Russie serait maintenant un pays en pleine transformation économique, où les paysans disposeraient de la terre et où les banques seraient nationalisées ; c’est-à-dire qu’elle aurait, dans cette mesure même (or, ce sont là des bases économiques extrêmement importantes de la vie d’aujourd’hui), dépassé tous les autres pays capitalistes.
La capacité de défense, la puissance militaire d’un pays où les banques sont nationalisées, est supérieure à celle d’un pays où les banques restent aux mains des particuliers. La puissance militaire d’un pays paysan où la terre est aux mains des comités paysans est supérieure à celle d’un pays de grandes propriétés foncières.
On invoque constamment le patriotisme héroïque et les prodiges de valeur militaire des Français en 1792‑1793. Mais on oublie les conditions matérielles économiques et historiques qui seules ont rendu possibles ces prodiges. La destruction effectivement révolutionnaire de la féodalité qui avait fait son temps, l’adoption par le pays tout entier avec une promptitude, une résolution, une énergie et une abnégation vraiment démocratiques et révolutionnaires d’un mode supérieur de production, la libre possession du sol par les paysans : telles sont les conditions matérielles, économiques, qui, avec une promptitude « prodigieuse », ont sauvé la France en régénérant, en rénovant sa base économique.
L’exemple de la France prouve une chose, et une seule : pour rendre la Russie apte à se défendre, pour y susciter également des « prodiges » d’héroïsme de masse, il faut balayer avec une implacabilité « jacobine » tout ce qui est vieux, et rénover, régénérer le pays économiquement. Or, on ne saurait le faire au XXe siècle simplement en balayant le tsarisme (la France d’il y a 125 ans ne s’en est pas tenue là). On ne saurait non plus le faire uniquement par la suppression révolutionnaire de la grande propriété foncière (même cela nous ne l’avons pas fait, les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks ayant trahi la paysannerie !), uniquement par la remise de la terre aux paysans. Car nous vivons au XXe siècle ; dominer le sol sans dominer les banques ne suffit pas à assurer la régénération et la rénovation de la vie du peuple.
La rénovation matérielle, économique, de la France, à la fin du XVIIIe siècle, était liée à une rénovation politique et spirituelle, à la dictature de la démocratie révolutionnaire et du prolétariat révolutionnaire (qui ne faisait qu’un encore avec la démocratie et se confondait presque avec elle), à la guerre implacable déclarée à toutes les formes de réaction. Le peuple entier – et surtout les masses, c’est-à-dire les classes opprimées – était soulevé d’un enthousiasme révolutionnaire sans bornes : tout le monde considérait la guerre comme une guerre juste, défensive, et elle l’était réellement. La France révolutionnaire se défendait contre l’Europe monarchique réactionnaire. Ce n’est pas en 1792‑1793, mais bien des années plus tard, après le triomphe de la réaction à l’intérieur du pays, que la dictature contre-révolutionnaire de Napoléon fit perdre aux guerres de la France leur caractère défensif pour en faire des guerres de conquête.
Et en Russie ? Nous continuons la guerre impérialiste, dans l’intérêt des capitalistes, en alliance avec les impérialistes, en exécution des traités secrets conclus avec les capitalistes d’Angleterre et d’ailleurs par le tsar qui, aux termes de ces traités, promettait aux capitalistes russes le pillage de pays étrangers, Constantinople, Lvov, l’Arménie, etc.
La guerre restera une guerre injuste, réactionnaire, une guerre de conquête de la part de la Russie, tant que celle-ci n’aura pas proposé une paix juste et rompu avec l’impérialisme. Le caractère social de la guerre, sa signification véritable ne sont pas déterminés par les positions qu’occupent les troupes ennemies (comme le pensent les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks, tombés aux conceptions vulgaires d’un moujik inculte). Son caractère est déterminé par la réponse à ces deux questions : quelle est la politique que continue la guerre (« la guerre est la continuation de la politique ») ? Quelle est la classe qui fait la guerre, et dans quels buts ?
On ne saurait conduire les masses à une guerre de rapine en vertu de traités secrets et compter sur leur enthousiasme. La classe d’avant-garde de la Russie révolutionnaire, le prolétariat, comprend de mieux en mieux ce que cette guerre a de criminel, et la bourgeoisie est loin d’avoir pu modifier cette conviction des masses ; bien au contraire, celle-ci ne fait que croître. Le prolétariat des deux capitales est devenu, en Russie, définitivement internationaliste !
Vous voyez d’ici ce que peut être l’enthousiasme des masses pour la guerre !
L’un est indissolublement lié à l’autre, la politique intérieure à la politique extérieure. Il est impossible de rendre le pays apte à se défendre sans un sublime héroïsme du peuple accomplissant avec hardiesse et résolution de grandes réformes économiques. Et il est impossible de faire naître l’héroïsme dans les masses sans rompre avec l’impérialisme, sans proposer à tous les peuples une paix démocratique, sans transformer ainsi la guerre criminelle de conquête et de rapine en une guerre juste, défensive, révolutionnaire.
Seule une rupture conséquente, absolue, avec les capitalistes, en politique intérieure comme en politique extérieure, peut sauver notre révolution et notre pays pris dans l’étau de fer de l’impérialisme.
Démocratie révolutionnaire et prolétariat révolutionnaire
Dans la Russie actuelle, la démocratie doit, pour être vraiment révolutionnaire, s’unir étroitement au prolétariat, le soutenir dans la lutte qu’il mène en tant que seule classe révolutionnaire jusqu’au bout.
Telle est la conclusion où conduit l’examen des moyens de conjurer une catastrophe imminente d’une ampleur inouïe.
La guerre a engendré une crise si étendue, bandé à tel point les forces matérielles et morales du peuple, porté des coups si rudes à toute l’organisation sociale actuelle, que l’humanité se trouve placée devant cette alternative : ou bien périr, ou bien confier son sort à la classe la plus révolutionnaire, afin de passer aussi rapidement et radicalement que possible à un mode supérieur de production.
Pour de multiples raisons historiques – retard plus considérable de la Russie, difficultés particulières résultant de la guerre, décomposition extrême du tsarisme, vitalité extraordinaire des traditions de 1905 –, la révolution en Russie a devancé celle des autres pays. La révolution a fait que la Russie a rattrapé en quelques mois, quant à son régime politique, les pays avancés.
Mais cela ne suffit pas. La guerre est inexorable. Elle pose la question avec une âpreté implacable : ou bien périr ou bien rattraper les pays avancés et les dépasser aussi du point de vue économique...
Cela est possible, car nous avons sous les yeux l’expérience toute prête d’un grand nombre de pays avancés, les résultats déjà acquis de leur technique et de leur culture. Nous trouvons un soutien moral dans le mouvement de protestation qui grandit en Europe contre la guerre, dans l’atmosphère de la révolution ouvrière qui monte dans tous les pays. Ce qui nous stimule, ce qui nous aiguillonne, c’est une liberté démocratique révolutionnaire exceptionnelle en temps de guerre impérialiste.
Périr ou s’élancer en avant à toute vapeur. C’est ainsi que l’Histoire pose la question.
Et l’attitude du prolétariat envers la paysannerie, dans un tel moment, confirme, en le modifiant comme le commande la situation, le vieux principe bolchevik : arracher la paysannerie à l’influence de la bourgeoisie. Là seulement est le gage du salut de la révolution.
La paysannerie est l’élément le plus nombreux de la masse petite-bourgeoise.
Nos socialistes‑révolutionnaires et nos mencheviks ont assumé un rôle réactionnaire : maintenir la paysannerie sous l’influence de la bourgeoisie, amener la paysannerie à une coalition avec la bourgeoisie, et non avec le prolétariat.
L’expérience de la révolution instruit vite les masses. Et la politique réactionnaire des socialistes‑révolutionnaires et des mencheviks fait faillite : ils ont été battus dans les Soviets des deux capitales[11]. L’opposition « de gauche » croît dans les deux partis démocratiques petits-bourgeois. Le 10 septembre 1917, la conférence des socialistes‑révolutionnaires de Petrograd a donné une majorité des deux tiers aux socialistes‑révolutionnaires de gauche qui penchent vers l’alliance avec le prolétariat et repoussent l’alliance (la coalition) avec la bourgeoisie.
Les socialistes‑révolutionnaires et les mencheviks reprennent à leur compte l’opposition, si aimée par la bourgeoisie, de ces deux concepts : bourgeoisie et démocratie. Mais, au fond, cette opposition est aussi absurde que le serait la comparaison entre des mètres et des kilogrammes.
Il peut y avoir une bourgeoisie démocratique, il peut y avoir une démocratie bourgeoise : pour le nier, il faut être d’une ignorance crasse en histoire comme en économie politique.
Les socialistes‑révolutionnaires et les mencheviks avaient besoin de cette opposition factice pour masquer un fait incontestable, à savoir qu’entre la bourgeoisie et le prolétariat se place la petite bourgeoisie. Celle-ci, par sa situation sociale et économique, hésite nécessairement entre la bourgeoisie et le prolétariat.
Les socialistes‑révolutionnaires et les mencheviks poussent la petite bourgeoisie vers l’alliance avec la bourgeoisie. Tel est le fond de toute leur « coalition », de tout le ministère de coalition, de toute la politique de Kerensky, ce semi-cadet typique. En six mois de révolution, cette politique a fait complètement faillite.
Les cadets exultent : vous voyez bien, la révolution a fait faillite, la révolution n’a pu venir à bout ni de la guerre, ni du marasme économique.
Cela est faux. Ce sont les cadets et les socialistes‑révolutionnaires avec les mencheviks, qui ont fait faillite ; car c’est ce bloc (cette alliance) qui a gouverné la Russie pendant six mois : il a en ces six mois aggravé le marasme économique, compliqué et rendu plus difficile la situation militaire.
Plus complète sera la faillite de l’alliance de la bourgeoisie avec les socialistes‑révolutionnaires et les mencheviks, et plus vite le peuple s’instruira. Plus il trouvera facilement la solution juste : l’alliance de la paysannerie pauvre, c’est-à-dire de la majorité des paysans, avec le prolétariat.
Le 10‑14 septembre 1917
[1] La Conférence démocratique de Russie (Pétrograd, 14-22 septembre 1917) avait été convoquée par les menchéviques et les s.-r. dans l’espoir d’affaiblir la montée révolutionnaire. Y prirent part divers représentants des partis petits-bourgeois, des soviets conciliateurs, des syndicats, des zemstvos, des milieux commerciaux et industriels, des unités militaires. Les bolcheviks y participèrent dans le but de dénoncer les plans des mencheviks et des s.‑r. La conférence démocratique forma un Préparlement (Conseil provisoire de la république) à l’aide duquel les mencheviks et les s.‑r. se proposaient de freiner la révolution et d’aiguiller le pays sur la voie du parlementarisme bourgeois.
Sur la proposition de Lénine, le C.C. du parti décida que les bolcheviks quitteraient le Préparlement; seuls Kaménev, Rykov et Riazanov, qui s’étaient élevés contre l’option du parti pour la révolution socialiste, préconisaient la participation au Préparlement. Les bolcheviks dénoncèrent la félonie de cette officine tout en préparant les masses à l’insurrection armée. (NDE)
[2] Kit Kitytch : surnom, riche marchand campé par Ostrovski dans sa comédie Payer les pots cassés. Lénine appelle Kit Kitytch les brasseurs d’affaires capitalistes. (NDE)
[3] Les comités des industries de guerre avaient été fondés en mai 1915 par la grande bourgeoisie impérialiste dans le but d’aider à l’effort de guerre du tsarisme. Le gros capitaliste A. Goutchkov, leader des octobristes (parti bourgeois « libéral »), était le président du Comité central des industries de guerre. Faisaient également partie de ce Comité l’industriel A. Konovalov, le banquier et industriel M. Terechtchenko, etc. Désireuse de placer les ouvriers sous son influence et de leur inculquer un état d’esprit chauvin, la bourgeoisie décida d’organiser des « groupes ouvriers » auprès de ces comités. Elle entendait montrer ainsi que la « paix sociale » avait été conclue entre la bourgeoisie et le prolétariat. Les bolcheviks boycottèrent les comités des industries de guerre et furent soutenus par la majorité des ouvriers. (NDE)
À la suite du vaste travail d’explication des bolcheviks, sur les 239 comités des industries de guerre régionaux et locaux, 70 seulement organisèrent des élections de « groupes ouvriers », et 36 eurent leurs représentants ouvriers. (NDE)
[4] Dien [Le Jour] : quotidien libéral-bourgeois qui paraissait depuis 1912. Passe sous contrôle menchevik après février 1917 et est interdit après la révolution d’Octobre 1917. (NDE)
[5] Edinstvo [l’Unité] : organe des mencheviks de droite, dirigés par Plekhanov. Quatre numéros parurent en mai-juin 1914. De mars à novembre 1917, le journal devient quotidien. Change de nom pour Naché édintsvo [Notre Unité] pour paraître ensuite jusqu’à janvier 1918. (NDE)
[6] Ces lignes étaient déjà écrites quand j’ai appris par les journaux que le gouvernement Kérensky établissait le monopole du sucre et qu’il l’établissait, naturellement, par des procédés bureaucratiques réactionnaires, sans congrès d’employés et d’ouvriers, sans publicité, sans mater les capitalistes !! (Lénine)
[7] Cf. l’article de Lénine : « Instaurer le socialisme ou divulguer les malversations ? » Pravda, 22 juin 1917. (NDE)
[8] J’ai déjà eu l’occasion d’indiquer dans la presse bolchévique que l’application de la peine de mort par les exploiteurs aux masses de travailleurs, en vue de maintenir l’exploitation, est le seul argument juste contre la peine capitale. (Voir l’article « Résolutions de papier », Rabotchi, 8 sept. 1917) (N.R.) Il n’est guère probable qu’un gouvernement révolutionnaire quelconque puisse se passer de la peine de mort contre les exploiteurs (c’est-à-dire contre les grands propriétaires fonciers et les capitalistes). (Lénine)
[9] « Svobodnaïa Jizn » [La Vie libre], journal d’orientation menchevik, parut à Petrograd du 2 (15) au 8 (21) septembre 1917 en remplacement du journal Novaïa Jizn temporairement interdit. (NDE)
[10] En français dans le texte. (NDT)
[11] Le 31 août (13 septembre) 1917, le Soviet de Petrograd adopta en séance plénière pour la première fois depuis sa création et à la majorité de 279 voix contre 115 et 50 abstentions, une résolution présentée par la fraction bolchevik, qui repoussait résolument la politique d’entente avec la bourgeoisie. La résolution préconisait la remise de la totalité du pouvoir aux mains des Soviets et esquissait un vaste programme de transformations révolutionnaires dans le pays. Quelques jours plus tard, le parti bolchevik remporta une nouvelle victoire d’importance. Le 5 (18) septembre, le soviet des députés ouvriers et soldats de Moscou adopta à la majorité de 355 voix une résolution bolchevik d’un contenu analogue. (NDE)