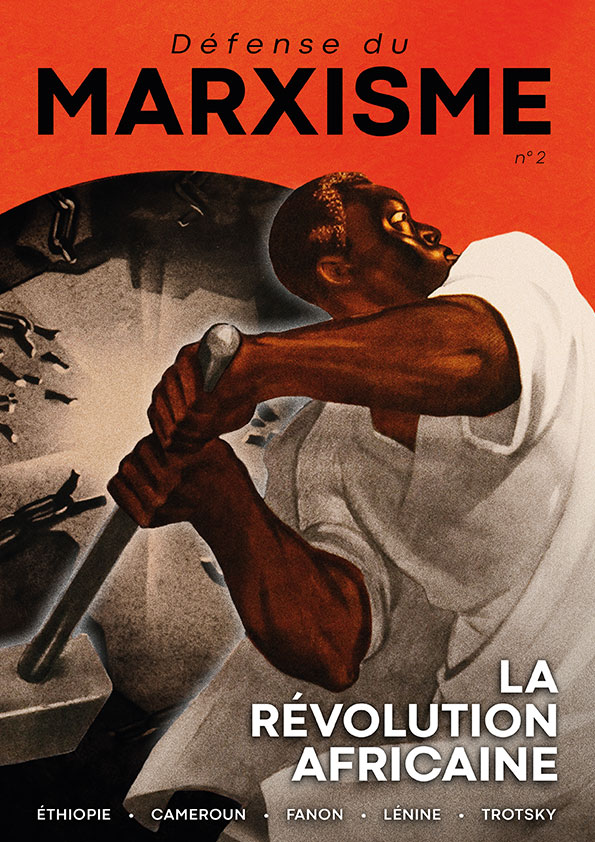Chapitre 6 - La philosophie au Moyen Age
Après l’effondrement de l’Empire romain d’Occident au Ve siècle, la majeure partie de l’Europe est entrée dans une longue phase de barbarie connue sous le nom d’« Age des ténèbres » et caractérisée par un déclin tragique de la culture. Les énormes progrès réalisés par les Grecs et les Romains dans les domaines de l’art, de la science et de la philosophie ont été perdus. Avant de les retrouver, l’Europe devra parcourir un douloureux chemin de près de mille ans.
Progressivement, une nouvelle forme de société émergea des décombres de l’ancien système. Elle était fondée sur l’exploitation d’une paysannerie qui n’était plus réduite à l’esclavage, mais attachée à la terre sous la domination de seigneurs temporels et spirituels. La structure pyramidale de la société reflétait cette domination, avec un système rigide de prétendus devoirs et droits envers les « supérieurs naturels ». Cependant, le devoir fondamental, dont dépendait tout le reste, était le devoir du serf de fournir du travail gratuit à son seigneur et maître. L’ensemble du système était sanctifié par l’Eglise, qui exerçait un pouvoir immense, et était organisée selon une structure hiérarchique similaire.
La hiérarchie sociale rigide qui caractérise le système féodal trouve une expression idéologique dans les dogmes figés de l’Eglise, qui exigent une obéissance inconditionnelle fondée sur l’interprétation officielle des textes sacrés. A la place de la raison, les Pères de l’Eglise prêchaient une foi aveugle, résumée dans la célèbre phrase attribuée à Tertullien : « Credo, quia absurdum est » (« Je crois parce que c’est absurde »). Héritage du paganisme, la science était considérée comme suspecte.
L’héritage de la philosophie grecque classique était perdu, et il n’a été que partiellement ravivé au XIIe siècle, en Europe occidentale. Une telle situation n’était pas propice au développement de la pensée et de la science. J. D. Bernal écrit : « Les conditions de la production féodale ont réduit la demande de science utile à un minimum. Elle ne devait plus augmenter jusqu’à ce que le commerce et la navigation créent de nouveaux besoins à la fin du Moyen Age. L’effort intellectuel devait s’orienter dans d’autres directions et être en grande partie au service d’une caractéristique radicalement nouvelle de la civilisation – les croyances religieuses organisées. » (J. D. Bernal, Science in History, p.254).
Selon Forbes et Dijksterhuis : « D’une manière générale, on peut dire que, durant les premiers siècles de son existence, le christianisme n’était pas propice aux activités scientifiques. La science était considérée avec suspicion en raison de son origine païenne ; en outre, l’idée prévalait qu’il n’était pas souhaitable, pour le bien-être spirituel des chrétiens, qu’ils pénètrent dans les secrets de la nature au-delà de ce que les Saintes Ecritures rendaient possible et nécessitaient pour être comprises. » (R. J. Forbes, E. J. Dijksterhuis, A History of Science and Technology, vol.1, pp.101-102).
Lorsque les vestiges de la culture classique ont fini par atteindre l’Europe occidentale, c’était dans des traductions arabes. Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, la grande énergie déployée par les Arabes pour conquérir l’Afrique du Nord et l’Espagne, jusqu’aux Pyrénées, s’est accompagnée d’une attitude intelligente et souple à l’égard de la culture des peuples conquis, ce qui contraste fortement avec la barbarie ignorante dont ont fait preuve les chrétiens après la reconquête d’Al-Andalus. Pendant des siècles, les universités islamiques d’Espagne, notamment celle de Cordoue, ont été les seuls véritables centres d’enseignement en Europe occidentale – si l’on excepte l’Irlande qui, en raison de son éloignement, est restée en dehors du courant dominant. Les Arabes ont fait de grands progrès dans de nombreux domaines comme les mathématiques, l’astronomie, la géographie, la médecine, l’optique et la chimie, ainsi que d’importants progrès techniques, comme en témoignent les vastes systèmes d’irrigation, détruits sans ménagement par les chrétiens. Mais il a fallu des centaines d’années pour que ces connaissances fassent leur chemin jusqu’en Europe occidentale.
En raison du monopole de l’Eglise sur la culture, toute la vie intellectuelle devait passer par elle. Pendant des siècles, l’éducation a été confinée dans les monastères, sous le strict contrôle de la bureaucratie cléricale. Pour les étudiants médiévaux – ou les scolastiques, comme on appelait l’intelligentsia officielle – la philosophie était la « servante de la théologie ». La science était réduite à son strict minimum : « L’arithmétique se réduisait à la numération ; la géométrie aux trois premiers livres d’Euclide ; l’astronomie ne dépassait guère le calendrier et la façon de calculer la date de Pâques ; la physique était très abstraite et de style platonicien. » (Ibid., p.218). La recherche et l’expérimentation scientifiques n’éveillaient aucun intérêt.
Réalisme et nominalisme : la question des universaux
Le pilier idéologique de la théocratie médiévale était constitué par les idées de saint Augustin d’Hippone (354-430), le philosophe le plus influent de l’âge des ténèbres. Augustin s’appuyait sur les éléments les plus réactionnaires de la pensée néo-platonicienne. Sa philosophie était un mélange de mysticisme chrétien et d’une forme grossière d’idéalisme platonicien. Toute opposition à la pensée augustinienne, devenue la principale idéologie de l’Eglise catholique romaine, était considérée comme intrinsèquement hérétique et, comme telle, était persécutée.
Comme Platon, Augustin pensait que tous les êtres étaient formés d’après des archétypes universels, qui sont des réalités transcendant notre monde physique. Dans le système de Platon, ces archétypes – ou « formes », comme il les appelait – existent dans un autre monde auquel les humains ne peuvent accéder que par la pensée philosophique pure. Pour Augustin, en revanche, les archétypes – ou « raisons » – existent dans l’esprit divin et ne sont accessibles aux humains qu’à travers la foi.
La théorie des universaux d’Augustin est au fondement de cette tendance de la philosophie médiévale qui fut nommée – d’une manière prêtant à confusion – « réalisme ». A la suite d’Augustin et de Platon, les réalistes pensaient que nos concepts généraux (« homme », « animal », « arbre », « rocher », etc.) sont fondés sur des archétypes réellement existants et immuables. Ces universaux constitueraient eux-mêmes le fondement des hommes, animaux, arbres et rochers singuliers et changeants que nous connaissons dans la vie. Mais comment pouvons-nous connaître ces universaux ? Selon Augustin, c’est dans l’esprit de Dieu que se trouve la véritable essence des choses. Il est donc inutile de la chercher sur terre : nous devons plutôt diriger notre regard vers les Cieux.
Cette vision du monde ne laisse aucune place à la science, à la recherche ou même à la pensée rationnelle. L’intellect y est passif ; il se contente de recevoir la connaissance que procure la foi. Conformément à la doctrine chrétienne, Augustin considère que toutes les choses matérielles et terrestres sont intrinsèquement inférieures, et même marquées du sceau du péché. Les corps des hommes et des femmes (en particulier des femmes) sont soumis au péché – et doivent donc être considérés avec horreur. La vraie vie commence au moment de la mort, lorsque l’âme est enfin libérée de sa prison matérielle. Dès lors, il va de soi que la vérité ne se trouve pas dans le monde matériel : « ... la vérité dans un sens authentique n’est pas quelque chose à attendre des sens corporels. » (Quatre-vingt-trois questions).
Le monde objectif est, au mieux, d’une importance secondaire, et nos sens sont inutiles pour nous conduire à la vérité. « Crede, ut intelligas » (« Crois pour comprendre ») était une célèbre formule d’Augustin. La vérité ne peut être trouvée que dans l’esprit statique et immuable de Dieu, lequel illumine nos esprits de sa vérité – à condition que nous soyons suffisamment « purs » et « saints ». Ainsi, le jugement ultime de toute vérité est placé entre les mains des plus saints parmi les saints : l’élite cléricale de l’Eglise catholique. Cette théorie de la connaissance était connue sous le nom de doctrine de l’illumination divine. Avec le réalisme augustinien, elle a jeté les bases philosophiques de la réaction médiévale.
Cette école de pensée a dominé l’Europe pendant des siècles. La situation de la science et de la culture semblait désespérée. Et pourtant, sous la surface, la taupe de l’histoire continuait à creuser. Les forces productives se développaient – quoique très lentement –, et avec elles la science et la technique.
Aux XIIe et XIIIe siècles, en Europe, la société féodale atteignait son apogée. La quasi-totalité des terres arables étaient exploitées et la productivité des terres, ainsi que le rendement total de l’agriculture, étaient à leur maximum. Sur cette base, la population augmentait. Le continent peu peuplé du début de la période médiévale faisait place à un vaste réseau de petites villes et de quelques grandes cités. Paris, Florence, Venise et Gênes atteignaient des populations d’environ 100 000 habitants, tandis que Londres, Gand et Cologne en comptaient environ 50 000. L’appareil d’Etat et les institutions urbaines se développaient, et avec eux le besoin de professionnels. Les anciennes institutions d’enseignement monastiques ne suffisaient plus. On assista donc à l’essor des universités, où le droit et la médecine s’enseignaient à l’écart de la théologie.
Dans la tradition monastique, les étudiants n’avaient pas le droit de parler, ni même de poser des questions. Mais dans les universités, les choses étaient bien différentes. L’une des principales méthodes d’apprentissage consistait en des « disputations » : des débats publics sur des sujets théologiques. La dialectique, comme discipline de l’argumentation rationnelle, s’est développée en même temps que les disputations. Les sujets débattus étaient encore hautement mystiques, et il n’était pas permis de s’écarter de l’autorité chrétienne. Les idées de Platon et d’Aristote, ainsi que leurs commentaires, constituaient des exceptions que l’Eglise acceptait à contrecœur.
Cette libération partielle des idées a donné à la philosophie un nouveau souffle. A travers des débats visant à déterminer si les anges sont des individus ou une espèce, si Dieu est simple ou complexe, ou encore quel est le statut des universaux dans l’esprit divin, les écoliers médiévaux redécouvraient lentement la philosophie.
Un autre événement important donna une impulsion majeure à ce développement. Pour remplir les programmes des universités, en particulier ceux des facultés des arts et de médecine, un effort sérieux a été engagé pour traduire en latin les textes scientifiques et philosophiques arabes. Presque tous les ouvrages grecs classiques avaient été perdus pendant l’âge des ténèbres, mais ils ont commencé à revenir en Europe, en même temps que les ouvrages des scientifiques et des philosophes arabes.
Ce fut le début du processus de séparation de la philosophie et de la science d’avec la religion. Pour la première fois depuis des siècles, une lueur commençait à briller dans l’obscurité qui avait recouvert l’Europe. En philosophie, les contradictions ont commencé à s’accumuler, dont le vieux paradigme augustinien était incapable de rendre compte.
La première rupture avec l’ancienne voie – la « via antiqua » – est venue du scolastique français Pierre Abélard (1079-1142). Abélard est connu pour son amour tragique d’Héloïse, un autre esprit éminent de l’époque. Mais cette circonstance ne doit pas occulter le fait qu’Abélard était un penseur novateur et courageux, réputé dans toute l’Europe pour être le plus redoutable « disputateur » et dialecticien de son temps.
Abélard fut également le père du nominalisme, une école de pensée affirmant que les universaux n’existent pas en tant que choses réelles dans l’esprit de Dieu ou ailleurs. Se fondant sur Aristote et sur une logique méticuleuse, Abélard a rejeté le réalisme augustinien et prouvé que les universaux ne sont pas des archétypes réellement existants, auxquelles participeraient les choses singulières du monde, ou qu’elles reflèteraient. Il a soutenu que tous les êtres sont singuliers : tel homme n’est que cet homme, et tel rocher n’est que cela, un rocher particulier.
Il soutenait que les concepts tels que l’homme, l’animal, etc., ne sont que des mots, c’est-à-dire des conventions désignant des choses dans le monde réel, mais n’ayant pas la moindre réalité en dehors de la conscience humaine. Selon Abélard, la forme des objets matériels n’est que le résultat de différentes combinaisons des quatre éléments : la terre, l’air, le feu et l’eau. Les universaux ne sont pas des êtres composés de ce type.
Cela ne signifie pas que, pour Abélard, nos concepts généraux, universels, ne correspondent à rien. En effet, les choses singulières ont des caractéristiques communes. Par exemple, il est dans la nature des oiseaux de pondre des œufs et d’avoir des ailes – ce que nous pouvons déduire de l’expérience que nous en avons. Nos mots universels correspondent à ce qu’Abélard appelle les « statuts » des choses, c’est-à-dire leur mode d’existence ou leur légalité interne. Ainsi, les caractéristiques communes des animaux, par exemple, ne sont pas arbitraires. Elles reflètent les processus naturels similaires qui ont conduit à la création des animaux.
Il s’agit là d’une rupture radicale avec les croyances conventionnelles de l’Eglise. Cette philosophie laisse peu de place au surnaturel. Abélard réduisait le rôle de Dieu à la définition initiale des lois de la nature. Autrement dit, aucune illumination divine n’est requise pour acquérir des connaissances : nos connaissances dérivent de nos expériences sensorielles, ainsi que de notre capacité à abstraire et à généraliser à partir des phénomènes que nous rencontrons dans le monde réel.
Cet écart par rapport aux doctrines officielles a provoqué la colère de la bureaucratie catholique, mais Abélard s’est obstiné. Malgré toutes les tentatives de ses ennemis pour le faire taire, il a porté un coup fatal à la théorie de la connaissance par illumination divine. Après lui, il était presque universellement admis que la connaissance s’acquiert par l’expérience des sens et l’abstraction. Cela devait conduire, plus tard, à un effondrement complet de la pensée augustinienne.
Abélard était un chrétien fervent, mais il se consacrait surtout à ses convictions philosophiques et à la pensée rationnelle, ce qui lui valut de nombreux conflits avec l’Eglise. A plusieurs reprises, il a été persécuté, excommunié et condamné comme hérétique par les autorités ecclésiastiques. Elles ont même ordonné que ses livres soient brûlés, et ceux-ci n’ont échappé à ce sort que grâce à l’intervention d’un riche mécène. Abélard n’en restait pas moins très populaire auprès des jeunes étudiants, qui se pressaient en grand nombre à ses cours.
Abélard n’était pas un révolutionnaire, mais ses idées étaient considérées comme une menace existentielle pour la mainmise idéologique de l’Eglise catholique sur la société médiévale. Cependant, cette bataille de l’Eglise était perdue d’avance. Abélard a anticipé les développements du XIIIe siècle, qui a vu la pensée augustinienne entrer dans une période de déclin définitif. L’événement décisif de cette évolution fut la récupération des œuvres d’Aristote, qui avaient été longtemps oubliées dans la tradition de l’enseignement monastique.
Avant le XIIe siècle, seules les Catégories et De l’Interprétation d’Aristote étaient disponibles en latin. Or ces œuvres étaient parmi les plus pauvres du philosophe grec. Mais au milieu du XIIIe siècle, la plupart des livres d’Aristote ont été traduits de l’arabe en latin, accompagnés de commentaires de penseurs islamiques tels qu’Avicenne et, surtout, Averroès. En fait, Averroès est devenu le principal guide à la lecture d’Aristote, au point que l’on désignait Aristote comme « le philosophe » et Averroès comme « le commentateur ». Sur la base des écrits d’Averroès, un courant aristotélicien radical commença à émerger parmi les universitaires.
Les écrits d’Aristote et d’Averroès ont révolutionné la philosophie et la pensée religieuse, provoquant une véritable crise au sein de l’idéologie dominante. La méthode scientifique et interrogative d’Aristote s’opposait radicalement aux dogmes néo-platoniciens d’Augustin. L’Eglise eut recours à la censure. Dans les condamnations de 1210, 1270 et 1277, des listes de livres et de thèses interdits furent dressées, principalement pour tenter de censurer la philosophie naturelle d’Aristote et son interprétation radicale par Averroès.
Mais l’Eglise ne pouvait pas arrêter la marche de l’histoire. La théorie de la connaissance d’Abélard était désormais universellement acceptée – et soutenue par la redécouverte d’Aristote. Avec la lente progression de la science, des lacunes de plus en plus importantes se firent jour dans la pensée augustinienne. L’averroïsme gagnait rapidement du terrain. En réaction, une tendance se développa qui s’efforçait de fusionner les philosophies platonicienne et aristotélicienne, afin de combattre l’interprétation averroïste – c’est-à-dire radicale – d’Aristote.
Le représentant le plus éminent de ce courant est Thomas d’Aquin (1225-1274), qui est sans doute le scolastique médiéval le plus célèbre. Thomas d’Aquin dut admettre que la connaissance des concepts universels s’acquiert par l’expérience des sens, expérience que l’esprit soumet ensuite à l’abstraction. Cependant, il soutenait que cette capacité d’abstraction est une fonction de l’âme, qui a été dotée par Dieu d’une lumière intelligible afin de comprendre les universaux. L’Aquinate – surnom donné à Thomas d’Aquin – croyait que l’opposition entre le matérialisme d’Aristote et l’idéalisme de Platon pouvait être réconciliée de cette manière. En réalité, il altérait les idées d’Aristote afin de sauver le platonisme de l’Eglise.
Il admettait que le monde n’est habité que par des êtres singuliers, mais ajoutait que ceux-ci sont constitués d’une combinaison de matière avec une essence universelle distincte, que seule la raison – sans le recours à l’expérience – est capable de comprendre. Là encore, l’Aquinate croyait pouvoir réconcilier l’approche scientifique, qui gagnait du terrain en Europe, avec l’ancienne tradition. Mais en fait, il restait un « réaliste », et sa philosophie n’était qu’une tentative de défendre les idées dominantes de l’époque.
Au début, Thomas d’Aquin fut accueilli avec hostilité par une grande partie de l’élite ecclésiastique. Plus tard, cependant, alors que les progrès de la science menaçaient de plus en plus les anciennes idées, l’Eglise dut céder et incorporer le « thomisme » à sa doctrine. La pensée augustinienne était condamnée ; dès lors, les idées de l’Aquinate devenaient le meilleur moyen de vendre l’ancien dogme sous une apparence quasi-scientifique. Aujourd’hui encore, le néo-thomisme demeure une position fondamentale de l’Eglise catholique romaine.
En s’opposant à l’Aquinate, le philosophe écossais John Duns Scot (1265-1308) a développé la théorie de l’univocité de l’être. L’univocité signifie la qualité de ne posséder qu’un seul sens, ce qui implique que les mêmes propositions que nous utilisons à propos du monde naturel peuvent être utilisées pour parler de Dieu. Ceci allait à l’encontre de la doctrine officielle, qui prétendait que Dieu et les propositions que nous lui appliquons appartiennent à un domaine entièrement différent. En substance, Scot laissait entendre qu’il n’y a qu’une différence de degré entre Dieu et les autres créatures.
Dans La Sainte Famille, Karl Marx écrivait à propos de Scot : « Le matérialisme est le vrai fils de la Grande-Bretagne. Déjà son scolastique Duns Scot s’était demandé “si la matière ne pouvait pas penser”. Pour opérer ce miracle, il eut recours à la toute-puissance de Dieu ; autrement dit, il força la théologie elle-même à prêcher le matérialisme. » La philosophie de Scot était à bien des égards une anticipation du panthéisme développé plus tard par Spinoza.
Le dernier des scolastiques importants est Guillaume d’Ockham (1287-1347), qui développa le nominalisme, cette école de pensée inaugurée par Abélard. Comme les autres nominalistes, Ockham soutenait que le monde n’est peuplé que d’éléments particuliers et qu’il n’y a pas de place pour les entités universelles. Il dénonçait la position du réalisme sur les universaux comme « la pire erreur de la philosophie ». Pour Ockham, les universaux sont des concepts de l’esprit humain fondés sur nos expériences – et sur rien d’autre. Ainsi, lorsque je dis « homme », je formule un concept développé à travers toutes mes expériences des hommes. C’est sur la base de ces expériences que la science peut établir des vérités universelles.
Ockham soutenait également que l’existence de Dieu et des autres dogmes religieux ne pouvait pas être démontrée par la raison, et qu’elle était donc uniquement fondée sur la foi. Il s’agissait d’une doctrine dangereuse, car elle revenait à séparer la philosophie de la religion, ce qui permettait à la première de se développer séparément, à l’abri du contrôle de l’Eglise. Ockham fut excommunié en 1328, mais il se réfugia sous la protection de Louis de Bavière et Empereur du Saint Empire, lui aussi excommunié. Louis fit alors appel à un concile général, et le pape se retrouva à son tour accusé d’hérésie. On dit que lorsqu’Ockham rencontra le Saint Empereur romain, il lui dit : « Si vous me défendez avec l’épée, je vous défendrai avec la plume ». Au fond, il ne s’agissait pas d’un débat philosophique abstrait, mais du reflet d’une lutte à mort entre l’Eglise et l’Empereur – et entre la France, l’Angleterre et l’Allemagne. La lutte autour d’idées apparemment abstraites s’inscrivait dans la crise générale de l’ordre féodal qui avait commencé au XIIIe siècle, avant même la Peste noire.
Tout en contenant le germe d’une idée matérialiste correcte, le nominalisme allait trop loin en affirmant que les concepts généraux (les « universaux ») ne sont que des dénominations, et rien d’autre. En fait, les concepts reflètent des qualités réelles de choses existant objectivement. Outre leurs caractéristiques particulières, ces choses portent en elles des éléments du général, qui les identifient comme appartenant à un genre ou à une espèce spécifique. Il ne s’agit pas de caractéristiques générales surnaturelles, mais de caractéristiques reflétant les lois générales de la nature elle-même.
Le rejet du général, au profit du particulier, est caractéristique de l’empirisme, qui a profondément marqué la tradition philosophique anglo-saxonne. Comme réaction aux doctrines idéalistes de l’Eglise médiévale, cela constituait un progrès important, un pas dans la direction de l’expérimentation scientifique. Le nominalisme contenait le germe du matérialisme – mais d’un matérialisme unilatéral et superficiel, qui devait conduire, plus tard, à une impasse avec Berkeley, Hume et les philosophes analytiques modernes. A l’époque, cependant, cela représentait un énorme progrès.
Ockham était le dernier des grands scolastiques, mais sa philosophie a encouragé une nouvelle génération de penseurs, qui ont fait d’importantes découvertes scientifiques. Au fond, le nominalisme d’Ockham représentait le dernier clou du cercueil de la scolastique en tant que telle. A partir de ce moment, la science et la philosophie se sont engagées dans une voie distincte de la théologie.
Il y avait de brillants penseurs parmi les scolastiques médiévaux, mais ils étaient limités par le dogme officiel imposé par l’Eglise. Même les œuvres des plus grands esprits de l’époque étaient obscurcies par le mysticisme religieux. Par conséquent, dans l’ensemble, la philosophie scolastique n’est pas allée au-delà des accomplissements de la philosophie grecque classique. Néanmoins, elle a joué un rôle important en ravivant les progrès du passé, ce qui a préparé les conditions des progrès accomplis par la Renaissance.
La science contre la religion
Pendant des siècles, les progrès de la science ont été étouffés par la police spirituelle de l’Eglise. Dans les universités, l’essentiel de l’énergie intellectuelle – qui n’était pas négligeable – s’est dissipée dans d’interminables débats sur des thèmes tels que le sexe des anges. Personne n’était autorisé à dépasser les limites fixées par les dogmes de l’Eglise, et ceux qui le tentaient s’exposaient à des représailles sévères. Mais à l’époque ici considérée, cette situation commençait à prendre fin. Outre Scot et Ockham, des penseurs tels que Robert Grosseteste, Albert le Grand et, plus tard, Jean Buridan, ont également contribué de façon importante au développement de l’observation et de l’expérimentation scientifiques.
Néanmoins, il fallut beaucoup de courage au scolastique anglais Roger Bacon (vers 1214-92) pour aller jusqu’à contester le dogmatisme et la vénération de l’autorité des scolastiques. A l’encontre de l’esprit du temps, il prôna l’étude expérimentale de la nature. La science ne s’étant pas encore, à l’époque, séparée de l’alchimie et de l’astrologie, il n’est pas surprenant que des éléments de celles-ci soient présents dans les écrits de Bacon. Il n’est pas surprenant, non plus, qu’il ait été récompensé – pour son audace – en étant renvoyé de l’université d’Oxford et confiné dans un monastère. Compte tenu des circonstances, on peut même juger qu’il s’en est tiré à bon compte.
Nicolas d’Oresme, un élève d’Ockham, anticipa les idées de Copernic : il remit en question la théorie géocentrique de l’univers, qui plaçait la Terre au centre de l’univers. Comparant cette théorie avec la théorie héliocentrique, selon laquelle c’est le soleil qui est au centre, il en conclut que chacune permettait d’expliquer tous les faits connus, de sorte qu’il était impossible de choisir entre les deux. Cette conclusion prudente était en réalité assez audacieuse, car elle remettait cause la position orthodoxe de l’Eglise et, par là même, toute sa conception du monde.
La cosmologie de l’Eglise médiévale constituait une partie importante de sa vision générale du monde. Ce n’était pas une question secondaire. L’univers était censé être le miroir de l’ordre social, avec son caractère statique et immuable, sa hiérarchie rigide. Cette cosmologie n’était pas dérivée de l’observation, mais reprise de la cosmologie d’Aristote et des Alexandrins – et acceptée dogmatiquement.
A ce propos, J. D. Bernal expliquait : « La hiérarchie de la société se trouvait reproduite dans la hiérarchie de l’univers lui-même ; de même qu’il y avait le pape, les évêques et les archevêques, l’empereur, les rois et les nobles, de même il y avait une hiérarchie céleste des neuf chœurs d’anges : séraphins, chérubins, trônes ; dominations, vertus et pouvoirs ; principautés, archanges et anges (…). Chacun d’entre eux avait une fonction précise à remplir dans le fonctionnement de l’univers, et ils étaient attachés, selon leur rang, aux sphères planétaires, pour les maintenir dans un mouvement approprié. L’ordre inférieur, celui des simples anges qui appartenaient à la sphère de la lune, avait naturellement le plus à voir avec l’ordre des êtres humains, juste en-dessous d’eux. En général, il y avait un ordre cosmique, un ordre social, un ordre à l’intérieur du corps humain, tous représentant des états auxquels la nature tendait à revenir après chaque perturbation. Il y avait une place pour chaque chose et chaque chose connaissait sa place. » (J.D. Bernal, Science in History, p.227).
Cette vision de l’univers ne pouvait être remise en cause sans entraîner une remise en question de toute la vision du monde de l’Eglise – et de l’ordre social qu’elle défendait. Le conflit autour des idées de Copernic et de Galilée n’était pas un débat intellectuel abstrait, mais une lutte à mort entre des visions du monde opposées, qui en dernière analyse reflétait une lutte à mort entre deux ordres sociaux mutuellement exclusifs.
L’ascension de la bourgeoisie
A la fin du Moyen Age, l’essor des villes et du commerce vit émerger un élément nouveau et vigoureux, dans l’équation sociale. Ce développement avait un caractère inégal. Certaines régions se développaient plus rapidement que d’autres. Mais de manière générale, la classe montante des riches marchands commençait à montrer ses muscles et à réclamer des droits. L’expansion du commerce, l’ouverture de nouvelles routes commerciales, l’essor de l’économie monétaire, la création de nouveaux besoins et des moyens de les satisfaire, le développement des arts et de l’artisanat, l’essor d’une nouvelle littérature nationale : tous ces développements marquaient la naissance d’une nouvelle force révolutionnaire dans la société, la bourgeoisie, qui avait intérêt à briser les barrières féodales qui entravaient son développement – mais aussi, dans une mesure toujours plus grande, à développer et à exploiter les innovations techniques.
Le développement de la navigation en haute mer, par exemple, exigeait la production de cartes nouvelles et meilleures, basées sur des observations astronomiques précises, ainsi que d’instruments de navigation plus perfectionnés. L’introduction du papier et de l’imprimerie a eu un impact révolutionnaire sur la circulation des idées, qui étaient auparavant limitées à une infime minorité d’ecclésiastiques. La production d’une littérature écrite en langue vernaculaire a eu le même effet, avec l’émergence de grands écrivains nationaux tels que Boccace, Dante, Rabelais, Chaucer et, enfin, Luther. L’invention de la poudre à canon a non seulement révolutionné la guerre et contribué à saper le pouvoir des nobles, mais elle a aussi donné un nouvel élan à l’étude de la physique et de la chimie.
D’abord en Italie, puis aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Bohème, en Allemagne et en France, cette nouvelle classe commençait à défier l’ordre ancien, qui entrait dans une phase de déclin. Les guerres sans fin et les guerres civiles de l’époque témoignent de l’impasse du féodalisme. La Peste noire, qui décima la population européenne au XIVe siècle, accéléra la dissolution des relations foncières féodales. Les jacqueries en France et la Révolte des paysans en Angleterre (1381) annonçaient la décomposition prochaine de l’ordre féodal. Pour beaucoup de gens, il semblait que la fin du monde était proche. La sensation d’un malheur imminent a donné lieu à des phénomènes tels que les sectes de flagellants, ces groupes de fanatiques religieux qui parcouraient le pays en se fouettant et en s’infligeant diverses souffrances en prévision de l’imminence du Jour de la Colère. Il ne s’agissait là que du reflet confus, dans l’imagination populaire, de l’effondrement imminent de l’ordre social existant.
Crise de l’idéologie
L’effondrement d’un système social est toujours précédé d’une crise de la morale et de l’idéologie officielles, qui entrent de plus en plus en conflit avec l’évolution des rapports sociaux. Un esprit critique se développe dans une fraction de l’intelligentsia, ce baromètre des tensions qui s’accumulent dans les profondeurs de la société.
La base morale et idéologique du système féodal était l’enseignement de l’Eglise. En conséquence, toute contestation sérieuse de l’ordre existant impliquait de s’en prendre à l’Eglise, qui défendait son pouvoir et ses privilèges par tous les moyens à sa disposition, y compris l’excommunication, la torture et le bûcher.
Le Moyen Age est généralement décrit comme une période de dévotion religieuse et de piété extrêmes. Mais cette description ne s’applique pas à la période que nous considérons à présent. L’Eglise, cette institution riche et puissante qui pesait lourdement sur la société, était largement discréditée. Huizinga écrit : « De toutes les contradictions que présente la vie religieuse de l’époque, la plus insoluble est peut-être celle d’un mépris avoué du clergé, mépris que l’on retrouve comme un courant sous-jacent tout au long du Moyen Age, à côté du très grand respect que l’on porte à la sainteté de la fonction sacerdotale... C’est pourquoi nobles, bourgeois et citadins nourrissaient depuis longtemps leur haine par des plaisanteries malveillantes aux dépens du moine incontinent et du prêtre goinfre. “Haine” est le mot juste à employer dans ce contexte, car la haine était latente, mais générale et persistante. Le peuple ne se lassait pas d’entendre dénoncer les vices du clergé. Un prédicateur qui invectivait l’état ecclésiastique était sûr d’être applaudi. Dès qu’un prêcheur aborde ce sujet, dit Bernardino de Sienne, ses auditeurs oublient tout le reste ; il n’y a pas de moyen plus efficace de raviver l’attention lorsque l’assemblée s’endort, ou souffre de la chaleur ou du froid. Tout le monde devient instantanément attentif et joyeux. » (J. Huizinga, The Waning of the Middle Ages, pp.172-173).
La dissidence se manifestait jusqu’au sein même de l’Eglise, reflétant les pressions de la société. Les mouvements hérétiques – comme celui des Albigeois – étaient réprimés dans le sang. Mais de nouvelles tendances d’opposition surgissaient. Sismondi, un historien italien du XIXe siècle, explique : « Le même esprit de réforme qui animait les Albigeois s’était répandu dans toute l’Europe : de nombreux chrétiens, dégoûtés de la corruption et des vices du clergé, ou dont l’esprit se révoltait contre la violence exercée sur leur raison par l’Eglise, se consacraient à une vie contemplative, renonçaient à toute ambition et aux plaisirs du monde, et cherchaient une nouvelle voie de salut dans l’alliance de la foi et de la raison. Ils s’appelaient cathari (les purifiés) ou paterini (les résignés). » (J.S. Sismondi, A History of the Italian Republics, p.66).
Les ordres dominicains et franciscains ont été fondés, au début du XIIe siècle, pour combattre les hérésies, l’anticléricalisme et les nouvelles idées philosophiques. Sismondi dit du pape Innocent III : « Il fonda les deux ordres mendiants des Franciscains et des Dominicains, nouveaux champions de l’église, chargés de réprimer toute activité de l’esprit, de combattre l’intelligence croissante et d’extirper l’hérésie. Il confia aux dominicains les redoutables pouvoirs de l’Inquisition qu’il avait instituée : il les chargea de découvrir, poursuivre et détruire les nouveaux réformateurs qui, sous le nom de paterini, se multipliaient rapidement en Italie. » (Ibid. p.60)
La répression violente de toute forme d’opposition était un trait constant de la conduite des autorités ecclésiastiques, à commencer par leur sommet, comme le montre l’histoire de la papauté. Lorsqu’il ne parvenait pas à obtenir le soutien de ses cardinaux, le pape Urbain VI résolvait le problème très simplement : en les accusant de conspirer contre lui. Il fit torturer de nombreux cardinaux en sa présence, tandis qu’il récitait calmement son rosaire. Il ordonna que certains soient enfermés dans des sacs et noyés dans la mer. Le moine réformateur Jérôme Savonarole, précurseur italien de Luther, fut torturé jusqu’à ce qu’il avoue tous les crimes qui lui étaient imputés, puis fut brûlé vif avec deux autres moines. On peut multiplier les exemples à l’envi.
Cependant, aucune répression ne peut préserver une idée dont le temps est passé. Une idéologie et une morale qui ne reflètent plus la réalité ne font que se survivre et sont condamnées à être balayées. Le terrain était préparé pour l’une des plus grandes révolutions de l’histoire. Lorsque, le 31 octobre 1517, un obscur moine du nom de Martin Luther cloua ses 95 thèses sur la porte de l’église de Tous les Saints, à Wittenberg, il alluma une mèche qui allait contribuer à faire sauter l’ancien ordre féodal. Une nouvelle ère s’ouvrait, celle des révolutions bourgeoises.